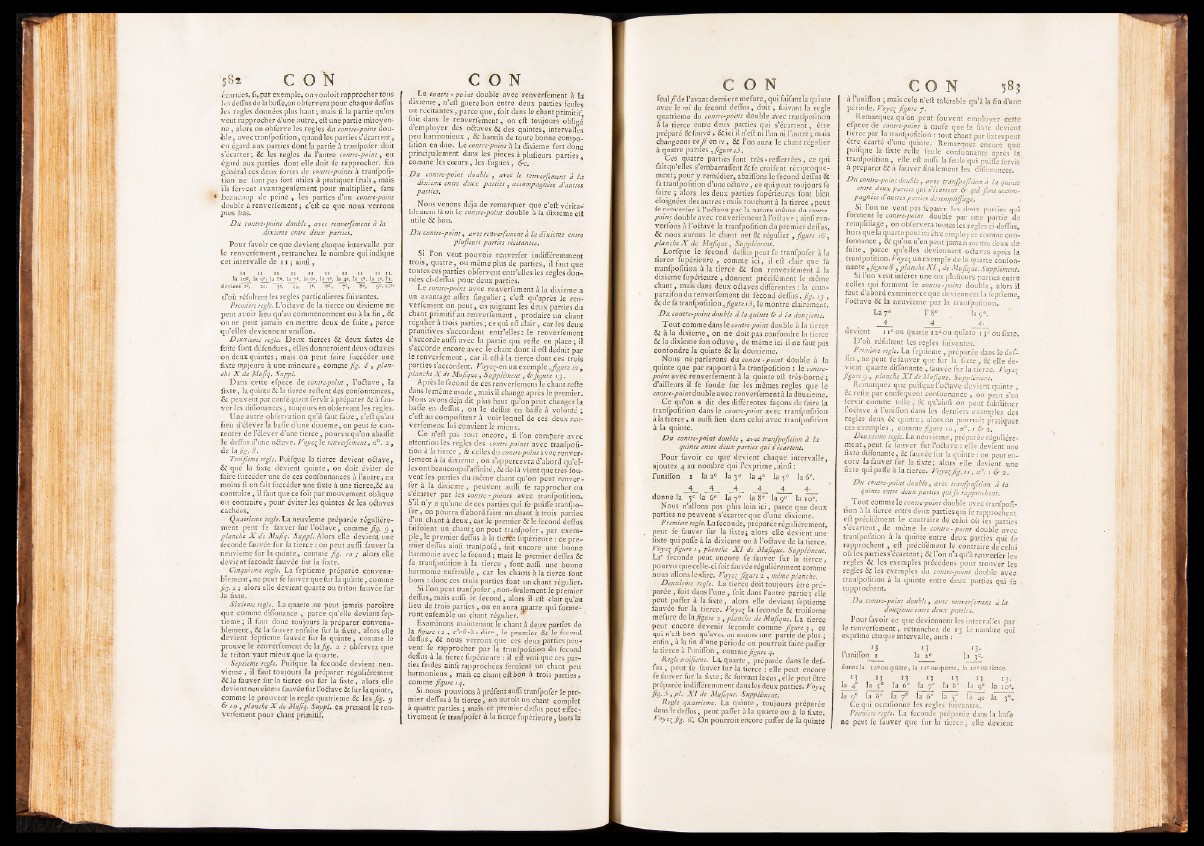
écartées, fi, par exemple, on vouloit rapprocher tous
les deffus de la baffe,on obfervera pour chaque deffus
les réglés données plus haut ; mais li la partie qu’on
■ veut rapprocher d’une autre, eft une partie mitoyenne
, alors on obferve les réglés du contre-point double
, avec tranfpofition, quand les parties s’écartent,
eu égard aux parties dont la partie à tranfpofer doit
s’écarter; & les réglés de l’autre contre-point, eu
égard aux parties dont elle doit fe rapprocher. En
général ces deux fortes de contre-points à tranfpofi-
lion ne font pas fort utiles à pratiquer feuls , mais
ils fervent avantageufement pour multiplier, fans
9 .beaucoup de peine , les parties d’un contre-pôint
'' double à renverfement ; c’eft ce que nous verrons
plus bas.
Du contre-point double, avec renverfement à la
dixième entre deux parties.
Pour favoir ce que devient chaque intervalle par
le renverfement, retranchez le nombre qui indique
ce t intervalle de 11 ; ainfi ,
la ioe, la 9e, la 8«, la 7e, la 6e, la 5e, la 4e,devient Ie, 2c, Hp, ’ la 3e, la 2«, l’i. 4c> ‘ f e> 6e, 7e, Se, 9e, 10e*
d’oii résultent les réglés particulières fuivantes.
Première réglé. L’oélave de la tierce ou dixième ne
peut avoir lieu qu’au commencement ou à la fin, &
■ on ne peut jamais en mettre deux de fuite, parce
<ju’elles deviennent uniffon.
Deuxieme réglé. Deux tierces & deux fixtes de
fuite font défendues, elles donneroient deux oélaves
•on deux quintes ; mais on peut faire fuccéder une
fixte n^ajeure à une mineure, comme fig. 8 , planche
X de Mujîq. Suppl.
Dans cette efpece de contre-point, l’oélave, la
fixte , la quinte Scia tierce relient des çonfonnances,
& peuvent par conféquent fervir à préparer & à fau-
verles diffonances, toujours enobfervant les réglés.
Une autre obfervation qu’il faut faire, c’eft qu’au
lieu d’élever îa baffe d’une dixième, on peut fe contenter
de l’élever d’une tierce, pourvu qu’on abaiffe
le deffus d’une oSlave. Voyelle renverfement, n°. z ,
de la fig. 8.
Troifieme réglé. Puifque la tierce devient oSlave,
& que la fixte devient quinte, on doit éviter de
faire fuccéder une de ce.s confonnances à l’autre; au
moins fi on fait fuccéder une fixte à une tierce,& au
contraire, il faut que ce foit par mouvement oblique
ou contraire, pour éviter le,s quintes & les oSlaves
cachées.
Quatrième réglé. La neuvième préparée régulièrement
peut fe fauver fur l’oSlave, comme fig. p ,
planche X de Mufiq. Suppl. Alors elle devient, une
fécondé fauvée fur la tierce : on peut aufli fauver la
neuvième fur la quinte, comme fig. 10 ; alors elle
devient fécondé fauvée fur la fixte.
Cinquième réglé. La feptieme préparée convenablement
, ne peut fe fauver que fur là quinte, comme
fig. 2 ; alors elle devient quarte ou triton fauvée fur
la fixte.
Sixième réglé. La quarte ne peut jamais paroître
que comme diffonance , parce qu’elle devient feptieme
; il faut donc toujours la préparer convenablement
, & la fauver en fuite fur la fixte, alors elle
devient feptieme fauvée fvir la quinte, comme le
prouve le renverfement de la fig. z : obfervez que
le triton'vaut mieux que la quarte.
Septième réglé. Puifque la fécondé devient neuvième
, il faut toujours la préparer régulièrement
& la fauver fur la tierce ou fur la fixte, alors elle
devient neuvième fauvée fur l’oSlave & fur la quinte,
comme le prouvent la réglé quatrième. & les fig. g
& 10 , planche X de Mufiq. Suppl, en prenant le renverfement
pour chant primitif.
Le contre - po int double avec renverfement à
dixième , n’eft guere bon entre deux parties feules
ou récitantes »parce que, foit dans le chant primitif,
foit dans le renverfement, on eft toujours obligé
d’employer des oSlaves & des quintes, intervalles
peu harmonieux , & bannis de toute bonne composition
en duo.' Le contre-point à la dixième fert donc
principalement dans les pieces à plufieurs parties,
comme les coeurs , les fugues, &c.
Du contre-point double , avec le renverfement à la
dixième entre deux parties, accompagnées £ autres
parties.
Nous venons déjà de remarquer que c’eft véritablement
là oit le contre-point double à la dixième eft
utile & bon.
Du contre-point, avec renverfement à la dixième entre
plufieurs parties récitantes.
Si l’on veut pouvoir renverfer indifféremment
trois, quatre, ou même plus de parties, il faut qite
toutes ces parties obfervent entr’elles les regies données
ci-deffus pour deux parties.
Le contre-point avec renverfement à la dixième a
un avantage affez fingulier ; c’eft qu’après le renverfement
on peut, en joignant les deux parties du
chant primitif au renverfement, produire un chant
régulier à trois parties ; ce qui eft clair, car les deux?
primitives s’accordent entr’elles: le renverfement
s’accorde aufli avec la partie qui refte en place ; il
s’accorde encore avec le chant dont il eft déduit par
le renverfement, car il eft à la tierce dont ces trois
parties s’accordent. V?yeç-en un exemple, figure 12 ,
planche X de Mufique, Supplément, & figure 13.
Apres le fécond de cesrenverfemens le chant refte
dans le meme mode, mais il change après le premier.
Nous avons déjà dit plus haut qu’on peut changer la
baffe en deffus, ou le deffus en baffe à volonté ;
c eft au compofiteur à voir lequel de ces deux ren-
verfemens lui convient le mieux.
C e n’eft pas tout; èncore, fi l’on compare avec
attention les regies des contrepoints avec tranfpofition
à la tierce , & celles du contre-point avec renverfement
a la dixième , on s’appercevra d’abord qu’elles
ont beaucoup d’affinité, & de-là vient que très-fou-
vent les parties du même chant qu’on peut renverfer
à la dixième, peuvent aufli fe rapprocher ou
secarter par les contre - points avec tranfpofition.
S il n y a qu’une de ces parties qui fe puiffe tranfpofer
, on pourra d’abord faire un chant à trois parties
d’un chant à deux, car le premier & le fécond deffus
faifoient.un chant; on peut tranfpofer , par exemple,
le premier deffus à la tierëe fupérieure : ce premier
deffus ainfi tranfpofé, fait encore une bonne
harmonie avec le fécond ; mais le premier deffus &
fa tranfpofition à la tierce , font aufli une bonne
harmonie enfemble , car les chants à la tierce font
bons : donc ces trois parties font un chant régulier.
Si Ion peut tranfpofer , non-feulement le premier
deffus, mais aufli le fécond, alors il eft clair qu’au
lieu de trois parties on en aura qpatre qui formeront
enfemble un chant régulier. ™ ■
Examinons maintenant le chant à deux parties de
la figure i z , c’eft-à - dire , le premier & le fécond
deffus, & nous verrons que ces deux parties peuvent
fie rapprocher par la tranfpofition du fécond
deffus à la tierce fupérieure : il eft vrai que ces parties
feules ainfi'rapprochées feroient un chant peu
harmonieux , mais ce chant eft bon à trois parties ,
comme figure 14.
Si nous pouvions à préfent aufli tranfpofer le premier
deffus à la tierce , on auroit un chant complet
à quatre parties ; mais ce premier deffus peut effectivement
fe tranfpofer à la tierce fitpérieure hors le
feulf i de Favant-derniere mefure, qui faifantla quinte
avec le mi du fécond deffus, do it, fuivant la réglé
quatrième du contre-point double aVec tranfpofition
à la tierce entre deux parties qui s’écartent, être
préparé & fauvé , & ici il n’eft ni l’un ni l’autre ; mais
changeons ce J i e n r e , & l’on aura le chant régulier
à quatre parties , figure /5 .
Ces quatre parties font très - refferrées, ce qui
fait qu’elles s’embarraffent&fe croifent réciproquement;
pour y remédier, abaiffons le fécond deffus &
fa tranfpofition d’une o û a v e , ce qui peut toujours fe
faire ; alors les deux parties fupérieures font bien
éloignées des autres : mais touchant à la tierce , peut
fe renverfer à l’o&ave par la nature même du contrepoint
double avec renverfement à l’oétave ; ainfi ren-
verfons à l ’o&ave la tranfpofition du premier deffus,
& nous aurons le chant net & régulier , figure /éT,
planche X de Mufique , Supplément.
Lorfque le fécond deffus peut fe tranfpofer à la
tierce lupérieure , comme ic i, il eft clair que fa
tranfpofition à la tierce & fon renverfement à la
dixième fupérieure , donnent précifément le même
chant, mais dans deux oélaves différentes : la com-
paraifon du renverfement du fécond deffus y fig. 13 ,
& de fa tranfpofition, figure 1 S, le montre clairement.
Du contre-point double à la quinte & à la douzième.
Tout comme dans le contre-point double à la tierce
& à. la dixième, on ne doit pas confondre la tierce
& la dixième fon o&ave, de même ici il ne faut pas
confondre la quinte & la deuxième.
Nous ne parlerons du contre-point double à la
quinte que par rapport à la tranfpofition : le contrepoint
avéc renverfement à la quinte eft très-borné ;
d’ailleurs il fe fonde fur les mêmes réglés que le
contre-point double avec renverfement à la douzième.
Ce qu’on a dit des différentes façons de faire la
tranfpofition dans le contre-point avec tranfpofition
à la tierce, a aufli lieu dans celui avec tranfpofition
à la quinte.
D u contre-point double , avec tranfpofition à la
quinte entre deux parties qui s'écartent.
Pour favoir ce que' devient chaque intervalle,
ajoutez 4 au nombre qui l’exprime, ainfi :
Funiffon i la ze la 3 e la 4e la 5® la 6e.
4 4 4 4 4 4-
donne la 5e la 6e la 7e la 8e la 9e la 10e.
Nous n’allons pas plus loin ic i, parce que deux
parties ne peuvent s’écarter que d’une dixième.
Première réglé. La fécondé, préparée régulièrement,
peut fe fauver fur la fixte; alors elle devient une
fixte qui paffe à la dixième ou à l’oâa ve de la tierce.
V>yei figure 1, planche X I de Mufique. Supplément.
La* fécondé peut encore fe fauver fur la tierce,
pourvu que celle-ci foit fauvée régulièrement comme -
nous allons le «dire. Voye^ figure 2 , même planche.
Deuxieme réglé. La tierce doit toujours être préparée
, foit dans l’une, foit dans l’autre partie ; elle
peut paffer à la fixte, alors elle devient feptieme
fauvée fur la tierce. Foye{ la fécondé & troifieme
mefure de la figure 2 , planche de Mufique. La tierce
peut encore devenir fécondé comme figure 3 , ce
qui n’eft bon qu’avec au moins" une partie de plus ;
enfin, à la fin d’une période on pourroit faire paffer
la tierce à Funiffon , comme figure 4.
Réglé troifieme. La. quarte , préparée dans le deffus
, peut le fauver fur la tierce : elle peut encore
fe fauver fur la fixte ; & fuivant le cas, elle peut être
préparée indifféremment dans les deux parties. Voye^
fig. S y pl. X I de Mufique. Supplément.
Réglé quatrième. La quinte, toujours préparée
dans le deffus, peut paffer à la quarté ou à la fixte.
Foyeifig, On pourroit encore paffer de la quinte
■ à Funiffon ; mais cela n’eft tolérable qu5à la fin d’urte
période. Voye1 figure y. ■
Remarquez qu’on peut fouvent employer cette
efpece de contrepoint à eaufe que la fixte devient
tierce par la tranfpofition : tout chant par fixtes peut
être écarté d’une quinte. Remarquez encore que
puifque la fixte refte feule confonnante après la
tranfpofition, elle eft aufli la feule qui puiffe fervir
à préparer & a fauver finalement les diffonances.
Du contre-point double, avec tranfpofition à la quinte
entre ' deux parties qui s'écartent & qui font accompagnées
(Cautres parties derempliffage.
Si Ion ne veut pas féparer les deux parties qui
forment le contre-point double par une partie de
rempliflage, on Obfervera toutes les réglés ci-deffus,
hors que la quarte peutici etre employée comme con-
fonnance , & qu’on n’en peut jamais mettre deux de
fuite, parce qu’elles deviennent oélaves après la
| tranfpofition. Voye{ un exemple de la quarte confonnante
y figure 8 'f planche XL^ de Mufique. Supplément.
Si l’on veut inférer une ou plufieurs parties entre
celles qui forment le contre-point double, alors il
faut d’abord examiner ce que deviennent la feptieme,
l’oétave & la neuvième par la tranfpofition. '
La 7 e , F 8 e ( la 9e.
4 4 4-
devient 11e ou quarte i z eou quinte i3 e oufixte.
D ’oii réfultent les réglés fuivantes.
Première réglé. La feptieme, préparée dans le deffus
, ne peut fe fauver que fur la fixte , & elle devient
quarte diffonante , fauvée flir la tierce. Voye£
figure C) y planche X I de Mufique. Supplément.
Remarquez que puifque l’o&ave devient quinte ,
& refte par conféquent confonnance , on peut s’en
fervir comme telle , & qu’ainfi on peut fubftituer
l’o&ave à l’uniffon dans les derniers exemples des
réglés deux & quatre ; alors on pourroit pratiquer,
ces exemples , comme figure 10 f n°. 1 & z.
Deuxieme réglé. La neuvième, préparée régulièrement
, peut fe fauver fur l’oélave : elle devient une 1
fixte diffonante, & fauvée fur la quinte : on peut encore
la fauver fur la fixte; alors elle devient une
fixte qui paffe à la tierce. Voye^fig. , , , n°. 1 & 2.
Du contre-point double y avec tranfpofition à la
quinte entre deux parties quife rapprochent.
Tout comme le contre-point double avec tranfpofi*
tion à la tierce entre deux parties qui fe rapprochent
eft précifément le contraire de celui où les parties
s’écartent , de même le contre - point double avec
tranfpofition à la quinte entre deux parties qui fe
rapprochent , eft précifément le contraire de celui
où les parties s’écartent ; & l’on n’a qu’à renverfer les
réglés & les exemples précédens pour trouver les
réglés & les exemples du contrepoint double avec
tranfpofition à la quinte entre deux parties qui fe
rapprochent.
Du contre-point double, avec renverfement à la
douzième entre deux parties.
Pour favoir ce que deviennent les intervalles parle
renverfement, retranchez de 13 le nombre qui
exprime chaque intervalle, ainfi :
I 3 13 13.
Funiffon 1 la ze la 3 e.
donne la 12e ou quinte, la n e ou quarte, la 10e ou tierce.'
13 13 !3 *3 n 13 I 3-
la 4 la 5e la 6e la 7* la 8e la 9e la 10e.
la 9e la 8e la 7e la (5e la 5e la 4e là 3®!
Ce qui occafionne les réglés fuivantes.
Premiere regle. La fécondé préparée dans la bafe
ne peut fe fauver que fur la tierce ; elle devient