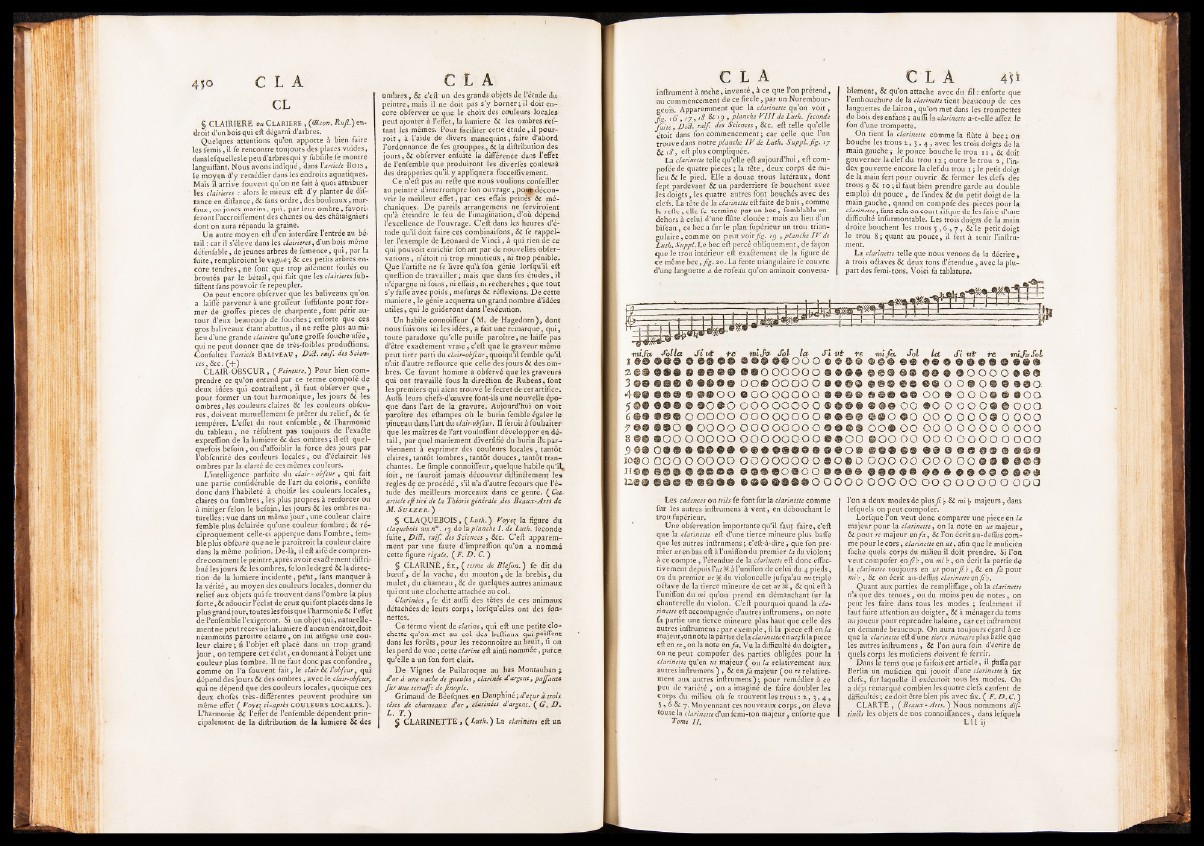
4 JO C L A
CL
§ CLAIRIERE ou Clàrierë , ( (Econ. RuJ2.) endroit
d’un bois qui efl dégarni d’arbres.
Quelques attentions qu’on apporte à bien faire
les femis, il fe rencontre toujours des places vuides,
danslefquellesle peu d’arbres qui y fubfifte fe montre
languiifant. Nous avons indiqué, dans l'article B o is ,
le moyen d’y remédier dans les endroits aquatiques.
Mais il arrive fouvent qu’on ne fait à quoi attribuer
les clairières : alors le mieux eft d’y planter de dif-
tance en diftanee, & fans ordre, des bouleaux, mar*
faux,ou joncs marins, qui, par leur ombre, favori-
ferontl’aecroiffement des chênes ou des châtaigniers
dont on aura répandu la graine.
Un autre moyen eft d’en interdire l’entrée au bétail
: car il s’élève dans les clairières, d'un bois même
défenfable, de jeunes arbres de femence, qui, par la
fuite, rempliroient le vague ; & ces petits arbres encore
tendres, ne font que trop aifément foules ou
broutés par le bétail, qui fait que les clairières fub-
liftent fans pouvoir fe repeupler. ^
On peut encore obferver que les baliveaux qu’on
a Iaiffé parvenir à une groffeur fuffifante pour former
de groffes pièces de charpente, font périr autour
d’eux beaucoup de fouches; enforte que ces
gros baliveaux étant abattus, il ne refte plus au milieu
d’une grande clairière qu’une groffe fouche ufée,
qui ne peut donner que de très-foibles produûiqns.
Confùltez l’article Baliveau, D ici. raif. des Sciences,
& c . (+ )
CLAIR-OBSCUR, ( Peinture. ) Pour bien comprendre
ce qu’on entend par ce terme compofé de
deux idées qui contraftent, il faut obferver qu e ,
pour former un tout harmonique, les jours & les
ombres,-les couleurs claires & les couleurs obfcu-
res, doivent mutuellement fe prêter du relief, &. fe
tempérer. L’effet du tout enfemble, & l'harmonie
du tableau, ne réfultent pas toujours de l’exa&e
expreffion de la lumière & des ombres ; il eft quelquefois
befoin, ou d’affoiblir la forcé des jours par
l ’obfcurité des couleurs locales, ou d’éclaircir les
ombres par la clarté de ces mêmes couleurs*
L ’intelligence parfaite du clair - obfcur , qui fait
une partie confidérable de l’art du coloris, confifte
. donc dans l’habileté à choifir les couleurs locales,
claires ou fombres, les plus propres à renforcer ou
à mitiger félon le befojn, les jours & les ombres na-
turelles : vue dans un même jour, une couleur claire
femble plus éclairée qu’une couleur fombre ; & réciproquement
celle-ci apperçue dans l’ombre, femble
plus obfcure que ne le paroîtroit la couleur claire
dans la même pofition. De-là, il eft aifé de comprendre
comment le peintre,après avoir exactement diftri-
bué les jours & les ombres, félon le degré & la direction
de la lumière incidente, petit, fans manquer à
la vérité, au moyen des couleurs locales, donner du
relief aux objets qui fe trouvent dans l’ombre la plus
forte, & adoucir l’éclat de ceux qui font placés dans le
plus grand jour, toutes les fois que l’harmonie & l’effet
de l’enfemble l’exigeront. Si un objet qui, naturellement
ne peut recevoir la lumière d’aucun endroit,doit
néanmoins paroître éclairé, on lui affigne une couleur
claire ; fi l’objet eft placé dans un trop grand
jou r, on tempere cet éclat, en donnant à l’objet une
couleur plus fombre. Il ne faut donc pas confondre,
comme on l ’a fouvent fait, le clair & l'obfcur, qui
dépend des jours & des ombres, avec le clair-obfcur,
qui ne dépend que des couleurs locales, quoique ces
deux chofes très-différentes peuvent produire un
même effet ( Voyc\ ci-après COULEURS LOCALES.).
L’harmonie & l’effet de Penfemble dépendent principalement
de la diftribution de la lumière & des
Oïnbres, Si. c’eft un des grands objets de l’étude du
peintre, mais il ne doit pas s’y borner ; il doit encore
obferver ce que le choix des cduleurs locales
peut ajouter à l’effet, la lumière & les ombres reliant
les mêmes. Pour faciliter cette étude , il pour-
r o it , à l’aide de divers manequins, faire d’abord
l’ordonnance de fes grouppes, & là diftribution des
jours, & obferver enfuitê la différence dans l’effet
de l’enfemble que produiront les diverfés couleurà
des drapperies qu’il y appliquera fucCeffivement.
Ce n’eft pas au refte que nous voulions confeiller
au peintre d’interrompre fon ouvrage, poq^décou-
vrir le meilleur effet, par ces effais peine^oc mé-
chaniques. De pareils arrangemens ne feryiroient
qu’à éteindre le feu de l’imagination, d’où dépend
l’excellence de l’ouvrage. C’eft dans les heures d’étude
qu’il doit faire ces combinaifons, Si fe rappel-
ler l’exemple de Leonard dé V in c i, à qui rien de ce
qui pôuvoit enrichir fon art par de nouvelles obfer-
vations, n’étoit ni trop minutieux, ni trop pénible.
Que l’artifte ne fe livre qu’à fon génie lorfqu’il eft
queftion de travailler ; mais que dans fes études, il
n’épargne ni foins, ni effais, ni recherches ; que tout
s’y faffe avec poids, mefures & réflexions. De cette
maniéré, le génie acquerra un grand nombre d’idées
utiles, qui le guideront dans l’exécution.
Un habile connoiffeur (M . de Hagedorn), dont
nous fuivons ici les idées, a fait une remarque, qui,
toute paradoxe qu’elle puiffe paroître, ne laiffe pas
d’être exactement vraie, c’eft que le graveur même
peut tirer parti du clair-obfcur, quoiqu’il femble qu’il
n’ait d’autre reffource que celle des jours Si des ombres.
Ce favant homme a obfervé que les graveurs
qui ont travaillé fous la direction de Rubens, font
les premiers qui aient trouvé le feCret de cet artifice.
Aufli leurs chefs-d’oeuvre font-ils une nouvelle époque
dans Part de la gravure. Aujourd’hui on voit
paroître des eftampes où le burin femble égaler le
pinceau dans l’art du clair-obfcur. Il feroit à fouhaiter
que les maîtres de l’art vouluffent développer en détail
, par quel maniement diverfifié du burin ils parviennent
à exprimer des couleurs locales, tantôt
claires, tantôt fombres, tantôt douces, tantôt tranchantes.
Le Ample connoiffeur, quelque habile qu’il*
fo it , ne fauroit jamais découvrir diftinCtement les
réglés de ce procédé, s’il n’a d’autre fecours que l’étude
des meilleurs morceaux dans ce genre. ( Cet.
article efl tiré de la Théorie générale / les Beaux-Arts det
M. SüLZER. )
§ CLAQUEBOIS, ( Luth. ) Voye^ la figure du
claquebois au n°. 13 de la planche I. de Luth, féconde
fuite, Dicl. raif des Sciences , &c. C’eft apparemment
par une faute d’impreflion qu’on a nommé
cette figure régale. ( F. D . C. )
§ CLARINÉ, ÊE, ( terme de Blafon. ) fe dit du
boeuf, de' la vache, du mouton, de la brebis, du
mulet, du chameau, & de quelques autres animaux
qui ont une clochette attachée au col.
Clarinées , fe dit aufli des têtes de c es animaux
détachées de leurs corps, lorfqu’elles ont des fon-
nettes.
Ce tèrme vient de clarine, qui eft une petite clochette
qu’on met au col des beftiaux qui paiffent
dans les forêts, pour les reconnoître au bruit, fi on
les perd de vue ; cette clarine eft ainfi nommee, parce,
qu’elle a un fon fort clair.
De Vignes de Puilaroque au bas Montauban ;
d’or à une vache de gueules , elarinée d’argent, paffants
fur une terrajfe de fînople.
Grimaud de Béefques en Dauphiné ; da^ur à trois
têtes de chameaux S or , clarinées d’argent. ( G. D .
L . T .)
§ CLARINETTE » ( Luth. ) La clarinette eft un
\a ca ^ o\sa 4.
infiniment i anche, inventé, à ce que l’on prétend,
au commencement de ce fîecle, par un Nurembour-
geoîs. Apparemment que la clarinette qu’on v o it ,
.fig. 1 6 , 17 ,18 Sci3 , planche V I I I de Luth, fécondé
fuite, b ici. raif. des Sciences, &C. eft telle qu’elle
étoit dans fon commencement ; car celle que l’on
trouve dans notre planche IVde Luth. Suppl, fig.;ij
& /<? , eft plus compliquée.
La clarinette telle qu’elle eft aujourd’hui, eft com-
pofée de quatre pièces ; la tête, deux corps de milieu
& le pied. Elle a douze trous latéraux, dont
fept pardevant & un parderriere fe bouchent avec
les doigts, les quatre autres font bouchés avec des
clefs. La tête de la clarinette eft faite de buis, comme
le refte ; elle fe termine par un b ec, femblable en-
dehors à celui d’une flûte clouée : mais au lieu d’un
bifeau, ce bec a fur le plan fupérieur un trou triangulaire
, comme on peut voir fig. 1$ , planche I V de
Luth. Suppl. Le bec eft percé obliquement, de façon
que le trou intérieur eft exaâement de la figure de
ce même bec, fig. 20. La fente triangulaire fe couvre
d’une languette a de rofea'u qu’on aminoit eonvenablement,
& qu’on attaché avec du fil : enforte que
l’embouchure de la clarinette tient beaucoup de ces
languettes de laiton, qu’on met dans les trompettes
de bois des enfans ; aufli la clarinette a-t-ellé affez le
fon d’une trompette.
On tient la clarinette c'ômme la flûte à. bec ; on
bouche les trous 1 , 3 , 4 , avec les trois doigts de la
rtain gauche ; le pouce bouche le trou 11 , & doit
gouverner la clef du trou 1i ; outre le trou 2 , l’index
gouverne encore Iâ clef du trou 1 ; le petit doigt
de la main fert pour ouvrir & fermer les clefs des
trous 9 Sc 10 ; i l faut bien prendre garde au double
emploi du pouce, de l’index & du petit doigt de là
main gauche, quand on compofe des-pièces pour la
clarinette, fans cela on court rifque de les faire d’une
difficulté infurmontable. Les trois doigts de la main
droite bouchent les trous 5 , 6 , 7 , & le petit doigt
le trou 8; quant au pouce, il fert k tenir l’inftru-
ment.
La clarinette telle que hôus venons de la décrire,
à trois oCtaves & d,eux tons d’étendue, avec la plupart
des femi-tons. Voici fa tablature.
mifa, Solia S i ut . te . n i Sa- Sol là- Si-u t te nrnfix Soi lu SI ait re ml fa Sol
2 © © 9 9 9 @ © 0 0 0 © © B®
© 0 0 0 O O O O O O © Ô O O Ô O ® @ 0
o o ® o o o o o ® 0 © @ ©m® o o m o ® ©
® © ® o o ©0000000 © © © & © 00 @ 0 0 0 © © § o a
© © 9 9 m ® ® o @ o 00000000 ® @ ® ® © ® @ o o @0 O o o o @ @ o o o
9® 9® 9 O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 9 0 0 . 0 O O O O 0 O O O Q
9® ® @ 0 ® 0 Ö Ö O O O O O O O O O © ® © © Ö O ® 00 0 O O Ö O Ö O Ó O O O
©00 O O O O O O O O O O O O O © 9 0 0 9 0 0 O O 0 0 O O O O O O O O O
00® ® ® 9® 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9m® 9 9® 9® © 0 © 9® ®
I0@O O O O O O O O O O O O O O O O 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 ©
Ï t 9 9 9 9 ® 9 9 9 0 9 © 9 9 9 0 9 0 0 9 9 @9 9 9 9 9 ® 0 ® & 9 9 9 9 9 9 9 ®
IZG® © 9 9 © 9 9 9 ® 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 O O O 0 0 O O O O O O O O O O O
Les cadences ou trils fe font fur là clarinette comme
fur les autres inftrumens à vent, en débouchant le
trou fupérieur.
Une obfervation importatîte qu’ il fauf faire, c’eft
que la clarinette eft d’une tierce mineure plus baffe
que les autres inftrumens ; c’eft-à-dire, que fon premier
ut en bas eft à l’uniffon du premier la du violon ;
à ce compte , l’étendue de la clarinette eft donc effectivement
de puis l’«r^ à l’uniffon de celui du 4 pieds,
ou du premier ut^ d u violoncelle jufqu’au mi triple
oéiave de la tierce mineure de cet utÿk, & qui eft à
l’uniffon du mi qu’on prend en démanchant fur la
chanterelle du violon» C’eft pourquoi quand la clarinette
eft accompagnée d’autres inftrumens, on note
fa partie une tierce mineure plus haut que celle des
autres inftrumens : par exemple, fi la piece eft en la
majeur,on note la partie de la clarinette en ut; fi la piece
eft en re, on la note en fa. Vu la difficulté du doigter,
on ne peut compofer des parties obligées pour la
clarinette qu’en ut majeur ( ou la relativement aux
autres inftrumens ) , & znfa majeur ( ou re relativement
aux autres inftrumens ) ; pour remédier à ce
peu de variété , on a imaginé de faire doubler les
corps du milieu où fe trouvent les trous 1 1 , 3 , 4 ,
5 ,6 Sl 7. Moyennant ces nouveaux corps, on éleve
toute la clarinette d’un femi-ton majeur, enforte que
Tome II.
l’on a deux modes dé plus ji\, St mi \, majeurs, dans
lefquels on peut compofer.
Lorfquè l’on veut donc comparer une piece en la
majeur pour la clarinette, on la note en ut majeur,
& pour re majeur en fa , Sc l’on écrit âu-deffus comme
pour le cors, clarinette en u t, afin que le muficien
fâche quels corps du milieu il doit prendre. Si l’on
veut compofer en_/?I7 ,o u mi b , on écrit la partie dé
la clarinette toujours, en ut pourf i l?, & en fa pour
rail?, & on écrit au-deffus clarinette enfi\>.
Quant aux parties de rempliffage, où la clarinette
n’a que des tenues, ou du moins peu de notes, on
peut les faire dans tous les modes ; feulement il
faut faire attention au doigter, & à ménagerdu tems
au joueur pour reprendre haleine, car cet infiniment
en demande beaucoup; On aura toujours égard à cé
que la clarinette eft d’une tierce mineure plus baffe que
les autres inftrumens , & l’on aura foin d’écrire de
quels corps les muficiens doivent fe fervir.
Dans le tems que je faifois cet article, il jfaffa par
Berlin un muficien qui jouoit d’une clarinette à fix
clefs, fur laquelle il exécutoit tous les modes. On
a déjà remarqué combien les quatre clefs caufent de
difficultés ; ce doit être bien pis avec fix. ( F. D . C. )
C L A R T É , ( Beaux-Arts. ) Nous nommons dïf-
tinUs les objets de nos connoiffances, dans lefquels
L U ij