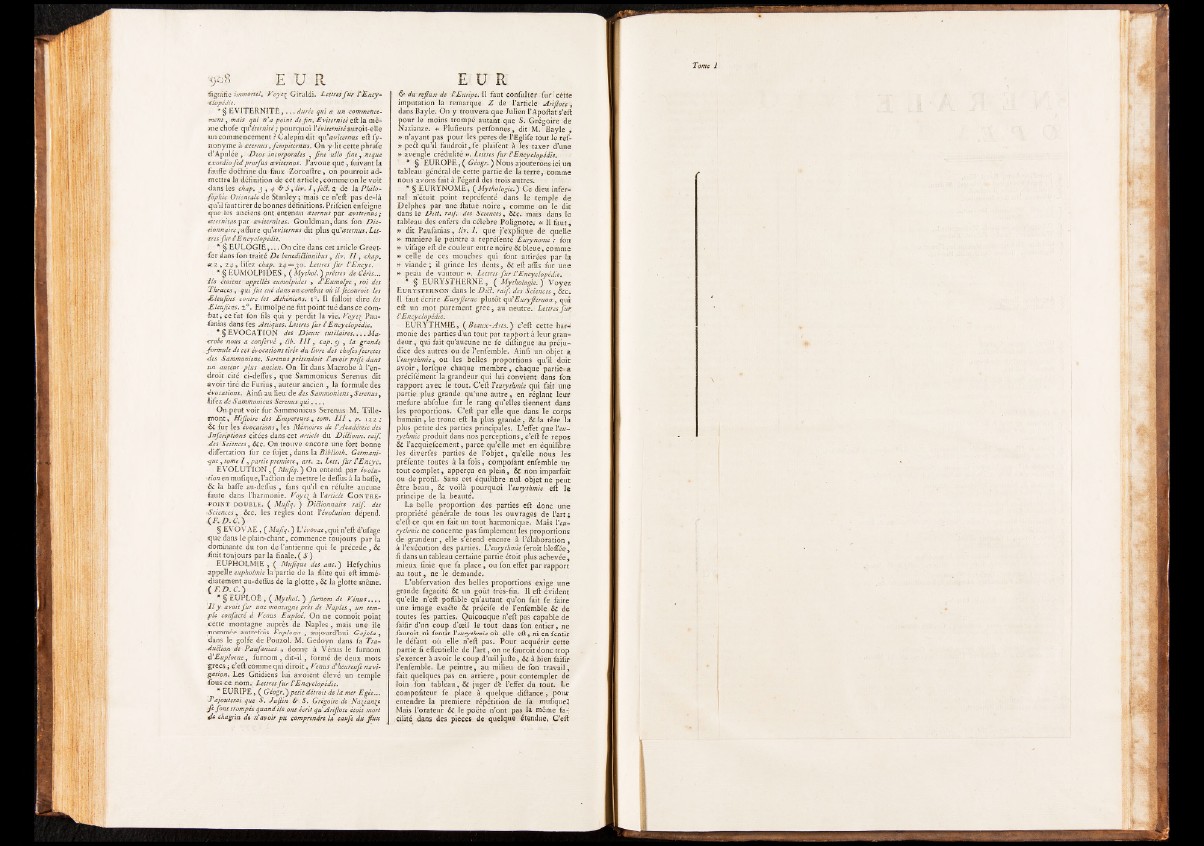
«ag E U R
fignifie immortel. Voyt^_ Giraldi. Lettres fu r VEncy-
•xlopédie.
* § EVITERNITÉ, . durée qui a un <ommettct-
ment, mais qui n'a point de-fin. Eviter ni té eft la même
chofe qu’'éternité; pourquoi Yéviternité auroit-elle
un commencement ? Calepin dit qu'aviternus eft fy-
nonyme à oeternus, fempiternus. On y lit cette phrafe
d’Apulée , Deos jncorporales , fine uilo fine, neque
exordiofed prorfus eevitetnos. J’avoue que , fuivant la
faillie doârine du faux Zoroaftre, on pourroit admettra
la définition de cet article,comme on le voit
dans lés chap. 3 , 4 & 5 ,/iv. 1 yfecl. 2. de la Philo-
fopliie Orientale de Stanley > mais ce n’eft pas de-Ià
qu’il faut tirer de bonnes définitions. Prifcien ènfeigne
que les anciens ont entendu a ternus par cevitemus ;
te terni tas par ceviternitas. Gouldman,dans fon Dictionnaire
,-affure oyYotviternus dit plus qu'ceternus. Lettres
fur CEncyclopédie.
* § EULOGIE,. . . On cite dans cet article Greet-
fer dans fon traité De benediclionibus, liv. I l , chap.
a 2 ,2 4 , lifez chap. 24 *‘-30. Lettres fur l'Encyc.
* § EUMOLPIDES , ( Mythol. prêtres de Céres...
-Us étaient appelles cumolpidcs , d'Eumolpe , roi des
Thraces , qui fut tué dans un combat ou il fecôuroit les
Eleufins contre les Athéniens. 1°. Il falloit dire les
ELeufiens. 20. Eumolpe né fut point tué dans ce comb
a t, ce fut fon fils qui y perdit la v ie .-Voye\- Pau-
-fanias dans fes Attiques. Lettres fur CEncyclopédie.
* § EVOCATION des Dieux tutélaires. . . . Ma-
<robe nous a confervé , lib. I I I , cap. g , la grande
formule de ces évocations tirée du livre des chofes fecretes
•des Sammoniens. Serenus prétendoit l'avoir prtfe dans
un auteur plus ancien. On lit dans Macrobe à l’endroit
cité ci-defliis, que Sammonicus Serenus dit
avoir tiré de Furius, auteur ancien , la formule des
évocations. Ainfi au lieu de des Sammoniens, Serenus,
lifez de Sammonicus Serenus qui. . . .
On peut voir fur Sammonicus Serenus M. Tille-
mont, Hifioire des Empereurs, tom. I I I , p. 122 ;
& fur les évocations , les Mémoires de C Académie des
-Jnfcriptions citées dans cet article du Diclionn. raif
des Sciences, &c. On trouve encore une fort bonne
diflertation fur ce fujet, dans la Bïblioth. Germanique
, tome I , partie première, art. 2. Lett. fur CEncyc.
EVOLUTION, ( Mufiq. ) On entend par évolu-
•■ tionen mufique, l’aôion de mettre le deflus à la baffe,
& la bafle au-defliis , fans qu’il en réfulte aucune
faute dans l’harmonie. Voye^ à Y article C ontrepoin
t DOUBLE. ( Mufiq. ) Dictionnaire raif. des
rSciences, &c. les réglés dont Y évolution dépend.
<F.Z> .C.)
§ EVOVAE, ( Mufiq. ) Vévovaei qm n’eft d’ufage
que dans le plain-chant, commence toujours par la
-dominante, du ton de l’antienne qui le précédé , &
finit toujours par la finale. ( S )
EUPHOLMIE , ( Mufique des anc.') Hefychius
appelle eupholmie la partie de la flûte qui eft immédiatement
au-defliis de la glotte, & la glotte même.
( F .D .C . )
* § EUPLOÉ, ( Mythol. ) furnom de Vénus. . . .
'11 y. avoit fur une montagne pris de Naples., un temple
confacré à Venus Euploé. On ne connoît point
cette montagne auprès de Naples , mais une île
nommée autrefois Euplocea , aujourd’hui Gajola ,
dans le golfe de Pouzol. M. Gedoyn dans fa Traduction
de P.uufanias^9 donne à Vénus le furnom
d 'Euploene, furnom , dit-il, formé de deux mots
■ grecs.; c’eft comme qui d iroit, Venus cTheureufe navigation.
Les Gnidiens lui avoient élevé un temple
Tous ce nom. Lettres fur C Encyclopédie.
* EURIPE , ( Géogr. ) petit détroit de la mer Egée...
■ Pajouterai que S. Juflin & S. Grégoire de N a fiance
f e font trompés quand ils ont écrit qu Arifiote étoit mort
fie chagrin dt ri avoir pu comprendre la caufe du fiux
E U R
& du reflux de CEuripe. Il faut confulter fuWcètte
imputation la remarque Z de l’article Arifiote,
dans Bayle. On y trouvera que Julien l’Apoftat s’eft
pour le moins trompé autant que S. Grégoire de
Nazianze, <« Plufieurs perfonnes, dit M. Bayle ,
» n’ayant pas pour les peres de l’Eglife tout le ref-
» pett qu’il faudroit, fe plaifent à les taxer d’une
» aveugle crédulité ». Lettres fur l'Encyclopédie.
* § EUROPE, ( Géogr. ) Nous ajouterons ici un
tableau général de cette partie de la terre, Comme
nous avons fait à Pégard des trois autres.
* § EURYNOME, ( Mythologie.) Ce dieu infernal
n’étoit point repréfenté dans le temple de
Delphes par une ftatuè noire , comme on le dit
dans le Dicl. raif. des Sciences, & c . mais dans le
tableau des enfers du célébré Polignote. « Il faut,
» dit Paufanias, liv. 1. que j’explique de quelle
» maniéré le peintre a repréfenté Eürynome : fon
» vifage eft de coulèur entre noire & bleue, comme
» celle de ces mouches: qui font attirées par la
» viande ; il grince les dents, & eft aflis fur une
» peaii de vautour». Lettres fur l'Encyclopédie.
* § EURYSTHERNE, ( Mythologie. ) Voyez
Eurysternon dans le Dicl. raif des Sciences, & c .
Il faut écrire Euryfierne plutôt cpx'Euryfiernon, qui
eft un mot purement grec, au neutre. Lettres fur,
V Encyclopédie.
EURYTHMIE, ( Beaux-Arts.') c’eft cette harmonie
des parties d’un tout par rapport à leur grandeur
, qui fait qu’aucune ne fe diftingue au préjudice
des autres ou deTenfemble. Ainfi un objet a
Y eurythmie, ou les belles proportions qu’il doit
avo ir, lorfque chaque membre, chaque partie^a
précifément la grandeur qui lui convient dans fon
rapport, avec le tout. C’eft Y eurythmie qui fait une
partie plus grande qu’une autre, en réglant leur
mefure abfolue fur le rang qu'elles tiennent dans
Jes proportions. C ’eft par elle que dans le corps
humain, le tronc eft la plus grande , & la tête la
plus, petite des parties principales. L’effet que Y eurythmie
produit dans nos perceptions, c’eft le repos
& l’acquiefcement, parce qu’elle met en équilibre
les diverfes parties de l’o bjet, qu’elle nous les
préfente toutes à la fois , compofant enfemble un
tout complet, apperçu en plein, & non imparfait
ou de profil. Sans cet équilibre nul objet ne peut
être beau, & voilà pourquoi Yeurythmie eft le
principe de la beauté.
La belle proportion des parties eft donc une
propriété générale de tous les ouvrages de l’art;
c’eft ce qui en fait un tout harmonique. Mais Y eurythmie
ne concerne pas Amplement les proportions
de grandeur, elle s’étend encore à l’élaboration,
à l’exécution des parties. Veurythmie feroit bleffée,
A dans un tableau certaine partie étoit plus achevée,
mieux finie que fa place, ou fon effet par rapport
au tout, ne le demande.
L’obfervation des belles proportions exige une
grande fagacité & un goût très-fin. Il eft évident
qu’elle n’eft poffible qu’autant qu’on fait fe faire
une image exatte & précife de l’enfemble & de
toutes fes parties. Quiconque n’eft pas capable de
faifir d’un coup d’oeil le tout dans fon entier, ne
fauroit ni fentir Y eurythmie où elle eft, ni en fentir
le défaut où elle n’ eft pas. Pour acquérir cette
partie, fi effentielle de l’art, on ne fauroit donc trop
s’exercer à avoir le coup d’oeil jufte, & à bien faifir-
l’enfemble. Le peintre, au milieu de fon travail,
fait quelques pas en arriéré, pour contempler de
lo in . fon tableau, & juger dfe l’effet du tout. Le
compofiteur fe place à quelque diftance, poiur
entendre la première répétition, de fa mufique^
Mais l’orateur & le poete n’ont pas la même fa-;
.cilité dans des pièces de quelque étendue. C ’eft