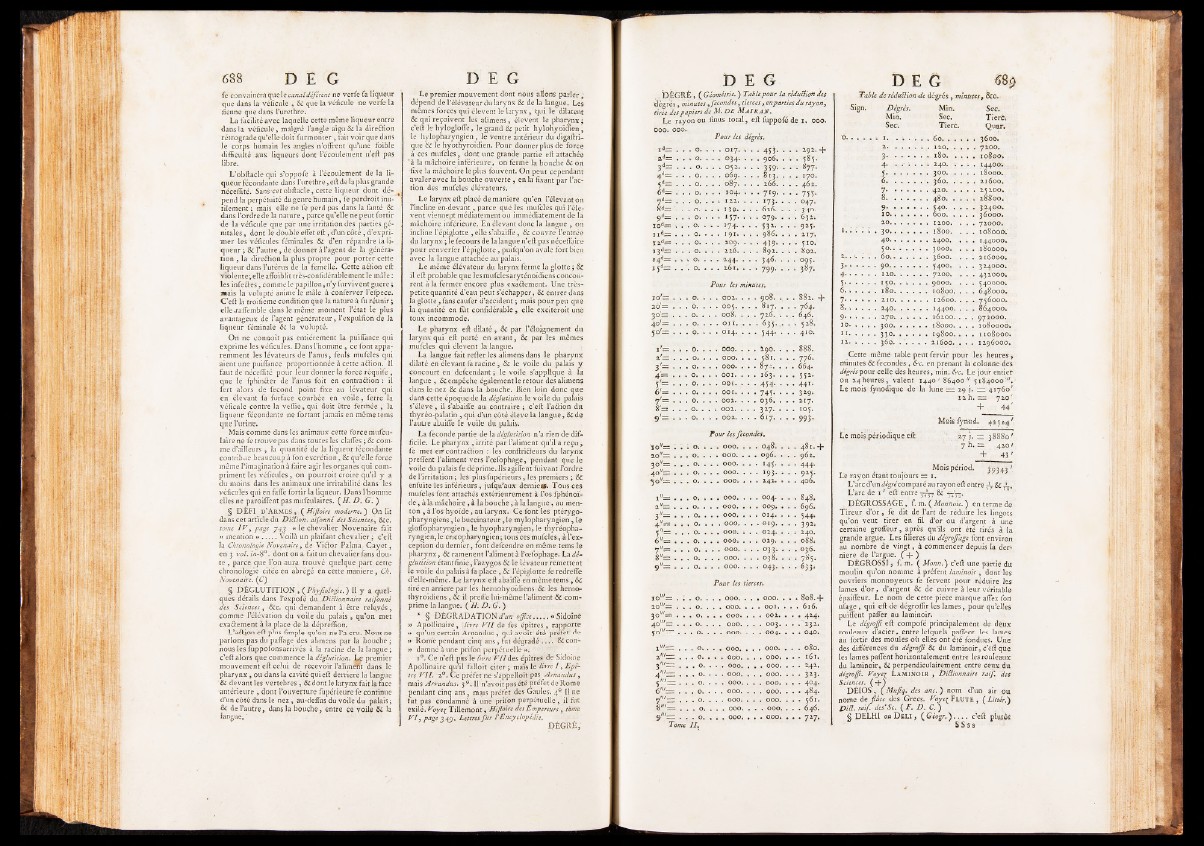
feconvaincra quele canal défèrent ne verfe fa liqueur
que dans la véficule , & que la véficule ne verfe la
iienne que dans l’urethre;
La facilité avec laquelle cette même liqueur entre
dans la véficule, malgré l’angle aigu & la direéïion
rétrograde qu’elle doit furmonter , tait voir que dans
le corps humain les angles n’offrent qu’une foible
difficulté aux liqueurs dont l’écoulement n’eft pas
libre.
L’obftacle qui s’oppofe à l’écoulement de la liqueur
fécondante dans I’urethre, eft de la plus grande
néceffité. Sans-cetobftacle, cette liqueur dont dépend
la perpétuité du genre humain, le perdroit inutilement
; mais elle ne 'fe perd pas danslafanté &
dans l’ordre de la nature, parce qu’elle ne peut fortir
de la véficule que par une irritation des parties génitales
, dont le double effet e f t , d’uri côté , d’exprimer
les véficules féminales & d’en répandre la liqueur
; & l’autre, de donner à l’agent de la génération
, la direftion la plus propre pour porter cette
liqueur dans l’utérus de la femelle. Cette aétion eft
violente; elle affoiblit très-confidérablement le mâle :
les infeftes, comme le papillon, n’y furvivent guere ;
mais la volupté anime le mâle, à conferver l’efpece.
C ’eft la troifieme condition que la nature à fu réunir ;
elle jaffemble dans le même moment l’état le plus
avantageux de l’agent générateur, l’expulfion de la
liqueur féminale & la volupté.
On ne connoît pas entièrement la puiffance qui
exprime les véficules. Dans l’homme , ce font apparemment
les lévateurs de l’anus, feuls mufcles qui
aient une puiffance proportionnée à cette aûion. Il
faut de néceffité pour leur donner la force réquife ,
que lé fphin&er de l’anus foit en contraction : il
fert alors de fécond point fixe au lévatèur qui
en élevant fa furface courbée en v o ilé , ferre la
véficule contre la veffie, qui doit être fermée , la
liqueur fécondante ne fortant jamais en même teins
que l’urine.
Mais comme dans les animaux cette force ni ulcu-
laire ne fe trouve pas dans toutes les claffes ; & comme
d’ailleurs , la quantité de la liqueuç.fécondante
contribue beaucoup à fon excrétion, Si qu’elle force
même l’imagination à faire agir les organes qui compriment
les véficules, on pourroit croire qu’il y a
du moins dans les animaux une irritabilité dans les
véficules qui en faffe fortir la liqueur. Dans l’homme
elles ne paroiffent pas mufculaires. ( H. D. G. )
§ DÉFI d’Armes , ( Hijloire moderne. ) On lit
dans cet article du Diction, aifonné des Sciences> &c.
tome I V , page 743 « le chevalier Novenaire fait
» mention » ........Voilà un plaifaht chevalier ; c’eft
la Chronologie Novenaire, de ViÇtpr Palmar Cayet.,
en 3 vol. in- 8°. dont on a fait un chevalier fans doute
, parce que l’on aura trouvé quelque part cette
chronologie citée en abrège en cette maniéré, Ch.
Novenai/e. (C)
§ DÉGLUTITION , ( Phyjlologie, ) Il y a. quelques
détails dans l’e.xpofé du ,Dictionnaire raifonnê
des Sciences, &c. qui demandent à être relevés,
comme l’élévation du voile du palais, qu’on met
exa&ement à la place de la dépreffion.
L’aftion eft plus fimple qu’on ne l’a cru. Nous ne
parlons pas du paffage des alimens par la bouche ;
nous lés fuppofons arrivés à la racine de la langue ;
c’eft alors que commence la déglutition. Le premier
mouvement eft celui de recevoir l’aliment dans le
pharynx, ou dans la cavité qui eft derrière la langue
' & devant les vertebres , & dont le larynx fait la face
antérieure , dont l’ouverture fupérieure fe’continue
d’un côté dans le nez , au-deffus du voile du palais ;
& de l’autre, dans la bouche, entre ce voile Sc la
langue,’
Le premier mouvement dont nous allons parler
dépend de l’élévateur du larynx & de la langue. Les
mêmes forces qui élevent le larynx, tjui le dilatent
& qui reçoivent les alimens, élevent le pharynx ;
c’eft le hylogloffe, le grand & petit hylohyoïdien,
le hylopharyngien, le ventre antérieur du digaftri-
que Si le hyothyroïdien. Pour donner plus de force
à ces mufcles, dont une grande partie eft attachée
*à la mâchoire inférieure-, on ferme la bouche Si on
•fixe la mâchoire le plus fouvent. On peut cependant
avaler avec la bouche ouverte , en la fixant par l’action
des mufcles élévateurs.
Le larynx eft placé de maniéré qu’en l’élevant on
l’incline en-devant, parce qué les mufcles qui l’ële-
vent viennent médiatement ou immédiatement de la
mâchoire inférieure. En élevant donc la langue , on
incline l’épiglotte , elle s’abaiffe, & couvre l’entrée
du larynx ; le fecoursde la langue n’ eft pas néçefl'aire
pour renverfer l’épiglotte, puifqu’on avale fort bien
avec la langue attachée au palais.
Le même élévateur du larynx ferme la glotte ; &
il eft probable que les mufclesaryténoidiens concourent
à la fermer encore plus exa&ement. Une très-
petite quantité d’eau peut s’échapper, & entrer dans
la glotte, fans caufer d’accident ; mais pour peu que
la quantité en fût confidérable , elle exciteroit une
toux incommode.
Le pharynx eft dilaté, Si par l’élojgnement du
larynx qui eft porté en avant, Si par les mêmes
mufcles qui élevent la langue.
La langue fait refter les alimens dans le pharynx
dilaté en élevant fa racine, & le voile du palais y
concourt en defeendant ; le voile s’applique à la
langue , & empêche également le retour des alimens
dans le nez & dans la bouche. Ëien loin donc que
dans cette époque de la déglutition le voile du palais
s’élève , il s’abaiffe au contraire ; .c’eft l’aftion du
thyréo-palatin , qui d’un côtjé éleve la langue, & d e
l’autre abaiffe le voile du palais.
La fécondé partie de la déglutition n’a rien de difficile.
Le pharynx , irrité par l’aliment qu’il a reçu ,
fe met err contraction : les conftriéteurs du larynx
preffent l’aliment vers l’oefophage, pendant que le
voile du palais fe déprime. Ils agiffent fuivant l’ordre
de l’irritation ; les plus fupérieurs, les premiers ; &
enfuite les inférieurs, jufqu’aux demie®. Tous ces
mufcles font attachés extérieurement à l’os fphénoï»
d e, à la mâchoire, à la bouche, à la langue, au menton
, à l’os hyoïde, au larynx. Ce font les ptérygo-
pharyngiens, le buccinateur ,1e mylopharyngien-, le
gloffopharyngien , le hyopharyngién, le thyréopha-r
ryngien,le cricopharyngien; tous ces mufcles, à l’exception
du dernier, font defeendre en même tems le
pharynx, & ramènent l’aliment à l’oefôphage. La déglutition
étant finie, l’azygos Si le lévatèur remettent
le voile du palais à fa place , Si l’épiglotte fe redreffe
d’elle-même. Le larynx eft abaiffé en même tems, Si
tiré en arriéré par les hernohyôïdiens Sc les herno-
thyroïdiens , Sc il préfl'e lui-même l’aliment Si comprime
la langue. ( H. D. G. ')
* § DÉGRADATION d'un office. . . . . « Sidoine
» Apollinaire, \livre F i l de fes épîtres , rapporte
» qu’un certain Arnandus , qui a voit été préfet'de
» Rome pendant cinq ans , fut dégradé . . . . &con-
» damné à une prifon perpétuelle »J ' ■
i°. Ce n’eft pas lé livre F I I des épîtres de Sidoine
Apollinaire qu’il falloit citer ; mais lè livre I , Epi-
ire.VII. i ° . Ce préfet ne s’appelloit pas Arnandus,
mais Arvandus. 3 Il n’avoit pas été préfet de Rome
pendant cinq ans, mais préfet des Gaules. 40 II ne
fut pas condamné à une prifon perpétuelle, il fut
exilé. Foye[ T illemont, Hiftoire des Empereurs, tome
F I . page 3 40, Lettres fur l'Encyclopédie.
DÉG RÉ,
DÊGRÉ , ( Géométrie. ) Table pour la réduction des
degrés, minutes,fécondés, tierces , en parties du rayon,
tirée des papiers de M. DE Ai a i r a n .
Le rayon ou finus total, eft fuppofé de 1. 000.
000. 000.
P o t ir tes dègr>
r = • • • o.
agg— b . o.
. . . o .
M .
Tome IE
. . . 017. R• • 453- ■ . 19». +
. . . ©34.1 . . 906. . • 585-'
. . . 0 5 2 .. . . 359; . ■ 877.
. . , . 069. . • • .813. • . 170.
. . . 087. . . . 266. . . 462.
. . . 104. | . . 7I9. . • 755-
. . v 122. , • • 173- • • ° 47*
. . I39. . ; E 626. E B 340-
. . . I57. . ! • ° 79* • . 632;
. . I74. . . 532. . • 925*
. . 191. > ; . 986. . . 217;
1 . 209. . • • 439v • . 510k
k . . 226. . . . 892. . . 802.
. . 244. . . 346. . . 095.
. . 261. » . ; 799. . 1 387‘
Pour les mitiutèS-,
1 . 002. . . 908. E . . 882. +
. . 605. . . 817. . . 1 764-
. SfflOEM! . 646.
. . o i i . . • 16 3 5 - ,- • • 528,'.
. . 014. . . 544- • • . 410k
. | 000. ; R S9Ô. ; . . 888.
. . OOO. ; . 5 8 . . . 1 • 776'
. . OOO. . . 8 7 ; . . . 664.
| . ÔOI. . . 163. ; . • 5S*‘
E . 0 0 1 .. • 454- • • • 441-
. . ÔOI; . . 745. . . 329;
. . 002. . . 036. . . . 217.
. . 002. . . 327. . . . 105.
; . 002. . . 617. . ; . 993.
Pour les fécondés;
. . 000. . . ; O48; . ; .4 8 1 .+
. ; OOO. . . O96. . . . 962.
. . OOO. . . . J45- • • • 444;
. . OOO. . . . 193* • • 9M-
. . 242. ; k k 406.
. . OOO. . ; . 604. . . 18 48 ,
; . OOO. . k . OO9. . ; . 696k
. . OOO. . . ; OI4. k ; . 544k
. . OOO. . . . O19. . k . 392k
; . OOO. l . . O24. . . : 240.
. . OOO; . . k 029. g . . 088k
. . OOO. ; . . 033k * . . 036.
. . 038. . . k 785.
. * 043. k k • 633*
Pour les tierces»
. . . OOO. ; . • OOÔ. . ; . 808.4-
. k 001. . . 616.
. ; . OOO. . k o o i. . . 424.
. . 003. . . 232.
. ; . OOO; ; . . 004. . k 040k
. . . OOO. . . . 000, . . 080.
. ; ; OOO., . . 000. . . l6 l.
. ; . OOO. . . 000. . • 242.
. . . OOO. . . oôo. . • 323-
. ; . OOO. k . 000. . k 404.
. . . OOO. . . 000. . . 484.
. . . OOO. k . 000. . . 561.
. . . OOO. . . 000. . . 646.
. « . OOO. • . 000k . • 7 *7-
D E G %
Table de réduction de dégrés, minutes, &C»
Sign. D égrés.
Min.
Sec;
Min;
Sec.
Tieré.
2............... ; 120. k
3................... l80. 1
4. . . . . . 24O. .
5................... 300. .
6. . . . . . 360. .
7................... 420. .
8................... 48O. .
9................... 540. .
1 0 . . . . . . 600. .
2 0 . . . . . . 1200.
. 1500.
. 2400.
300b.
Sec.
Tierfc,
Quar.
, 3600.
, 7200.
. 10800;
. 14400;
, 18000.
, 21600.
. 25200.
28800.
32400.
36000.
72000.
. 108000;
. 144000.
. 180000;
. r. ; . . 60.. . ; . . 3600. . . 216000;
k . . . ; 90. . . . . . 54OQ. ; . 324OOO;
..............120. . . k . 7200. . . 432000;
. . . . . 150. ; . . ; 9000. . . 54OOOO;
• . . . . 180. . ; . . 108,00. . . 64800b.
.............. 210. . . . . 1260b.
vo
O00
v • . . . 24O. ; . . k 14400. . . 864000k
. . . . . 27O; ; . ; . 162OO. . ; 972OOO.
>. k . ; . 366; , k . . . 180OO. . . ioSoopb.
.............. 330. . . ; . 19800. . . I 108000.
• . . ; . 36b. . . . . 21600. k . I2960OO;
Cette même table peut fetvir pour les heures,
minutes Si fécondés, &c. en prenant la colonne dès
dégrés pour celle dès heures, min. &c. Le jour entier
ou 24 heures; valent 1440’ 8640011 518-4000 "V
Le mois fynodique de la lune == 29 j. czz 41760'
12 hîtsz^n 720'
+ 44 '
Le mois périodique eft
Mois lynod. 415 247.
'• -27 j. — 38880/
7 h’- i S 410 '
+ 4 3 '
Mois périod; 39343
Le rayon étant toujours = 1.
L’arc d’un dégré comparé au rayon eft ehtre ~ & -i-.
L’arc de 1 * eft entre j~ j j & H j i -
DÉGROSSAGE, f. m. ( Monnoic. ) en terme de
Tireur d’o r , fe dit de l’art de réduire les lingots
qu’on veut tirer en fil d*or ou d’argent • à une
certaine groffeur, après qu’ils ont été tirés à la
grande argue. Les filières du dégrojfage font environ
au nombre de vingt, à commencer depuis la der1
niere de l’argue. ( + )
DÉGROSSI, f. m. ( Monn.'y c’eft une partie du
moulin qu’on nomme à préfent laminoir , ddnt'les
ouvriers monnoyeurs fe fervent pour réduire les
lames d’o r , d’argent & de cuivre à leur véritable
épaiffeur. Le nom de cette pieCe marque affez fort
ufage , qui eft de dégroffir les lames, pour qu’elles
puiffent paffer au laminoir.
Le dégroffi eft compofé principalement dé deux
rouleaux d’acier, entre lefquels paffent les lames
au fortir des mdules oh elles ont été fondues. Une
des différences du dégroffi. & du laminoir, c’ëft que
les lames paffent horizontalement entre les rouleaux
du laminoir, & perpendiculairement entre ceux du
dégroffi. Foye£ LAM IN O IR , Dictionnaire raif. des
Sciences. ( + )
DÉIOS , ( Mujiq. des anc. ) nom d’un air ç>u
nome de fiute des Grecs. Foye^ F l û t e , ( Littér.)
D i cl. raif. des’Sc. ( F. D .C . )
§ DELHI ou D eli , ( Gèogr, ) . . . . c’eft plutôt
S S ss