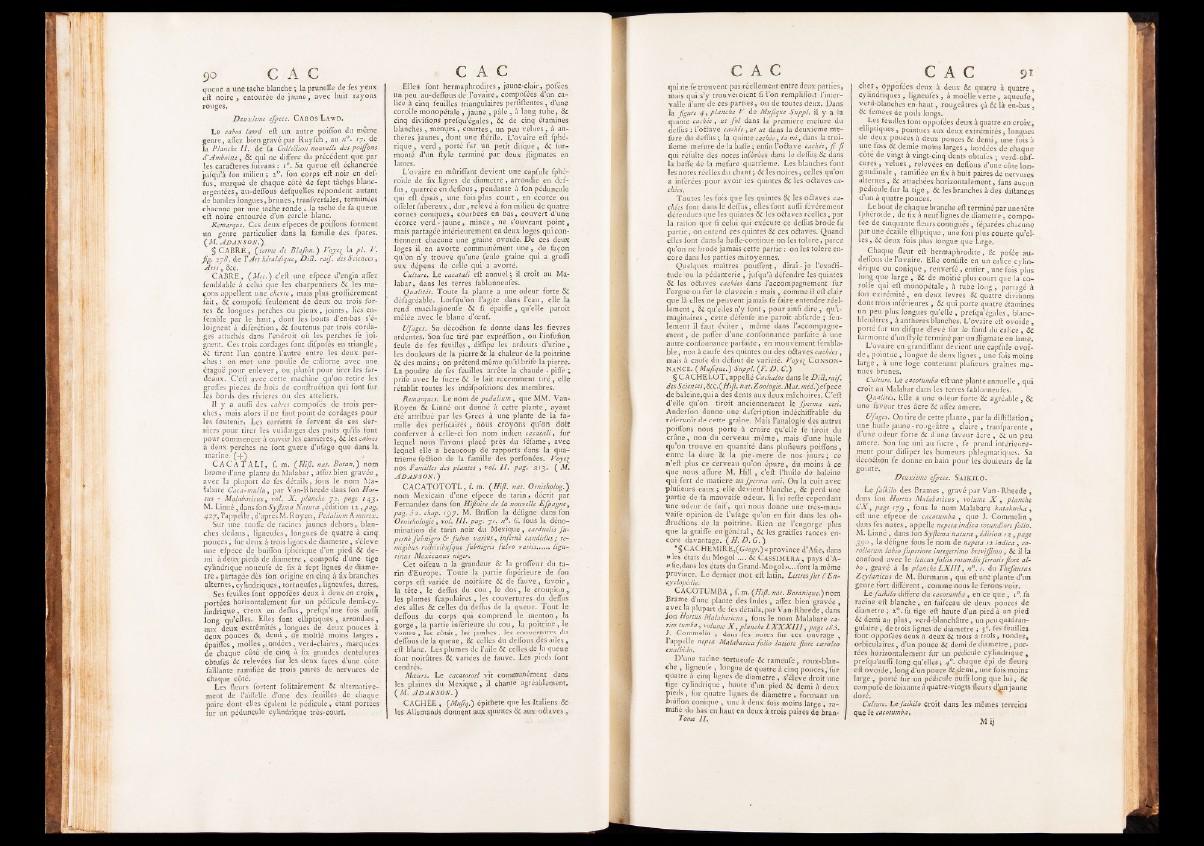
queue a une tache blanche ; la prunelle de fes yeux
eft noire > entourée de jaune, avec huit rayons
rouges.
Deuxieme efpece. C àBOS L awd.
Le cabos lav/d eft un autre poiffon du même
genre, aflez bien gravé par Ruyfch , au n°• /y. de
la Planche II. de fa Collection nouvelle des poiffons
d'Amboifte, 8c qui ne différé du precedent que par
les caraâeres fuivans : i°. Sa queue eft échancree
jufqu’à fon milieu ; 2°. fon corps eft noir en def-
fus, marqué de chaque côté de fept tâchas blanc-
argentées, au-deffous defquelles répondent autant
de bandes longues, brunes, tranfverfales, terminées
chacune par une tache ronde, la taché de fa queue
eft noire entourée d’un cercle blanc.
Remarque. Ces çleux efpeces de poiffons forment
un genre particulier dans la famille des fpares.
(Af. A d a n so n .')
§ CABRÉ, ( terme de Blafon.') Voye^ la pl. V.
fig. iy8. de l’Art héraldique, Dicl. raif. des Sciences,
A r ts , &c.
CABRE, ( Mec.) c’eft une efpece d’engin aflez
femblable à celui que les charpentiers & les maçons
appellent une chevre, mais plus grofliérement
fait, 8c compofé feulement de deux ou trois fortes
8c longues perches ou pieux, joints, liés eo-
femble par le haut, dont les bouts d’en-bas s’éloignent
à diferétion, Ôc foutenus par trois cordages
attachés dans l’endroit où les perches fe jpi?;
gnent. Ces trois cordages font difpofés en triangle,
& tirent l’un contre l’autre entre les deux perches
: on met une poulie de caliorne avec une
étaguë.pour enlever, ou plutôt pour tirer les fardeaux.
C ’eft avec cette machine qu’on retire les
groffes pièces de bois de conftruâion qui font fur
les bords des rivières ou des atteliers.
Il y a aufli des cabres comp'ofés de trois perches
, mais alors il ne faut point de cordages pour
les foutenir. Les carriers fe fervent de ces derniers
pour tirer les vuidanges des puits qu’ils font
pour commencer à ouvrir les carrières, 8c les cabres
il deux, perches ne font guere d’ufage que dans la
marine. (+ ) ,
C A C A T A L I , f. m.. \Hifl’ tiat. Botan.') nom
brame d’une plante du Malabar, aflez bien gravée ,
avec la plupart de fes détails, fous le nom Ma-
îabare Caca-mullu, par Van-Rheede dans fon Hortus
- Malabaricus, vol. X . planche yx. page Z 43.
M. Linné, dans fon Syflema Naturce , édition 12 , pag.
427, l’appelle, d’après M. Royen, Pedalium A murex.
Sur une touffe de racines jaunes dehors, blanches
dedans, ligneufes, longues de quatre à cinq
pouces, fur deux à trois lignes de diamètre, s’élève
une efpece de buiflon fphérique d’un pied 8c demi
à deux pieds de diamètre , compofé d’une tige
cylindrique noueùfe de fix à fept lignes de diame-.
t r e , partagée dès fon origine en cinq à fix branches
alternes, cylindriques, tortueufes, ligneufes, dures*
Ses feuilles font oppofées deux à deux en croix,
portées horizontalement fur un pédicule demi-cylindrique
, creux en defliis, prefqu’une fois aufli
long qu’elles. Elles font elliptiques , arrondies,
aux deux extrémités, longues de deux pouces à
deux pouces 8c demi , de moitié moins larges ,
épaiffes , molles ondées, verd-claires, marquées
de chaque côté de cinq à fix grandes dentelures,
obtufes 8c relevées fur les deux faces d’une côte
faillante ramifiée de trois paires de nervures de
chaque côté.
Les fleurs fortent folitairement 8c alternativement
de l’ aiffelle d’une des, feuilles de chaque
paire dont elles égalent le pédicule, étant portées
fur un péduncule cylindrique très-court.
Elles font hermaphrodites, jaune-clair, pofées
un peu au-deflousde l’ovaire, compofées d’un calice
à Cinq feuilles triangulaires perfiftentes, d’une
corolle monopétale , jaune., pâ le, à long tube, 8c
cinq divifiqns prefqu’égales, 8c de cinq étamines
blanches , menijes, courtes, un peu velues, à anthères
jaunes, dont une ftérile. L’ovaire eft fphérique
, v e rd , porté fur un petit difque, 8c fur-
monté d’un ftyle terminé par deux ftigmates en
lames.
L’ovaire en mûriflant devient une capfule fphé-
roïde de fix lignes de diamètre, arrondie en def-
fus, quarrée en deflous, pendante à fon péduncule
qui eft épais, une fois plus court, en écorce ou
offelet fubereux , dur, relevé à fon milieu de quatre
cornes coniques, courbées en bas, couvert d’une
écorce verd-jaune, mince, ne s’ouvrant point,
mais partagée intérieurement en deux loges qui contiennent
chacune une graine ovoïde. De ces deux
loges il en avorte communément une, de façon
qu’on n’y trouve qu’une feule graine qui a grofli
aux dépens de celle qui a avorté.
Culture. Le cacatali eft annuel ; il croît au Malabar,
dans les terres fablonneufes.
Qualités. Toute la plante a une odeur forte &
défagréable. Lorfqu’on l’agite dans l’eau, elle la
rend mucilagineufe 8c fi épaifle , qu’elle paroît
mêlée avec le blanc d’oeuf.
Ufages. Sa décoâion fe donne dans les fievres
ardentes. Son fuc tiré par expréflion, ou lfinfufion
feule de fes feuilles -, diflipe les ardeurs d’urine,
les douleurs de la pierre & la chaleur de la poitrine
8c des mains ; oh prétend même qii’il brife la pierre.
La poudre de fes feuilles arrête la chaude - piffe ;
prife avec le fucre 8c le lait récemment tiré, elle
rétablit toutes les indifpofitions des membres.
Remarques. Le nom de pedalium, que MM. Van-
Royen 8c Linné ont donné à cette plante, ayant
été attribué par les Grecs à une plante de la famille
des perficaires , nous croyons qu’on doit
eonferver à celle-ci fon nom indien cacatali, fur
lequel nous l’avons placé près du féfame, avec
lequel elle a beaucoup de rapports dans la quatrième
feâion de la famille des perfonées. Voye£
nos Familles des plantes , vol. I I . pag. 2.13. ( M.
A DANSONS)
C A C A TO T O T L , f. m. (fHifi. nàt. Ornitkolog.')
nom Mexicain d’une efpece de tarin, décrit par
Fernandez dans fon Hifloire de la nouvelle Efpagne,
pag. Sx. chap. i$y. M. Briflon la défigne dans fon
Ornithologie, vol. III. pag. y ,. n°. 6. fous la déno-<
mination dé tarin noir au Mexique, carduelis fu -
perne fubnigro & fulvo varius, infernï candidus ; re-
migibus reclricibufque fubnigris fulvo variis...... ligurinus
Mexicanus niger.
Cet oifeau a la grandeur & la groffeur du tarin
d’Europe. Toute la partie fupérieure de fon
corps eft variée de noirâtre & de fauve, favoir,
la tê te , le defliis du co u , le dos, le croupion ,
les plumes fcapulaires, les couvertures du defliis
des aîles & celles du defliis de la queue. Tout le
deflous du corps qui comprend le menton, la
gorge, la partie inférieure du cou, la poitrine , le
ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du
deflous de la queue, 8c celles du deflous des aîles ,
eft blanc. Les plumes de l’aîle 8c celles de la queue
font noirâtres 8c variées de fauve. Les pieds font
cendrés.
Moeurs. Le cacatototl vit communément dans
les plaines du Mexique , il chante agréablement.
( M. A D A N SO N . )
CACHÉE, (Mufiqf) épithete que les Italiens 8c
les Allemands donnent aux quintes 8c aux oâaves
qui ne fe trouvent pas réellement entre deux parties,
mais qui s’y trouveroient fi l’on remplifloit l’intervalle
d’une de ces parties, ou de toutes deux. Dans
la figure 4 , planche V de Mujîque Suppl, il y a la
quinte cachée , ut fo l dans la première mefure du
defliis : l’oâave cachée , ut ut dans la deuxieme rrre-
fure du defliis ; la quinte cachée, la mi, dans la troi-
fieme mefure de la baffe ; enfin l’oâave cachée, f i f i
qui réfulte des notes inférées dans le defliis 8c dans
la bafl’q de la mefure quatrième. Les blanches font
les notes réelles du chant ; & les noires, celles qu’on
a inférées pour avoir les quintes 8c les oftaves cachées.
Toutes les fois que les quintes & les oftaves cachées
font dans le defliis, elles font aufli févérement
défendues que les quintes 8c les oâaves réelles, par
la raifon que fi celui qui exécute ce defliis brode fa
partie, on entend ces quintes 8c ces oftaves. Quand
elles font dans la baffe-continue on les toléré, parce
qu’on ne brode jamais cette partie : on les toléré encore
dans les parties mitoyennes.
Quelques maîtres pouffent, dirai - je l’exââi-
tude ou la pédanterie , jufqti’à défendre les quintes
& les oâaves Cachées dans l’accompagnement fur
l’orgue ou fur le clavecin : mais , comme il eft clair
que là elles ne peuvent jamais fe faire entendre réellement
, 8c qu’elles n’y font, pour ainfi dire , qu’imaginaires
, cette défenfe me paroît abfurde ; feulement
il faut éviter , même dans l’accompagnement
, de paffer d'une confonnance parfaite à une
autre confonnance parfaite, en mouvement femblable
, non à caufe des quintes ou des oâaves cachées,
mais à caufe du défaut de variété. Voyeç CONSON-
N ANC E. ( Mujîque. ) Suppl. (F. D. C.)
§ CACHELOT, appellé Cachalot dans le Dicl.raif.
des Sciences,8ic.(Hifi. hat.Zoologie. Mat. méd.') efpece
de baleine,qui a des dents aux deux mâchoires. C ’eft
d’elle qu’on tiroit anciennement le fperma ceti.
Anderfon donne une defeription indéchiffrable du
réfervoir de cette graine. Mais l’analogie des autres
poiffons nous porte à croire qu’elle fe tirôit du
crâne, non du cerveau même, mais d’une huile
qu’on trouve en quantité dans plufieurs poiffons,
entre la dure & la pie-mere de nos jours; ce
n’eft plus ce cerveau qu’on épure, du moins à ce
que nous affure M. Hill , c’eft l’huile de baleine
qui fert de matière au fperma ceti. On la cuit avec
plufieurs eaux; elle devient blanche, 8c perd une
partie de fa mauvaife odeur. Il lui refte cependant
line odeur de fuif, qui nous donne une très-mau-
vaife opinion de l’ufage qu’on en fait dans les ob-
ftruâions de la poitrine. Rien ne l’engorge plus
que la graiffe en général, 8c les graiffes rances encore
davantage. ( H. D .G . )
*§ CACHEMIRE,(Gcogr.)«province d’Afie, dans
»les états du M o gol.... 8c Cassimera , pays d’A-
» fie,dans les états du Grand-Mogol»...font la même
province. Le dernier mot eft latin. Lettres fur l'Encyclopédie.
CACOTUMBA , f. m. (Htfl. nat. Botanique.') nova.
Brame d’une plante des Indes, aflez bien gravée ,
avec la plupart de fes détails, par Van-Rhëede, dans
ion Hortus Malabaricus, fous le nom Malabare ca-
rim tumba, volume X , planche L X X X I I 11 page ,85.
J. Commelm , dans fes notes fur cet ouvrage ,
1 appelle nepea Malabarica folio latiore flore coerüleo
exalbido.
D une racine tortueufe 8c rameufe, roux-blan-
che , ligneufe , longue de quatre à cinq pouces,'fur
quatre à cinq lignes de diamètre , s’élève droit une
tige cylindrique , haute d’un pied & demi à deux
pieds , fur quatre lignes de diamètre , formant un
buiffon conique , une à déux fois moins large , ramifié
du bas en haut en deux à trois paires de bran-
Tome I I , 1
cbes, opjpofées deux à deux 8c quatre à quatre ,
cylindriques , ligneufes , à moelle v e r te , aqueufe,
verd-blanches en-haut, rougeâtres çà 8c là en-bas,
8c femées de poils longs.
Les feuilles font oppofées deux à quatre en croix,
elliptiques , pointues aux deux extrémités, longues
de deux pouces à deux pouces 8c demi, une fois à
une fois 8c demie moins larges, bordées de chaque
côté de vingt à vingt-cinq dents obtufes ; verd-obf-
cures, velues, relevées en deflous d’une côte longitudinale
, ramifiée en fix à huit paires de nervures
alternes, 8c attachées horizontalement, fans aucun
pédicule fur la t ig e , 8c les branches à des diftances
d’un à quatre pouces.
Le bout de chaque branche eft terminé par une tête
fphéroïde, de fix à neuf lignes de diamètre •, compo-
fee de cinquante fleurs contiguës, féparées chacune
par une écaille elliptique, une fois plus courte qu’el-,
les , .8c deux fois plus longue que large.
Chaque fleur eft hermaphrodite, 8c pofée au-
deffous de l’ovaire. Elle confifte en un calice cylindrique
ou conique , renverfé, entier , une fois plus
long que large , 8c de moitié plus court que la corolle
qui eft monopétale, à tube long , partagé à
-fon extrémité, en deux levres 8c quatre divilions
dont trois inférieures , 8c qui porte quatre étamines
un peu plus longues qu’elle , prefqu’égales, blanc-
bleuâtres , à anthères blanches. L’ovaire eft ovoïde ,
porté fur un difque élevé fur le fond du calice , 8c
furmonté d’un ftyle terminé par unftigmate en lame.
L’ovaire en grandiffant devient une capfule ovoïde
, pointue, longue de deux lignes, une fois moins
la rg e, à une loge contenant plufieurs graines menues
brunes.
Culture. Le cacotumba eft une plante annuelle, qui
croît au Malabar dans les terres fablonneufes.
Qualités. Elle a une odeur forte 8c agréable, 8c
une faveur très-âcre 8c aflez amere.
Ufages. On tire de cette plante, par la diftillation
une huile jaune-rougeâtre , claire , tranfparente,
d’une odeur forte 8c d'une faveur âcre , 8c un peu
amere. Son fuc uni au fucre , fe prend intérieurement
pour dilfiper les humeurs phlegmatiques. Sa
décoâion fe donne en bain pour les douleurs de la
goutte*
Deuxieme efpece. SAIKILO.
Le faikild des Brames , gravé par Van-Rheede ,
dans fon Hortus Malabaricus , volume X , planche
C X , page iyc) , fous le nom Malabare katakurka,
eft une efpece de cacotumba , que J. Commelin,
dans fes notes, appelle nepeta indica rotundiore folio.
M. Linné , dans fon Syfiema naturce, édition 12, page
3S>°1 la défigne fous le nom de nepeta 12. indica, co-
rollarum labio fuperiore integerrimo breviffinio , ÔC il la
confond avec le leucus foliis rotundisferratisflore al-
bo , gravé à la planche L X I I I , n°. /. du Thefaurus
Zeylahiçus de M. Burmann, qui eft une plante d’un
genre fort différent, comme nous le ferons voir.
Le faikilo différé du cacotumba, en ce que , i°. fa
racine eft blanche, en faifeeau de deux pouces de
diamètre ; 2?. fa tige eft haute d’un pied à un pied
8c demi au plus, verd-blanchâtre, un peu quadran-
gulaire, de trois lignes de diamètre ; 30. fes feuilles
font oppofées deux à deux & trois à trois, rondes,
orbiculaires, d’un pouce & demi de diamètre, portées
horizontalement firr un pédicule cylindrique ,
prefqu’aufli long qu’elles ; 40. chaque épi de fleurs
eft ovoïde, long d'un pouce dz^demi, une fois moins-
large , porté fur un pédicule aufli long que lu i, 8c
compofé de.foixante à quatre-vingts fleurs d|un jaune
doré.
Culture. Le faikilo croît dans les mêmes terreins
que le cacotumba,
M i;