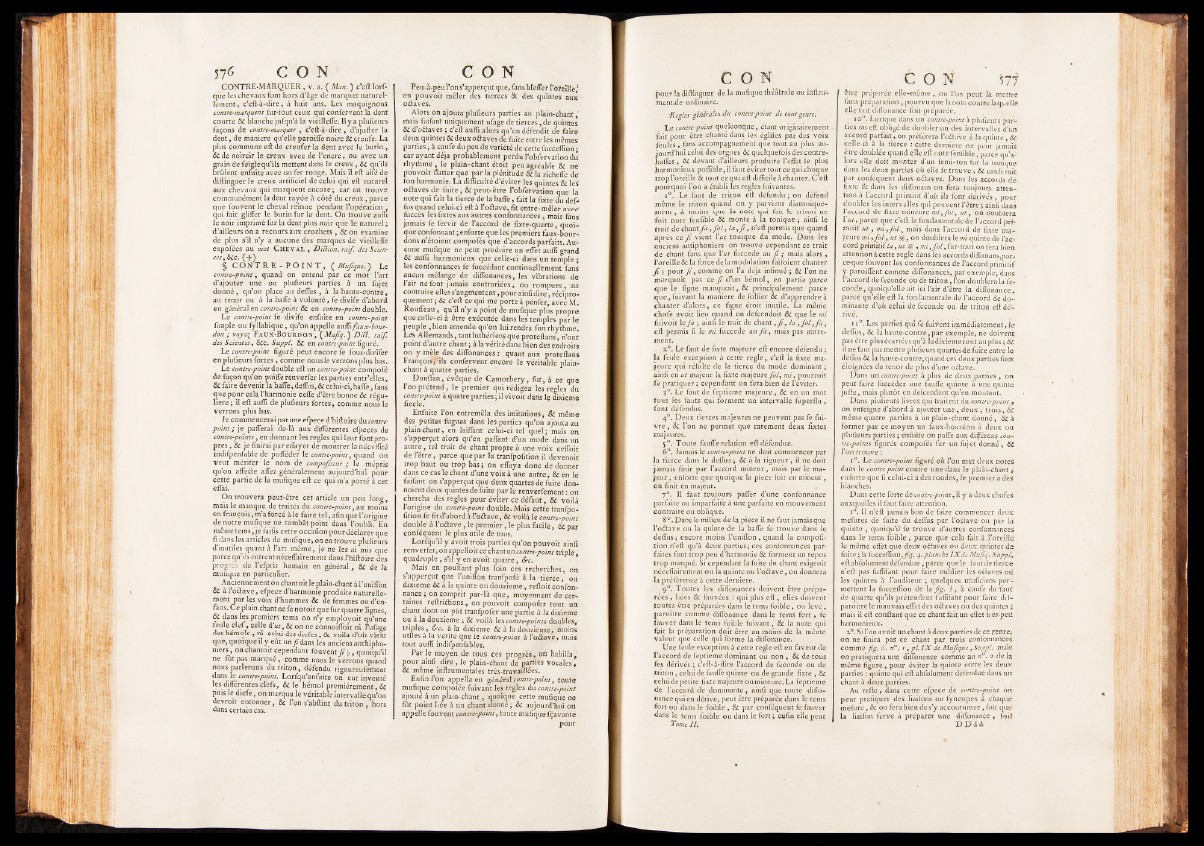
CONTRE-MARQUER, v. a. ( Man. ) e’eft lorf-
que les chevaux font hors d’âge de marquer naturellement,
c’eft-à-dire, à huit ans. Les maquignons
contre-marquent fur-tout ceux qui confervent la dent
courte & blanche jufqu’à la vieillefle. Il y a plufieurs
façons de contre-marquer , c’eft-à-dire, d’ajufter la
dent, de maniéré qu’elle paroHTe noire & creufe. La
plus commune eft de creufer la dent avec le burin,
&de noircir le creux avec de l’encre, ou avec un
grain de feigle qu’ils mettent dans le creux, 8c qu’ils
brûlent enfuite avec un fer rouge. Mais il eft ailé de
diftinguer le creux artificiel de celui qui eft naturel
aux chevaux qui marquent encore ; car on trouve
communément la dent rayée à côté du creux, parce
que fouvent le cheval refaire pendant l’opération ,
qui fait gliffer le burin fur la dent. On trouve aufli
le noir imprimé fur la dent plus noir que lé naturel ;
d’ailleurs-on a recours aux crochets , & on examine
de plus s’il n’y a aucune des marques de vieillefle
expofées au mot Cheval , Diction, raif. des Sciences,
8cc. (+)
§ CONTRE - POINT , ( Mufique.) Le
contre-point, quand on entend par ce mot l’art
d’ajouter une ou plufieurs parties à un fujet
donné, qu’on place au deffus , à la haute-contre,
au ténor ou à la baffe à volonté, fe divife d’abord
en général en contre-point 8c en contre-point double.
Le contre-point fe divife enfuite en contre-point
fimple ou fyllabique, qu’on appelle aufli faux-bourdon
; voyei FAUX-BOURDOS, (Mufiq. ) Dicl. raif.
des Sciences, &c. Suppl. 8c en contre-point figuré.
Le contre-point figuré peut encore fe fous-divifer
en plufieurs fortes, comme nous le verrons plus bas.
Le contre-point double eft un contre-point compofé
de façon qu’on puiffe renverfer les parties entr’elles,
8c faire devenir la baffe, deffus, & celui-ci, baffe, fans
que pour cela l’harmonie ceffe d’être bonne & régulière
; il eft aufli de plufieurs fortes, comme nous le
verrons plus bas.
Je commencerai par une efpece d’hiftoire du contrepoint
; je pafferai de-là aux différentes efpeces de
contre-points, en donnant les réglés qui leur font propres
, & je finirai par effayer de montrer la néceflité
indifpenfable de pofféder le contre-point, quand on
veut mériter le nom de compojiteur ; le mépris
qu’on affefte affez généralement aujourd’hui polir
cette partie de la mufique eft ce qui m’a porté à cet
effai.
On trouvera peut-être cet article un peu long,
mais le manque, de traités du contre-point, au moins
en françois, m’a forcé à le faire tel, afin que l’origine
de notre mufique ne tombât point dans l’oubli; En
mêmetems, je faifis cette occafîon pour déclarer que
fi dans les articles de mufique, on en trouve plufieurs
d’inutiles quant à l’art même, je ne les ai mis que
parce qu’ils entrent néceffairement dans l’hiftoire des
progrès de l’efprit humain en général, 8c de la
mufique en particulier.
Anciennement on chantoit le plâin-chant à l’uniffon
& à l’oûave, efpece d’harmonie produite naturellement
par les voix d’hommes & de femmes ou d’en-
fans. Ce plain-chant ne fe notoit que fur quatre lignes,
& dans les premiers tems on n’y employoit qu’une
feule clef, celle d'u t, & on ne connoiffoit ni l’ufâge
des bémols , ni celui des diefes ; & voila d’oii vient
que, quoique il y eut un jfdans les anciens anthipho-
niers , on chantoit cependant fouvent f i |,, quoiqu’il
ne fut pas marque , comme nous le verrons quand
nous parlerons du triton, défendu rigoureufement
dans le contre-point. Lorfqu’enfuite on eut inventé
les différentes clefs, 8c le bémol premièrement, &
puis le diefe, on marqua le véritable intervalle qu’on
devroit entonner, & l’on s’abftint du triton, hors
dans certain cas.
Peu-à-peul’oti s’appérçut que, fans bleffer Poreïlîe,’
on pouvoit mêler des tierces & dès quintes aux
oétaves.
Alors on ajouta plufieurs parties au plain-chant,
mais faifant uniquement ufage de tierces, de quintes
& d’oflaves ; c’eft aufli alors qu’on défendit de faire
deux quintes & deux OélâVês de fuite entre les mêmes
parties, à caufe du peu de variété dé cette fucceflion ;
car ayant déjà probablement perdu l’obfervation du
rhythme, le plain-chant étoit peu agréable 8c ne-
pouvoit flatter que par la plénitude 8c la richeffe de
fon harmonie. La difficulté d’éviter les quintes & les
oftaves de fuite, 8c peut-être l’obfervation que la
note qui fait la tierce de la baffe, fait la fiXté du defr
fus quand celui-ci eft à l’oâave, fit entre-mêler avec1
fuecès les fixtes aux autres confonnances , mais fans
jamais fe fervir de l’accord de fixte-quarte, quoique
confonnant ; enforte que les premiers faux-bourdons
n’étoient compofés que d’accords parfaits. Aucune
mufique ne peut produire un effet aufli grand
& aufli harmonieux que celle-ci dans un temple ;
les confonnances fe fuccédant continuellement fans
aucun mélange de diffonahces, les vibrations dé
l’air ne font jamais- contrariées, ou rompues, ait
contraire elles s’augmentent, pour ainfi dire, réciproquement
; & c’eft ce qui me porte à pènfer, avec M.
Rouffeau , qu’il n’y a point de mufique plus propre
que celle-ci à être exécutée dans les temples par le
peuple ,bien entendu qu’on lui rendra fon rhythme.
Lés Allemands, tant luthériens que proteftans, n’ont
point d’autre chant ; à la vérité dans bien des endroits
on y mêle des diffonances :. quant aux proteftans
Françoi^ils confervent encore le véritable plàin-
chant à quatre parties.
Dunftan, évêque de Cantorbery, fut, à ce quê
l’on prétend, le premier qui rédigea lés réglés dit
contre-point à quatre parties ; il vivoit dans le dixième
fiecle.
Enfuite l’on entremêla des imitations, 8c même
des petites fugues dans les parties qu’on ajouta ait
plain-chant, en laiflànt celui-ci tel quel; mais oh
s’apperçut alors qu’en paffant d’un mode dans un
autre, tel trait de chant propre à une Voix ceffoit
de l’être , parce que par la tranfpofitiort il devenoit
trop haut ou trop bas ; on effaya donc de donner
dans ce cas le chant d’une voix à une autre, & en le
faifant on s’apperçut que deux quartes de fuite don-
noient deux quintes de fuite par le renvérfement : on
chercha des réglés pour éviter ce défaut, & voilà
l’origine du contre-point double. Mais cette tranfpo-
fition fe fit d’abord à l’o&ave, & voilà Iè contre-point
double à l’o&ave, le premier, le plus facile, & par
conféquent le plus utile de tous.
Lorlqu’il y avoit trois parties qu’on pouvoit ainfi
renverfer, on appelloit ce chant un contre-point triple ,
quadruple , s’il y en avoit quatre, &c.
Mais en pouffant plus loin ces recherches, on
s’apperçut que l’uniffon tranfpofé à la tierce, oit
dixième & à la quinte ou douzième, reftoit cônfon-
nance; on comprit par-là que, moyennant de certaines
reftriétions, on pouvoit compofer tout un
chant dont on pût tranfpofer une partie à la dixième
ou à la douzième ; & voilà les contre-points doubles,-
triples, &c. à la dixième & à la douzième, moins
utiles a la vérité que le contre-point à l’oâave, mais
tout aufli indifpenfables.
Par le moyen de tous ces progrès, ori habilla
pour ainfi dire, le plain-chant de parties vocales,
& même inftrumeptales très-travaillées.
Enfin T on appella en général contre-point, toute
mufique compofée fiiivant les réglés du contre-point
ajouté à un plain-chant, quoique cette mufique ne
fût point liée à un chant donné; 8c aujourd’hui on
appelle fouvent contre-point, toute mufiquefçavante
pour
pour la diftinguer de la mufique théâtrale ou iriftru-
mentale ordinaire.
■ Revies ge/ierdîes dà contre-point de tout genre'.
Le contre-point quelconque, étant originairement
fait pour être chanté dans les églifes par des voix
feules, fans accompagnement que tout au plus aujourd’hui
celui des orgues & quelquefois des contre-
baffes , 8c devant d’ailleurs produire l’effet le plus
harmonieux pofîible, il faut éviter tout ce qui choque
trop l’oreille & tout ce qui eft difficile à chanter. C ’eft
pourquoi l’on a établi les réglés fuivantes.
i° . Le faut de triton eft défendu ;■ on défend
même le triton quand on y parvient diatoniquement
, à moins que la note qui fait le triton ne
foit note fenfible 8c monte à la tonique ; ainfi le
trait de chant fa , fo l, la, f i , n’eft permis qiie quand
après ce f i vient l’ar tonique du mode. Dans les
anciens antiphoniers on trouve cependant ce trait
de chant fans que Yut fuccede au f i ; mais alors ,
l ’oreille & la force delà modulation faifoient chanter
f i b pour f i , comme on l’a déjà infinué ; 8c l’on ne
marquoit pas ce f i d’un bémol, en partie parce
que le ligne manquoit, 8c principalement parce
que, fuivant la maniéré de folfier 8c d’apprendre à
chanter d’alors, ce figne étoit inutile. La même
çhofe avdit lieu quand on defcendoit 8c que le mi
fuivoit le fa ; ainfi le trait de chant , f i , la , fo l, fa ,
eft permis fi le mi fuccede au f a , mais pas autrement.
a0. Le faut de fixte majeure eft encore défendu ;
la feule exception à cette réglé, c’eft la fixte majeure
qui réfulte de la tierce du mode dominant ;
ainfi en ut majeur la fixte majeure fo l, mi, pourrbit
fe pratiquer ; cependant on fera bien de l’éviter. ■
3°. Le faut de feptieme majeure, & en un mot
tous les fauts qui forment un intervalle fuperflu,
font défendus»
4°. Deux tierces majeures ne peuvent pas fe fui-
v r e , 8c l’on ne permet que rarement deux fixtes
majeures.
5°. Toute fauffe relation eft défendue.
6°. Jamais le contre-point ne doit commencer par
la tierce dans le deffus ; & à la rigueur, il ne doit
jamais finir par l’accord mineur, mais par le majeur
, enforte que quoique la piece foit en mineur,
on finit eh majeur.
• 70. Il faut toujours paffer d’une eônfonnance
parfaite ou imparfaite à une parfaite en mouvement
contraire ou oblique.
8°. Dans le milieu de la piece il rie faut jamais que
ï’oétave ou la quinte-de la baffe fe trouve dans le
deffus ; encore moins l’uniffon, quand la compofi-
îion n’eft qu’à deux parties; ces confonnances parfaites
font trop peu d’harmonie & forment un repos
trop marqué. Si cependant là fuite du chant exigeoit
néceffairement ou la quinte ou l’oû a ve , on donnera
la préférence à cette derniere.
9°. Toutes les diffonances1 doivent être préparées
, liées & fauvées : qui plus e f t , elles doivent
toutes être préparées dàris le tems foible, ou ie vé,
paroître comme diffonanee dans le tems fo r t , fe
fauver dans le tems foible fuivant, 8c la note qui
fait la préparation doit être au moins de la même
Valeur que celle qui forme la diffonanee»
Une feule exception à cette réglé eft en favèur de
l ’accord de feptieme dominant ou non , 8c de tous
fes dérivés ; c’eft-à-dire l’aGcord de fécondé ou de
triton, celui de fauffe quinte-ou de grande fixte , 8c
celui de petite fixte majeure ou mineure. La feptieme
de l’accord de dominante, ainfi que toute diffo-
nance qui en dérive, peut être préparée dans le tems
fort ou dans le foible , & par conféquent fe fauver
dans ie tems foible oit dans le fort ; enfin elle peut
Tom e JL
f ôtre préparée ëlle-même , ou l’on peut là. mettre
fans préparation, pourvu que là note contre laquelle
elle fait, diffonanee foit préparée.
io°. Lorlque dans Un contre-point à plufieurs parties
on eft obligé de doubler un des intervalles d’uii
accord parfait, on préférera l’o&ave à la quibte, &
celle-ci à la tierce : cette derniere ne peut jamaii
être doublée quand elle eft note fenfible, parce qu’a-
lors elle doit monter d’un femi-ton fur la tonique
dans les deux parties oîi elle fe trouve, 8c caiiferoit
par conféquent deux oélaves. Dans les accords dé
fixte & dans les diflpnans on fera toujours, attention
à l’accord primitif d’oii ils font dérivés, pour
doubler les intervalles qui peuvent l’être ; ainfi dans
l’accord de fixte mineure mi, f o l , u t , on doublera
Y u t , parce que c’eft la fondamentale de l’accord pri*
mitit u t , m i, f o l y màis dans l’accord de fixte majeure
m i, f o l ,.u t% -, On doublera le mi quinte de l’accord
primitif la , Ut % , mi, f o l , fur-tout on fera bien
attention à cette réglé dànsles accords diffonans,par-,
coque fouvent les confonnances de l’accord primitif
y paroiffent comme diffonances, par exemple, dans
l’accofd de fécondé Ou de triton, l’on doublera la féconde,
quoiqu’elle ait ici l’air d’être la diffonanee,
parcé qii’elle eft la fondamentale-de l’accord de do-i
minante d’où celui de fécondé ou de triton eft dérivé.
î i°. Les parties qui fé fuiVent immédiatement, le
deffus, 8c la haute-contre, par exemple, ne doivent
pas être plus écartées qu’à la dixième tout au plus ; &
il ne faut pas mettre plufieurs quartesde fuite entre le
deffus 8c la haute-contre; quand ces deux parties font
éloignées du tenôr de plus d’une o£tave.
Dans un contre-point à plus de deux parties , on
peut faire fuccéder une fauffe quinte à une quinte
jufte, mais plutôt en defeendant qu’en montant.
Dans plufieurs livres qui traitent du contre-point,
ori enfeigne d’abord à ajouter une, deux ; trois, &
même quatre parties à un plain-chant donné, 8c à
former par ce moyen un faiix-bdurdori à deux ou
plufieurs parties ; enfuite on paffe âux différens contre
points figurés compofés fur uri fujet donné, 8c
l’ori trouve :
t ° . Le contre-point figuré où l’on riiet detix hoteS
dans le contre point contre une dans le plain-chant ;
enforte que fi celui-ci a deS rondes, le premier à dèè
blanches:
Dans cette forte de contre-point, il y a deux chofeS
auxquelles il faut faire attention.
i°. Il n’eft jamais bon de faire commencer deux
mefures de fuite du deffus par l’oétave oit par là
quinte , quoiqu’il fe trouve d’autres confonnanceà
dans le tems foible, parce que cela fait à. l’oreille
le même effet que deux oélaves ou deux quintes de
fuite ; la fucceflion,^. 4 .planche IX d e Mufiq. Suppl.
eft abfo'lument défendue , parce que le faut de tierce
n’eft pas fuffifant pour faire oublier les oélaves où
les quintes à. l’auditeur ; quelques nïuficiens per-
mettent-la fucceflion de la fig. 5 , à caufe du*fauf
de quarte qu’ils prétendent fufiîfarit pour faire dif-
parôître le mauvais effet des oélaves ou des quintes $
mais il eft confiant que ce chant fait un effet très-peit
harmonieux.
20. Si l’on avoit un chant à deux parties de ce genre;
on ne finira pas ce chant par trois confonnances
comme fig. <0. n°. 1 , pi. I X de Mufique, Suppl, mais
ori pratiquera une diffonanee comme au n°. 2 de la
même figure, pour éviter la quinte entre les deusî
parties : quinte qifi eft abfolument défendue dans un
chant à deux parties.
Au refte, dans cette efpece de contre-point ori
peut pratiquer des liaifons ou fyncopes à chaque
mefure, 8c on fera bién de s’y accoutumer, foit que
la liaifon ferve à préparer une diffonanee, fois
DDdd