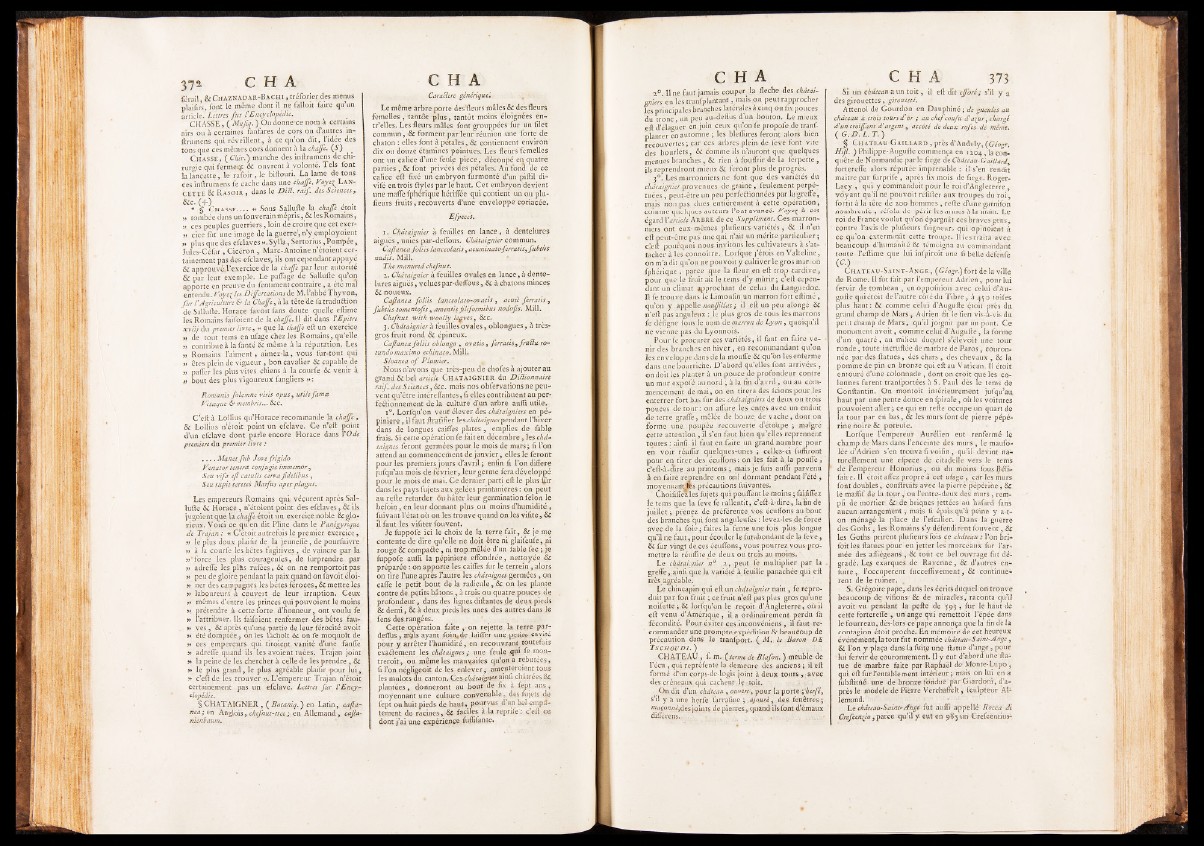
jférail, & C haznadar-Ba ch i , tréforier des menus
plaifirs, font le même dont il ne falloit faire qu’un
article. Lettres fur C Encyclopédie.
CHASSE, ( Mujiq. ) On donne-ce nom à certains
airs ou à certaines fanfares de cors ou d’autres in-
ftrumens qui réveillent, à ce qu’on dit, l’idée des
tons que ces mêmes cors donnent à la chajfe. ( i')
C hasse, ( Chir.) manche des inftrumens de chirurgie
qui ferment & ouvrent à volonté. Tels font
la lancette, le rafoir, le biftouri. La lame de tous
ces inftrumens fe cache dans une chajfe. Voye^ L anc
e t t e & R asoir , dans le Dicl. raif. des Sciences,
C hasse. . . . « Sous Sallufte la chajfe étoit
» tombée dans un fouverain mépris,8c les Romains,
», ces peuples guerriers, loin de croire que cet exer-
» cice fut une image de la guerre’, n’y employoient
» plus que des efclaves >>.Sy lia, Sertorius, Pompée ,
Jules-Céfar, Cicéron , Marc-Antoine n’étoient certainement
pas des efclaves, ils ont cependant appuyé
& approuvé.l’exercice de la chajfe par leur autorité
& par leur exemple. Le paffage de Sallufte cju’on
apporte en preuve du fentiment contraire, a été mal
entendu. Voyelles Dijfer tâtions de M. l’abbé Thyvon,
fur VAgriculture & la Chajfe, à la tête 'de fa tradu&ion
de Sallufte. Horace favoit fans doute quelle eftime
les Romains faifoient de la chajfe. Il dit dans VE pitre
xviij du premier livre, « que la chajfe eft un exercice
>> de tout terni en ufage chez les Romains, qu’elle
» contribue à la fanté 8c même à la réputation. Les
» Romains l’aiment, aimez-la, vous fur-tout qui
» êtes plein de vigueur , bon cavalier 8c capable de
» paffer les plus vîtes chiens à la eourfe 8c venir à
» bout des plus vigoureux fangliers » :
Romanis folemne vins opus, utile James
Vitceque & membres... 8cc.
C ’eft à Lollius qu’Horace recommande la chajfe ,
8c Lollius n’étoit point un efclave. Ce n’eft point
d’un efclave dont parle encore Horace dans VOde
premiers du preniier livre :
. . . . Manet fub Jove frigido
Venator tenercs conjugis immemor ,
S eu v if a eji catulis cerva fidelibus ,
S eu riipit teretes Marfus aper plagas.
Les empereurs Romains qui. vécurent après Sallufte
8c Horace , n’étoient point des efclaves, 8c ils
jugoient que la chajfe étoit un exercice noble & glorieux,.
Voici ce qu’en dit Pline dans le Panégyrique
de Trajan: « C’étoit,autrefois le premier exercice,
» le plus doux plaifir de la jeuneffe, de pourfuivre
» à la eourfe les bêtes fugitives, de vaincre par la
»'force les plus courageufes., de furprendre par
» adrefle les plfts rufées, 8c on ne remportoit pas
» peu de gloire pendant la paix quand on favoit éloi-
» ner dès campagnes les bêtes féroces, 8c mettre les
» laboureurs à couvert de leur irruption. Ceux
» mêmes d’entre les princes qui pouvoient le moins
» prétendre à cetteforte d’honneur, ont voulu fe
» l’attribuer. Ils faifoient renfermer des bêtes fam-
. » ves , 8c après qu’une partie de leur férocité avoit
» été domptée, on les lâchoit 8c on fe moquoit de
» ces empereurs qui tir oient- vanité d’une fauffe
» adrefle quand ils les avoient tuées; Trajan joint
» la peine de les chercher à celle de les prendre , 8c
» le plus grand, le plus agréable plaifir «pour lui,
» c’eft de les trouver ». L ’empereur Trajan n’étoit,
certainement pas un efclave. Lettres fur l'Encyclopédie.
% CHATAIGNER , ( Botaniq. ) en Latin , cafta-
nea;en Angfois, chefnut-tree y en Allemand* cajlanienbaum.
Caractère générique
Le même arbre porte desTleurs mâles & des fleurs
femelles, tantôt plus, tantôt moins éloignées en-
tr’elles. Les fleurs mâles font grouppées fur un filet
commun, 8c forment par leur réunion -une forte de
chaton : elles font à pétales, 8c contiennent environ '
dix ou douze étqmines pointues. Les fleurs femelles
ont un calice d’une feulp piece, découpé en quatre
parties , & font privées des pétales; Au fond de ce
calice eft fixé un embryon furmonté d’un piftil di-
vifé entrois ftyles par le haut. Cet embryon devient
une maffe fphérique hériffée qui contient un ou plu-,
fleurs fruits, reebuverts d’une enveloppe coriacée.
Efpeces.
i . Châtaignier à feuilles en lance, à dentelures
aiguës , unies par-deflous. Châtaignier commun.
Cajtaneafoliis lanceolatis, acuminatoferratis,fubtîts
nudis. Mill.
The mànured chefnut.
z. Châtaignier à feuilles ovales en lance, à dentelures
aiguës, velues par-deflbus, 8c à chatons minces
8c noueux.
Cajtanea foliis lanceolato-ovatis , deutè ferratis,
fubtùs tomentojis, arnentis filiformibus nodojis. Mill.
Chefnut with woolly leaves, &C.
3. Châtaignier à feuilles ovales, oblongues, à très-
gros fruit rond 8c épineux.
Cajtanea foliis oblongo , ovatis, ferratis, fructu ro-
tundo maximo echinato. Mill.
Sloanea o f Plumier.
Nous n’avons que très-peu de chofes à ajouter au
grand 8c bel drtiçle C h â ta ig n ier du Dictionnaire
raif. des Sciences, &c. mais nos obfervations ne peuvent
qu’être intéreflantes, fl elles contribuent au perfectionnement
de la culture d’un arbre aufîi utile.
i° . Lorfqu’on veuf élever des châtaigniers en pépinière
, il faut ftratifier les châtaignes pendant l’hiver
dans de longues caifles plates , ; emplies de fablç
frais. Si cette opération fe fait èn décembre, les châtaignes
feront germées pour le mois de mars ; fi l’on
attend au commencement de janvier, elles le feront
pour les premiers jours d’avril ; enfin fi l’on différé
jufqu’au mois de février, leur germe fera développé
pour le mois de mai. Ce dernier parti eft le plus fiir
dans les pays fujets aux gelées printanières : on peut
au refte retarder ou hâter leur germination félon le
befoin, en leur donnant plus ou moins d’humidité,
fuivant l’état oii on les trouve quand on les vifite , 8c
il faut les vifiter fouvent.
Je fuppofe ici le choix de la terre fait, & je me
contente de dire qu’elle ne doit être ni glaifeufe, ni
rouge 8c comp are, ni trop.mêlée d’un labié fec ; je
fuppofe aufli la pépinière effondrée, nettoyée 8c
préparée : on apporte les caifles fur le terrein,,alors
on tire l’une après l’autre les châtaignes germées , on
çaffe le petit bout de la radicule, 8c on les plante
contre de petits bâtons, à trois ou quatre pouces de
profondeur, dans des lignes diftantes de deux pieds
& demi, 8c à deux pieds les unes des autres dans le
fens des rangées.
Cette opération faite , on rejette la terre par-
defîiis., mais ayant foin*de laiffer une petite cavité
pour y arrêter l’humidité, en recouvrant toutefois
exactement les châtaignes ; une feule qui fe mon-
treroif, ou même les mau^aifes qu’qn a rebuteè?,-
fl l’on négligeoit de les enlever j amepteroienr tous
les mulots du canton.; Ces châtaignes ainfi châtrées §C
plantées, donneront au bout de fix a fep.t ans
moyennant ;une culture convenable, des fujets d,e
fept ou huit pieds de haut., pourvus d’un bel empâtement
de- racines, 8c faciles à la reprife : ç’eft ce
dont j’ai une expérience fuffifante.
a°. Il ne faut jamais couper la fléché, des d hâ tii-
gniers en les trahfpïantant, mais Qfi peut rapprocher
le s principales branches latérale»,àçmq ou fix pouces
du trône, un peu au-deflus d’un bouton. Le mieux
eft d’élaguer en juin ceux qu’on fe propofe de tranf-
planter en automne ; les blefliires feront alors bien
recouvertes ; car ces arbres plein de feve font vite
des bourlets, 8c comme ils n’auront que quelques
menues branches, 8c rien à fouffrir de la ferpette ,
ils reprendront mieux 8c feront plus de progrès.
30. Les marronniers ne font que des variétés du
châtaignier provenues de graine , feulement perpétuées
, peut-être un peu perfectionnées par la greffe,
mais non pas dues entièrement à cette opération,
comme quelques autèurs i’ont avancé. Voye{ à cet
égard Varticle Arbre de ce Supplément. Ces marronniers
ont eux-mêmes plufieurs variétés , 8c il n en
eft peut-être pas' une qui n’ait un mérite particulier ;
c ’eft, pourquoi nous invitbns les cultivateurs à s’at- •
tacher à les connoître. Lorfque j’étois en Valteline,
on m'a dit qu’on ne pou voit ÿ cultiver le gros marron
fphérique , parce que la fleur en eft trop .tardive ,
pour que je fruit ait le tems d’y mûrir; c’eft cependant
un climat approchant de celui du Languedoc.
Il fe trouve dans le Limoufin un marron fort eftimé ,
qu’on y appelle noujjillat} il eft un peu alongé 8c
n’eft pas anguleux : le plus gros de tous les marrons
fe défigne fous le nom de marron de Lyon, quoiqu’il
ne vienne pas du Lyônnois. -
Pour fe procurer ces variétés, il faut en faire venir
des branches en h iver,,en recommandant qu’on
les enveloppe dans de la moufle 8c qu’bn les enferme
dans une bourriche. D ’abord qu’elles font arrivées ,
on doit les planter à un pouce de profondeur contre
un mur exppfé au nord ; à la fin d’a v r il, ou au commencement
de mai, on en tirera des lcion's pour les
enterrer fort bas fur des châtaigniers de deux ou trois
pouces de tour: on aflure les entes avec un enduit
de terre grafle, mêlée de bouze de vache, dont on
forme une poupée recouverte d’étoupe ; malgré
cette attention , il s’en faut bien qu’elles reprennent
toutes : ainfi il faut en faire un grand nombre pour
en voir réuflir quelques-unes ; celles-ci fuffiront
pour en tirer des écuflbns : op les fait à. la pouffe,
c’eft-à-^ire au printems; mais je fuis aufli parvenu
à en faire ireDr-endre en <jeij dormant pendant l’été ,
moyennaritfès précautions fuivantes.
' Choififlez les fujets qui pouflent le moins ; faififfez
le tems que la feve fe rallentit, c?eft-à-dire.,;laifin de
juillet ; prenez de préférença vos écuflbns au b.out
des branches qui font anguleules : levez-les .de forcé
avec de la foie ; faites la fent-e une fois plus longue
qu’il ne faut, pour écouler le futabondant de la fève,
8c fur vingt de ces écuflbns, vous pourrez vous-promettre
la réuflite de deux ou trois au moins. '
Le châtaignier n° gz-, peut fe multiplier par la
greffe, ainfi que la variété à feuille panachée qui eft
très# "agréable.
Le chincapin qui eft un châtaignier nain , fe reproduit
par fon fruit ; ce fruit n’eft pas plus gros qu’une
noifette ; 8c lorfqu’on le reçoit d’Angleterre , oh il
eft venu d’Amériqu,e, il a ordinairement;, perdu fa
fécondité. Pour éviter cesinconvéniens , il faut recommander
upe prompte-expédition 8c beaucoup de
précaution dans le tranfport.; ( Af.. le Baron DS
Ts ch o u d i . )
CHATEAU , f. tn. f terme de Blafori. ) meuble de
l’écu , qui repréfente la demeure des, anciens ; il eft
formé d’un côrps-de-logis joint à deux tours , avec
des créneaux qui cachent ,lç -.tpit.
On dit d’un château r ouvert', pour la porte^'herfé,
s’il y à une he-r-fe farrafine 4 -.éeS- fenêtres;-
maçon/U^des joints de pierres, quand ils font d’émaux
différens- .
Si un château a un to i t , il eft dit effort; s’il y à
des girouettes, girouette.
Attenol de Gourdon en Dauphiné ; de gueules au
château à trois tours d'or ; au chef coufu d'atfur, chargé
d’un croijfant d’argent, accoté de deux rofes de même.
( G.D. L. T. )
§ Chateau G aillard , près d’Andely, (Géogr.
Hiji. ) Philippe-Augufte commença en 1'104, la conquête
de Normandie parle fiege de Château-Gaillard
fortereffe alors réputée imprenable : il s’en rendit
maître par furprife , après fix mois de fiege. Roger-
Lacy , qui y commandoit pour le roi d’Angleterre ,
voyant qu’il ne pou voit réfifter aux troupes du ro i,
fortit à la tête de zoo hommes , refte d’une garnifon
nombreufe , réfolu de périr les armes à la main. Le
roi de Fi ance voulut qu’od épargnât ces braves gens,
contre l’avis de plufieurs feigneura qui opirioient à
ce qu’on- exterminât cette troupe. Il les traita aVec
beaucoup d’humanité 8c témoigna au commandant
toute l’ eftime que lui infpiroit une fi belle défenfe
Chateau-Saint-Ange, (Géogr.)fort de la ville
de Rome, il fût fait par l’empereur Adrien, pour lui
fervir de tombeau , en bppofitioh avec celui d’Au-
gufte qui étoit de l’autre côté du Tibre , toifes
plus haut: & comme celui d’Augufte çtbit près du
grand champ dè Mars, Adrien fit le lien Vis-ci-vis du
petit champ de Mars, qu’il joignit par fin pont. Ce
monument avoit, comme celui d’Augufte, la forme
d’un quarjé , au milieu duquel s’élevoit une tour
ronde, toute iricrùftée de marbre de Paros, couronnée
par des.ftatues, des chars , des chevaux , 8c la
pomme de pin en bronze qui eft au Vatican. Il étoit
entouré d’une colonnade , dont on croit que les colonnes
furent tranfportées à S. Paul dès le tems de
Conftantin. On montoit intérieurement jufqu’au
haut par unè pente douce en fpirale, où les voitures
pouvoient aller.; ce qui en refte occupe un quart de
la tour par en bas les murs font de pierre pépé-
rine noire & porfeufe.
Lorfque l'empereur- Aurélieh eut renfermé lé
champ de Mars dans l’enceinte des murs , le maufo-
lée d’Adrien s ’en trouva fi voifin , qu’il devint naturellement
une efpece dé citadelle vers le tems
de l’em.péreur Honoriiis, bii du moins fous Béli-
faire. 11 étoit affez propre à cet ufage , car les murs
font doubles, conftruits avec la pierre gépérihe, &
le maffif dè la tour ^ ou l’entre-deux deis murs , rempli
de mortier ôtede briques jettées:aii hafard fans
aucun.arrangement, mais fi épais.qu’à péine y a-t-
on ménagé la place de l’efcalier. Dans la guerre
des Goths , les.Rohaains s’y défendirent fouvent, 8c
les Goths prirènt plufieurs fois ce château i l’on bri-
foitles ftatues pour en jetter les morceaux fur l’armée
des afliégeanS4'& toiit ce bel ouvrage fut dé^
gradé; Les exarqueà de Rayerine, 8c d’aiitres en-
fuite , l’occuperent lucceflivement, 8c continuèrent
de le ruiner. „
S. Grégoire pape, dans les écrità duquel ori trouve
beaucoup de vifions'& de miracles, ràconta qu’il
avoit, vu-pendant la pefté de '593 , fur lé haut de
cette fortereffe , un ange qui remettoit l ’épée dans
le fourreau, dès-lors ce pape annonça que la fin de la
contagion étoit proche. En mémoire dé cet heureux
événémënt, la tour fut nommée château-Sdint-Ange ,
& l?on y plaça dans la fuite une ftatue d’ange, pour
lui fervir de couromrement. Il y eut d’abord une ftatue
dé marbre faite par Raphaël de Monte-Lupo ,
qui eft fur l’entablement intérieur; mais on lui en a
fubftitûéi. une de bronze fdridtiè par Giârdqni , d’après
le modèle de Pierre Verchâfféh, fcùlpteur AU
lémand. ^
Lechâteàü-Sairtt-Ange fat aufli appèlié Rocca-dt
Cnfctnfo, parce qu’il y eut en 985 un Créfcèntius