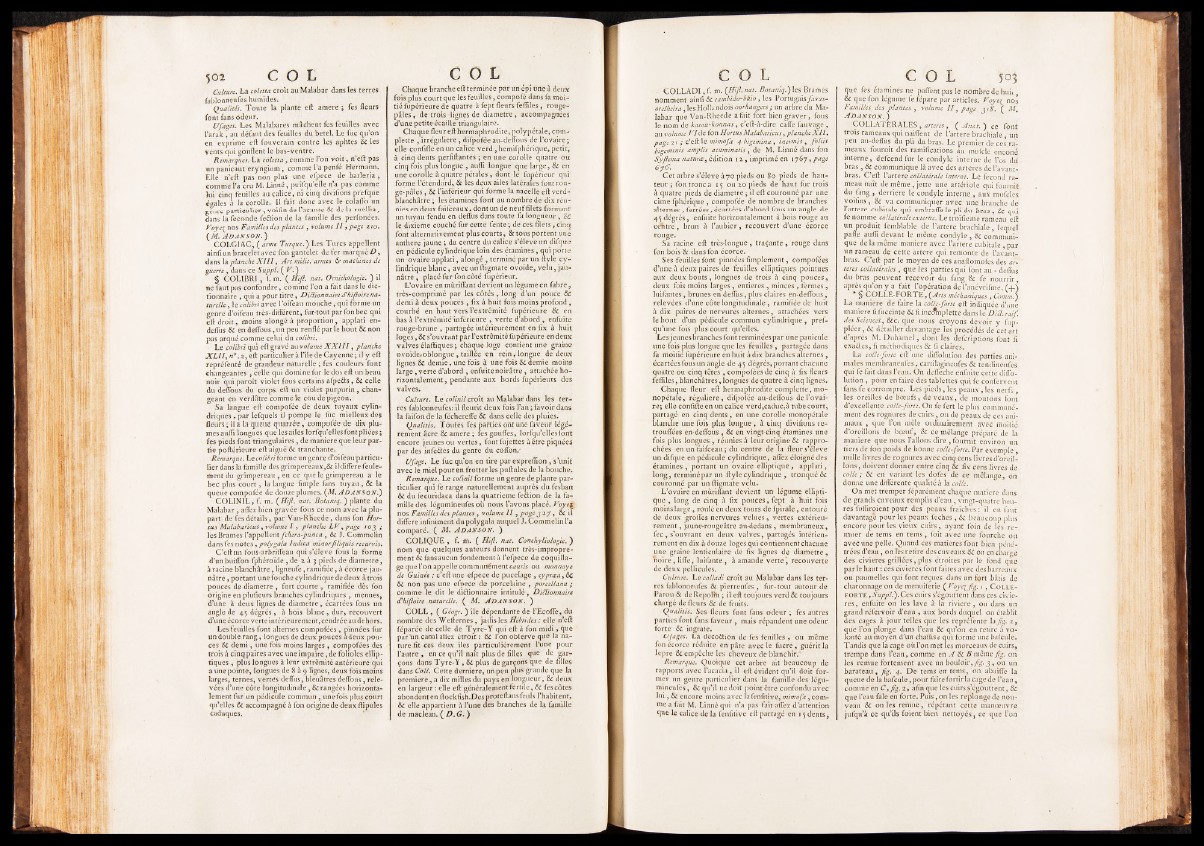
Culture. La coktta croît au Malabar dans les terres
fablonneufes humides. '
Qualités. Toute la plante eft amere ; fes fleurs
font fans odeur.
Ufages. Les Malabares mâchent fes feuilles avec
l’aralc , au défaut des feuilles du betel. Le fuc qu’on
en exprime eft fouverain contre les aphtes 6c les
vents qui gonflent le bas-Ventre.
Remarques. La coletta, comme l’on v o it , n’eft pas
un panicaut eryngium, comme l’a penfe Hermann.
Elle n’eft pas non plus une efpece de barleria ;
comme l’a cru M. Linné, puifqu’elle n a pas comme
lui cinq feuilles au calice, ni cinq divifions prefque
égales à la corolle. 11 fait donc avec le colaflo un
genre particulier, voiftn de l’acànte 6c de la ruellia,
dans la fécondé feftion de la famille des perfonées.
Foye{ nos Familles des plantes , volume I I , page 2 io.
(Af. A d a n s o n .)
COLGIAC, ( arme Turque.) Les Turcs appellent
ainfi un bracelet avec fon gantelet de fer marqué/?,
dans la planche X I I I , Art tnilit:armes & machines de
guerre , dans ce Suppl. ( F .)
§ COLIBRI , f. m. ( Hifl. nat. Ornithologie. ) il
ne faut pas confondre, comme l’on a fait dans le dictionnaire
, qui a pour titre , Dictionnaire d’hifioire naturelle
, le colibri avec l’oifeau mouche, qui forme un
genre d’oifeau très-différent, fur-tout par fon bec qui
eft droit, moins alongé à proportion, applati en-
deffus 6c en deffous, un peu renflé parle bout 6c non
pas arqué comme celui du colibri.
Le colibri qui eft gravé au volume X X I I I , planche
X L I I , n°. 2, eft particulier à Hle de Cayenne ; il y eft
représenté de grandeur naturelle ; fes couleurs font
changeantes , celle qui domine fur le dos eft un beau
noir qui paroît violet fous certains afpeâs , 6c celle
du deffous du corps eft un violet purpurin, changeant
en verdâtre comme le cou de pigeon.
Sa langue eft compofée de deux tuyaux cylindriques
, par lefquels il pompe le fuc mielleux des
fleurs ; il a la queue quarrée , compofée de dix plumes
aufli longues que les ailes lorfqu’ellesfontpliées ;
fes pieds font triangulaires, de maniéré que leur partie
poftérieure eft aiguë & tranchante.
Remarque. Le colibri forme un genre d’oifeauparticu-
lier dans la famille des grimpereaux,& il différé feulement
du grimpereau , en ce que le grimpereau a le
bec plus court, la langue fxmple fans tuyau , & la
queue compofée de douze plumes. (M. A d a n s o n .)
COLINIL, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) plante du
Malabar , affez bien gravée fous ce nom avec la plupart
de fes détails, par Van-RHeede, dans fon Hor-
tus Malabaricus , volume I , planche L F , page io$ ;
les Brames l’appellent fchera-punca , 6c J. Commelin
dans fes notes, polygala Indien minorjiliquis recurvis.
C ’eftun fous-arbriffeau qui s’élève fous la forme
d’un buiffon fpnéroïde , de i à 3 pieds de diamètre,
à racine blanchâtre, ligneufe, ramifiée, à écorce jaunâtre
, portant une fouche cylindrique de deux à trois
pouces de diamètre , fort courte , ramifiée dès fon
Origine en plufieurs branches cylindriques , menues,
d’une à deux lignes de diamètre, écartées fous un
angle de 45 dégrés , à bois blanc, dur, recouvert
d’une écorce verte intérieurement,cendrée au dehprs.
Les feuilles font alternes compofées , pinnées fur
un double rang, longues de deux pouces à deux pouces
6c demi, une fois moins larges, compofées des
trois à cinq paires avec une impaire, de folioles elliptiques
, plus longues à leur extrémité antérieure qui
a une pointe, longues de 8 à 9 lignes, deux fois moins
larges, ternes, vertes deffus, bleuâtres deffous, relevées
d’une côte longitudinale,6c rangées horizontalement
fur un pédicule commun , unefois plus court
qu’elles 6c accompagné à fon origine de deuxftipules
caduques.
Chaque branche eft terminée par un épi une à deux
fois plus court que les feuilles, compofé dans fa moi-<
tié fupérieure de quatre à fept fleurs feflîles, rouge-
pâles, de trois lignes de diamètre, accompagnées
d’une petite écaille triangulaire.
Chaque fleur eft hermaphrodite, poly pétale, corn-
plette , irrégulière, difpofée au-deffous de l’ovaire;
elle confifte en un calice v erd , hemifphérique, petit,
à cinq dents nerfiftantes ; en une corolle quatre ou
cinq fois plus longue , aufli longue que large, 6c en
une corolle à quatre pétales , dont le fupérieur qui
forme l’étendard, & les deux ailes latérales font rouge
pâles , 6c l’inférieur qui forme la nacelle eft verd-
blanchâtre ; les étamines font au nombre de dix réunies
en deux faifeeaux, dont un de neuf filets formant
un tuyau fendu en deffus dans toute fa longueur, 6c
le dixième couché fur cette fente; de ce's filets, cinq
font alternativement plus courts, & tous portent une
anthère jaune ; du centre du calice s’élève un difque-
en pédicule cylindrique loin des étamines, qui porte
un ovaire applati, alongé , terminé par un ftyle cy lindrique
b lanc, avec un ftigmate ovoïde, v elu, jaunâtre
, placé fur fon côté fupérieur.
L’ovaire en mûriffant devient un légume en fabre,
très-comprimé par les côtés , long d ’un pouce 6c
demi à deux pouces , fix à huit fois moins profond ,
courbé en haut vers l’extrémité fupérieure 6c en
bas à l’extrêmité'infërieure , verte d’abord , enfuite
rouge-brune , partagée intérieurement en fix à huit
loges, 6c s’ouvrant par l’extrémité fupérieure en deux
valves élaftiques ; chaque loge contient une graine
o voïde^oblongue , taillée en rein y longue de deux
lignes 6c demie, une fois à une fois 6c demie moins
large, verte d’abord , enfuite noirâtre, attachée horizontalement,
pendante aux bords fupérieurs des
valves.
Culture. Le colinil croît au Malabar dans les terres
fablonneufes: U fleurit deux fois l’an ; favoir dans
la faifon de la féchereffe 6c dans celle des pluies.'
Qualités. Toutes fes parties ont une faveur légèrement
âcre 6c amere ; fes goufles, lorfqu’ellesforit
encore jeunes ou vertes, font fujettes à être piquées
par des infeftès du genre du coffon/
Ufage. Le fuc qu’on en tire par expreflion , s ’unit
avec le miel pour en frotter les pullules de la bouche.
Remarque. Le colinil forme un genre de plante particulier
qui fe range naturellement auprès du fesban
6c du fecuridaca dans la quatrième feélion de la famille
des Içgumineufes où nous l’avons placé. Foye\
nos Familles des plantes, volume I I , page 3 2 7 , 6c il
différé infiniment du polygala auquel J.Commelinl’a
comparé. ( M. A d a n s o n . )
COLIQUE , f. m. ( Hiß. nat. Conchyliologie. )
nom que quelques auteurs donnent très-improprement
& fans aucun fondement à l’efpece de coquillage
que l’on appelle communément cauris ou monnoye
de Guinée : c’ eft une efpece de pucelage , cypraa, 6c
6c non pas une efpece de porcelaine , porcellana ;
comme le dit le diélionnaire intitulé, Dictionnaire
d'hißoire naturelle. ( M. A DAN SON. )
COLL , ( Géogr. ) île dépendante de l’Ecofle, du
nombre des Wefternes, jadis les Hébrides : elle n’eft
féparée de celle de T y re -Y qui eft à fon midi, que
par\in canal affez étroit : 6c l’on obferve que la nature
fit ces deux îles particuliérement l’une pour
l’autre , en ce qu’il naît plus de filles que de garçons
dans T y re -Y , 6c plus de garçons que de filles
dans Coll. Cette derniere, un peu plus grande que la
première, a dix milles du pays en longueur, 6c deux
en largeur : elle eft généralement fertile, 6c fescôtes
abondent en ftockfish.Desproteftansfeuls l’habitent,
6c elle appartient à l’une des branches de la famille
de maclean. ( D. G. )
- CO L LAD I, f. m. (Hi(t. nat. Botaniq.) les Brames
nomment ainfi 6c tambido-bhio, les Portugais fiivas-
orelheira, les Hollandois oorhangers ; un arbre du Malabar
que Van-Rheede a fait fort bien graver, fous
le nom de katou-konnas, c’eft-à-dire caffe fauvage ',
au volume FIde fon Hortus Malabaricus, planche X I I .
page 21 ; c’eft le mimofa 4 bigernina, inermis, foliis
bigeminis amplis acuminatis, de M. Linné dans fon
Syjtema natures, édition 1 2 , imprimé en 1767, page
6y6.
Cet arbre s’élève à 70 pieds ou 80 pieds de hauteur
; fon tronc a 15 ou 20 pieds de haut fur trois
à quatre pieds de diamètre ; il eft couronné par une
cime fpherique , compofée de nombre de branches
alternes , ferrées, écartées d’abord fous un angle de
45 dégrés, enfuite horizontalement à bois rouge au
cehtre., brun à l’aubier, recouvert d’une écorce
rouge.
Sa racine eft très-longue , traçante , rouge dans
fon bois & dans fon écorce.
Ses feuilles font pinnées Amplement, compofées
d’une à' deux paires de feuilles elliptiques pointues
aux deux bouts, longues de trois à cinq pouces,
deux fois moins larges, entières , minces , fermes ,
luifantes, brunes en-deffus, plus claires en-deffous,
relevées d’une côte longitudinale, ramifiée de huit
à dix paires de nervures alternes, attachées vers
le bout d’un pédicule commun cylindrique , pref-
qu’une fois plus court qu’elles.
Les jeunes branches font terminées par une panicule
une fois plus longue que les feuilles , partagée dans
fa moitié fupérieure en huit à dix branches alternes ,
écartées fous un angle de 45 dégrés, portant chacune
quatre ou cinq têtes , compofées de cinq à fix fleurs
feflilesy blanchâtres, longues de quatre à cinq lignes.
Chaque fleur eft hermaphrodite complette, monopétale,
régulière, difpofée au-deffous de l’ovaire;
elle confifte en un calice verd,caduc,à tube court,
partagé en cinq dents, en une corolle monopétale
blanche une fois plus longue, à cinq divifions re-
trouffées en-deffous , & en vingt-cinq étamines une
fois plus longues, réunies à leur origine 6c rapprochées
en un faifeeau ; du centre de la fleur s’élève
un difque en pédicule cylindrique, affez éloigné des
étamines , portant un ovaire elliptique > applati,
long, terminé par un ftyle cylindrique , tronqué 6c
couronné par un ftigmate velu.
L’ovaire en mûriffant devient un légume elliptique
, long de cinq à fix pouces, fept à huit fois
moins large, roulé en deux tours de fpirale, entouré
de deux groffes nervures velues, vertes extérieurement
, jaune-rougeâtre au-dedans , membraneux,
fe c , s’ouvrant en deux valves, partagés intérieurement
en dix à douze loges qui contiennent chacune
une graine lenticulaire de fix lignes de diamètre,
noire, liffe, luifante, à amande verte j recouverte
de deux pellicules.
Culture. Le colladi croît au Malabar dans les terres
fablonneufes & pierreufes , fur-tout autour de
Parou & de Repolîh ; il eft toujours verd 6c toujours
chargé de fleurs 6c de fruits.
Qualités. Ses fleurs font fans odeur ; fes autres
parties font fans faveur , mais répandent une odeur
forte 6c ingrate.
Ufages. La décoftion de fes feuilles , ou même
fon écorce réduite en pâte avec le fucre, guérit la
lepre 6c empêche les cheveux de blanchir.*
Remarque. Quoique cet arbre ait beaucoup de
rapports avec l’acacia, il eft évident qu’il doit former
un genre particulier dans la famille des légu-
mineufes, 6c qu’il ne doit point être confondu avec
lu i, 6c encore moins avec lafenfitive, mimofa, comme
a fait M. Linné qui n’a pas fait affez d’attention
que le calice de la fenfitive eft partagé en 15 dents,
que fes étamines ne paffent pas le nombre de huit,
6c que fon légume fe fépare par articles. Foye^ nos
Familles des plantes r volume I I , page 31#. ( M.
A d a n s o n . )
c o l l a t é r a l e s , artères, ^ a nat. ) ce font
trois rameaux qui naiffent de l’artere brachiale , un
peu au-deffus du pli du bras. Le premier de ces rameaux
fournit des ramifications au mufcle enconé
interne, defcendfur le condyle interne de l’os dû
bras , 6c communique là avec des arteres de l’avant-
bras. C ’eft 1’ artere collatérale interne. Le fécond rameau
naît de même, jette une artériole qui fournit
du lang , derrière le condyle interne , aux mufcles
voifins, 6c va communiquer avec une branche de
l’artere cubitale qui embraffe le pli du bras , 6c qui
fe nomme collatérale externe. Le troifieme rameau eft
un produit femblable de l’artere brachiale, lequel
paffe aufli devant le meme condyle , 6c communique
de la même maniéré avec l’artere cubitale , par
un rameau de cette artere qui remonte de l’avant-
bras. C’eft pat le moyen de ces anaftomofes des an.
teres collatérales , que les parties qui font au - deffus
du bras peuvent recevoir du fang 6c fe nourrir,
après qu’on y a fait l’opération de l’anévrifme. (+')
* § COLLE-FORTE, {Arts méchaniques , Comm.)
La maniéré de faire la colle-forte eft indiquée d’une
maniéré fi fuccinte 6c fi incdmplette dans le Dict. raif.
des SciençeS, 6cc. que nous croyons devoir y fup-
pléer, 6c détailler davantage les procédés de cet art
d’après M. Duhamel, dont les deferiptions font fi
Cxattes, fi méthodiques 6c fi claires.
La colle-forte eft une diffolution des parties ani*
males membraneufes, cartilagineufes 6c tendineufes
qui fe fait dans l’eau. On deffeche enfuite cette diffolution
, pour en faire des tablettes qui fe confervent
fans fe corrompre. Les pieds, les peaux, les nerfs ,
les oreilles de boeufs, dé veaux, de moutons font
d’excellente colle-forte. On fe fert le plus communément
des rognures de cuirs, ou de peaux de ces animaux
, que l’on mêle ordinairement avec moitié
d’oreillons de boeuf, 6c ce mélange préparé de la
maniéré que nous l’allons dire , fournit environ un
tiers de fon poids de bonne colle-fortes Par exemple
mille livres de rognures avec cinq cens livres d’oreillons,
doivent donner entre cinq & fix cens livres de
colle; 6c en variant les dofes de ce mélange, on
donne une différente qualité à la colle.
On met tremper féparément chaque matière dans
de grands cuveaux remplis d’eau , vingt-quatre heures
luffiroient pour des peaux fraîches : il en faut
davantagl pour les peaux feches , 6c beaucoup plus
encore pour les vieux cuirs, ayant foin de les remuer
de téms en tems, foit avec une fourche ou
avec une pelle. Quand ces matières font bien pénétrées
d’eau, on les retire des cuveaux 61 on en charge
des civières grillées, plus étroites par le fond que
par le haut : ces civières font faites avec des barreaux
ou paumelles qui font reçues dans un fort bâtis de
charonnage ou de menuiferie ( Foye^fig. 1 , C olle-
forte , Suppl.). Ces cuirs s’égouttent dans ces civières
, enfuite on les lave à la riviere, ou dans un
grand réfervoir d’eau , aux bords duquel on établit
des cages à jour telles que les repréfente la fig. 2 ,
que l’on plonge dans l’eau 6c qu’on en retire à volonté
au moyen d’un chaflis e qui forme une bafcule»
Tandis que laçage où l’on met les morceaux de cuirs,
trempe dans l’eau, comme en A 6c B même fig. on
les remue fortement avec un bou!oir,j%. 3 , ou un
barateau, fig. 4. De tems en-tems, on abaiffe la
queue de la bafcule, pour faire fortir la cage de l’eau,
comme en C,fig. 2» afin que les cuirs s’égouttent, 6c
que l’eau fale en forte. Puis, on les replonge de nouveau
6c on les remue, répétant cette manoeuvre
jufqu’à ce qu’ils foient bien nettoyés, ce que l’on