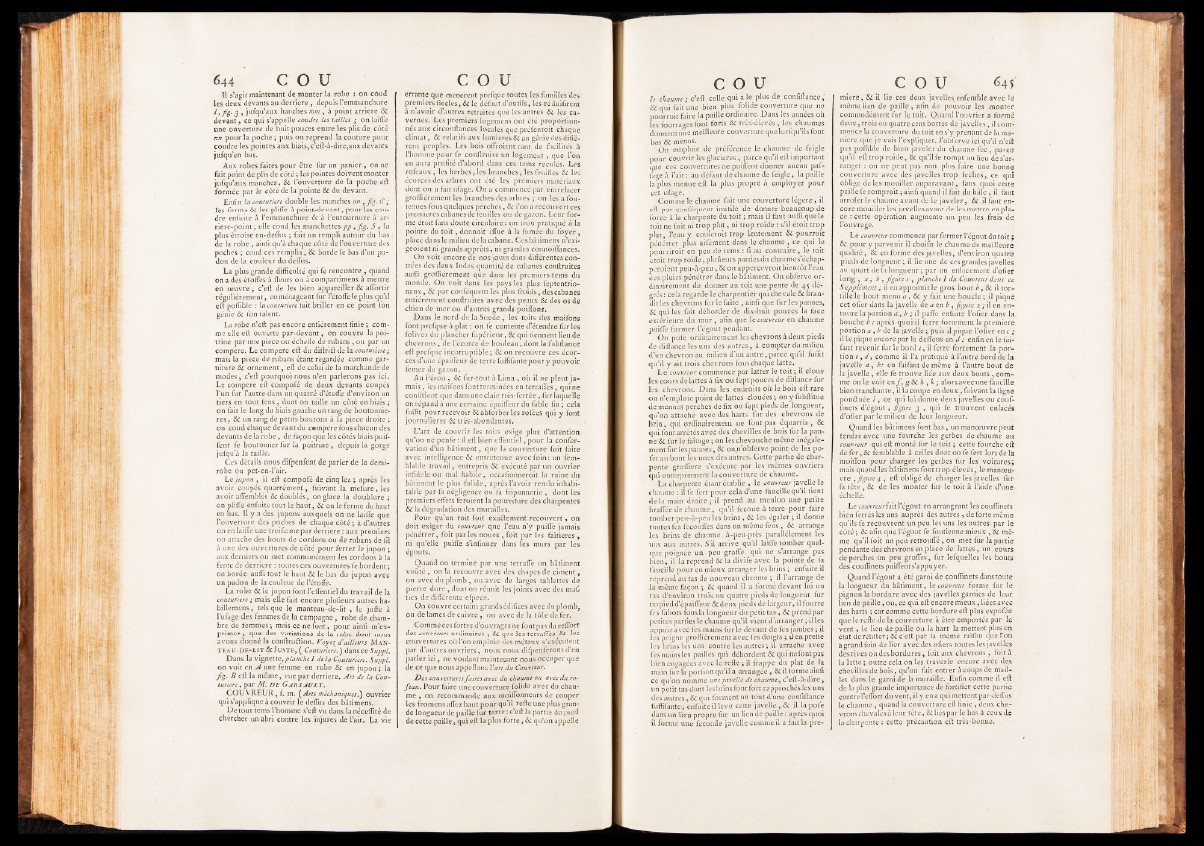
Il s’agît maintenant de monter la robe t on côud
les deux devants au derrière , depuis l’emmanchure
l t fig. 3 , jufqu’aux hanches mm, à point arriéré &
devant , ce qui s’appelle coudre les tailles ; on laine
une ouverture de huit pouces entre les plis de côté,
nn pour la poche ; puis on reprend la couture pour
coudre les pointes aux biais, c’eft-à-dire,aux devants
jufqu’en bas.
Aux robes faites pour être fur un panier, on ne
fait point de plis de côté ; les pointes doivent monter
jufqu’aux manches, & l’ouverture de la poche eft
formée par le côté de la pointe & du devant.
Enfin la couturière double les manches oo,fig. C';
lès forme les pliffe à point-devant, pour les coudre
enfuite à l’emmanchure & à l’entournure à ar-
riere-point ; elle coud les manchettes p p , fig. 5 , la
plus étroite en-deffus ; fait un rempli autour du bas !
de la robe , ainfi qu’à chaque côté de l’ouverture des
poches ; coud ces remplis, & borde le bas d’un padou
de la couleur du deffus.
La plus grande difficulté qui fe rencontre , quand
on a des étoffes à fleurs ou à compartimens à mettre
en oeuvre, c’eft de les bien appareiller & affortir
régulièrement, en ménageant fur l’étoffe le plus qu’il
eft poffible : la couturière fait briller en ce point fon
génie & fon talent.
La robe n’ eft pas encore entièrement finie ; comme
elle eft ouverte par-devant, on couvre la poitrine
par une piece ou échelle de rubans , ou par un
compere. Le compere eft du diftri&de la couturière;
mais la piece de rubans étant regardée comme garniture
& ornement, eft de celui de la marchande de
modes, c’eft pourquoi nous n’en parlerons pas ici.
Le compere eft compofé de deux devants coupés
l ’un fur l’autre dans un quarré d’étoffe d’environ un
tiers en tout fens, dont on taille un côté en biais ;
on fait le long du biais gauche un rang de boutonnières,
& un rang de petits boutons à la piece droite ;
on coud chaque devant du cempere fous chacun des
devants de la robe, de façon que les côtés biais puif-
fent fe boutonner fur la poitrine, depuis la gorge
jufqu’à la taille.
Ces détails nous difpenfent de parler de la demi-
robe ou pet-en-l’air.
Le jupon , il eft compofé de cinq lez ; après les
avoir coupés quarrément, fuivant la mefure, les
avoir affemblés & doublés, on glace la doublure ;
on pliffe enfuite tout le haut, & on le ferme du haut
en bas. Il y a des jupons auxquels on ne laiffe que
l’ouverture des poches de chaque côté ; à d’autres
on en laiffe une troifieme par derrière : aux premiers
on attache des bouts de cordons ou de rubans de fil
à une des ouvertures de côté pour ferrer le jupon ;
aux derniers on met communément les cordons à la
fente de derrière : toutes ces ouvertures fe bordent;
on borde auffi tout le haut & le bas du jupon ave,c
un padou de la couleur de l’étoffe.
La robe & le jupon font l’effentiel du travail de la
couturière ; mais elle fait encore plufieurs autres ha-
billemens, tels que le manteau-de-lit , le jufte à
l’ufage des femmes de la campagne, robe de chambre
de femmes ; mais ce ne font, pour ainfi m’exprimer
, que des variations de la robe dont nous
avons donné la conftruftion. Voye^ d'ailleurs Man-
TEaU-DE-LIT & JUSTE, ( Couturière. ) dans ce Suppl.
Dans la vignette,planche 1 delà Couturière. Suppl.
on voit en A une femme en robe & en jupon ; la
fig. B eft la même, vue par derrière. Art de la Couturière
, par M. d e Ga r s au lt .
COUVREUR, f. m. (Arts méchaniquesi) ouvrier
qui s’applique à couvrir le deffus des bâtimens.
De tout tems l’homme s’eft vu dans la néceflité de
chercher un abri contre les injures de l’air. La vie
errante que menèrent prefque toutes les familles des
premiers fiecles, & le défaut d’outils, les réduifirenj
à n’avoir d’autres retraites que les antres &c les cavernes.
Les premiers logemens ont été proportionnés
aux circonftances locales que préfentoit chaque
climat, & relatifs aux lumières & au génie des diffé-
rens peuples. Les bois offroient tant de facilités à
l’homme pour fe conftruire un logement , que l’on
en aura profité d’abord dans ces te nas reculés. Les
rofeaux, les herbes , les branches , les feuilles & les
écorces des arbres ont été les premiers matériaux
dont on a fait ufage. On a commencé par entrelacer
groffiérement les branches des arbres ; on les a fou-
tenuesjfous quelques pérchés, & l’on a recouvert ces
premières cabanes de feuilles ou de gazon. Leur forme
étoit fans doute circulaire : un trou pratiqué à la
pointe du to it , donnoit iffue à la fumée du foy er ,
placé dans le milieu de la cabane. Ces bâtimens n’exi-
geoient ni grands apprêts, ni grandes connoiffances.
On voit encore de nos jours dans différentes contrées
des deux Indes quantité de cabanes conftruites
auffi groffiérement que dans les premiers tems du
monde. On voit dans les pays les plus feptentrio-
naux, & par conféquent les plus froids, des cabanes
entièrement conftruites avec des peaux & des os de
chien de mer ou d’autres grands poiffons.
Dans le nord de la Suede , les toits des maifons
font prefque à plat : on fe contente d’étendre fur les
folives du plancher fupérieur, & qui tiennent lieu de
chevrons, de l’écorce de bouleau, dont laiubftance
eft prefque incorruptible ; & o n recouvre ces écorces
d’une épaiffeur de terre fuffifante pour y pouvoir
femer du gazon.
Au Pérou , & fur-tout à Lima , oh il ne pleut jamais
, les maifons font terminées en terraffes, quine
confident que dans une claie très-ferrée , fur laquelle
on répand à une certaine épaiffeur du fable fin ; cela
fuffit pour recevoir &abforber les rofées qui y font
journalières & très-abondantes.
L’art de couvrir les toits exige plus d’attention
qu’on ne penfe : il eft bien effentiel, pour la confer-
vation d’un bâtiment, que la couverture foit faite
avec intelligence & entretenue avec foin : un fem-
blable travail, entrepris & exécuté par un ouvrier
infidèle ou mal habile, occafionneroit la ruine du
bâtiment le plus folide, après l’avoir rendu inhabitable
par fa négligence ou fa friponnerie , dont les
premiers effets feroient la pourriture des charpentes
& la dégradation des murailles.
Pour qu’un toit foit exa&ement recouvert, on
doit exiger du couvreur que l’eau n’y puiffe jamais
pénétrer, foit par les noues , foit par les faîtieres ,
ni qu’elle puiffe s’infinuer dans les murs par les
égouts.
Quand on termine par une terraffe un bâtiment
voûté, on la recouvre avec des chapes de ciment,
ou avec du plomb, ou avec de larges tablettes de
pierre dure , dont on réunit les joints avec des mafi
tics de différente efpece.
On couvre certains grands édifices avec du plomb,
ou de lames de cuivre, ou avec de la tôle de fer.
Comme ces fortes d’ouvrages ne font pas du reffort
des couvreurs ordinaires , & que les terraffes & les
couvertures oit l’on emploie des métaux s’exécutent
par d’autres ouvriers, nous nous difpenferons d’en
parler ic i, ne voulant maintenant nous occuper que
de ce que nous appelions Y art du Couvreur.
Des couvertures faites avec du chaume ou avec du ro-
feau. Pour faire une couverture folide avec du chaume
, on recommande aux moifl'onneurs de couper
les fromens affez haut pour qu’il refte une plus grande
longueurde paille fur terre : c’eft la partie du pied
de cette paille, qui eft la plus forte, & qu’on appelle
h chaume ; c’e'ft celle qui a le plus de confiftance ;
& qui fait une bien plus folide couverture que ne
pourroit faire la paille ordinaire. Dans les années oit
les fourrages font forts & très-élevés , les chaumes
donnent une meilleure couverture quelorfqu’ils font
bas & menus.
On emploie de préférence le chaume de feigle
pour couvrir les glacières , parce qu’il eft important
que ces couvertures ne puiffent donner aucun paf-
fage à l’air : au défaut de chaume de feigle, la paille
la plus menue eft la plus propre à employer pour
cet ufage.
Comme le chaume fait une couverture légère, il
eft par conféquent inutile de donner beaucoup de
force à la charpente du toit ; mais il faut auffi que le
toit ne foit ni trop plat, ni trop roide : s’il étoit- trop
plat, l’eau y couleroit trop lentement & pourroit
pénétrer plus aifément dans le chaume, ce qui le
pourriroit en peu de tems : fi au contraire, le toit
étoit trop roide, plufieurs parties du chaume s’échap-
peroient peu-'à-peu, & on appercevroit bientôt l’eau
des pluies pénétrer dans le bâtiment. On obferve ordinairement
de donner au toit une pente de 45 dé-
grés : cela regarde le charpentier qui chevale & brandit
les chevrons fur le faîte , ainfi que fur les pannes,
& qui les fait déborder de dix-huit pouces la face
extérieure du mur , afin que le couvreur en chaume
puiffe former l’égput pendant.
On pofe ordinairement les ehevrons.à deux pieds
de diftance les uns des autres , à compter du milieu
d’un chevron au milieu d’un autre, parce qu’il fuffit
qu’il y ait trois chevrons fous chaque latte.
L e couvreur commence par latter le toit ; il cloue
les cours de lattes à fix ou fept pouces de diftance fur
les chevrons. Dans les endroits où le bois eft rare
on n’emploie point de lattes clouées; on y fubftitue
de menues perches de fix ou fept pieds de longueur,
qu’on attache avec des harts fur des chevrons de
brin, qui ordinairement ne font pas equarris , &
qui font arrêtés avec des chevilles de bois fur la panne
& fur le faîtage ; on les chevauche même inégalement
fur les pannes, & onn’obferve point de les po-
ferau bout les unes des autres. Cette partie de charpente
groffiere s’exécute par les memes ouvriers
qu,i entreprennent la couverture de chaume.
La charpente étant établie , le couvreur javelle le
chaume : il fe fert pour cela d’une faucille qu’il tient
de la main droite ; il prend au meulon une petite
braffée de chaume , qu’il fecoue à terre pour faire
tomber peu-à-peu les brins, & les égaler ; il donne
toutes fes fecouffes dans un même fens , & arrange
les brins de chaume à-peu-près parallèlement les
uns aux autres. S’il arrive qu’il laiffe tomber quelque
poignée un peu groffe qui ne s’arrange pas
bien, il la reprend & la divife avec la pointe de fa
faucille pour en mieux arranger les brins ; enfuite il
reprend au tas de nouveau chaume ; il l’arrange de
la même façon ; & quand il a formé devant lui un
tas d’environ trois ou quatre pieds de longueur fur
tinpiedd’épaiffeur & deux pieds de largeur, il fourre
fes fabots fous la longueur du petit tas , & prend par
petites parties le chaume qu’il vient d ’arranger ; il les
appuie avec fes mains fur le devant de fes jambes ; il
les peigne groffiérement avec fes doigts ; il en preffe
les brins les uns contre les autres ; il arrache avec
fes mains les pailles qui débordent & qui ne font pas
bien engagées avec le refte ; il frappe du plat de la
main fur la portion qu’il a arrangée, & il forme ainfi
ce qu’on nomme une javelle de chaume, c’eft-à-dire,
un petit tas dont les brins font fort rapprochés les uns
des autres, & qui forment un tout d’une confiftance
fuffifante; enfuite il leve cette javelle , & il la pofe
dans un lieu propre fur un lien de paille : apres quoi
il forme une fcconde javelle comme il a fait la prem
ie r é ,& i l lie ces deux javelles^ enfemble avec lô
même lien de paille, afin de pouvoir les monter
commodément fur le toit. Quand l’ouvrier a formé
deux, trois ou quatre cens bottes de javelles, il commence
la couverture du toit en s’y prenant de la maniéré
que je vais l’expliquer. J’obferve ici qu’il n’eft
pas poffible de bien javeler du chaume fec, parce
qu’il eft trop roide, & qu’il fe rompt au lieu des’ar-j
ranger : on ne peut pas non plus faire une bonne
couverture avec dés javelles trop feches, ce qui
oblige de les mouiller auparavant, fans quoi cette
paille fe romproit ; ainfi quand il fait du hâle , il faut
arrofer le chaume avant de le javeler, & il faut encore
mouiller les javelles avant de les mettre enpla-t
ce : cette opération augmente un peu les frais de
l’ouvrage.
Le couvreur commence par former l’égout du toit ;
& pour y parvenir il choifit le chaume de meilleure
qualité, & en forme des javelles, d’environ quatre
pieds de longueur ; il lie une de ces grandes javelles
au quart de fa longueur ; par un enlacement d’ofier
long , a , b , figuret , planche I du Couvreur dans ce
Supplément ; il en appointit le gros bout b , & il tortille
le bout menu a , & y fait une boucle ; il pique
cet ofier dans la javelle de a en b , figure 2 ; il en entoure
la portion a , b ; il paffe enfuite l’ofier dans la
bouche b : après quoi il ferre fortement la première
portion a ,b de la javelle ; puis il pique l’ofier en c ;
il le pique encore par le deffous en d : enfin en le fai^
fant revenir fur le bord e , il ferre fortement la portion
e , d t comme il l’a pratiqué à l’autre bord de la
javelle a , b: en faifant de même à l’autre bout de
la javelle, elle fe trouve liée aux deux bouts , comme
on le voit en ƒ , g&c h , k ; alors avec une faucille
bien tranchante, il la coupe en d eux, fuivant la ligne
ponftuée i , ce qui lui donne deux javelles ou couf-
finets d’égout, figure 3 , qui fe trouvent enlacés
d’ofier par le milieu de leur longueur.
Quand les bâtimens font bas, urt manoeuvre peut
tendre avec une fourche les .gerbes de chaume ait
couvreur qui eft monté fur le toit ; cette fourche eft
de fer, & femblable à celles dont on fe fert lors de la
moiffon pour charger les gerbes fur les voitures;
mais quand les bâtimens font trop élevés, le manoeuvre
, figure 4 , eft obligé de charger les javelles fur
fa tê te , & de les monter fur le toit à l’aide d’ une
échelle.
Le couvreur fait l’égout en arrangeant les couffinets
bien ferrés les uns auprès des autres , de forte même
qu’ils fe recouvrent un peu les uns les autres par le
côté ; & afin que l ’égout fe foutienne mieux , & même
qu’il foit un peu retrouffé , on met fur la partie
pendante des chevrons en place de lattes, un cours
de perches un peu groffes, fur lefquelles les bouts
des couffinets puiffent s’appuyer.
Quand l’égout a été garni de couffinets dans toute
la longueur du bâtiment, le couvreur forme fur le
pignon la bordure avec des javelles garnies de leur
lien de paille, ou, ce qui eft encore mieux, liées avec
des harts ; car comme cette bordure eft plus expofée
que le refte de la couverture à être emportée par le
v en t , le lien de paille ou la hart la mettent plus ep
état de réfirter; & c’eft par la même raifon que l’on
a grand foin de lier avec desofiers toutes les javelles
des rives ou des bordures, foit aux chevrons , foit à
la latte ; outre cela on les traverfe encore avec des
chevilles de bois, qu’on fait entrer à coups de maillet
dans le garni de la muraille. Enfin comme il eft
de la plus grande importance de fortifier cette partie
contre l’effort du vent, il y en a qui mettent par-deffus
le chaume , quand la couverture eft finie, deux chevrons
chevalés à leur tête, & liés par le bas à ceux de
la charpente : cette précaution eft très-bonne.
i