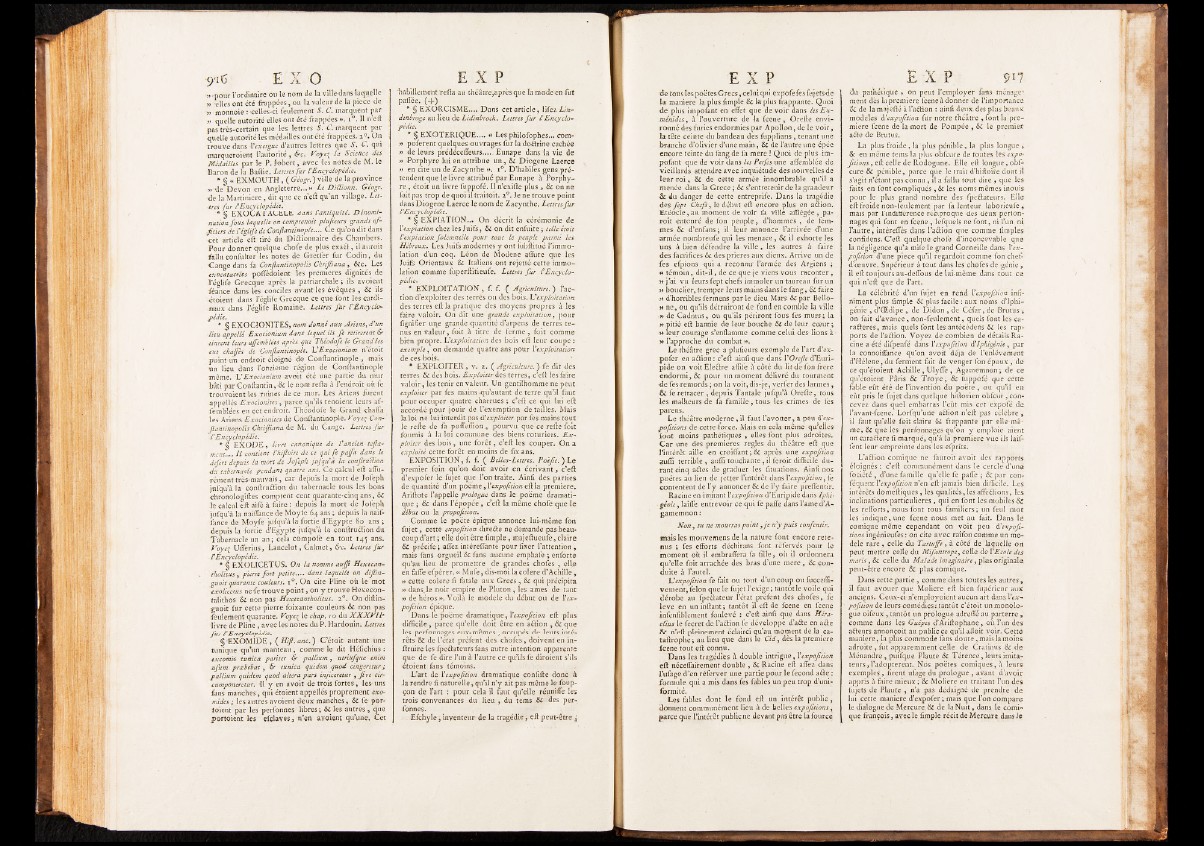
•»-pourl’ordinaire ou le nom de la villëdanslaquelle
» -elles ont été frappées, ou la valeur de la piece de
» monnoie : jcelles-ci feulement S. C. marquent par
» quelle autorité elles ont été frappées ». i° . Il n’eft
pas très-certain que les lettres S. C. marquent par
quelle autorité les médailles ont ete frappées. i ° . On
trouve dans Vexergue d’autres lettres que S-. C. qui
marqueroient Pautorite, &c. Voye^ la Science des
Médailles par le P. Jobert, avec ‘les notes de M. le
Baron de la Baftie. Lettres fur C Encyclopédie.
* § « EXMOUTH, ( Géogr. ) ville de la province
»‘de Devon en Angleterre...» Le DiSionn. Géogr.
•de la Martiniere, dit que ce n’eft qu’un village. Lettres
fur ÜEncyclopédie.
* § EXOCATACELE dans tantiquité. Dénomination
fous 'laquelle on comprenoit plujieurs grands officiers
de réglife de-Confiantinople.... Ce qu’on dit dans
cet article eft tiré du Di&ionnaire des Chambers.
Pour donner quelque chofe de plus exaft , il auroit
fallu confulter les notes de Gretfer fur Codin, du
Cange dans fa Confiantinopolis Chrijliana, &c. Les
exocatacelts poffédoient les premières dignités de
l’églife Grecque après la patriarchale ; ils avoient
féance dans lesrcônciles avant les évêques , 8c ils
étoient dans l’églife Grecque ce que font les cardinaux
dans l’églife Romaine. Lettres fur l'Encyclopédie.
* § EXO CIONIT ES, nom donné aux A riens y d'un
lieu appelle Exocionium dans lequel ils fe retirèrent &
tinrent leurs affemblées après que Théodofe le Grandies
eut chajfés de Confiantinople. L’Exocionium n’étoit
point un endroit éloigné de Confiantinople > mais
un lieu dans Ponzieme région- de Confiantinople
même. VExocioniurn avoit été une partie du mur
bâti parConftantin, & le nom refta à l’endroit oh fe
trouvoient les ruines de ce mur. Les Ariens furent
appelles Exocionites-, parce qu’ils tenoient leurs affemblées
en cet endroit. Théodofe le Grand chafla
les Ariens Exocionites de Conftantinople. Voyt%_ Conjlantinopolis
Chrijliana de M. du Cange. Lettres fur
:CEncyclopédie.
* § EX O D E , livre canonique de l'ancien te f a mé
nt.... I l contient l'hiftoire de ce qui fe paffa dans le
defert depuis la mort de Jofeph jufqu'à la conjlr.uclion
du tabernacle pendant quatre ans. Ce calcul eft aflù-
rément très-mauvais, car depuis la mort de Jofeph
jufqu’à la conftru&ion du tabernacle tous les bons
dironologiftes comptent cent quarante-cinq ans, 8c
le calcul eft aifé à faire : depuis la mort de Jofeph
jufqu’à la naitfance de Moyfe 64 ans ; depuis la naif-
fance de Moyfe jufqu’à la fortie d’Egypte 80 ans ;
depuis la fortie d’Egypte jufqu’à la conftrufïion du
Tabernacle un an; cela compofe en tout 145 ans.
Voyei Ufferius, Lancelot, Calmet, &c. Lettres fur
F-Encyclopédie.
* § EXOLICETUS. On la nomme auffi Hexecan-
tholitus, pierre fort petite.... dans laquelle on difiin-
guoit quarante couleurs. i° . On cite Pline où le mot
exolicctus neffe trouve point, on y trouve Hexecon-
talithos & non pas Hexgcantholitus. 20. On diflin-
3>uoit fur cette pierre foixante couleurs & non pas
feulement quarante. Voyeç le chap. 10 du X X X V I I e
livre de Pline, avec les notes du P. Hardouin. Lettres
fur I'Encyclopedie,
§ ’EXOMIDE, ( Hifi.anc. ) C ’étoit autant une
tunique qu’un manteau, comme le dit Héfichius :
excomis -tunica pariter ■ & pallium, utriufquc enim
ufum preebebat , & tunica -quidem quod cingeretur ;
pallium quidem quod àlura pars injiceretur , Jive cir-
cùmponoretur. Il y en avoit de trois fortes, les-uns
fans manches, qui étoient appelles proprement exo-
mides ; les autres avoient deux manches, & fe pôr-
toient par les perfonnes libres ; 8c les autres, que
.portoient les efçlaves, n’en avoient qu’une. Cet
habillement relia au théâtre,aprèsqtieIamodeen fut
paflee. (+ )
* § EXORCISME..., Dans cet article, lifez Lin-
denbroge au lieu de Lidinbrock. Lettres fur l'Encyclopédie.
* § EXOTERIQUE.... « Les philofophes.;. corn-
» poferent quelques ouvrages fur la doârine cachée
» de leurs prédéceffeurs..... Eunape dans la vie de
» -Porphyre lui en attribue un, & Diogene Laerce
» en cite un de Zacynthe ». i° . D’habiles gens prétendent
que lé livre attribué par Eunape à Porphyre
, étoit un livre fuppofé. Il n’exifte plus , & on ne
fait pas trop de quoi il traitoit. 20. Je ne trouve point
dans Diogene Laerce le nom de Zacynthe. Lettres fur
l'Encyclopédie.
* § EXPIATION... On décrit la cérémonie de
Xexpiation chez les Juifs, & Qn dit enfuite ; telle étoit
F expiation folemnelle pour tout le peuple parmi les
Hébreux. Les Juifs modernes y ont fubftitué l’immolation
d’un coq. Léon de Modene gflure que les
Juifs Orientaux 8c Italiens ont rejetté cette immolation
comme fuperftitieufe. Lettres fur FEncyclo-
pédie.
* EXPLOITATION, f. f. ( Agriculture.) l’action
d’exploiter des terrés ou des bois.-Uexploitation
des terres eft la pratique des moyens propres à les
faire valoir. On dit une grande exploitation, pour
lignifier une grande quantité d’arpens de terres tenus
en valeur, foit à titre de ferme, foit comme
bien propre. L’exploitation des bois eft leur coupe :
exemple, on demande quatre ans pour Xexploitation
de ces bois»
* EXPLOITER, v. a. ( Agriculture. ) fe dit des
terres & des b ois.Exploiter des terres, c’eft les faire
valoir, les tenir en valeur. Un gentilhomme ne peut
exploiter par fes mains .qu’autant de terre qu’il faut
pour occuper quatre charrues ; c’eft ce qui lui eft
accordé pour jouir de l’exemption détaillés. Mais
la loi ne lui interdit pas d'exploiter par fes mains tout
le refte de fa pofléfîion, pourvu que ce refte foit
fournis à la loi commune des biens roturiers. E x ploiter
des bois, une fo rê t , c’eft les couper. On a
exploité cette forêt en moins de fix ans.
EXPOSITION, f. f. ( Belles-Lettres. P défit.) Le
premier foin qu’on doit avoir en écrivant, c’eft
d’expofer le fujet que l’on traite. Ainfi des parties
de quantité d’un poème, X expofition eft la première,
Ariftote l’appelle prologue dans le poème dramatique
; 8c dans l’épopée, c’eft la même chofe que le
début ou la propofition.
Comme le poète épique annonce lui-même fon
fujet, cette expofition direâe ne demande pas beaucoup
d’art ; elle doit être fimple, majeftueufe, claire
8c précife; affez-intéreffante pour fixer l’attention,
mais fans orgueil 8c fans aucune emphafe ; enforte
qu’au lieu de promettre de grandes chofes , elfe
en faffe efpérer. « Mufe, dis-moi la colere d’Achille ,
» cette colere fi fatale aux Grecs , 8c qui précipita
» dans, le noir empire de Pluton, les âmes de tant
» de héros». Voilà le modèle du début ou de X expofition
épique.
Dans le poème dramatique, Xexpofition eft plus
difficile, parce qu’elle doit être en a£lion , 8c que
les perfonnages eux-mêmes , occupés de leurs intérêts
& de l’état préfent des chofes, doivent en in-
ftruireles fpeélateurs fans autre intention apparente
que de fe dire l’un à l’autre ce qu’ils fe diroient s’ils
étoient fans témoins.
L’art de Xexpofition dramatique confifte donc à
la rendre li naturelle, qu’il n’y ait pài même le foùp-
-çon de l’art : pour cela il faut qu’elle réunifie les
trois convenances du lieu , du tems & des personnes.
Efchyle ; inventeur de la tragédie, eft peut-être J
de îotis les poètes Grecs, celui qui expofefesfujetsde
la maniéré la plus fimple 8c la plus frappante. Quoi
die plus impofant en effet que de voir dans les Euménides
, à l’ouverture de la feene, Orefte environné
des furies endormies par Apollon, de le v o ir ,
la tête ceinte du bandeau des fupplians , tenant une
branche d’olivier d’une main, & de l’autre une épée
encore teinte du fang de fa mere ! Quoi de plus impofant
que de voir dans les Perfes une affemblée de
vieillards attendre avec inquiétude des nouvelles de
leur r o i, & de cette armée innombrable qu’il a
menée dans la Grece ; 8c s’entretenir de la grandeur
& du danger de cette entreprife. Dans la tragédie
de,s fept Chefs, le début eft encore plus en aâion.
Etéocle, au moment de voir fa Ville afliégée , pa-
roît entouré de fon peuple, d’hommes , de femmes
8c d’enfans ; il leur annonce l’arrivée d’une
armée nombreufe qui les menace, 8c il exhorte les
uns à bien défendre la v ille , les autres à faire
des facrifices 8c des prières aux dieux. Arrive un de
fes efpions qui a reconnu’ l’armée des Argiens ; .
m témoin, dit-il, de ce que je viens vous raconter,
■ » j ’ai vu leurs fept chefs immoler un taureau fur un
» bouclier, tremper leurs mains dans le fang, 8c faire
» d’horribles fermens par le dieu Mars 8c par Bello-
» ne, ou qu’ils détruiront de fond en comble la ville
•»de Cadmus, ou qu’ils périront fous fes murs; la
».pitié eft bannie de leur bouche 8c de leur coeur;
leur courage s’enflamme comme celui des lions à 1
» l’approche du combat ».
Le théâtre grec a plufieurs exemple de l’art d’expofer
en a&ion : c’eft ainfi que dans XQrefie d’Euripide
on voit Eleftre affile à côté du lit de fon frere
«ndormi, 8c pour un moment délivré du tourment
de fes-remords ; on la voit, dis-je, verfer des larmes,
& fe retracer , depuis Tantale jufqu’à Orefte, tous
les malheurs de fa famille, tous les .crimes de fes
pare ns.
Le théâtre moderne, il faut l’avouer, a peu d'ex-
■ vofitions de cette force. Mais en cela même qu’elles
font moins pathétiques , elles font plus adroites.
Car une des premières réglés du théâtre eft que
l’intérêt aille en croiffant ; 8c après une expofition
auffi terrible , auffi touchante, il feroit difficile durant
cinq a&es de graduer les fttuations. Ainfi nos
poètes au lieu de jetter l’intérêt dans Xexpofition, fe
contentent de l’y annoncer 8c de l’y faire preffentir.
Racine en imitant Xexpofition d’Euripide dans IphL
-génie, laiffe entrevoir ce qui fe paffe dans l’ame d’A-
gamemnon :
Non, tu ne mourras point, je n'y puis conftntir.
mais les mouvemens de la nature font encore retenus
; fes efforts déchirans, font réfervés pour le
moment où il embrafferà fa fille, où il ordonnera
qu’elle foit arrachée des bras d’une mere, 8c conduite
à l’autel.
U expofition fe fait ou tout d’un coup ou fucceffi-
vement; félon que le fujet l’exige; tantôt le voile qui
dérobe au fpeûateur l’état préfent des chofes, fe
leve en un inftant ; tantôt il eft de feene en feene
infenfiblement foulevé : c’eft ainfi que dans Héra-
clius le fecret de l’attion fe développe d’aûe en a£te
& n’eft pleinement éclairci qu’au moment de la ca-
taftrophe ; au lieu que dans le Cid, dès la première
feene tout eft connu.
Dans les tragédïfes à double intrigue, Xexpofition
eft néceffairement double , 8c Racine eft affez- dans
l’ufage d’en réferver une partie pour le fécond aûe :
formule qui a mis dans fes fables un peu trop d’uniformité.
Les fables dont le fond eft un intérêt public,
donnent communément lieu à de belles expofitions,
parce que l’intérêt public ne devant pas être la fource
du pathéfiqüe > on peut l’employer fans- ménage*
ment dès la première feene à donner de l’impomance
8c de la majefté à l’âftion : ainfi deux, des plus beaux
• modèles d'expofition fur notre théâtre , font la pre-»
mîere feene de la mort de Pompée , 8c le premier
aâ e de Brutus.
La plus froide, la plus pénible, la plus longue >
& en même tems la plus obfcure de toutes les expo*
jiùous, eft celle de Rodogune. Elle eft longue, obA-
cure 8c pénible, parce que le trait d’hiftoîfe dont il
s’agit n’étant pas.connu, il a fallu tout dire , que les
faits en font compliqués , & les noms mêmes inouis
pour le plus grand nombre des fpeélateurs. Elle
eft froide non-feulement par fa lenteur laborieufe ,
mais par l’indifférence réciproque des deux perlon-
nages qui font en feene , lefquels ne font, ni l’un ni
l’autre, intérefles dans l ’aétion que comme fimples
confidens. C’eft quelque chofe d’inconcevable que
la négligence qu’a mife le grand Corneille dans Xex-
pofition d’une piece qu’il regardoit comme fon chef-
d’oeuvre. Supérieur à tout dans les chofes de génie ,
il eft toujours au-deffous de lui-même dans tout ce
qui n’eft que de l’art.
La célébrité d’un fujet en retld Xexpofition infi*
niment plus fimple 8c plus facile : aux noms d’Iphigénie
, d’OEdipe , de Didon , de Céfar, de Brutus *
on fait d’avance, non-feolement, quels font les ca-
rafteres, mais quels font lés antécédens & les rap»
ports de l’a&ion. Voyez de combien de détails Racine
a été difpenfé dans Xexpofition d!Iphigénie, par
la connoiffance qu’on avoit déjà de l’enlèvement
d’Hélene, du ferment fait de venger fon époux , de
ce qu’étoient Achille, Ulyffe , AgamCinnon; de ce
qu’étoient Pâris & T ro y e ; & fuppofé que cette
fable eût été de l’invention du poète, ou qu’il en
eût pris le fujet dans quelque hiftorien obfcur, concevez
dans quel embarras l’eût mis cet expofé de
l’avanr-feene. Lorfqu’uné aâion n’eft pas célèbre ,
il faut qu’elle foit claire 8c frappante par elle-même,
& que les perfonnages qu’ on y emploie aient
un caraftere fi marqué, qu’à la première vue ils laif-
fent leur empreinte dans les efprits.
L’a&ion comique ne fauroit avoit des rapports
éloignés : c’eft communément dans le cercle d’un®
fociété , d’une faniille qu’elle fe paffe ; 8c par con-
féquent Xexpofition n’en eft jamais bien difficile. Les
intérêts domeftiques , les qualités,les affections, îes
inclinations particulières, qui en font les-mobiles 8c
les refforts, nous font tous familiers ; un feul mot
les indique, une feene nous met au fait. Dans lô
comique même cependant on voit peu d'expofitions
ingénieufes: on cite avec raïfon comme un modèle
rare , celle du Tartuffe , à côté de laquelle on
peut mettre celle du Mifantrope, celle de XEcole des
maris, 8c celle du Malade imaginaire, plus originale
peut-être encore 8c plus comique.
Dans cette partie, comme dans toutes les autres ,
il faut avouer que Moliere eft bien fupérieur aux
anciens. Ceux-ci n’employoiént aucun art dans.l’c^:-
pofition de leurs comédies: tantôt c’étoit un monologue
oifeux, tantôt un prologue adreffé au parterre ,
comme dans les Guêpes d’Ariftophane, où l’un des
afteurs annonçoit au public ce qu’il alloit voir. Cettô
manière, la plus commode fans doute, mais la moins
adroite , fut apparemment celle de Cratinus 8c de
Ménandre , puifque Plaute & Térence, leurs imitateurs
, l’adopterent. Nos poètes comiques, à leurs
exemples, firent ufage du prologue , avant d’avoir
appris à faire mieux ; & Moliere en traitant l’un des
fujets de Plaute , n’a pas dédaigné de prendre de
lui cette maniéré d’expofer ; mais que l’on compare
le dialogue de Mercure 8c de la Nuit, dans le comique
françois, avec le fimple récit de Mercure dans le
lit