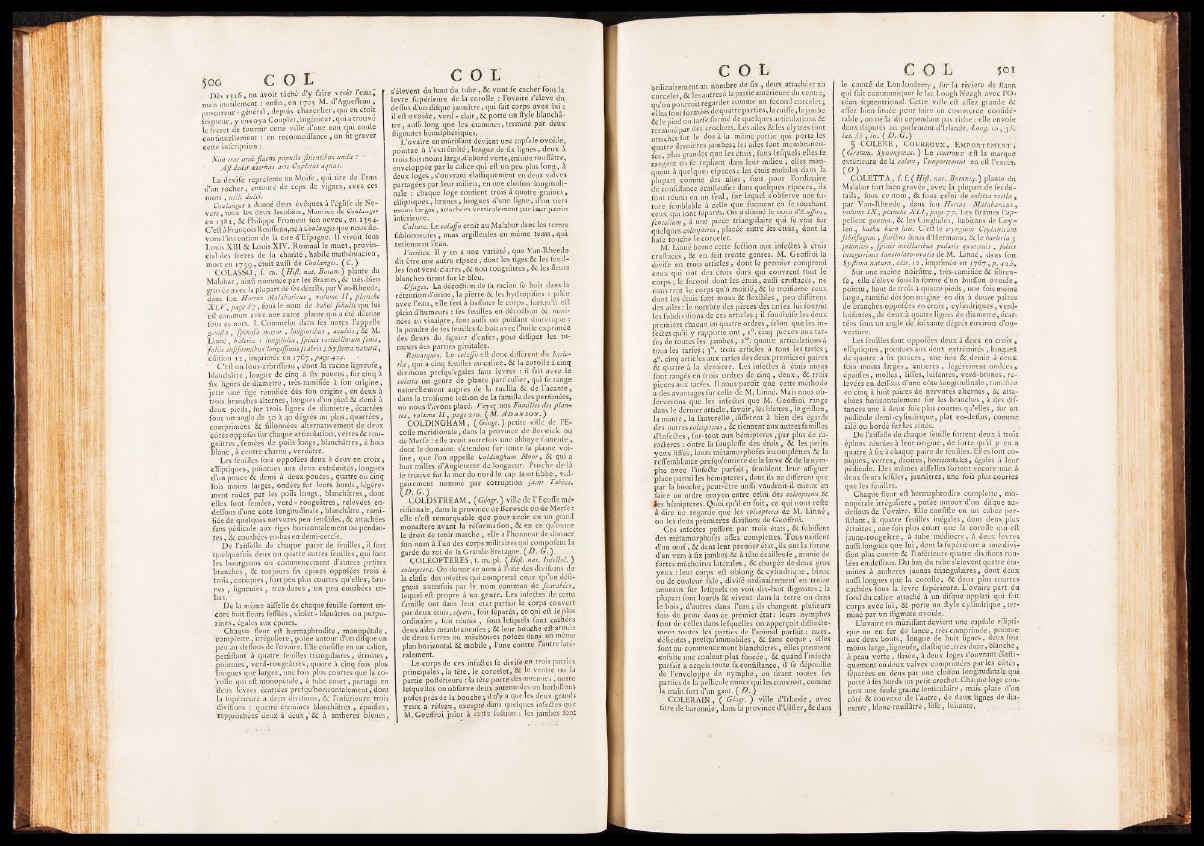
$oô C O L
Dès 15 1S, on avoit tâché d’y faire venit lW u ;
mais inutilement : enfin, en 1705 M. d’Agueffeau ,
procureur - général, depuis chancelier, qui en etott
feigneur, y envoya Couplet, ingénieur, qui a trouve
le fecret de fournir cette ville d’une eau qui coule
continuellement : en reconnoiffance, on fat graver
cette infcription s
Non erat anà jluens, populis Jit'untibus unda :
dédit oeternas arte Cupletus aquas.
La devife repréfente un Moïfe, qui tire de l’eau
d’un rocher, entouré de ceps de vignes., avec ces
mots , utile dulci.
Coulanges a donné deux eveques à 1 eglile de N e-
vers tous les deux Jacobins, Maurice de Coulanges
en 1381, & Philippe Froment fon neveu, en 1394.
C ’eft à François Rouffeau,né à Coulanges que nous devons
l’invention de la cire d’Efpagne. Il vivoit fous
Louis XIII 6c LouisXIV. Romual le muet, provirir
da l des freres de là charité, habile mathémacien,
mort en 1739 , étoit aufli de Coulanges. (C. )
COLASSO, f. m. (Hi(l. nat. Botan.) plante du
Malabar, ainfi nommée par les Brames, & très-bien
gravée avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede,
'dans fon Hortus Malabaricus , volume I I , planche
X L V , page 8y > fous le nom de bahel fchulli qui lui
ieft commun avec une autre plante qui a été décrite
fous ce nom. J. Commeliri dans fes notes l’appelle
genifla , fpinofa major , longioribus , aculeis ; 6c M.
Linné, baieria 1 longifolia, fpinis yerticillorumfenis9
'foliis ehjiformibus lohgijjîmisfcabrisSyflerna natura,
édition 1 z , imprimée en 1767, page 424.
* C ’eft un fous-arbriffeau, dont la racine ligneufe,
blanchâtre , longue de cinq à fix pouCes, fur cinq à
fix lignes de diamètre, très-ramifiée à fon origine ;
jette une tige ramifiée dès fon origine, en deux à
trois branches alternes, longues d’un pied 6c demi à
deux pieds, fur trois lignes de diamètre, écartées
fous un angle de 30 à 40 dégrés au plus, quarrées ,
comprimées 6c fillonnées alternativement de deux
côtés ôppôfés fut chaqùe articulation, ver tes & rougeâtres,
femées de poils longs, blanchâtres, à bois
blanc, à centre charnu, verdâtre.
Les feuilles font oppofées deux à deux en croix,
elliptiques, pointues aux deux extrémités, longues
d’un pouce 6c demi à deux pouces, quatre ou cinq
fois moins larges, ondées fur leurs bords, légère*
ment rudes par les poils longs, blanchâtres, dont
elles font femées, verd - rougeâtres, relevées en-
deffous d’une côte longitudinale, blanchâtre , ramifiée
de quelques nervures peu fenfibles, 6c attachées
fans pédicule aux tiges horizontalement ou pendantes
, 6c courbées en-bas en demi-cercle.
De l’aiffelle de chaque paire de feuilles, il fort
Quelquefois deux ou quatre autres feuilles, qui font
les bourgeons ou commencement d’autres petites
branches, 6c toujours fix épines oppofées trois à
trois, coniques, fort peu plus courtes qu’elles, brunes
, ligneufes , très-dures , un peu courbées en-
fias.D
e la même aiffelle de chaque feuille fortent encore
huit fleurs fefliles, violet - bleuâtres ou purpurines,
égales aux épines.
Chaque fleur eft hermaphrodite , monopétale ,
"èomplette, irrégulière, pofëe autour d’un difque un
■ peu au deflous de l’ovaire. Elle confifte en un calice,
-perfiftant à quatre feuilles triangulaires, étroites,
-pointues, verd-rougeâtrës, quatre à cinq fois plus
longues que larges, une fois plus courtes que la co-
t'olle qui eft monopétale, à tube court, partagé en
deiôt levres écartées prefqu’horizontalement, dont
la fupérieure a deux divifions, 6c l’inférieure trois
'divifions : quatre étaminës blanchâtres , épaifles,
'rapprochées' deiiX: à ‘ deux,’ 6c à anthères bleues,
C O L
s’élèvent du haut du tube, 6c vont fe cacher fous la
levre fupérieure de la corolle : l’ovaire s’élève du
deflus d’un difque jaunâtre, qui fait corps avec lui :
il eft ovoïde, verd - clair, 6c porte un ftyle blanchâtre,
aufli long qne les étamines, terminé.par deux
ftigmates hémifphériques.
L’ovaire en müriffant devient une eapfule ovoïde,
pointue à l’ extrémitélongue de fix lignes-, deux à
trois fois moins large,d’abord verte,enfuit.e rouffâtre,
enveloppée par le calice qui eft un peu plus long, à
deux loges , s’ouvrant élaftiquement en deux valves
partagées par leur milieu, en une cloifon longitudinale
: chaque loge contient trois à quatre graines ,
elliptiques, brunes, longues d’une ligne, d’un tiers
moins larges , attachées verticalement par laur.partie
inférieure. A
Culture. Le colaJJb croit au Malabar dans les terres
fablonneufes, mais argilleufes en même tems, qui
retiennent l’eau.
Variétés. Il y en a une variété, que Van-Rheede
dit être une autre efpece , dont les tiges 6c les feuilles
font verd-claires ,& non rougeâtres, 6c les fleurs
blanches tirant fur le bleu.
Ufages. La décoôion de fa racine fe boit dans la
rétention d’urine, la pi’erre &,les hydropifies : pilée
avec l’eau,, elle fert à bafliner le corps, lorfqu’il eft
plein d’humeurs : fes feuilles en décottion 6c mari-
nées au vinaigre, font aufli un puiflânt diurétique :
la poudre de fes feuilles fe boit avec l’huile exprimée
des fleurs du figuier d’enfer, pour difliper les tumeurs
des parties génitales.
Remarques. Le colajjo eft donc différent du barle*
ria, qui a cinq feuilles au calice, & la eorolle à cinq
divifions prefqu’égales fans levres : il fait avec le
çoletta un genre de plante particulier, qui fe range
naturellement auprès de la ruellia 6c de Laçante *
dans la troifieme fe&ion de la famille des perfonées,
oü nous l’avons placé. Voye[ nos Familles des plan*
test volume /ƒ, pagezio. (.M. ÂDANSON.)
COLD1NGHAM, ( Gèôgr. ) petite ville de l’E-
cofle méridionale, dans la province de Berwick ou
de Merfe : elle avoit autrefois une abbaye fameufe
dont le domaine s’étendoit fur toute la plaine voi-
fine, que l’on appelle Coldingkam Moor, 6c qui a
huit milles d’Angleterre de longueur. Proche de-là
fe trouve fur la mer du nord le cap laint Ebbe, vulgairement
nommé par corruption faine Tabb.es.
( D .G .)
COLDSTREAM, {Géogr. ) ville de l’ Ecoffe me«
ridionale, dans la province de Berwick ou de Merfe :
elle n’eft remarquable que pour avoir eu un grand
monaftere avant la réformation, & en ce qu’outre
le droit de tenir marché , elle a l’honneur de donner
fon nom à l’un des corps militaires qui compofent la
garde du roi de la Grande-Bretagne. {D . G.'),
COLEOPTERES, f. m. pl. WdfflË nat. Infeclol. )
coleoptera. On donne ce nom à l’une des divifions de
la claffe des infe&es qui comprend ceux qu’on défi-
gnoit autrefois par le nom commun de fcarabées,
lequel eft propre à un genre. Les infe&es de cette
famille ont dans leur état parfait le corps couvert
par deux étuis, elytrq, foit féparés, ce qui eft le plus
ordinaire, foit réunis , fous lefquels font cachées
deux ailes membraneufes ; 6c leur bouche eft armée
de deux ferres ou mâchoires pofées dans un même
plan horizontal 6c mobile, l’une contre l’autre latéralement.
.
Le corps de ces infeftes fe divife en trois parties
principales, la tête, le corcelet, 6c Ie ventre ou la
partie poftérieure : la tête porte des antennes , outre
lefquelles on obferve deux antennules ou barbillons
pofés près de la bouche ; il n’y a que les deux grands
yeux à réfeau, excepté dans quelques infeftes que
M. Geoffroi joint à cette Jetfjon : .les jambes fonî
C O L
tordinairement au nombre de fix , deux attachées au
c o r c e l e t , & les autres à la parue anterieure du ventre,
qu’on pourroit regarder comme un fécond corcelet
elles font forniées de quatre parties, la.cuille, la jambe
& le pied ou tarfe formé de quelques articulations 6c
terminé par des crochets. Les ailes & les élytres font
attachés fur le dos à la même partie qui porte les
quatre dernieres jambes; les ailes font membraneufes,
plus grandés que les étuis, fous lefquels.elles fe
rangent en fe repliant dans leur milieu ; elles manquent
à quelques efpeces: les étuis mobiles, .dans la,
plupart comme des ailes, font pour l’ordinaire
de confiftance écailleufe : dans quelques efpeces , ils,
font réunis en un feul , fur lequel s’obferve une future
femblable à celle que forment en fe touchant
ceux qui font féparés. On a donné le nom d’jcujfon,,
CcutelLum, ,à une piece triangulaire qui fe.voit fur
quelques coleôpteres, placée entre les étuis, dont la
bafe touche lecorcelet.. . ;r ■■
M. Linné borne cette feâion aux infeûes à étuis
cruftacés , & en fait trente genres. M. Geoffroi la
divife en trois articles , dont le premier comprend
ceux qui ont des étuis durs qui couvrent, tout le
corps ; le fécond dont les étuis, aufli cruftacés, ne
couvrent le corps qu’à moitié, & le troifieme ceux
dont les étuis font mous 6c flexibles , peu diflerens
des ailes i le nombre des pièces des tarfes lui fournit
les fubdivifions de ces articles ; il foudivife les deux
premiers chacun en quatre ordres, félon que les in-
feâes qu’il y rapporte on t, i° . cinq pièces aux tarfes
de toutes les jambes ; z ° . quatre articulations à
tous les tarfes ; 30. trois articles à tous les^tarfes
4?. cinq articles aux tarfes des deux premières paires
ôc quatre à la derniere. Les infeûes à etuié mous
font rangés en trois ordres de cinq , deux , & trqis
pièces aux târfes. Il nous paroît que cette méthode
a des avantages fur celle de M. Linné. Mais nous ,ob-
ferverons que les infe&es que M. Geoffroi range
dans le dernier artièle, favoir, les blattes, le grillon,
la mante, la fauterelle, different à bien dés égards
des autres coléoptères, & tiennent aux autres familles
d’ infe&es , fur-tout aux hémiptères, par plus de ca- (
faâeres : outre la foupléffe des étuis, & les petits
yeux liffes, leurs métamorphofes incompléttes & la
reflemblance prefqu’erttiere de la larve & de la nymphe
avec l’infeâe parfait, femblent leur aifigner
place parmi les hémiptères, dont ils ne different que
par la bouche ; peut-être aufli vâudroit-il mieux en
faire un ordre moyen entre celui des coleôpteres 6c
les hémiptères. Quoi qu’il en foit, ce qui nous refte
à dire ne regarde que les coleôpteres de M. Linné,
ou les deux premières divifions de Geoffroi.
Ces infe&es paffent par trois états, .&■ fùbiffent
des métamorphofes affez complettes,. Tous naiffent
d’un oe u f, 6c dans leur premier état, ils ont la forme
d’un vers à fix jambes 6c à tête écailleufe, munie de
fortes mâchoires latérales, & chargée de deux gros;
yeux : leur corps eft oblong 6c cylindrique, blanc
ou de couleur, la ie, divifé ordinairement en treize
anneaux fur lefquels on voit dix-huit ftigmates ; la.
plupart font lourds 6c vivent dans la terre oü dans
le bois, d’autres dans l’eau ; ils changent plufieurs
fois de peau dans ce premier état: leurs nymphes
. font de celles dans lefquelles on apperçoit diftinfte-
ment toutes les parties de l’animal parfait: nues,
délicates, prefqu’immobiles , 6c fans coque , elles
font au commencement blanchâtres, elles, prennent
enfuite une couleur plus foncée , 6c quand l’infefte
parfait a acquis toute fa confiftance, il fe dépouille
de l’enveloppe de nymphe, en tirant toutes fes
parties de la pellicule mince qui les couvroit, comme
la main fort d’un gant. ( D. )
COLERAÎN, ( Géogr. ) ville dTrIande, avec
titre de baronnie, dans la province d’Ulfter, 6c dans
C O L 501
le comte'de Londonderry, fur la riviefe -de Bann
qui fait communiquer le lac LoughNeagh avec l’O-1
céan feptentrional. Cette ville eft affez grande 6c
affez bien fituée pour faire un commerce confidé*
table ;-on ne la dit cependant pas riche.: elle envoie
deux députés au parlement d’Irlande. Long. 10. 35ï
lat'. àjj f /9'. ( D. G .)
§ COLERE, Courroux, Emportement^
( Gramm. Synonymes.') Le courroux eft la marque
extérieure de là colere, l’emportement en eft l’excès:
( o ) I m m 1 .
--ÇOLETTA, f. f. (Hifl. nat. Botaniq. ) plante du
Malabar fort bien gravée, avec la plupart de fes détails
, fous ce nom, 6c fous celui de coletta v,eetla,
par Van-Rheede , d^ns fon Hortus Malabaricus i
volume I X , planche X L l , page 77. Les Brames l’appellent
gontua, 6c les Cinghales, habitans de C e y -
lan , katku karo hiti. C ’eft le eryngium Ceylahicum
febrifugum , fLoribus luteis d’Hermann; 6ç le bar 1eria3
prionitis , fpinis axillaribus pedatis qu a ternis , folïis
integerrimis lanceolato-ovatis de M. Linné, dans fon
Syflerna naturce, edit. i z , imprimée en 1767, p. 42Si
Sur une racine noirâtre , très-ramifiée & fibreu-
fe , elle s’élève fous la forme d’un buiffori ovoïde *
pointu, haut de trois à quatre pieds, une fois moins
large, ramifié dès fon origine en dix à douze paires
de branches oppofées en croix, cylindriques, verd-
luifantes, de deux à quatre lignes de diamètre, écartées
fous un angle de foixante dégrés environ d’ouverture.
Les feuilles font oppofées deux à deux en croix ,
elliptiques, pointues aux deux extrémités , longues
de quatre à fix pouces, une fois 6c demie à deux
fois moins larges, entières , légèrement ondées,,
épaifles, molles , liffes, luifantes, verd-brunes, relevées
en-deffous d’une côte longitudinale, ramifiée,
en cinq à huit paires de iiervures alternes , & attachées
horizontalement fur les branches , à des, dif-
tances une à deux fois plus courtes qu’elles ; fur un
pédicule demi-cylindrique, plat en-deffus, comme-
ailé ou bordé fur les côtés.
De l’aiffeile de chaque feuille fôrtertt deux à trois
épines réunies à leur origine , de forte qu’il y en a
quatre à fixà chaque paire de feuilles. Elles font coniques,
vertes, droites,horizontales, égales à leur
pédicule. Des mêmes aiffelles fortent encore une à
deux fleurs fefliles, jaunâtres, une fois plus courtes
’ que les feuilles*
Chaque fleur eft hermaphrodite complette, mô-
nopétale irrégulière , pofée autour d’un difque au-*
deflous de l’ovaire. Elfe confifte en un calice perfiftant
, à quatre feuilles inégales, dçnt deux plus
étroites, une fois plus court que la corolle qui eft
jaune-rougeâtre, à tube médiocre, à deux levres
auflilongues que lui, dont lafupérieure a unedivi-
fion plus courte 6c l’inférieure quatre divifions roulées
en-deffous. Du bas du tube s’élèvent quatre étamines
à anthères jaunes triangulaires, dont deux-
auflilongues que la corolle, 6c deux plus courtes
cachées fous la levre fupérieure. L’ovaire part du
fond du calice attaché à un difque applati qui fait
corps avec lui, 6c porte un ftyle cylindrique , terminé
par un ftigmate ovoïde. ,
L’ovaire en mûriffant devient une eapfule elliptique
ou en fer de lance, très-comprimée, pointue,
aux deux bouts, longue de huit lignes , deux fois,
moins large, ligneufe, élaftique, très-dure, blanche,
à peau ve r te , ftriée, à deux loges s’ouvrant élaftiquement
en deux valves comprimées par les cotes,
féparées en deux par une cloifon longitudinale qui
porte à fes bords un petit crochet. Chaque loge contient
une feule graine lenticulaire, mais plate d’un
côté 6c convexe de l’autre, de deux lignes de dia-
metfe, blanc-rouffâtre, liffe, luilante.