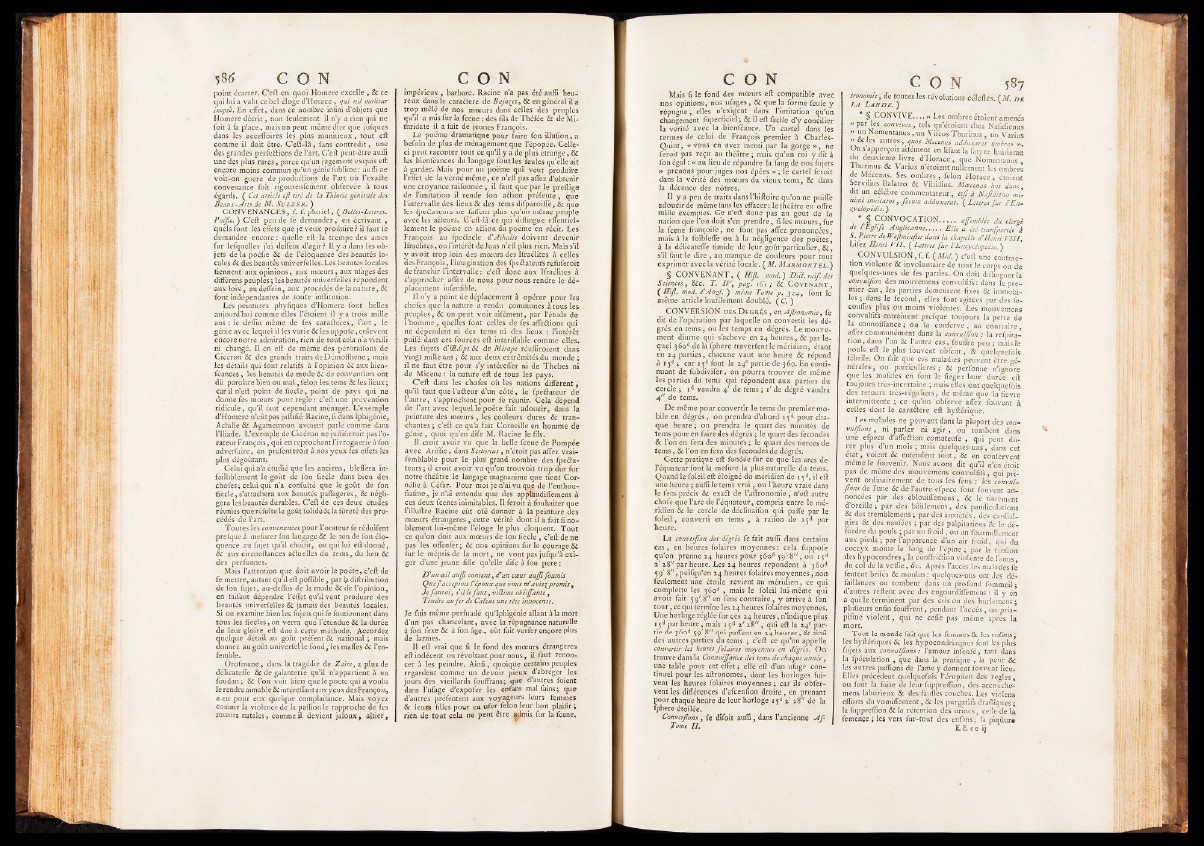
586 C O N
point écarter. C’eft en quoi Homere excelle , & ce
qui lui a valu ce bel éloge d’Horace , qui nil molitur
ineptê. En effet, dans ce -nombre infini d’objets que
Homere décrit, non feulement il n’y a rien qui ne
foit à fa place, mais on peut même dire que jufques
dans les acceffoires les plus munitieux, tout eft
comme il doit être. C ’eft-là, fans contredit, une
des grandes perfections de l’art. C’eft peut-être aufîi
une des plus rares, parce qu’un jugement exquis eft
encore moins commun qu’un génie fublime: aufîi ne
voit-on guere'de productions de l’art où l’exaéte
convenance foit rigoureufement obfervée à tous
égards. ( Cet article efl tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. SuLZER. )
CONVENANCES, f. f. pluriel, ( Belles-Lettres.•
Poéjîe.) C ’eft peu de fe demander, en écrivant ,
quels font les effets que je veux produire ? il faut fe
demander encore: quelle eft‘la trempe des âmes
fur lefquelles j’ai deffein d’agir ? 11 y a dans les objets
de la poéfie &c de l’éloquence des beautés locales
& des beautés univerfelles. Les beautés locales
tiennent aux opinions, aux moeurs, aux ufages des
différens peuples ; les beautés univerfelles répondent
aux lo ix, au deffein, aux procédés de la nature, &
font indépendantes de toute inftitution.
Les peintures phyfiques d’Homere font belles
aujourd’hui comme elles l’étoient il y a trois mille
ans : le deflin même de fes cara&eres, l’a r t , le
génie avec lequel il les varie & les oppofe, enlevent
encore notre admiration, rien de tout cela n’a vieilli
ni changé. 11 en eft de même des péroraifons de
Cicéron & des grands traits de Démofthene ; mais
les détails qui font relatifs à l’opinion & aux bien-
féances, les beautés de mode &c de convention ont
dû paroître bien ou m al, félon les tems & les lieux ;
car il n’eft point de fiecle, point de pays qui ne
donne fes moeurs pour réglé : c’eft une prévention
ridicule, qu’il faut cependant ménager. L’exemple
d’Homere n’eût pas juftifié Racine, fi dans Iphigénie,
Achille & Agamemnon avoient parlé comme dans
l’Iliade. L’exemple de Cicéron ne juftifieroit pas l’orateur
François, qui en reprochant l’ivrognerie à fon
adverfaire, en préfenteroit à nos yeux les effets les
plus dégoûtans.
Celui qui n’a étudié que les anciens, bleffera infailliblement
le goût de fon fiecle dans bien des
chofes; celui qui n’a confulté que le goût de fon
fiecle, s’attachera aux beautés pafîageres, & négligera
les beautés durables. C ’eft de ces deux études
réunies queréfulte le goût folide&la fûreté des procédés
de l’art.
Toutes les convenances pour l’orateur fe réduifent
prefque à mefurer fon langage & le ton de fon éloquence
au fujet qu’il choifit, ou qui lui eft donné,
& aux circonftances actuelles du tems, du lieu &
des perfonnes.
Mais l’attention que doit avoir le poëte, c’eft de
fe mettre, autant qu’il eft poflible, par Ig diftribution
de fon fujet, au-deffus de la mode & de l’opinion,
en faifant dépendre l’effet qu’il veut produire des
beautés univerfelles & jamais des beautés locales.
Si on examine bien les fujets qui fe foutiennent dans
tous les fieclesjon verra que l’étendue 6c la durée
de leur gloire eft due à cette méthode. Accordez
quelque détail au goût préfent 6c national ; mais
donnez au goût univerfel le fond, les maffes 6c l’en-
femble.
Orofmane, dans la tragédie de Zaïre, a plus de
délicateffe & de galanterie qu’il n’appartient à un
foudan ; 6c l’on voit bien que le poëte qui a voulu
lerendre aimable & intéreffant auxyeux des François,
a eu pour eux quelque complaifance. Mais voyez
comme la violence de la paflion le rapproche de fes
piceurs natales, comme il devient ja loux, altier,
C O N
impérieux , barbare. Racine n’a pas été aufîi heureux
dans le caraôere de Bajaqet, 6c eh général il à
trop mêlé de nos moeurs dans celles des peuples
qu’il a mis fur la fcene : des fils de Théfée & de Mi-
thridate il a fait de jeunes François.
Le poëme dramatique pour faire fon illufion, a
befoin de plus de ménagement que l’épopée. Celle-
ci peut raconter tout ce qu’il y a de plus étrange, 6c
les bienféances du langage font les feules qu’elle ait
à garder. Mais pour un poëme qui veut produire
l’effet de la vérité même, ce n’eft pas affez d’obtenir
une croyance raifonnée , il faut que par le preftige
de l’imitation il rende fon aCtion préfente, que
l’intervalle des lieux & des tems difparoiffe, 6c que
les fpeélateurs ne faffent plus qu’un même peuple
avec les afteurs. G’eft-là ce qui diftingue eflentiel-
lement le poëme en aCtion du poëme en récit. Les
François au fpeûacle d'Athalie doivent devenir
Ifraélites, ou l’intérêt de Joas n’eft plus rien. Mais s’il
y avoit trop loin des moeurs des Ifraélites à celles
des François, Fimagination des fpe&ateursrefuferoit
de franchir l’intervalle: c’eft donc aux Ifraélites à
s’approcher affez de nous pour nous rendre le déplacement
infenfible.
Il n’y a point de déplacement à opérer pour les
chofes que la nature a rendu communes à tous les
peuples, 6c on peut voir aifémént, par l’étude de
l ’homme, quelles font celles de fes affections qui
ne dépendent ni des tems ni des lieux : l’intérêt
puifé dans ces fources eft intariffable comme elles.'
Les fujets A'OEdipe 6c de Mérope réuffiroient dans
vingt mille ans, 6c aux deux extrémités du monde ;
il ne faut être pour s’y intéreffer ni de Thebes ni
.de Micene: la nature eft de tous.les pays:
C’eft dans les chofes où les nations different
qu’il faut que l’a£leur d’un cô té, le fpe&ateur de
l ’autre, s’approchent pour fe réunir. Cela dépend
de l’art avec lequel le poëte fait adoucir, dans la
peinture des moeurs , les couleurs dures 6c tranchantes
; c’eft ce qu’a fait Corneille en homme de
génie, quoi qu’en dife M. Racine le fils.
Il croit avoir vu que la belle fcene de Pompée
avec Ariftie, dans Sertorius, n’étoit pas affez vrai-
femblable pour le plus grand nombre des fpeCta-
teurs; il croit avoir vu qu’on trou voit trop dur fur
notre théâtre le langage magnanime que tient Cor-
nélie.à Céfar. Pour moi je n’ai vu que de l’enthou-
fiafme, je n’ai entendu que des appfeudiffemens à
ces deux fcenes inimitables. Il feroit à fouhaiter que
l’illuftre Racine eût ofé donner à la peinture des
moeurs étrangères , cette vérité dont il a fait fi noblement
lui-même l’éloge le plus éloquent. Tout
ce qu’on doit aux moeurs de fon fiecle , c’eft de ne
pas les offenfer ; 6c nos opinions fur le courage 6c
fur le mépris de la mort, ne vont pas jufqu’à exiger
d’une jeune fille qu’elle dife à fon pere :
D ’un oeil aufji content, d’un coeur aujji fournis
Quej acceptois T époux que vous m’aviez promis ,
Je f aurai, s’il le faut, victime obéijfante ,
Tendre au fer de Calcas une tête innocente.
Je fuis même perfuadé qu’Iphigénie allant à la mort
d’un pas chancelant, avec la répugnance naturelle
à fon fexe 6c à fon âge, eût fait verfer encore plus
de larmes.
Il eft vrai que fi le fond des moeurs étrangères
eft indécent ou révoltant pour nous, il faut renoncer
à les peindre. Ainfi, quoique certains peuples
regardent comme un devoir pieux d’abréger les
jours des vieillards fouffrans; que d’autres foient
dans l ’ufage d’expofer les enfans mal fains; que
d’autres préfentent aux voyageurs leurs femmes
& leurs filles pour en ufer félon leur bon plaifir ;
rien de tout cela ne peut être admis fur la fcene.
C O N
Mais fi le fond des moeurs eft compatible avec
nos opinions, nos ufages, 6c que la forme feule y
répugne, elles n’exigent dans l ’imitation qu’un
changement fuperficiel; 6g. il eft facile d’y concilier
la vérité avec la bienféance. Un cartel dans les
termes de celui de François premier à Charles-
Quint, «vous en avez menti par la gorge » , ne
feroit pas reçu au théâtre ; mais qu’un roi y dît à
fon égal : « au lieu de répandre la fang de nos fujets
» prenons pour juges nos épées » ; le cartel feroit
dans la vérité des moeurs du vieux tems, 6c dans
la décence des nôtres.
Il y a peu de traits dansl’hiftoire qu’on ne puiffe
adoucir de même fans les effacer: le théâtre en offre
mille exemples. Ge n’eft donc pas au goût de la
nation que l’on doit s’en prendre, fi les moeurs, fur
la fcene françoife, ne font pas affez prononcées,
mais à la foibleffe ou à la négligence des poëtes,
à la délicateffe timide de leur goût particulier, & ,
s’il faut le dire , au manque de couleurs pour tout
exprimer avec la vérité locale. (AL Ma rm o n te l .)
§ CONVENANT, ( Hifi. mod.) Dicî. raif. des
Sciences, &C. T. lV t pag. /(f/ ; 6c COVENANT,
( Hijl. mod. cCAngl, ) même Tome'p. 324, font le
I même article inutilement doublé. ( C. )
CONVERSION d é s D e g r é s , en Aflrohomie, fe
dit de l’opération par laquelle on convertit les dé-
grés en tems, ou les temps en dégrés. Le mouvement
diurne, qui s’acheve en 14 heures, & par lequel
360** delafphere traverfentle méridien, étant
en 24 parties, chacune.vaut une heure & répond
à 1 5d ; car 1 cd foqt la 24e partie de 36p. En continuant
de fubdivifer, on pourra trouver de même
les parties du tems qui' répondent aux parties du
cercle ; i d vaudra 4' de tems ; T de dégré vaudra
4" de tems.
De même pour convertir le tems du premier mobile
en dégrés, on prendra d’abord 1 çd pour chaque
heure; on prendra le quart des minutes de
tems pour, en faire des dégrés ; le quart des fécondés
& Fon en fera des minutes ; le quart des tierces de-
tems, & l’on en fera des fécondés de dégrés.
Cette pratique çft fondée fur ce que les arcs de ,
l’équateur font la mefure la plus naturelle du tems.
Quand le foleil eft éloigné du méridien de 1 5d, il eft
une heure ; aufîi le tems vrai , ’ou l’heure vraie dans
le fens précis 6c exaCt de l’aftronomie, n’eft autre
chofe que l’arc de l’équateur, compris entre le méridien
&c le cerclé de déclinaifon qui paffe par le
foleil, converti en tems , à raifon de i5 d par
heure.
La converjîon des'dégrés fe fait aufîi dans certains
ca s , en heures folaires moyennes : cela fuppofe
qu’on prenne 24 heures pour 3<Sod 59t'8//, ou 1 <rd
2' 28" par heure. Les 24 heures repondent à 360e1
59' 8W, puifqu’en 24 heures folaires moyennes, non
feulement une étoile revient au méridien, ce qui
complette les 360e1 , mais le foleil lui-même qui
âvoit fait 59' 8" en fens contraire, y arrive à fon
tour, ce qui termine les 24 heures folaires moyennes.
Une horloge réglée fur ces 24 heures, n’indique plus
i5 d. par heure, mais i5 d 2' 2 8 " , qui eft la 24e partie
de 36od 59' 8" qui paffent en 24 heures, & àinfi
des autres parties du tems ; c’eft ce qu’on appelle
convertit les heures folaires moyennes en dégrés. On
trouve dans la Connoijfance des tems de chaque année,
une table pour cet effet ; elle eft d’un ufage continuel
pour les aftronomes, dont les horloges fui-
vent les heures folaires moyennes ; car ils obfer-
vent les différences d’afeenfion droite , en prenant
pour chaque heûre de leur horloge 1 5d 2' 28" de la
fphere étoilée.
Çonverfions, fe dîfoit aufîi, dans l’ancienne A ffame
ƒƒ,
C O N 587
tronamie, de toutes les févoltttious câefles. ( M. du
l a La n d e .') v
* § CO N V IV E .... « Les ombres étoient amenés
»par les convives, tels qu’étoient chez Nafidienus
- » unNomentanus , un Vifcus Thurinus , un Varius
» « l e s autres, quos Mecenas adduxerat timbras ».
On s apperçoit aifement en lifant la fatyre huitième
du deuxieme livre d’Horace, que Nômentanus
Thurinus &c Varius n’étoient nullement les ombres
de Mécenas; Ses ombres , félon Horace , étoient
Servilius Balatro & Vibidius. Aloecenas hos duos,
dit un célébré commentateur, etfià Nafdie no mi-
nimè invitatos, fecum adduxerat. ( Lettres fur F Encyclopédie.
)
* § CONVOCATION........ afemblée Au clergé
de UEglife Anglicanne........Elle a été tranfportée à
S. Pierre de Wtjlminfler dans la chapelle d’Henri VIII.
Lifez Henri VII. ( Lettres fur l’Encyclopédie. )
^ CONVULSION, f . f. (MeV. ) e’eft une contraction
violente & involontaire de tout le corps ou de
quelques-unes dè fes parties. On doit diftinguerla
convuljîon des mouvemens convulfifs : dans le premier
cas, les parties demeurent fixes & immobiles
; dans le fécond, elles font agitées par des fe-
couffes plus ou moins violentes. Les mouvemens
convulfifs entraînent prefque toujours la perte de
la connoiffance ; on la conferve, au contraire
affez communément dans la convuljion : la refpira-
tion, dans 1 un & 1 autre cas, foufffe peu ; mais le
pouls eft le plus fouvent obfcur, & quelquefois
febrile. On fait que ces maladies peuvent être générales
, ou particulières ; & perfonne n’ignore
que les mufclës en font le fiege : leur durée eft
toujours très-incertaine ; mais elles ont quelquefois
des retours très-réguliers, de même que la fievre
intermittente ; ce qu’on obfervè affez fouvent à
celles dont le caraaere eft hyftëriquè.
Les malades ne peuvent dans la plupart dés con-
vulfions, ni parler ni agir , ou tombent dans ^
une efpecè d’âffe£tion comatèufe , qiii peut durer
plus d’un mois; mais' quélqués-üns, dans cet
état, voient & entendent tout, & en cdnfèrvent
même le fouvèriir. Nous avons dit qu’il n’en étoit
pas de même dès mouvemens convulfifs, qui privent
ordinairement de tous les fens : les convul-
jîoris de l’iïnë & de l’autre ëfpece font fouvent annoncées
par des éblouiffemens , & lë tintement
d’oreille; par des bâillemens, des pandiculations
& des tremblemens ; par des anxiétés, dés cardial-
gies & des naufées ; par des palpitations & le dé-
lordre du pouls ; par un froid, ou un fourmillement
aux pieds ; par l’apparëncë d’un air froid, qui du
coccyx monte le long de l’épine ;. par là tenfion
.‘des hypocondres, la conftriétion violente de l’anus
du col de la veffie, &c. Après l’accès lès malades fe
fentent brifés & moulus : quelques-uns ont des défaillances
ou tombent dans un profond fommeil *
d’autres relient avec dès engourdiflëmens : il y en
a qui le. tèrminènt par des cris ou des hurlemens;
plufieurs enfin fouffrent, pèndant l’accès , un pria-
pifme violent, qui ne ceffe pas même après la
mort.
Tout le monde fait que les femmes & les enfans,'
les hyftériques & les hypocondriaques font les plus
fujets aux convuljions : l’amour inienfé, tant dans
la fpéculation , que dans la pratique , la peur &
les autres pallions de l’âme y donnent fouvent lieu.
Elles précèdent quelquèfôis l’éruption des réglés,
ou font la fuite de leur fuppréffion, des accoucHe-
mens laborieux & des, fauffes couches. Les viclens
efforts du vomiffemertt, & les purgatifs draftiques ;
la fuppréffion & la rétention des urines, celle de la
femençe ; les vers fur-tout des enfans ; la piqûur«