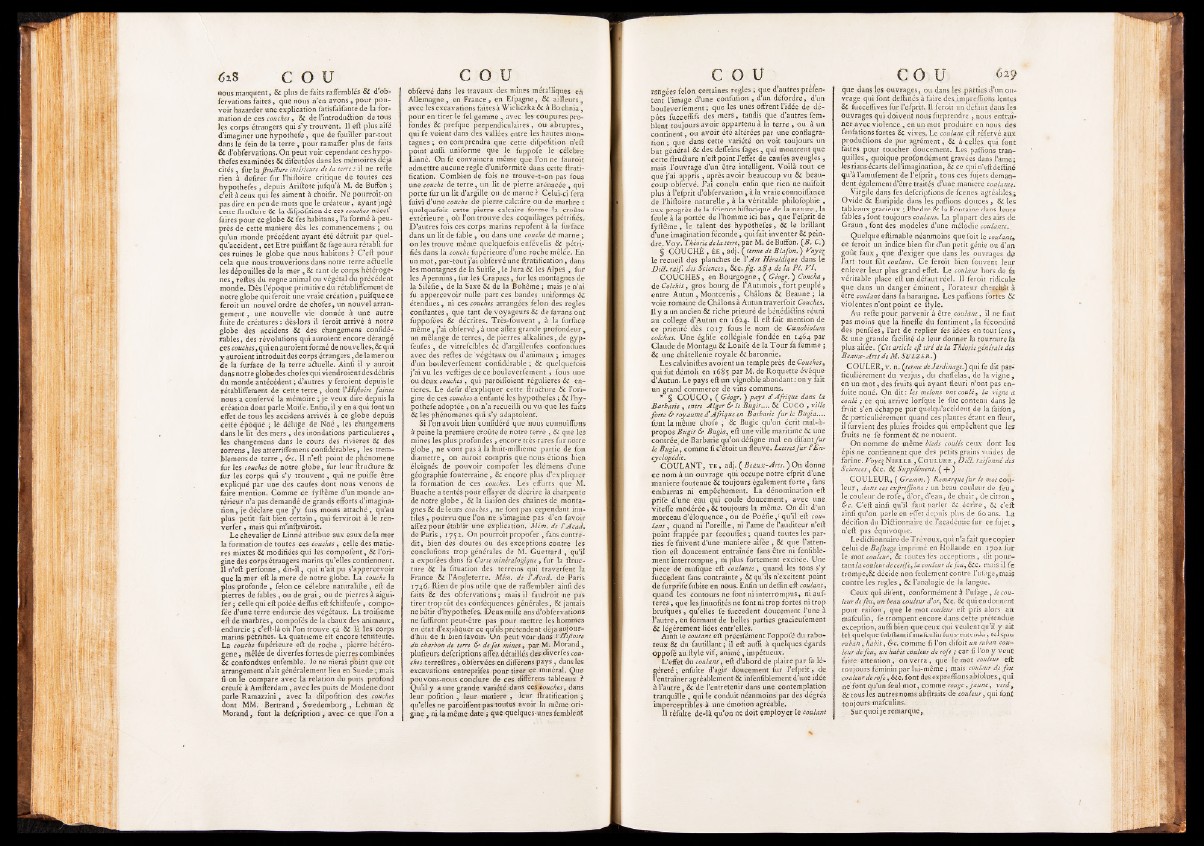
6z8 c o u
nous manquent, & plus de faits raffembles & d ob-
fervations faites, que nous n’en avons, pour pouvoir
hazarder une explication fatisfaifante de la formation
de ces couches, & de l’introduâion de tous
les corps étrangers qui s’y trouvent. Il eft plus ailé
d’imaginer une hypothefe, que de fouiller par-tout
dans le fein de la terre , pour ramaffer plus de faits
& d’obfervarions. On peut voir cependant ces hypo-
thefes examinées & difeutées dans les mémoires déjà
cités , fur la Jlruclure intérieure de la terre : il ne relie
rien à defirer fur l’hiftoire critique de toutes ces
hypothefes , depuis Ariftote jufqu’à M. de Buffon ;
c’ellàceux qui les aiment à choifir. Ne pourroit-on
pas dire en peu de mots que le créateur, ayant jugé
cette ftruâure & la difpofirion de ces couches nécel-
faires pour ce globe & les habitans, l’a formé à-peu-
près de cette maniéré dès les commencemens ; ou
qu’un monde précédent ayant été détruit par quel-
qu’accident, cet Etre puiffant & fage aura rétabli fur
ces ruines le globe que nous habitons } C’eft pour
cela que nous trouverions dans notre terre aâuelle
les dépouilles de la mer , & tant de corps hétérogènes,
reftes du régné animal ou végétal du precedent
monde. Dès l’époque primitive du rétabliffement de
notre globe qui feroit une vraie création, puifque ce
feroit un nouvel ordre de chofes, un nouvel arrangement
, une nouvelle vie donnée à une autre
fuite de créatures : dès-lors il feroit arrivé à notre
globe des accidens & des changemens confîdé-
rables, des révolutions qui auroient encore dérangé
ces couches y qui en auroient formé de nouvelles, & qui
y auroient introduit des corps étrangers, de la mer ou
de la furface de la terre aâuelle. Ainfi il y auroit
dans notre globe des chofes qui viendraient des débris
du monde antécédent ; d’autres y feraient depuis le
rétabliffement de cette terre , dont VHiJioire fainte
nous a confervé la mémoire ; je veux dire depuis la
création dont parle Moïfe. Enfiû, il y en a qui font un
effet de tous les accidens arrivés à ce globe depuis
cette époque ; le déluge de N o é , les changemens
dans le lit des mers , des inondations particulières ,
les changemens dans le cours des rivières & des
torrens , les atterriffemens confidérables, les trem-
blemens de terre , &c. Il n’eft point de phénomène
fur les couches de notre globe, fur leur ftruâure &
fur les corps qui s’y trouvent, qui ne puiffe être
expliqué par une des caufes dont nous venons de
faire mention. Comme ce fyftême d’un monde antérieur
n’a pas demandé de grands efforts d’imagination
, je déclare que j’y fuis moins attaché, qu’au
plus petit fait bien certain, qui ferviroit à le ren-
verfer , mais qui m’inftruiroit.
Le chevalier de Linné attribue aux eaux de la mer
la formation de toutes ces Couches, celle des matières
mixtes & modifiées qui les compofent, & l’origine
des corps étrangers marins qu’elles contiennent.
Il n’ eft perfonne , dit-il, qui n’ait pu s’appercevoir
que la mer eft la mere de notre globe. La couche la
plus profonde , félon ce célébré naturalifte, eft de
pierres de fables , ou de grai, ou de pierres à aigui-
ler ; celle qui eft polée deffus eft fehifteufe, compo-
fée d’une terre endurcie des végétaux. La troifieme
eft de marbres, compofés de la chaux des animaux,
endurcie ; c’eft-là oit l’on trouve çà & là les Corps
marins pétrifiés. La quatrième eft encore fehifteufe.
La couche fupérieure eft de roche , pierre hétérogène
, mêlée de diverfes fortes de pierres combinées
& confondues enfemble. Je ne nierai point que cet
arrangement n’ait généralement lieu en.Suede ; .mais
fi on le compare avec la relation du puits profond
creufé à Amuerdam, avec les puits de Modehedont
parle Ramazzini, avec la difpofirion des couches
dont MM. Bertrand , Swedemborg , Lehman &
Morand, font la description , avec ce que l’on a
C O U
obfervé dans les travaux des mines métalliques eh
Allemagne, en France, en Efpagne, & ailleurs,
avec les excavations faites à Wieliczka & à Bochnia,
pour en tirer le fel gemme , avec les coupures profondes
& prefque perpendiculaires , ou abruptes,
qui fe voient dans des vallées entre les hautes montagnes
; on comprendra que cette difpofirion n’eft
point aufli uniforme que le fuppofe le célébré
Linné. On fe convaincra même que l’on ne fauroit
admettre aucune réglé d’uniformité dans cette ftrati-
fication. Combien de fois ne trouve-t-on pas fous
une couche de terre, un lit de pierre arénacée , qui
porte fur un lit d’argille ou de marne ? Celui-ci fera
fuivi d’une couche de pierre calcaire ou de marbre :
quelquefois cette pierre calcaire forme la croûte
extérieure , oh l’on trouve des coquillages pétrifiés-
D ’autres fois ces corps marins repofent à la furface
dans un lit de fable , ou dans une couche de marne ;
on les trouve même quelquefois enfévelis & pétrifiés
dans la couche fupérieure d’une roche mêlée. En
un mot, par-tout j’ai obfervé une ftratification, dans
les montagnes de la Suiffe, le Jura & les Alpes , fur
les Apennins, fur les Crapacs, fur les montagnes de
la Siléfie, de la Saxe & de la Bohême ; mais je n’ai
fu appercevoir nulle part ces bandes uniformes &
étendues, ni ces couches arrangées félon des réglés
confiantes, que tant de voyageurs & de favans ont
fuppofées & décrites. Très-fouvent , à la furface
même, j’ai obfervé , à une affez grande profondeur ,
un mélange de terres, de pierres alkalines, de gyp-
feufes, de vitrefcibles & d’argilleufes confondues
avec des reftes de 'végétaux ou d’animaux ; images
d’un bouleverfement confidérable ; & quelquefois
j’ai vu les veftiges de ce bouleverfement , fous une
ou deux couches , qui paroiffoient régulières & entières.
Le defir d’expliquer cette ftruâure & l’origine
de ces couches a enfanté les hypothefes ; & l’hy-
pothefe adoptée , on n’a recueilli ou vu que les faits
& les phénomènes qui s’y adaptoient.
Si l’on avoit bien çonfidéré que nous connoiffons
à peine la première croûte de notre terre , & que les
mines les plus profondes , encore très-rares fur notre
globe, ne vont pas à la huit-millieme partie de fon
diamètre , on auroit compris que nous étions bien
éloignés de pouvoir compofer les élémens d’une
géographie fouterraine, & encore plus d’expliquer
la formation de ces couches. Les efforts que M.
Buache a tentés pour effayer de décrire la charpente
de notre globe, & la liaifon des chaînes de montagnes
& de leurs couches, ne font pas. cependant inutiles
, poiïrvu que l’on ne s’imagine pas d’en fa voir
affez pour établir une explication. Mém. de U Acad.
de Paris, 17 52. On pourrait propo fer , fans contredit,
bien des doutes ou des exceptions contre les
conclufions trop générales de M. Guettard , qu’il
a expofées dans fa Carte minéralogique, fur la ftruc-
ture & la fituation des terreins qui traverfent la
France & l’Angleterre. Mém. de T Acad, de Paris
1746. Rien de plus utile que de raffembler ainfi des
faits & des obfervations ; mais il faudrait -ne pas
tirer trop tôt des cônféquences générales, & jamais
ne bâtir d’hypôthefes. Deux mille ans-d’ob fer varions
ne fuffiront peut-être pas pour mettre les hommes
en état d’expliquer ce qu’ils prétendent déjà aujourd’hui
de fi bienfavoir. On peut voir dans VHiJioire
du charbon de terre & de fes mines y par.M. Morand ,
plufieurs deferiptions affez détaillés des diverfes cou-
cé«;terreftres, ©bfer.vées en différens pa ys , dans les
excavations entreprifes pour tirer ce minéral. Que
.pôuv'onsmous conclure de ces différens tableaux ?
Qu’il y a une grande variété >dans cessouches, dans
leur pofition , .leur matière , fleur «ratification ;
qu’elles ne paroiffent pasToutes avoir la même origine
, ni la même date ; que quelques-unes femblenî
§•!
il
c o u
rangées feîdn certaines réglés ; que d’autres présentent
rimage d’une confufion , d’un défqrdre, d’un
bouleverfement ; que les unes offrent l’idée de dépôts
fuccelfifs des mers, tandis que d’autres fem-
blent toujours avoir appartenu à la terre , ou à un
continent, ou avoir été altérées par une conflagration;
que dans cetté variété on voit toujours un
but général & des deffeins fages, qui montrent que
cette ftruâure n’eft point l’effet de caufes aveugles,
mais l’ouvrage d’un être intelligent. Voilà tout ce
que j’ai appris , après avoir beaucoup vu & beaucoup
obfervé. J’ai conclu enfin que rien ne nuifoit
plus à I’efprit d’obfervation, à la vraie connoiffance
de l’hiftoire naturelle, à la véritable philofophie ,
aux progrès de la fcience hiftorique de la nature, la
feule à la portée de l’homme ici bas, que l’efprit de
fyftême, le talent des hypothefes, 6c le brillant
d’une imagination féconde, qui fait inventer & peindre.
Voy. Théorie de la terre, par M. de Buffon. (B. C.)
§ COUCHÉ , ÉE, adj. ( terme de Blafon. ) Vlye^
le recueil des planches de l'Art Héraldique dans le
Dïcl. raif. des Sciences, SiCifg. Z84 de la PI. VI.
COUCHES, en Bourgogne, ( Géogr. ) Conclut,
de Colchis, gros bourg de lAutunois, fort peuplé,
entre Autun, Montcenis , Châlons & Beaune ; la
voie romaine de Châlons à Autun traverfoit Couches.
Il y a un ancien & riche prieuré de bénédiâins réuni
au college d’Autun en 1614. Il eft fait mention de
ce prieuré dès 1017 fous le nom de Coenobiolum
colchas. Une églife collégiale fondée en 1464 par
Claude de Montagu & Louife de la Tour fa femme ;
& une châtellenie royale & baronnie.
Les calviniftes avoient un temple près de Couches,
qui fut démoli en 1685 par M. de Roquette évêque
d’Autun. Le pays eft un vignoble abondant: on y fait
un grand commerce de vins communs.
* § COU C O , ( Géogr. ) pays £ Afrique dans la
Barbarie , entre Alger & le Bugir.... & C u c o , ville
forte & royaume £ Afrique en Barbarie fur le Bugia....
font la même chofe ; ôc Bugie qu’on écrit mal-à-
propos Bugir & Bugia, eft une ville maritime & une
contrée. de Barbarie qu’on défigne mal en difant fur
le Bugia, comme fi c’étoit un.fleuve. Lettresfur £ Encyclopédie.
COULANT, TE, adj. ( Beàux-Àrts.) On donne
ce nom à un ouvrage qui occupe notre efprit d’une
maniéré foutenue & toujours également forte, fans
embarras ni empêchement. La dénomination eft
prife d’une eau qui coule doucement, avec une
vîteffe modérée, & toujours la même. On dit d’un
morceau d’éloquence, ou de Poéfie,: qu’il eft coulant
, quand ni l’oreille, ni l’ame de l’auditeur n’eft
point frappée par fecouffes ; quand toutes les parties
fe fuivertt d’une maniéré aifée , & que l’attention
eft doucement entraînée fans être ni fenfible-
ment interrompue, ni plus fortement excitée. Une
piece de mufique eft coulante, quand les tons s’y
luccedent fans contrainte, & qu’ils n’excitent point
de furprife fubite en nous. Enfin un deflin eft coulant,
quand les contours ne font ni interrompus, ni auf-
teres, que les finuofités ne font ni trop fortes ni trop
brufques, qu’elles fe fuccedent doucement l’une à
l’autre, en formant de belles parties gracieulement
& légèrement liées entr’elles.
Ainfi le coulant eft précifément l’oppofé du raboteux
& du fautillant ; il eft aufli à quelques égards
ôppofé au ftyle v if, animé, impétueux.
L’effet du coulant, eft d’abord de plaire par fa légèreté
; enfuite d’agir doucement fur l ’efprit, de
l’entraîner agréablement & infenfiblement d’ime idée
à l’autre, & de l’entretenir dans une contemplation
tranquille , qui le conduit néanmoins par des dégrés
imperceptibles-à une émotion agréable.
11 réfulte de-là qu’on ne doit employer le coulant
C O U
que dans les ouvrages, ou dans les patries d’un ouvrage
qui font deftinés à faire desimpreffions lentes
& luçcelîives fur l’efprit. Il feroit un défaut, dans les
ouvrages qui doivent noiis furprendre * nous entraîner;
avec violence , en un mot produire en nous, des
fenfations fortes & vives. Le coulant eft réfervé aux
produâions de pur agrément,’ &. à celles qui lqnt
faites pour toucher doucement. Les pallions tranquilles.,
quoique profondément gravées dans l’ame;
les rians écarts de l’imagination, & ce qui n’eft deftiné
qu’à l’amufement de l’efprit, tous ces fujets demandent
également d’être traités d’une maniéré coulante*
Virgile dans fes deferiptions de feenes agréables,;
Ovide & Euripide dans les pallions douces, & les
tableaux gracieux ; Phedre & la Fontaine dans leuçs
fables » font toujours çoulans. La plupart des airs de
Graun , font des modèles d’une mélodie coulante.
Quelque eftimable néanmoins que foit lq coulant,*
ce feroit un indice bien fur d’un petit génie ou d’un
goût faux, que d’exiger que dans les ouvrages dp
l’art tout fût coulant. Ce feroit bien fouvent leur
enlever leur plus grand effet. Le coulant hors de fa,
véritable place eft un défaut réel. Il feroit ridiculp
que dans Un danger éminent, l’orateur cherchât à
être coulant dans fa harangue. Les pallions fortes ÔC
violentes n’ont point ce ftyle.
Au refte pour parvenir à être coulant, il ne faut
pas moins que la fineffe du fentiment, la fécondité
des penfées * l’art de replier fes idées en topt fens,
& une grande facilité de leur donner la tournure la
plus aifée. (Cet article efi tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. SuLZER.')
COULER, v. n. ( terme de Jardinage.) qui fe dit particuliérement
du verjus-, du ehaffelas, de la v igne,
en un mot, des fruits qui ayant fleuri n’ont pas en-
fuite noué. On dit : les melons ont coulé, la vigne a
coulé ; Ce qui arrive lorfque le fue contenu dans le
fruit s’en échappe par quelqu’accident de lafaifon,
& particuliérement quand ces plantes étant en fleur,
il furvient des pluies froides qui empêchent que les
fruits he fe forment & ne nouent.
On nomme de même bleds coulés ceux dont les
épis ne contiennent que des petits grains vu ides de
farine. Voye{Nielle , Coulure, Dicjf. raifonné des
Sciences, &c, & Supplément. ( + )
COULEUR, ( Granitn. ) Remarque fur leihot cou-'
leur, dans ces exprejjions : un beau couleur de feu
le couleur de tofe, d’or, d’eau, de chair, de citron ,
&c. C ’eft ainfi qu’il faut parler & écrire, & c’eft
ainfi qu’on parle en effet depuis plus de 60 ans. La
décifion du Diâionnaire de l’académie fur ce fujet,
n’eft pas équivoque.
Le diâionnaire de Trévoux, qui n’a fait que copier
Celui de Bafnage imprimé en Hollande en 1702 fut
le mot couleur, & toutes fes acceptions , dit pourtant
Az couleur dé ceriftyla couleur de feu, &c. mais il fis
trompe,& décide non feulement contre l’ulage,mais
contre les réglés, & l’analogie de la langue.
Ceux qui dilent, conformément à l’ufage , le couleur
de fïu, un beau couleur £ or, & c. & qui ën donnent
pour raifon, que lé mot couleur eft pris alors ait
mafeulin, fe trompent encore dans Cette prétendue
exception, aufli bien que ceux qui veulent qu’il y ait
ici quelque fubftantif mafeulin fous-entendu, tel que
ruban, habit, &c. comme fi l’on difoit un ruban cou-
leur de feu, un habit couleur de rofe ; car fi l’on y veut
fàire attention , on Verra, que le mOt^couleur eft
toujours féminin par lui-même ; mais couleur de feu
couleur de rofe, &c. font des expreflioos abfolues, qui
né font qu’un feul mot, comme rouge, jaune, verd,
& tous les autres noms abfiraits de couleur, qui font
toujours mafculinS..
Sur quoi je remarque,