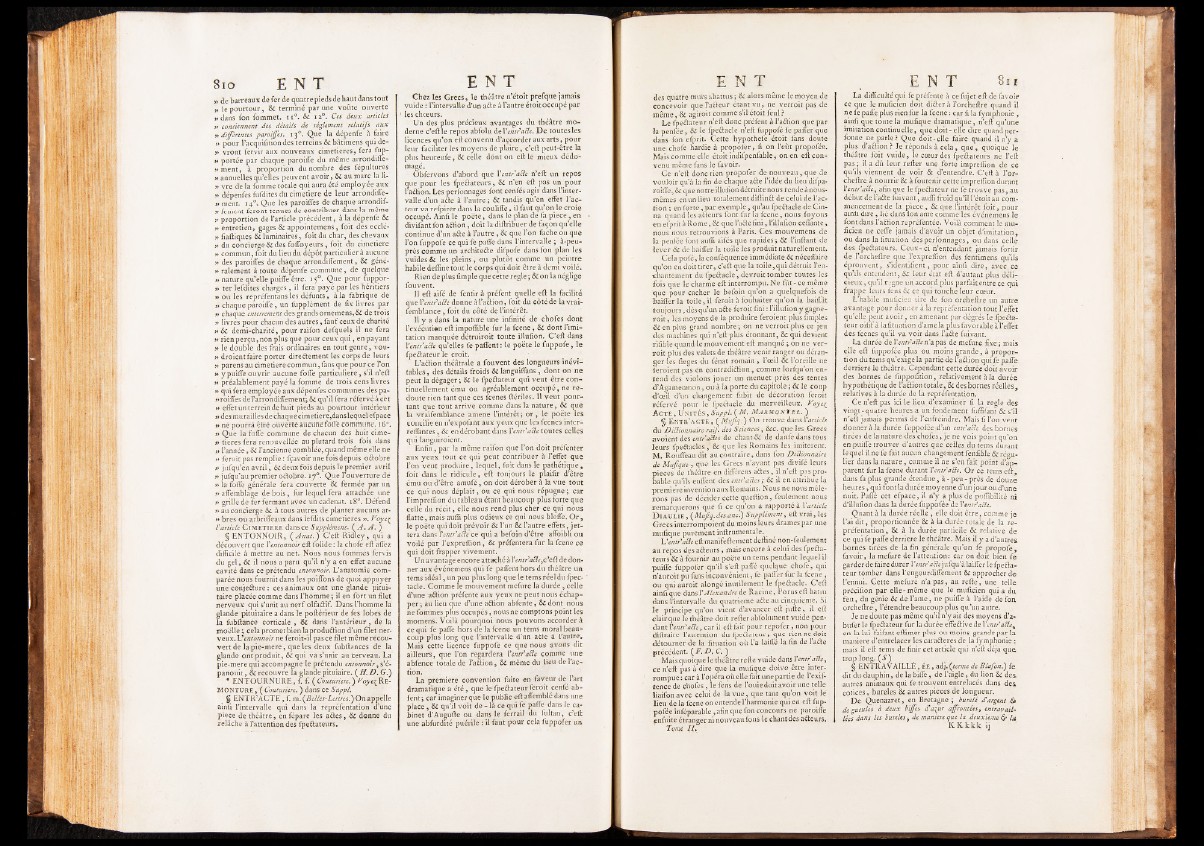
810 E N T
» de barreaux de fer de quatre pieds de haut dans tout
„ le pourtour, Si terminé par une voûte ouverte
»dans fon fommet. i i °. Si n ° . Ces deux articles
» contiennent des details de reglement relatifs aux
»différentes paroiffes. 13°* Que la depenfe à faire
» pour Tacquifition des terreins Si bâtimens qui de-
>♦ vront fervir aux nouveaux cimetières, fera fup-
» portée par chaque paroiffe du même arrondiffe-
»ment, à proportion du nombre des fepultures
» annuelles qu’ elles peuvent avoir, Si au'marc la li-
» vre de la fomme totale qui aura été employée aux
» dépenfes fufdites du cimetiere de leur arrondiffe-
» ment. 140. Que les paroiffes de chaque arrondif-
» fement feront tenues de contribuer dans la même
» proportion de l’article précédent, à la dépenfe Si
» entretien, gages Si appointemens, foit des ecelé-
» fiaftiques Si luminaires, foit du char, des chevaux
» du concierge Si des foffoyeurs, foit du cimetiere
» commun, foit du lieu du dépôt particulier à aucune
» des paroiffes de chaque arrondiffement, Si géné-
» râlement à toute dépenfe commune, de quelque
» nature qu’elle puiffe être. 1 50. Que pour fuppor-
» ter lefdites charges , il fera payé par les héritiers
» ou les repréfentans les défunts, à la fabrique de
» chaque paroiffe, un fupplément de fix livres par
» chaque enterrement des grands ornemens,& de trois
» livres pour chacun des autres, fauf ceux de charité
» Si demi-charité, pour raifon defquels il ne fera
» rien perçu, non plus que pour ceux q ui, en payant
» le double des frais ordinaires en tout genre, vou-
» droient faire porter directement les corps de leurs
» parens au cimetiere commun, fans que pour ce l’on
» y puiffe ouvrir aucune foffe particulière, s’il n’eft
» préalablement payé la fomme de trois cens livres
» qui fera employée aux dépenfes communes des pa-
»roiffes de l’arrondiffement; Si qu’il fera réfervé à cèt
» effet un terrein de huit pieds au pourtour intérieur
» des murailles de chaque cimetiere,dans lequel efpace
» ne pourra être ouverte aucunefoffe commune. 160.
» Que la foffe commune de chacun des huit cime-
» tieres fera renouvellée au plutard trois fois dans
» l’année, & l’ancienne comblée, quand même elle ne
» feroit pas remplie : fçavoirune fois depuis o&obre
» jufqu’en avril, Si deux fois depuis le premier avril
» jufqu’au premier oriobre. 170. Que l’ouverture de
» la foffe générale fera couverte Si fermée par un
» affemblage de bois, fur lequel fera attachée une
» grille de ter fermant avec un cadenat. 180. Défend
» au concierge Si à tous autres de planter aucuns ar-
» bres ou arbriffeaux dans lefdits cimetières ». Voye^
V article C IM E T IER E dans ce Supplément. { A . A . )
§ ENTONNOIR, ( Anat. ) C’eft Ridley, qui a
découvert que l’entonnoir eft folide : la chofe eft affez
difficile à mettre au net. Nous nous fommes fervis
du g el, Si il nous a paru qu’il n’y a en effet aucune
cavité dans ce prétendu entonnoir. L’anatomie comparée
nous fournit dans les poiffons de quoi appuyer
une conjecture : ces animaux ont une glande pituitaire
placée comme dans l’homme ; il en fort un filet
nerveux qui s’unit au nerf olfaftif. Dans l’homme la
glande pituitaire a dans le poftérieur de fies lobes de
la fubftance corticale , & dans l’antérieur, de la
moelle ; cela promet bien la production d’un filet nerveux.
L'entonnoir ne feroit-il pas ce filet même recouvert
de la p ie-mere, que les deux fubltances de la
glande ont produit, Si qui va s’unir au Cerveau. La
pie-mere qui accompagne le prétendu entonnoir, s’épanouit
, & recouvre la glande pituiaire. ( H. D. G.)
* ENTOURNURE, f. f. ( Couturière.) t'oyezR e-
MONTüre , ( Couturière. ) dans ce Suppl.
% ENTR’A C T E , f. m. {Belles-Lettres.) On appelle
ainfi l’intervalle qui dans la repréfentation d’une
pièce de théâtre, en fépare les aCtes, Si donne du
relâche à l’attention des fpeCtateurs.
E N T
Chez les Grecs, le théâtre n’étoit prefqiïe jamais
vuide : l’intervalle d’un aCte à l’autre étoit occupé par
les choeurs.
Un des plus précieux avantages du théâtre moderne
c’eft le repos abfolu de Venir*acte. De toutes les
licences qu’on eft convenu d’açcorder aux arts, pour
leur faciliter les moyens de plaire, c’ eft peut-être là
plus heureufe, & celle dont on eft le mieux dédo-
magé.
Obfervons d’abord que Vent?acte n’eft un repos
que pour les fperiateurs, Si n’en eft pas un pour
Tariion. Les perfonnages font cenfés agir dans l’intervalle
d’un arie à l’autre ; Si tandis qu’en effet l ’acteur
va refpirer dans la couliffe, il faut qu’on le croie
occupé. Ainfi le poëte, dans le plan de fa piece, en
divifant fon ariion, doit la diftribuer de façon qu’elle
continue d’un arie à l’autre, Si que l’on fâche ou que
l’on fuppofe ce qui fe paffe dans l’intervalle ; à-peu-
près comme un architerie difpofe dans fon plan les
vuides Si les pleins, ou plutôt comme un peintre
habile deffinetout le corps qui doit être à demi voiléi
Rien de plus limple que cette réglé ; & on la néglige
fouvent.
Il eft aifé de fentir à préfent quelle eft la facilité
que Ventr*acte donne à Tariion, foit du côté de la vrai-
femblance, foit du côté de l’intérêt.
Il y a dans la nature une infinité de chofes dont
l’exécutien eft impoffible fur la fcene, Si dont l’imitation
manquée détruiroit toute illufion. C ’eft dans
Ventr acte qu’elles fe paffent : le poëte le fuppofe, le
fperiateur le croit. . , .
L’ariion théâtrale a fouvent des longueurs inévitables,
des détails froids & languiffans , dont on ne
peut la dégager ; Si le fperiateur qui veut être continuellement
ému ou agréablement occupé, ne redoute
rien tant que ces fcenes ftériles. Il veut pourtant
que tout arrive comme dans la nature, Si que
la vraifemblance amene l’intérêt ; o r , le poëte les
concilie en n’expofant aux yeux que les fcenes inter-
reffantes, Si en dérobant dans Vent?acte toutes celles
qui languiroient.
Enfin, par la même raifon que l’on doit préfenter
aux yeux tout ce qui peut contribuer à l’effet que
l’on veut produire, lequel, foit dans le pathétique,
foit dans le ridicule, eft toujours le plaifir d’être
ému ou d’être amufé, ôn doit dérober à la vue tout
ce qui nous déplaît, ou ce qui nous répugne ; car
l’impreffion du tableau étant beaucoup plus forte que
celle du récit, elle nous rend plus cher ce qui nous
flatte, mais auffi plus odieux ce qui nous bleffe. O r ,
le poëte qui doit prévoir Si l’un Si l’autre effets, jettera
dans Vent?acte ce qui a befoin d’être affoibli ou
voilé par l’expreffion, Si préfentera fur la fcene ce
qui doit frapper vivement.
Un avantage encore attaché à Ventr'acle,c ’eft de donner
aux événemens qui fe paffent hors du théâtre un
tems idéal, un peu plus long que le tems réel du fpec-
tacle. Gomme le mouvement mefure la durée, celle
d’une ariion préfente aux yeux ne peut nous échapper
; au lieu que d’une ariion abfente, Si dont nous
ne fommes plus occupés, nous ne comptons point les
momens. Voilà pourquoi nous pouvons accorder à
ce qui fe paffe hors de la fcene un tems moral beaucoup
plus long que l’intervalle d’un arie à l’autre.
Mais cette licence fuppofe ce que nous avons dit
ailleurs, que l’on regardera Vent?acte comme une
abfence totale de Tariion, Si même du lieu de l’action.
La première convention faite en faveur de l’art
dramatique a été, que le fperiateur feroit cenfé ab-
fent ; car imaginer que le public eft affemble dans une
place, & qu’il voit de - là ce qui fe paffe dans le cabinet
d’Augufte ou dans le ferrail du fultan, c’eft
une abfurdité puérile : il faut pour cela fuppofer un
E N T
des quatre mifts abattus ; Si alors même le moyen de
concevoir que Parieur étant v u , ne verroit pas de
même, Si agiroit comme s’il étoit feul ?
Le fperiateur n’eft donc préfent à l’ariion que par
la penfée, & le fperiacle n’eft fuppofé fe palier'que
dans fon efprit. Cette hypothefe étoit fans doute
une. chofe hardie à propofer, fi on l’eût propofée.
Mais comme elle étoit indifpenfable, on en eft convenu
même fans le favoir.
Ce n’eft donc rien propofer de nouveau, que de
vouloir qu’à la fin de chaque arie l’idée du lieu difpa-
roiffe, Si que notre illufion détruite nous rende à nous-
mêmes en un lieu totalement diftinri de celui de l ’action
; en forte, par exemple, qu’au fperiacle de Cin-
na quand les arieurs font fur la fcene, nous foyons
en efprit à Rome, Si que Parie fini, l’illufion ceffante,
nous nous retrouvions à Paris. Ces mouvemens de
la penfée font auffi ailes que rapides ; Si l’inftant de
lever Si de baiffer la toile les produit naturellement.
Cela pofé, la conféquence immédiate Si néceffaire
qu’on en doit tirer, c’eft que la toile, qui détruit l’enchantement
du fperiacle, devroit tomber toutes les
fois que le charme eft interrompu. Ne fût - ce même
que pour cacher le befoin qu’on a quelquefois de
baiffer la toile, il feroit à fouhaiter qu’on la baifl’ât
toujours, dès qu’un arie feroit fini : l’illufion y gagne-
ro it , les moyens de la produire feroient plus fimples
& en plus grand nombre; on ne verroit plus ce jeu
des machines qui n’eft plus étonnant, & qui devient
rifible quand le mouvement eft manqué ; on ne verroit
plus des valets de théâtre venir ranger ou déranger
les fxeges du fénat romain , l’oeil Si l’oreille ne
feroient pas en contradiriion, comme lorfqu’on entend
des violons jouer un menuet près des tentes
d’Agamemnon, ou à la porte du capitole ; Si le coup
d'oeil d’un changement fubit de décoration feroit
réfervé pour le fperiacle du merveilleux. Voye1
A c t e , Un it é s , Suppl. (M . Ma rm o n ^e l . )
§ Entr’acte , ( Mujiq. ) On trouve dans Varticle
du Dictionnaire raif. des Sciences, &c. que les GreCs
avoîent des entr’acies de chant Si de danfe dans tous
leurs fperiaclçs ,‘ Si que les Romains les imitèrent.
M. Rouffeaudit au contraire, dans fon Dictionnaire
de Mujîqùe, que les Grecs n’ayant pas divifé leurs
pièces de théâtre en différens aries, il n’eft pas probable
qu’ils euflènt des entr’acies ; Si il en attribue la
première inventionaux Romains. Nous ne nous mêlerons
pas de décider cette queftion, feulement nous
remarquerons que fi ce qu’on a rapporté à Varticle
D iaulie , (Mujiq.desanc.) Supplément, eft vrai, les
Grecs interrompoient du moins leurs drames par une
mufique purement inftrumentale. ^
Vent?acte eft manifellement deftiné non-feulement
au repos dçs arieurs, mais encore à celui des fperia-
teurs Si à fournir au poëte un tems pendant lequel il'
puiffe. fuppofer qu’il s’eft paffe quelque chofe, qui
n’auroit pu fans inconvénient, fe paffer fur la fcene ,
ou qui auroit alongé inutilement le fperiacle. C’eft
ainfi que dans VAlexandre de Racine, Porus eft batiu
dans l’intervalle du quatrième arie au cinquième. Si
le principe qu’on vient d’avancer eft jufte, il eft
clair que le théâtre doit refter abfolument vuide pendant
Vent?acte t car il eft fait pour repofer, non pour
diftraire l’attention du fperiateur, que rien ne doit
détourner de la fituation où l’a laiffé la fin de l’arie
précédent. ( F. D. C. ) ^
Mais quoique le théâtre refte vuide dans Ventr'acte,
ce n’eft pas à dire que la mufique doive être interrompue
: car à l’opéra 9Î1 elle fait une partie de l’exif-
tence de çhofes, le fens de l’ouie doit avoir une telle
liaifonavec celui de la vue, que tant qu’on voit lé
lieu de la fcene on entende l’harmonie qui en eft fup-
pofée inféparable, afin que fon concours ne paroiffe
tpnfuite étranger ni nouveau fous le chant des arieurs.
Tçm ç II*
E N T
La difficulté qui fe préfente à cefujet eft de lavoir
ce que le muficien doit difter à l’orcheftre quand il
ne fe paffe plus rien fur la fcene : car fi la fymphonie,
ainfi que toute la mufique dramatique, n’eft qu’une
imitation continuelle, que doit - elfe dire quand per-
fonne ne parle? Que doit-elle faire quand il n’y a
plus d’ariion? Je réponds à cela, que , quoique le
théâtre foit vuide, le coeur des fperiateurs ne l’eft
pas; il a dû leur refter une forte impreffion de ce
qu’ils viennent de voir & d’entendre. C’eft à l’orcheftre
à nourrir & à foutenir cette impreffion durant
Vent?acte, afin que le fperiateur ne fe trouve pas, au
début de Tarie fuivant, auffi froid qu’il l’étoit au commencement
de la piece , & que.l’intérêt foit, pour
ainfi dire, lié dans fon ame comme les événemens le
font dans l’ariion repréfentée. Voilà comment le muficien
ne ceffe jamais d’avoir un objet d’imitation,
ou dans la fituation des perfonnages, ou dans celle
des fperiateurs. C eux -ci n’entendànt jamais fortir
de l’orcheftre que i’expreffion des fentimens qu’ils
éprouvent, s’identifient, pour ainfi dire, avec.ee
qu’ils entendent, & leur état eft d’autant plus délicieux
, qu’il régné un accord plus parfait entre ce qui
frappe leurs fens & ce qui touche leur coeur.
L’habile muficien tire de fon orcheftre un autre
avantage pour donner à la repréfentation tout l’effet
qu’elle peut avoir, en amenant par dégrés le .fperiateur
o ififà la fituation d’amela plus favorable à l’effet
des fcenes qu’il va voir dans Tarie fuivant.
La durée de Vent?acte n’a pas de mefure fixe ; mais
elle eft fuppofée plus ou moins grande, à proportion
du tems qu’exige la partie de Tariion qui fe paffe
derrière le théâtre. Cependant cette durée doit avoir
des bornes de fuppofition, relativement à la durée
hypothétique de Tariion totale, & des bornes réelles ,
relatives à la durée de la repréfentation.
Ce n’eft pas ici le lieu d’examiner fi la réglé des
vingt-quatre heures a un fondement fuffifanr & s’il
n’eft jamais permis de Tenfréindre. Mais fi Ton veut
donner à la durée fuppofée ;d’un entr'acte des bornes
tirées de la nature des chofes , je ne vois ppint qu’on
en puiffe trouver d’autres .que celles du tems durant
lequel il ne fe fait aucun changement fenfible & régulier
dans la nature, comme il ne s’en fait point d’ap-,
parent fur la fcene durant Vent?acte. Or ce tems eft,
dans fa plus grande étendue,, à-peu-près de douze
heures, qui font la durée moyenne d’un jour ou d’une
nuit. Paffé cet efpace, il n’ÿ a plus de poffibilité ni
d’illufion dans la durée fuppofée de l'tnt?acte.
Quant à la durée réelle, elle doit être, comme je
l’ai dit, proportionnée & à la durée totale de la repréfentation
, & à la durée partielle & relative de
ce qui fe paffe derrière le théâtre. Mais il y a d’autres
bornes tirées de la fin générale qu’on le propofe,
favoir, la mefure de l’attention: car on doit bien fe
garder de faire durer Vent?acte jufqu’à laiffer le fperiateur
tomber dans l’engourdiffement & approcher de
l’ennui. Cette mefure n’a pas, au refte, une telle
précifion par elle-même que le muficien qui a du
feu, du génie & de l’ame, ne puiffe à l’aide de fon
orcheftre, l’étendre beaucoup plus qu’un autre.
Je ne doute pas même qu’il n’y ait des moyens d’a-»
bufer le fperiateur fur la durée efferiive de Vent?acte%
en la lui faifant eftimer plus ou moins grande par la
maniéré d’entrelacer les cararieres de la fymphonie :
mais il eft tems de finir cet article qui n’eft déjà que
trop long. (£ )
§ ENTRA VAILLÉ, ÉE, adj* (terme de B la fon?) fe
dit du dauphin, de la biffe, de l’aigle, du lion Si. des
autres animaux qui fe trouvent entrelacés dans des,
cotices, bureles Si autres pièces de longueur.
De Quenazret, en Bretagne ; burelé d!argent &
de gueules à deux biffes d'azur affrontées, entravait-
lies dans les bureles, de maniéré que la deuxieme 6* lu.
K K k k k ij