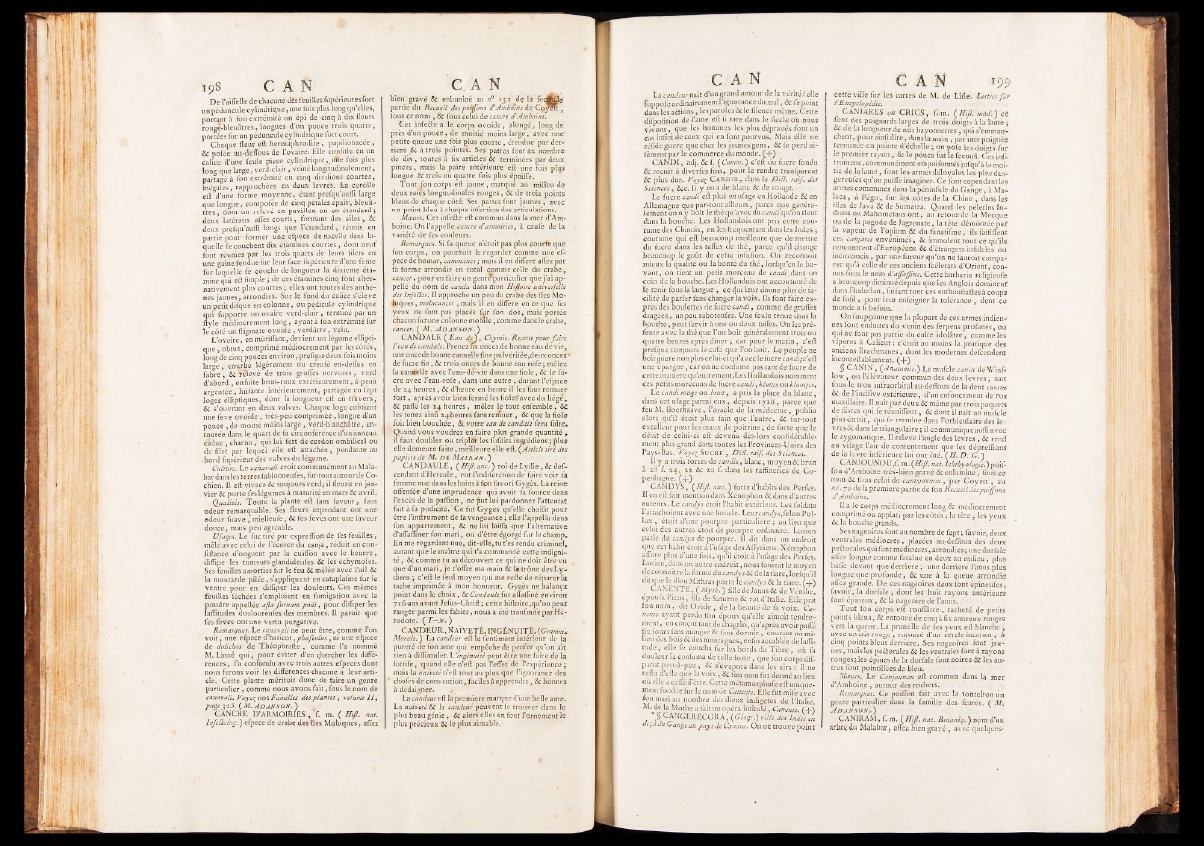
De l’aiffelle de chacune dès feuilles fupérieitres fort
un péduncule cylindrique, une fois plus long qu’elles,
portant à fon extrémité un épi de cinq à dix fleurs
rouge-bleuâtres, longues d’un pouce trois quarts,
portées fur un péduncule cylindrique fort' court.
Chaque fleur eft hermaphrodite, papilioriacée ,
& pofée au-deflous de l’ovaire. Elle confifte^ en un
calice d’une feule piece cylindrique,^i®e fois plus
long que large, verd-clair, veiné longitudinalement,
partagé à fon extrémité en cinq divifions courtes,
inégales, rapprochées en deux levre's. La corolle
eft d’une forme moyenne, étant prefqu’aufli large
que longue, compofée de cinq pétales épais*, bleuâtre
s , dont un relevé en pavillon ou en étendard}
deux latéraux allez courts , formant des ailes ,. Sc
deux prefqu’aufli longs que l’étendard, réunis en
partie pour former une efpece de nacelle dans laquelle
fe couchent dix étamines courtes, dont neuf
font réunies par les trois quarts de leurs filets en
une gaine fendue fur leur face fupérieure d’une fente
fur laquelle, fe couche de longueur la dixième étamine
qui eft Ample ; de ces étamines cinq font alternativement
plus courtes ; elles ont toutes dès anthe--
nes jaunes, arrondies. Sur le fond du calice s’élève
un petit difque en colonne, ou pédicule cylindrique
qui fupporte un ovaire verd-clair , terminé par un
ftyle médiocrement long , ayant à fon extrémité fur
le côté un ftigmate ovoïde , verdâtre, velu.
L’ovaire, en mûriffant, devient un légume elliptique
, obtus, comprimé médiocrement par les côtés,
long de cinq pouces environ, prefque deux fois moins
large courbé légèrement ou creufé en-deffus en
fabre , & relevé de trois groffes nervures, verd
d’abord , enfuite brun-roux extérieurement, à' peau
argentée , luifante intérieurement, partagée en fept
loges elliptiques, dont la longueur eft en travers,
& s’ouvrant en deux valves. Chaque loge contient
Une feve ovoïde , très-peu comprimée , longue dîun
pouce , de moitié moins large, verd-blancfiâtre, entourée
dans le quart de fa circonférence d’un anneau
caduc , charnu, qui lui fert de cordon ombilical ou
de filet par lequel elle eft attachée, pendante au
bord fupérieur des valves du légume^
Culture. Le cahavali croît communément au Malabar
dans les terres fablonneufes, fur-tout autour de Cochien.
Il eft vivace & toujours verd; il fleurit en janvier
& porte fes légumes à maturité en mars & avril.
Qualités. Toute la plante eft fans faveur, fans
odeur remarquable. Ses fleurs cependant ont une
odeur fuave , mielleufe, & fes feves ont une faveur
douce, mais peu agréable.
Urages. Le fuc tiré par expreflxon de fes feuilles,
mêlé avec celui de l’écorce du canja , réduit en con-
liftance d’onguent par la cuiflon avec le beurre,
diflïpe les tumeurs glanduleufes & les échymofes.
Ses feuilles amorties fur le feu & mêlée avec l’ail &
la moutarde pilée, s’appliquent en cataplafme fur le
ventre pour en difliper les douleurs. Ces mêmes
feuilles féchées s’emploient en fumigation avec la
poudre appellée ajla furnam podi, pour difliper lès
laflitudes douloureufes dès membres. 11 paroît que
fes feves ont une vertu purgative.
Remarques. Le canavali ne peut être, comme l’on
voit, une efpece d’haricot,/?A<z/èo/«s, ni une efpece
de dolickos de Théophrafte , comme l’a nommé
M. Linné qui, pour éviter d’en chercher les différences,
l’a confondu avec trois autres efpeces dont
nous ferons voir les différences chacune à leur article.
Cette plante méritoit donc de faire un genre
particulier , comme nous avons fait, fous le-nom de
canavali. Voye%_ nos Familles des plantes, volume I I ,
page $25. (M. A d AN s o n . )
CANCRE D’ARMOIRIES, f. m. ( Hift. nat.
Infeclolog. ) efpece de crabe des lies Moluques, affez
bien grâvé & enluminé au n° 132 dç la feqÉffide
partie du Recueil despoiffons cf Amboïne de Coy^ut 9
fous ce nom , & fous celui de cancre d’Amboinè.
Cet infefte a le corps ovoïde, àlongé, long de
près d’un pouce, de moitié moins large, avec une'
petite queue une fois glus courte, étendue par derrière
„& à trois pointes. Ses pattes font au nombre
de dix, toutes'à fix articles & terminées par deux
pinces, mais la paire antérieure eft une fois plus
longue & trois ou quatre fois plus épaiffe.
Tout fon cofps eft jaune, marque au milieu de
deux raies longitudinales rouges, & de trois points
bleus de chaque côté. Ses pattes font jaunes , avec
un point bleu à chaque infertion des articulations.
Moeurs. Cet infeéle eft commun dans la mer d’Am-
boine. On l’appelle cancre d'armoiries, à caufe de la
variété de fes couleurs.
Remarques. Si fa queue n’etoit pas plus courte que
fon corps, on pourvoit le regarder comme Une efpece
de homar, cammanes; mais il en diffère affez par
fa forme arrondie en total comme celle du crabe,
cancer t pour en faire'un genrepartieulier que j’ai ap-
pellé du nom de canda dans mon Hifioire univerfelle
des Infectes. Il approche un peu du crabe des îles Mo-
kiques, môlucancer , mais il en différé en ce que fes
yeux ne font pas placés fur fon dos, mais portés
chacun fur une colonne mobile, comme dans le crabe,
cancer. ( M. A d a n so n . )
CANDA LE ( 27. au def) , Chy mie. Recette pour faire
Veau de candale. Prenez fix onces de bonne eau de vie,
une oncede bonne cannelle fine pulvérifée,deux onces*
de fucre fin, & trois_onces de bonne eau rofe ; mêlez
la canaelle avec l’eau-d£vie dans une fioje, & le fifc
cre avec l’eau-rofe , dans une autre , durant l’efpace
de 14 heures, & d’heure en heure il les'faiit remuer
fo r t , après avoir bien fermé les fiole^avec du liège,
& paffé lès 14 heures, mêlez le tout enfemble, &c
les tenez ainfi 24fieuresfans remuer., & que la fiole
foit bien bouchée, & votre eau de candale fera faite.
- Quand vous voudrez en faire plus grande quantité ,
il faut doubler ou triplés- les fufdits ingrédiens ; £lus
elle demeure faite, meilleure elle eft; {Article tiré des
papiers de M. d e Ma ir a n . )
CANDAULE, ( Hijl.'anc. ) roi de L ydie, & défi
Cendant d’HercuIe, eut l’indifcrétion de faire voir fa1
femme nue dans les bains à fon favori Gygès. La reine
offenfée d’une imprudence qui avoit fa fource dans
l’excès de la paflïon , ne put lui pardonner l’attentat
fait à fa pudicité.*Ce fut G ygès qu’elle choilit pour
être l’inftrument de fa vengeance ; elle l’appella dans
fon appartement, & ne lui laifla que l’alternative
d’affafliner fon mari, ou d’être égorgé fur le champ.
En me regardant nue, dit-elle, tu t’es rendu criminel,
autant que le maître qui t’a commandé cette indignité
, & comme tu as découvert ce qui ne doit être vu
que d’un mari, je t’offre ma main & le trône des Lydiens
; c'eft le feul moyen qui me refte de réparer la
tache imprimée à mon honneur. Gygès ne balança
point dans le choix, & Candaule fut affafliné environ
7i6-ansavant Jefus-Chrift; cette hiftoire,qu’on peut
ranger parmi les fables, nous a été tranfmife par Hérodote.
( T—n . )
CANDEUR, NAÏVETÉ, INGÉNUITÉ, {Gramm*
Morale. ) La candeur eft le fentiment intérieur de la /
pureté de fon ame qui empêche de penfer qu’on ait
rien à diflimuler. L'ingénuité peut être une fuite de la
fottife, quand elle n’eft pas l’effet de l’expérience ;
mais la naïveté n’eft tout au plus que l’ignorance des
# chofes de convention, faciles à apprendre, & bonnes
à dédaigner.
La candeur eft la première marque d’une belle ame.
La naïveté & la candeur peuvent fe trouver dans le
plus beau génie, & alors elles en font l’ornement le
plus précieux 8c le plus aimable.
t a candeur naît d’un grand amour de la vérité,? elie
fuppofe ordinairement l’ignorance du mal, & fe peint
dans les aérions, les paroles & le fîlence mêifie. Cette
difpofition de l’ame eft fi rare dans le fieclepù nous
vivons, que- les hommes les plus dépravés font un
cas infini de ceux qui èn four pourvus. Mais elle ne
réfide guere que chez les jeunes gens, & fe perd ai-
fément par le commerce du monde. (+ )
C AN D I, àdj. & f. {Comm. ) c’eft du fucre fondu
& recuit à diverfes fois, pour le rendre tranfparent
& plus dur. Voye£ C a n d i R , dans le D i cl. rd i f de s
Sciences, &c. Il y en a de blanc & de rouge. :
Le lucre candi éft plus en ufage en Hollande & en
Allemagne que par-toutailleurs, parce que généralement
on n’y boit le thé qu’avec du candi qu’on tient
dans la bouche. Les Hollandois ont pris cette coutume
des Chinois , en les fréquentant dans les Indes ;
coutume qui eft beaucoup meilleure que de mettre
du fucre dans les taffes de thé, parce qu’il change
beaucoup le goût de cette. infufion, On reconnoît
mieux la qualité ou la bonté dit thé, lorfqu’en le buvant,
on tient un petit morceau de candi dans un
coin de la bouche. Les Hollandois ont accoutumé de
le tenir fous la langue , ce qui leur donne plus de facilité
de parler fans changer la voix. Ils font faire exprès
des boulettes de fucre candi, comme degrpffes
dragées, un peu raboteufes. Une feule tenue dans la
bpuche, peut fervir à une ou deux taffes. On les préfente
avec le thé que l’on boit généralement trois^ou
quatre heures après diner ; car pour le matin, c’eft
prefque toujours le café que l’on boit. Le peuple ne
boit guere non plus celui-ci qu’avec le fucre candi; c’eft
une épargne, car on ne confume pas tant de fucre de
cette maniéré qu’autrement»Les Hollandois nomment
ces petitsmorceauxde fucre candiyklonts ou klontjes*
Le candi rouge ou brun * a pris la place du blanc,
dans cet ufage parmi eux, depuis 1728, parce que
feu M. Boerhaave, l’oracle de la médecine, publia
alors; qu’il étoit plus fain que l’autre, & fur-tout
excellent pour les maux de poitrine ; de forte que le
débit de celui-ci eft devenu dès-lors confidérable-
ment plus grand dans toutes les Provinces-Unies des
Pays-Bas. Foye?^ Sucre , D ici. raif. des Sciences.
11 y a trois fortes de candis, blanc, moyen & brun
à 28 f. 24, 22 & 20 f. dans les raffineries de Co penhague.
(+ )
CAN D YS, ( Hiji. anc. ) forte d’habits des Perfes-.
Il en eft fait mention dans Xénophon &dans d’autres
auteurs. Le candÿs étoit l’habit extérieur. Les foldats
l ’attachoiènt avec une boucle. Leur candysyfélon Pol-
lux , étoit d’une pourpre particulière ; au lieu que
celui des autres étoit de pourpre ordinaire. Lucien
parle du candys de pourpre. Il dit dans un endroit
que cet habit etoit a l’ufage des Affynens. Xénophon
affure plus d’une fois, qu’il étoit à l’ufage des Perfes»
Lucien, dans un autre endroit, nous fournit le moyen
de connoître la forme du candys &Z de la tiare, lorfqu’il
dit que le dieu Mithras porte le candys & la tiare. (-{-)
> CANENTE, ( Myth. ) fille de Janus & de Vénilie,
epoufa Picus, fils de Saturne & roi d’Italie. Elle prit
fon nom , dit Ovide , de la beauté de fa voix. Ca-
nente ayant perdu fon époux qu’elle aimoit tendre-
ment, en conçut tant de chagrin, qu’après avoirpafle
fix jours fans manger & fans dormir, courant au milieu
des bois & des montagnes, enfin accablée de. lafli-
tude -, elle fe coucha fur les bords du T ib re , où fa
douleur la confuma de telle forte, que fon corps dif-
parut peu-à-peu , & s’évapora dans les airs : il ne
refta d’elle que la vo ix , & ion nom fut donné au lieu
où elle a ceffé d’être. Cette métamorphofe eft uniquement
fondée fur le nom de Canente. Elle fut mife avec
fon mari au nombre des dieux indigetes de PItalie.
M. de la Mothe a fait un opéra intitulé, Canente. f-f')
(§ CANGERECORA, {Géogr.') ville des Indes en
deçà du Gange an pays de Canara. On nç trouve point
éetté ville fur les cartes de M. de Lifte. Lettres fur
,V Encyclopédie.
y CANJARES oïl. C R IC S t f.’m. {Hijl. môd:) cé
font dés poignards larges de trois doigts à la lame}
& de lalongueur.de nos bayonnettes ,' qui s’emmanchent,.
pour àihfi dire \ dans la main , par une poignée
termine^ en pointe d’échelle.; on pofe les doigts fur
le premier rayon le pouce fur le-feecmd. Ces inf-
trumens » communément efhpoifonnés jufqu’ à la moitié
dé. la lame ;>font les armes déloyales les plus dangereuses
qu’on puiffe imaginer. Ce font cependant les
armes communes dans la péninfule du G ange, à Ma-^
laça, à PégUi, fur les côtes de la Chine , dans leâ
ifles de Java & de Sumatra. Quand les pèlerins In-*
diens ou Mahométàns;ont, au fetour de la Mecque
ou de la pagode de Jagrenate, la tête démontée paf
la vapeur de l’opium & du fanatifme, ils faififfent
c es çanjares envenimes, & immolent tout ce qu’ils
rencontrent d’Européens & d’étrangers infidèles ou
inch;c.oncis, par une; fureur qu’on ne fauroitcompa-
rer qu’à celle de ces anciens fcélerats d’Grient, connus
lo.us. le nom àéafajfns. Cette barbarie religieufe
^ beaucoup diminué depuis que les Anglois dominent
dans rindoftan, faifanttuer ces enthoufiaftés à coups
de fu.fil j pour leur ehfeigner la tolérance , dont ce
monde a:fi befoin» - -
On foupçonne que la plupart de ces armes indien-^
nés font enduites du venin dés ferpens profanes, oit
gui ne font pas partie du culte idolâtre , comme les
vipères a Calicut : c’étoit au moins la pratique des
anciens Brachmanes ,-dont les modernes defcèndent-
inconteftablement. (+ )
§ CANIN , {Anatomie.) Lë mufcle canin de Winf-
low , ou l’élévateur commun des deux levres, iiaîc
fous cl§ trou infraorbital au-deffous de la dent canine
& de l’incifive extérieure, d’un enfoncement de’Pos
maxillaire. Il naît par deux& même par trois paquets
dé fibres qui fe réunifient, & dont il naît un mufcle
plus é troit, qui fe termine dans l’orbiculaire des le-
v res& dans le triangulaire ; il communique aufli aveé
le zygomatique. Il relevé l’angle des levres , & rend
au vifage l’air de contentement que les dèpreflîons
de la leyre inférieure lui ont ôté. {H. D. G. )
CANJOUNOUjf. m .{Hifl. nat. Ichthyologie.) poif-
fon d’Amboine très-bien gravé & enluminé, fous ce'
npm & fous celui de cantsjoùnou Ç par C o y e t t , au
nv. yo de la première partie de fon Recueil despoiffons
cTAmboine. .
Il a le corps médiocrement long & médioctement
comprimé ou applati par les côtés ; la tête ; les yeux
& la bouche grands.
Ses nageoires font au nombre de fépt ; fa voir, deux
ventrales médiocres, placées au-deffous des deux
peétorales qui font médiocres, arrondies ; une dorfales
affez longue comme fendue en deux au milieu, plus
baffe devant que derrière une derrière l’anus plus
longue que profonde , & une à la queue arrondie
allez grande. De ces nageoires deux font épineufes4
fa voir., la dorfale , dont les huit rayons 'antérieurs
font épineux, & la nageoire de l’anus.
Tout fori cofps eft rouffâtre , : tacheié-de petits
points bleus, & entourédé cinq à fix anneaux rouges
vers la queue. La prunelle de. fes yeux eft blanche ,
avec un iris rouge , entouré d’un cercle incarnat, à
cinq points bleus derrière. Ses nageoires font jaunes;
mais les peûorales & les-ventrales font à rayons
rouges;les épines de :la dorfale font noires & lés autres
font pointillées de bleu.
Moeurs. Le Canjounou eft commun dans la mer
d’Amboine , autour d e s rochers..
Remarques. Ce poiflbn fait avec le tontelton tin
genre particulier dans la famille des. feares. { M\
A d a n s o n , )
C a NIRAM, f. m. {Hifl. nat. Botaniq. ) nom d’un
arbrçdn Malabeur, affez bien gravé , avec quelques