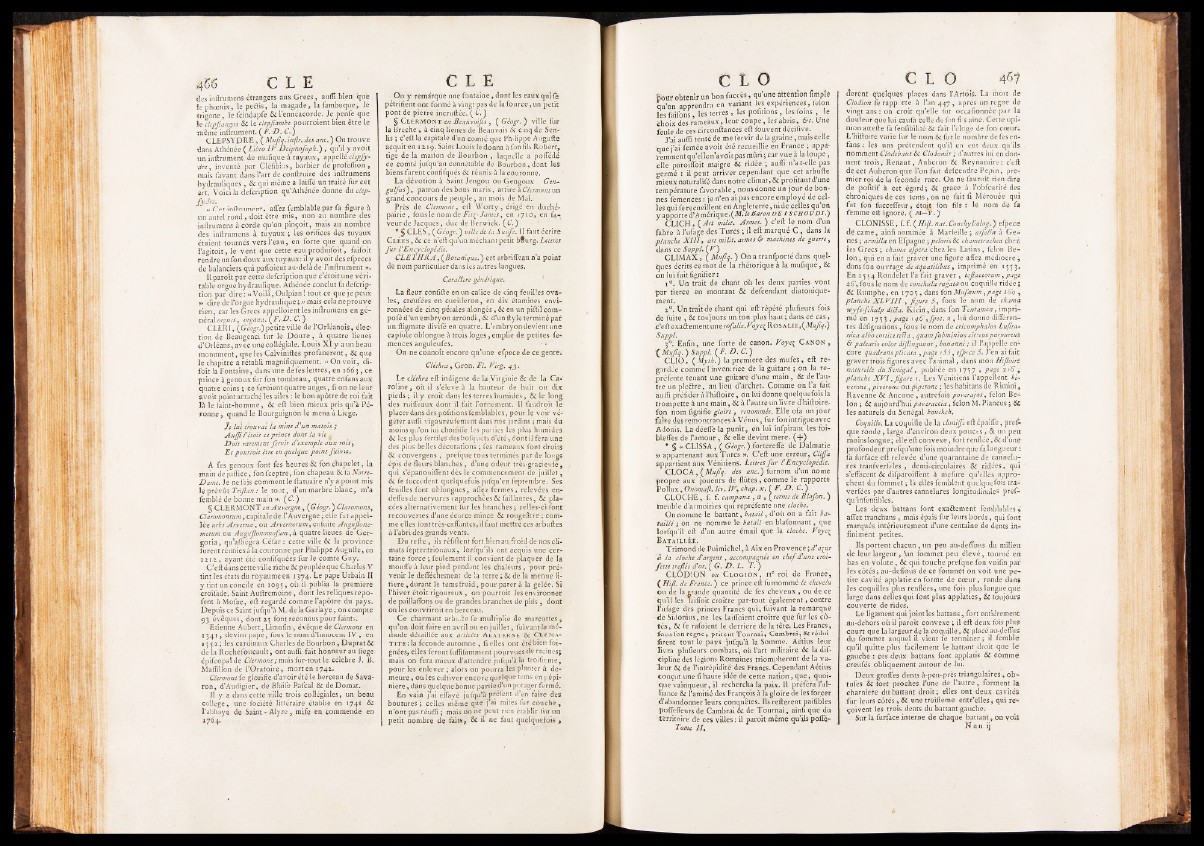
teil
4S6 C L E
•des inftrumens étrangers aux G recs, auffi bien ipiê |
ie phoenix, le pe&is, la magade, la fambuque* le
trigone, le fcindapfe 6c l’ennéacorde. Je penfe que
ie ckpjiangos & le cUpjiambt pourroient bien être le
même infiniment. ( F. D . C..)
CLEPSYDRE, ( Mujîq. infîr. des anc. ) On trouve
dans Athénée ( Libro IVDeipnofoph.) , qu’il y a voit
un infiniment de mufique à tuyaux, appellé clepfy-
dre, inventé par Cléfibias, barbier deprofeffion,
mais favant dans l’art de confiruire des inftrumens
hydrauliques , 6c qui meme a laifle un traite fui cet
art. Voici la defcription qu’Athénée donne du clep-
fydre.
« Cet infiniment, afîez femblable par-fa figure à
un autel rond, doit être mis, non au nombre des'
inftrumens à corde qu’on pinçoit, mais au nombre
des inftrumens à tuyaux ; les orifices des tuyaux
étoient tournés vers l’eau, en forte que quand on
i’agitoit, le vent que cette eau produifoit, faifoit
rendre un fon doux aux tuy au* : il y a voit des efpeces
de balanciers qui pafloient au-delà de l’inftrument »*
Il paroît par cette defcription que c’étoit une véritable
orgue hydraulique. Athénée conclut fadefcrip-
tiop par dire : «Voilà, Oulpian ! tout ce que je peux
» dire de l’orgue hydraulique ; » mais cela ne prouve
rien, car les Grecs appelloientles inftrumens en général
orgues, organa. ( F f D . C. )
CLERI, (GMgr.} petite ville de l’Orléanois, élection
de Beaugenci fur le D o u re , à quatre lieues
d’Orléans, avec une collégiale. Louis XI y a un beau
monument, que 1-es Calviniftes profanèrent, & que
le chapitre a rétabli magnifiquement. « On voit, di-
foit la Fontaine, dans une defeslettres, en 1663 , ce
prince à genoux fur fon tombeau, quatre enfans aux
quatre coins ; ce feroientquatre anges, fi on ne leur
avoit point arraché les ailes : le bon apôtre de roi fait
là le faint-homme, 6c eft bien mieux pris qu’à Pé-
ronne, quand le Bourguignon le mena à Liege.
Je lui trouvai la mine d'un matois ;
Auffi l'étoit ce prince dont la vie *
ï)oit rarement fervir d'exemple aux rois,
Et .pourroit être en quelque point fuivie.
A fes genoux font fes heures 6c fon chapelet, la
main de juftice, fon fceptre, fon chapeau 6c fa Notre-
Dame. Je ne fais comment le ftatuaire n’y a point mis
le prévôt Trifian : le tout, d’un marbre blanc, m’a
femblé de bonne main ». (C. )
§ CLERMONT en Auvergne, (Géogr.) Claromons,
Claromontum, capitale de l’Auvergne ; elle fut appel-
lée urbs -Arverna, ou Arvernorum, enfuite Augujlone-
Tnetutn ou Augùfionomofum, à quatre lieues de Ger-
goria, qu’affiégea Céfar : cette ville & la province
furent réunies à la couronne par Philippe Augufte, en
1212., ayant été confifquées fur le comte Guy. •
C ’eft dans cette ville riche 6c peuplée que Charles V
tint les états du royaume en 1374. Le pape Urbain II
y tint un concile en 1095, oîi,il publia la première
croifade. Saint Auftremoine, dont les reliques repo-
fent à Mofac, eft regardé comme l’apôtre du pays.
Depuis ce Saint jufqu’à M. delaGarlaye, on compte
93 évêques , dont 25 font reconnus pour faints.
Etienne Aubert, Limofin , évêque de Clermont en
134 1, devint pape, fous le nom d’innocent IV , en
13 52 ; les cardinaux Charles de Bourbon, Duprat6c
de la Rochefoucault, ont auffi fait honneur au fiege
épifcopalde Clermont; mais fur-tout le.célébré J. B.
Maffillon de l’Oratoire, mortén 1742.
Clermont fe glorifie d’avoir été le berceau de Sava-
ron, d’Audigier, de Blaife Pafcal & deDomat. -
Il y a dans cette ville trois collégiales, un beau
college, une fociété littéraire établie en 174-1 6c
l ’abbaye de Saint - A lyre, mife en commende en
1764.
C L E
On y remarque une fontaine, dont les eaux qui fi*
pétrifient ont formé à vingt pas de la fource, un petit
pont de pierre incruftée. ( C. )
§ C lermon t en Beauvoifis -, ( Géogr.) ville fur
la Breche , à cinq lieues de Beauvais & cinq de Sen-
lis ; c’ eft la capitale d’un comté que Philippe Auguftè
acquit en 1219. Saint Louis le donna à fon fils Robert,
tige de la mailôn de Bourbon , laquelle a poffédé
ce comté jufqu-au connétable de Bourbon, dont les
biens furent confifqués 6c réunis à la couronne.
La dévotion à Saint Jengou ou Gengoux Gen-
gulfus) , patron des bons maris, attire à Clermont \\A
grand concours de peuple , au mois de Mai.
Près de Clermont, eft Worty , érigé, en duché-
pairie , fous le nom de Fit^-James, en 1716, en faveur
de Jacques, duc de Berwick. (C. )
* § CLES, ( Géogr. ) ville de la Suiffe. Il faut écrire
C lées , 6c ce n’eft qu’un méchant petit bfurg. Lettres
fur-l'Encyclopédie.
CLETHRA, (Botanique,) cet arbriffeau n’a point
de nom particulier dans les autres langues.
C.araclere générique.
La fleur confifte en un calice de cinq feuilles ovales,
creiifées en cueilleron, en dix étamines environnées
de cinq pétales alongés , 6c en un piftil com-
pofé d’un embryon arrondi, 6c d’un ftyle terminé par
un ftigmate divifé en quatre. L’embryon devient une
capfule ôblongue à trois loges,emplie de petites fer
mences anguleufes. •<
On ne connoît encore qu’une efpece de ce genre.’
Cléthra, Gron. Fl. Virg. 43.
Le cléthra eft indigène de la Virginie & de la Caroline
, oit il s’élève à la hauteur de huit ou dix
pieds ; il y croît dans les terres humides , & le long
des ruiffeaux dont il fait l’ornement. Il faudroit le
placer dans des^pofitionsfemblables, pour le voir végéter
auffi vigoureüfement dans nos jardins ; mais du
moins qu’on lui choififle les parties les plus humides
6c les plus fertiieS'desbofquets d’été, dont il fera une
des plus belles décorations ; fes rameaux font droits
6c convergens , prefque tous terminés par de longs
épis de fleurs blanches , d’une odeur très-gracieufe ,
qui s’épanouiffent dès le commencement de juillet ,
6c fe l'uccedent quelquefois jufqu’en feptembre. Ses
feuilles font oblongues, afl'ez fermes, relevées en-
deflus de nervures rapprochées 6c faillantes, & placées
alternativement fur les branches; celles-ci font
recouvertes d’une écorce mince 6c rougeâtre ; comme
elles fonttrès-caflantes,ilfaut mettre ces arbuftes
à l’abri des grands vents.
Du refte, ils réfiftent fort bien au.froid de nos climats
feptentrionaux, lorfqu’ils ont acquis une certaine
force ; feulement il convient de plaquer de lâ
moufle à leur pied pendant les chaleurs , pour prévenir
le delféchement de la terre ; & de la menue li-*
tiere , durant le tems froid , pour parer à la gelée. Si
l’hiver étoit rigoureux, on pourroit les environner
de paillaflons ou de grandes branches de pins , dont
on les couvriroit en berceau.
Ce charmant arbufte fe multiplie de marcottes,
qu’on doit faire en avril ou en juillet, fuivant la méthode
détaillée aux articles Alaterne 6c C I éMa-
TiTE : la fécondé automne , fi elles ont été bien foi-
gnées, elles feront fuffifamment pourvues de racines;
mais on fera mieux d’attendre jufqu’à la troifieme,
pour les enlever ; alors on pourra les planter à demeure
, ou les cultiver encore quelque tems en pépinière
, dans quelque bonne partie d’un potager fermé.
En vain j’ai eflayé jufqu’à préfent d’en faire1 des
boutures’; celles même que j’ai miles fur couche ,
n’ont pas réuffi ; mais on ne peut rien établir fur un
petit nombre de faits, 6c il ne faut quelquefois ,
C L O
SbUf obtenir un bon fuccés, qu’une attention fimpië
qu’on apprendra en variant les expériences,, félon
les faifonà , les terres, les pofitionsl, les foins , le
ihoix des rameiux', leur çotlpe, les"abris. &c. Une
feule de ces circonfianées eft fouvent décifive;
J’ai auffi ténté de me fervir de là graine, mais celle
que j’ai fehlée àvoit été recueillie en France ; appâ^
'remment qu’elle n’avôît pas mûri; car vue à la loupe,
elle paroiffoit maigre 6c ridee ; auffi n a t-elle pas
germé : il peut arriver cependant que cet arbufte
mieux natutalifé dans notre climat, 6c profitant d’une
température favorable, nous donne un jour de bonites
femences : je n’en ai pas encore employé de celles
qui fe recueillent en Angleterre, ni de celles qu’on
y apporte d’Amérique^ AL le Baron u e T s c h o u d i .)
CL ICH, ( Art milit. Armes. ) c’eft le nom d’un
fabfe à l’ufagé des Turcs ; il eft marqué C , dans la
planché X I I I , art milit. arrhes & machines de guerre,
dans ce Suppl. (V )
CL IMAX, ( Mufiq. ) On ä tranfporté dans quelques
écrits ce mot de la rhétorique à la mufique, 6c
on lui fait fignifier :
i ° . Un trait de chatit oh les deux parties vont
£ar tierië en montant & defcendant diatoniquement.
2°. Un ffait de chant qui eft répété plufieurs fois
de fuite , 6c toujours un ton plus haut ; dans cë cas,
c’eft exactement une oye{ Rosalie , (Mufiq.)
Suppl.
30. Enfin , une forte de canon. Voye1 Canon ;
( Mufiq. ) Suppl. ( F. D. C. )
CL IO, ( Mytk. ) la première des irtufes, eft regardée
comme l'inventrice de la guitare ; on la re-
jpréfente tenant une guitare d’une main, & de Vautre
un pleftrë, au lieu d’archet. Comme on l’a fait
auffi pfélider à l’hiftoife, on lui donne quelquefois la
trompette à une main, & à l’autre un livre d hiltoire.
fon nom figriifie gloiïe , Yetiommée. Elle ofa un jour
faîte des remontrances à Vénus, fur fon intrigue avec
Adonis. Là déefle la punit ^ en lui infpirant les foi-
fclefles de l’amour, & elle devint mere.' (+ )
* § « CLISSA , ( Géogr.) fortereffe de Dalmàtie
*> appartenant aux Turcs ». C’eft une erreur, Clifia
appartient aux Vénitiens. Lettres fur l'Encyclopédie.
C LO C A , (Mufiq. des anc.) l'utnom d’un nome
propre aux joueurs de flûtes , comme le rapporte
Pollux, Onömafl. liv. IV, chap. x . ( F . D . C.)
CLOCHE, f . f. campana , ® > ( terme de Blàfon. )
taeuble d’armoiries qui repréfente une cloche.
On nomme le battant, batail, d’oit on a fait ba>-
taillé ; Ori ne nomme le batail en blafonnant, que
lorfqu’il eft d’un autre émail que la cloche, Voye{
Bataillée.
Trimond de Puîtiiichel, à Aix en Provence ; d'azur
<i la cloche J argent, acc'orhpagnée én chef d'une croi-
fette trefiée et or. (G . D . L. T .)
CLODION ou Clog io n , lie roi de France,
( Hifi. de France. ) ce prince eft furnommé le chevelu
ou de la grande quantité de fes cheveux , ou de ce
qu’il les laifloit croître par-tout également, contre
i’ufagé des princes Francs qui, fuivant la remarque
• de Sidönius, ne les laifloient croître que fur les côté
s , & fe rafoient le derrière de la tête; Les Francs,
fous fon règne, prirent Tournai, Cambrai,&rédui-
firent tout le pays jufqu’à la Somme. Aétius leur
livra plufieurs combats, oît l’att militaire & la discipline
des légions Romaines triomphèrent de la valeur
6c de l’intrépidité' des Francs. Cependant Aétius
tonçut urte fi haute idée de cette nation, que, quoique
vainqueur, il rechercha la paix. 11 préféra l’alliance
6c l’amitié des François à la gloire de les forcer
d’abandonner leurs conquêtes. Ils refterent pailibles
poffefleurs de Cambrai 6c de Tournai, ainfi que du
territoire de ces villes : il paroît même qu’ils poffér
Tome IE
C L O 4 61
aerent quelques places dans l’Artois. La mort de
Clodion fe rapporte à l’an 447 , après un régné de
vingt ans: ôn crôit.'qu’elle fut oecafionnée par la
douleur que lui caufa telle de fon fi s aîné. Cette opinion
attefte fa fenfibihté 6c fait l’éloge de fon coeur.
L ’iiiftoire varie fur le nom 6c fut le nombre de fes en-
fans : les uns prétendent qu’il en eut deux qu’ils
nomment Glodebani 6c Glodomîr ; d’autres lui en donnent
trois, Renaut, Auberon 6c Reynaeaire: c’eft
de cet Auberon que l’on fait defeendre Pépin, prêt
mier roi de la fécondé, rafee. On ne-fauroit rien dire
de pofitif à eet égard ; & grâce à l’obfcurité des
chroniques de ces tems » on ne fait fi Mérouée qui
fut fon fuccefleiir, étoit; Ion fils : le nom de fa
femme eft ignoré. ( M—Ÿ. )
CLONISSE, f. f. (Hifi. nat.ConchyliologF) efpecé
de came, airifi nommée à Marfeille; arfella à Gênés
; armilla èrt Efpagné ; peloris 6c chametrachea chez
les Grecs ; chanta afpéra chez les Latins, félon Be-
loh ; qui en a fâit gràver une figure affez médiocre ;
dans (bn ouvrage de aquatilibus, imprimé en 1553;
En 1554 Rondelet l ’a fait graver , tefiaceorum, page.
ïG , fous le nom de cônchùla rngatà ou coquille ridée J
6c Rumphe, en 1705 , dans fon Mufoeunt, page 1G0 ,
plahcke X L V I I I , figure 5 , fous le nom de chamà
■ wyfs-fchulp dicta. Klein, darts fon Teniamèn, imprimé
en 1753 , page iqG,Jpec. 2 , lui donne différentes
défignations, fous le nom de cricomphaïos Lufita-
nica atbo cortice tecta, quant fubminius citreus purpureui
& palearis color difiinguunt, bonanni; il l’appelle encore
quàdrànsplicàta , page /J5 , efpece 6. J’en ai fait
graver trbis figures avec l’animal, dans mon Hifioiré
naturelle dUStrïégàl, publiée en 1757 * page 21&,
planche X V I , figure /. Les Vénitiens l’appellent bi*
vetoïte, pivèrohe ou pipefone ; les habitans de Rimini,
Ravenne 6c Ancône , autrefois poverajos , félon BeA
Ion ; 6c aujourd’hui pavéraccia, félon M. Planeus ; 6c
les naturels du Sénégal bouckch.
Coquille. Lâ coquille deria cloniJJe eft épaiffë * p rê t
que ronde , large d’environ deux pouces , & un peu
moins longue ; elle eft convexe, fort renflée, & d’une
profondeur prefqu’une Fois moindre qüe fa longueur :
fa furface eft relevée d’une quarantaine de cannelures
trànfverfales , demi-circulàirés & ridées, qui
s’effacerit 6t difparoiffent à nlefure qu’elles approchent
du fommet ; là elles femblent quelquefois trâ-
verfées par d’autres cannelures longitudinales prefc
qu’infenfibles.
Les deux battàns font exaftement femblables >
affez tranchans , mais épais fur leurs bords, qui font
marqués intérieurement d’une centaine de dents iri—
finimënt petites.
Ils portent chacun, un peu àu-deffous du milieu
de leur largeur, hin fommet peu élevé, tourné eri
bas en volute, & qui touché prefque fon voifin par
les côtés; au-deflbus de ce fommet ôn Voit une petite
cavité^ applatie en forme de coeur, ronde dans
les coquilles plus renflées, une fois plus longue que
iarge dans celles qui font plus applaties, & toujours
couverte de rides.
Le ligament qui joint les battans, fort entièrement
au-dehors oîi il paroît convexe ; il eft deux fois plus
court que la largeur de la coquille, & placé aii-defliiS
du fommet auquel il vient fe terminer ; il femblé
qu’il quitte plus facilement le battant droit que le
gauche : ces deux battans font applatis 6c comme
cre.ufés obliquement autour dè lui.
Deux groffes dents à-peu-près triangulaires-, 0b4*
tufés 6c fort proches l’une de l’autre, forment là
charnière du battant droit ; elles Ont deux cavités
fur leurs côtés, & une troifieme etltr’elles, qui re*
çoivent les trois dents du battant gauche.
Sur la furface interne de chaque battant, pn yoi$
K nn ij