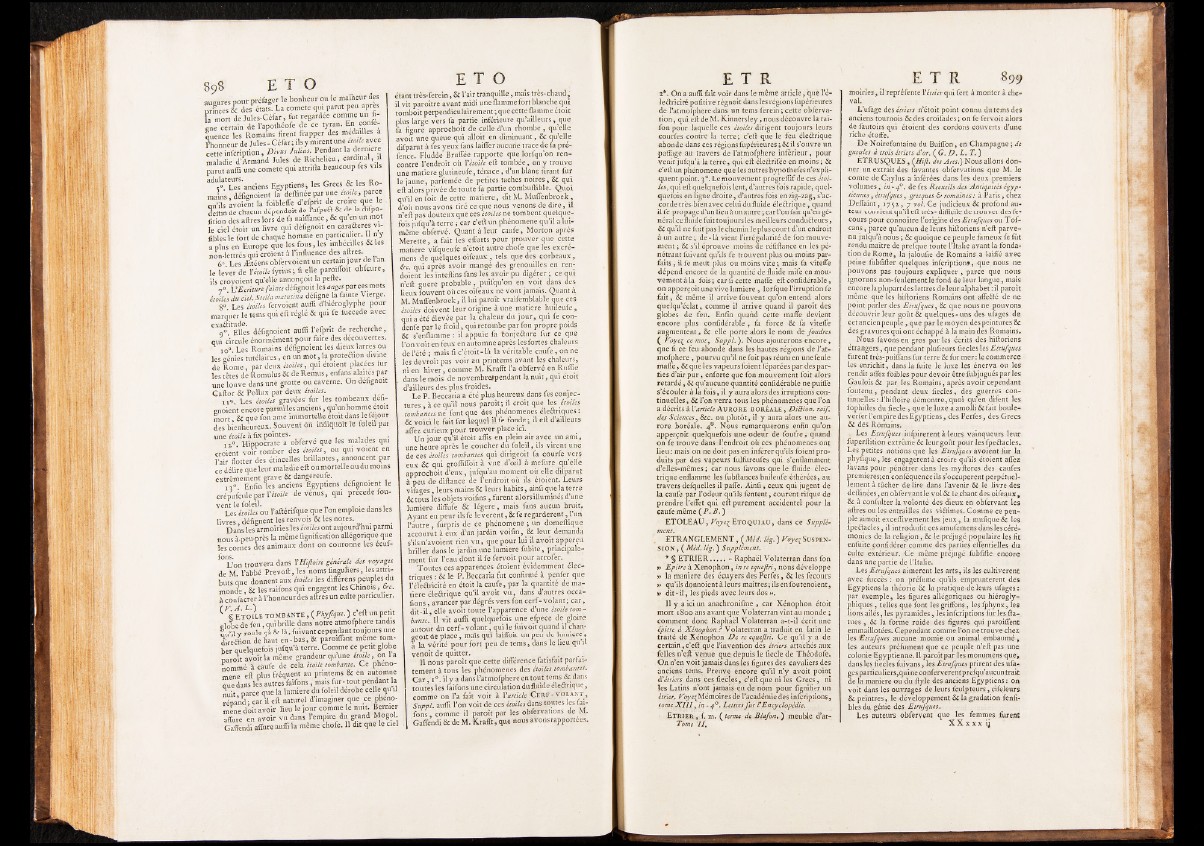
augures pour préfager le bonheur ou le malheur oes
ormees & des états. La comete qui parut peu apres
la mort de Jules-Céfar, fut regardee comme un fi-
gne certain de l’apothéofe de ce tyran. En confe
quence les Romains firent frapper des medailles à
rhonneur de Jules - Céfar ; ils y mirent une ctoüc avec
cette infcription, Divus Julius. Pendant la ÿ rn,er.®
maladie d’Armand Jules de Richelieu, cardinal 1
parut aufli une comete qui attnfla beaucoup fes vils
B B h W I Egyptiens-, les Grecs & les Ro
mains, défignoient la deffinee par une m û t , parce
qu’ils avoient la foibleffe d’efprit de croire que le.
deftin de chacun dëpendoit de 1 afpeô & de la difpo-
fition des aftres lors de fa naiffance, & qu en un mot
le ciel étoit un livre qui défignoit en caraÊleres, vi-
fibles le fort de chaque homme en particulier. U n y
a plus en Europe que les fous, les imbeciUes & les
non-lettrés qui croient à l’influence des aftres.
6°. Les Ætéens obfervoient un certain jour de i an
le lever de Y étoile fyrius ; fi elle paroifïoit obfcure,
ils crovoient qu’elle annonçoit la pefte.
7 ° L’Ecriture fainte défignoit les anges par ces mots
Æ S m M M — I famte V.erge.
00 Les imiUs fervoient auffi d’hiéroglyphe pour
marquer le tems qui eft réglé & qui fe luccede avec
H H H défignoient auffi l’efprit de recherche,
qui circule énormément pour faire des découvertes.
^ ■ Les Romaiqs défignoient les dieux iarrës ou
les génies tutélaires, en Un mot, la proteaion divine
de Rome, par deux étoiles,,qui étoient placées tur
les têtes de Romulus 8c de Remus, enfans alaites par
une louve dans une grotte oü caverne. On défignoit
Càftor 8c Póllux par deux ItoiUs.
11«. Les étoiles gravées fur les tombeaux défi-
«noient enfeorê parmîlesanciens, qu’un homme étoit
mort & que fon amé immortelle étoit dans le tejour
des bienheureux. Souvent on indiquoit le foleiï'par
une étoile à fix pointes. . ,
H a Hippocrate a obïerve que les malades qui
croient voir tomber des éioiks, ou qui v o ie« en
l’air flotter des étincelles brillantes, annoncent par
ce délire que leur maladie eft "6u mortelle ou du moins
extrêmement gravé 8c dangéréufe.. . .
1 1 ° Ehfih les anciens Egyptiens défignoient le
crépufcule par Yétoile devenus, qui précédé fouvent
le loîcil. ........... I . . H ,
Les étoilés ou l’aftérifque que l’on emploie dans les
livres, défignent les renvois Scies notes. I
étant très-ferein, & l’air tranquille, mais très-chaud;
il vit paroître avant midi une flamme fort blanche qui
tomboit perpendiculairement ; que cette flamme étoit
plus large vers fa partie inférieure qu’ailleurs, que
fa figure approchoit de celle d’un rhombe , qu’elle
avoit une queue qui alloit en diminuant, & qu’elle
difparut à les yeux fans laiffer aucune trace de fa pré-
fence. Fludde Bruffée rapporte que lorfqu’on rencontre
Dans les armoiries les Hólles ont aujourd hui parmi
nous à-peu-près la même lignification allégorique que
les cornés dés animaux dont on couronne les ecuf-
° L’on trouvera dans YHiJloirc générale des voyages
de M l’abbé Prevoft,les noms finguliers, lesattrt-
buts que donnent aux étoiles les difïèrens peuples du
monde 8c les raifons qui engagent les Chinois,, trc.
à confacrer à l’honneur des aftres un cuite particulier.
^ « r t i u tombante , ( Phyfique. ) c’eft un petit
«lobe defiéu, quihrille dans notre atmofphere tandis
qu’il V roule 8c là , fuivant cependant toujours une
direftion de haut en-bas, 8t paroiffant meme tomber
quelquefois jufqu’à’terre. Comme ce petit globe
naroitavoirlamêfhe grandeur qu une étoile,on la
nommé ‘à càufe de celà étoile tombante. Ce phénomène
eft plus fréquent au primeras 8c en automne
‘ que dans les autres faifons, mais fur - tout pendant la
miit parce que la lumière du folell dérobé celle qu il
répand; car.il eft naturel d’imaginer que ce phénomène
doit avoir lieu le jour comme le nuit. Bermer
affûte en avoir vu dans l’empire du grand Mogol.
Galïèndi allure aufli la même chofe. Il dit que le ciel
l’endroit où Vétoile eft tombée, on y trouve
une matière glutineufe, ténace, d’un blanc tirant fur
le jaune, parfemée de petites taches noires, & qui
eft alors privée de toute fa partie combuftible. Quoi
qu’il en foit de cette matière, dit M. Muffenbroek,
d’où nous avons tiré ce que U U ll IIUU à aVV lH — — 1 “ - -n--o—us ve--n--o--n--s de direa, il
n’eft pas douteux que ces étoiles ne tombent quelquefois
jufqu’à terre ; car c’eft un phénomène qu’il a lui-
même obfervé. Quant à leur caufe, Morton après
Merette, a fait fes efforts pour prouver que cette
matière vifqueufe n’étoit autre chofe que les excré-r
mens de quelques oifeaux , tels que des corbeaux,
&c. qui après avoir mangé des grenouilles en ren-
doient les inteftins fans les avoir pu digérer ; ce qui
n’eft guere probable, puifqu’on en voit dans des
lieux fouvent où ces oifeaux ne vont jamais. Quant à
M. Muffenbroek, il lui paraît vraifemblable que ces
étoiles doivent leur origine à une matière huîleufe,
qui a été élevée par la chaleur du jour, qui fe con-
denfe par le froid, qui retombe par fon propre poids
& s’enflamme : il appuie fa tonje&ure fur ce quq
l’on voit en feux en automne après les.fortes chaleurs
de l’été ; mais fi c^étoit-là la véritable caufe, on ne
les devrait pas voir au printems avant les chaleurs,
ni en hiver, comme M. Krafft l’a obfervé en Ruffie
dans le mois de novembrefpendant la nuit, qui étoit
d’ailleurs des plus froides*
Le P. Beccaria a été plus heureux dans fes conjectures
, à ce qu’il nous paraît; il croit que les étoiles
tombantes ne font que des phénomènes é t r iq u é s s
& voici le fait fur lequel il fe fonde ; il eft d’ailleurs
affez curieux pour trouver place ici.
Un jour qu’il étoit aflis en plein air avec un ami,
une heure après le coucher du foleil, ils virent une
de ces étoiles tombantes qui dirigeoit fa courfe vers
eux & qui grofliffoit à vue d’oeil à mefure qu’elle
approchoit d’eux, jufqu’au moment ou elle difparut
à peu de diftance de l’endroit où ils étoient. Leurs
vifages, leurs mains & leurs habits, ainfi quela terre
& tous les objets voifins , furent alors illuminés d’une
lumière diffufe & légère, mais fans aucun bruit.
Ayant eu peur ils fe levèrent, & fe regardèrent, l’un
l’autre, furpris de ce phénomène ; un domeftique
accourut à eux d’un jardin voifin, & leur demanda
s’ilsn’av.oient rien v u , que pour lui il avoit apperçù
briller dans le jardin une lumière fubite, principale-^
ment fur l’eau dont il fe fervoit pour arrôfer.
Toutes ces apparences étoient évidemment électriques
: & le P. Beccaria fut confirmé à penfer que
l’ éle&ricité en étoit la caufe, par la quantité de matière
éleftrique qu’il avoit v u , dans d’autres occa-
fions, avancer pardégrésvers fon cerf-Volant; car,
dit-il, elle avoit toute l’apparence d’une étoile tombante.
11 vit auffi quelquefois une efpece de gloire
autour du cerf- volant, qui le fuivoit quand il chan-
geoït de place, mais qui laiffoit un peu de lumière,
à la vérité pour fort peu de tems, dans le lieu qu’il
verioit de quitter.
Il nous paraît que cette différence fatisfait parfaitement
à tous les phénomènes des étoiles tombantes.
C a r , 1 °. il y a dans l’atmofphere en tout tems & dans
toutes les faifons une circulation du fluide éleûrique ,
comme on l’a fait voir à l’article C e r f - v o l a n t ,
Suppl. aufli l’on voit de ces étoiles dans toutes les faifons
, comme il paraît par les obfervations de M.
Gaffendi & de M. Krafft, que nous avons rapportées,
On a auffi fait voir dans le même article, què l’é-
ledricifé pofitive régnoit dans les régions fupérieures
de l’atmofphere dans un tèms ferein; cette obferva-
tion, qui eft de M. Kinnersley, nous découvre la rai-
fon pour laquelle ces étoiles dirigent toujours leurs
courfes contre la terre; c’eft que le feu éleftrique
abonde dans ces régions fupérieures ; & i l s’ouvre un
paffage au travers de l’atmofphere inférieur, pour
venir jufqu’à la terre, qui eft éleftrifée en moins ; &
c’eft un phénomène que les autres hypothefes n’expliquent
point. 30. Le mouvement progreffif de ces étoiles.,
qui eft quelquefois lent, d’autres fois rapide, quelquefois
en ligne droite, d’autres fois enzig-zag, s’accorde
très-bien avec celui du fluide électrique, quand
il fe propage d’un lieu à un autre ; car l’on fait qu’en général
ce fluide fuit toujours les meilleurs conducteurs,
& qu’il ne fuit pas le.chemin le plus court d’un endroit
à un autre ; de - là vient l’irrégularité de fon mouvement
; & s’il éprouve moins de réfiftance en les pénétrant
fuivant qu’ils fe trouvent plus ou moins parfaits
, il fe meilt plus ou moins vîte ; mais fa vîteffe
dépend encore de la quantité de fluide mife en mouvement
à la fois ; car fi cette maffe eft confidérable,
on apperçoit une vive lumière , lorfque l’irruption fe
fait, & même il arrive fouvent qu’on entend alors
quelqu’éclat, comme il arrive quand il paraît des
globes de feu. Enfin quand cette maffe devient
encore plus confidérable , fa force & fa vîteffe
augmentent, & elle porte alors le nom de foudres
( Voye{ ce mot, Suppl. ) . Nous ajouterons encore,
que fi ce feu abonde dans les hautes régions de l’at-
mofphere, pourvu qu’il ne foit pas réuni en une feule
maffe, & que les vapeurs foient féparées par des parties
d’air pur, enforte que fon mouvement foit alors
retardé, & qu’aucune quantité confidérable ne puiffe
s’écouler à la fois, il y aura alors des irruptions continuelles
, & l’on verra tous les phénomènes que l’on
a décrits à l'article A urore BORÉALE, Diction, raif.
des Sciences, &c. ou plutôt , il y aura alors une aurore
boréale. 40. Nous remarquerons enfin qu’on
apperçoit quelquefois une odeur de foufre, quand-
on fe trouve dans l’endroit où ces phénomènes ont
lieu: mais on ne doit pas en inférer qu’ils foient produits
par des vapeurs fulfureufes qui s’enflamment
d’elles-mêmes ; car nous favpns que le fluide électrique
enflamme les fubftances huileufe éthérées, au
travers defquelles il paffe. Ainfi, ceux qui jugent dé
la caufe par l’odeur qu’ils fentent, courent rifque de
prendre l’effet qui eft purement accidentel pour la
caufe même ( P. B. )
ETOLEAU, Voye^ Eto q u ia u , dans ce Supplément.
ÉTRANGLEMENT, ( Méd. lég. ) Vôye^Suspens
i o n , ( Méd. lég. ) Supplément.
* § ETRIER. . . . ; « Raphaël Volaterran dans fon
» Epitre à Xenophon, in re equejlri, nous développe
» la maniéré des écuyers des Perfes, & les fecours
» qu’ils donnoient à leurs maîtres ; ils en foutenoient,
» d it- il, les pieds avec leurs dos >>.
Il y a ici un anachronifme , car Xénophon étoit
mort 1800 ans avant que Volaterran vînt au monde ;
comment donc Raphaël Volaterran a-t-il écrit une
epitre à Xénophon ? Volaterran a traduit en latin le
traité de Xénophon De re equejlri. Ce qu’il y a de
certain,c’eft que l’invention des étriers attachés aux
Telles n’eft venue que. depuis le fiecle de Théodofe.
On n’en voit .jamais dans les figures des cavaliers des
anciens tems. Preuve encore qu’il n’y avoit point
d'étriers dans ces fiecles, c’eft que ni les Grecs, ni
les Latins n’ont jamais eu.de nom pour lignifier un
étrier. Foye^ Mémoires dè l’académie des inferiptions,
tome X I I I , in - 40. Lettres fur VEncyclopédie.
Etr ier , f. m. ( terme de Blafon, ) meuhle d’ar-
Tome ‘II.
moîries, il repréfente Vitrier qui fert à monter à che^
val.
L’ufage des étriers n’étoit point connu du tems des
anciens tournois & des croifades ; on fe fervoit alors
de fautoirs qui étoient des cordons couverts d’une
riche étoffe.
De Noirefontaine du Buiffon, en Champagne; de
gueules à trois étriers dé or. (G . D . L. T .)
ÉTRUSQUES, {Hift. des Arts.) Nous allons donner
un extrait des favantes obfervations que M. le
comte de Caylus a inférées dans les deux premiers
volumes, in-40. de fes Recueils des Antiquités égyptiennes
, étrufques) grecques & romaines: à Paris, chez
Deffaint, 1752, 7 vol. Ce judicieux & profond auteur
convient qu’il eft très - difficile de trouver des fecours
pour connoître l’origine des Etrufques ou T o f-
cans, parce qu’aucun de leurs hiftoriens n’eft parvenu
jufqu’à nous ; & quoique ce peuple fameux fe fût
rendu maître de prefque toute l’Italie avant la fondation
de Rome, la jaloufie de Romains a taillé avec
peine fubfifter quelques inferiptions, que nous ne
pouvons pas toujours expliquer , parce que nous
ignorons non-feulement le fond de leur langue, mais
encore la plupart des lettres de leur alphabet : il paraît
même que les hiftoriens Romains ont affeété de ne
point parler des Etrufques, & que nous ne pouvons
découvrir leur goût & quelques-uns des ufages de
cet ancien peuple, que par le moyen des peintures &
des gravures qui ont échappé à la main des Romains.
Nous favons en gros par les écrits des hiftoriens
étrangers, que pendant plufieurs fiecles les Etrufques
furent très-puiffans fur terre & fur mer : le commerce
les enrichit, dans la fuite le luxe les énerva ou les
rendit affez foibles pour devoir êtrefubjugués par les
Gaulois & par les Romains, après avoir cependant
foutenu , pendant deux fiecles.,,; des guerres continuelles
: J’hiftoire démontre, quoi qu’ en difent les
fophiftes du fiecle , que le luxe a amolli & fait boule-
verfer l’empire des Egyptiens, des Perfes, des Grecs
& des Romains.
. Les Etrufques ■ infpirerent à leurs vainqueurs leur
fuperftition extrêmefic leur goût pour les fpe&acles.
Les petitjes notions que les Etrufques avoient fur la
phyfique, lès engagèrent à croire qu’ils étoient affez
favans pour pénétrer dans les myfteres des caufes
premieres;en conféquençeils s'occupèrent perpétuellement
à tâcher de lire dans l’avenir & le livre,des
deftinées, en obfervant Je vol & le chant des oifeaux ,
& à conlulter la volontés des dieux en obfervant les
aftres ou les entrailles dès vi&imes. Gomme ce peuple
aimoit excefîivement les jeux, la mufique & les
fpeftacles, il introduifit cesamufemens dans les cérémonies
de la religion, & le préjugé populaire les fit
enfuite çonfidérer comme des parties effentielles du
culte extérieur. Ce même préjugé fubfifte encore
dans une partie de l’Italie.
Les Etrufques aimèrent les arts, ils les cultivèrent
avec fuccès : on préfume qu’ils empruntèrent des
Egyptiens la théorie & la pratique de leurs ufages:
par exemple, les figures allégoriques ou hiéroglyphiques
, telles que font les griffons, les fphynx, les
lions ailés, les pyramides, les inferiptions fur les fta-
tues , & la forme raide- des figures qui paroiffent
emmaillotées. Cependant comme l’pn ne trouve chez
les Etrufques aucune momie ou animal embaumé ,
les auteurs préfument que ce peuple n’eft pas une
colonie Egyptienne. Il paraît par les monuniens que,
dans les fiecles fuivans, 1 ts Etrufques prirent des ufagesparticuliers,
qui ne conferverent prefqu’aucun trait
de la maniéré ou du ftyle des anciens Egyptiens : on
voit dans les ouvrages de leurs fculpteurs, cifeleurs
& peintres, le développement & la gradation fenfi-
blés du génie des Etrufques.
Les auteurs obfèryent que les femmes furent
X X x x x ij