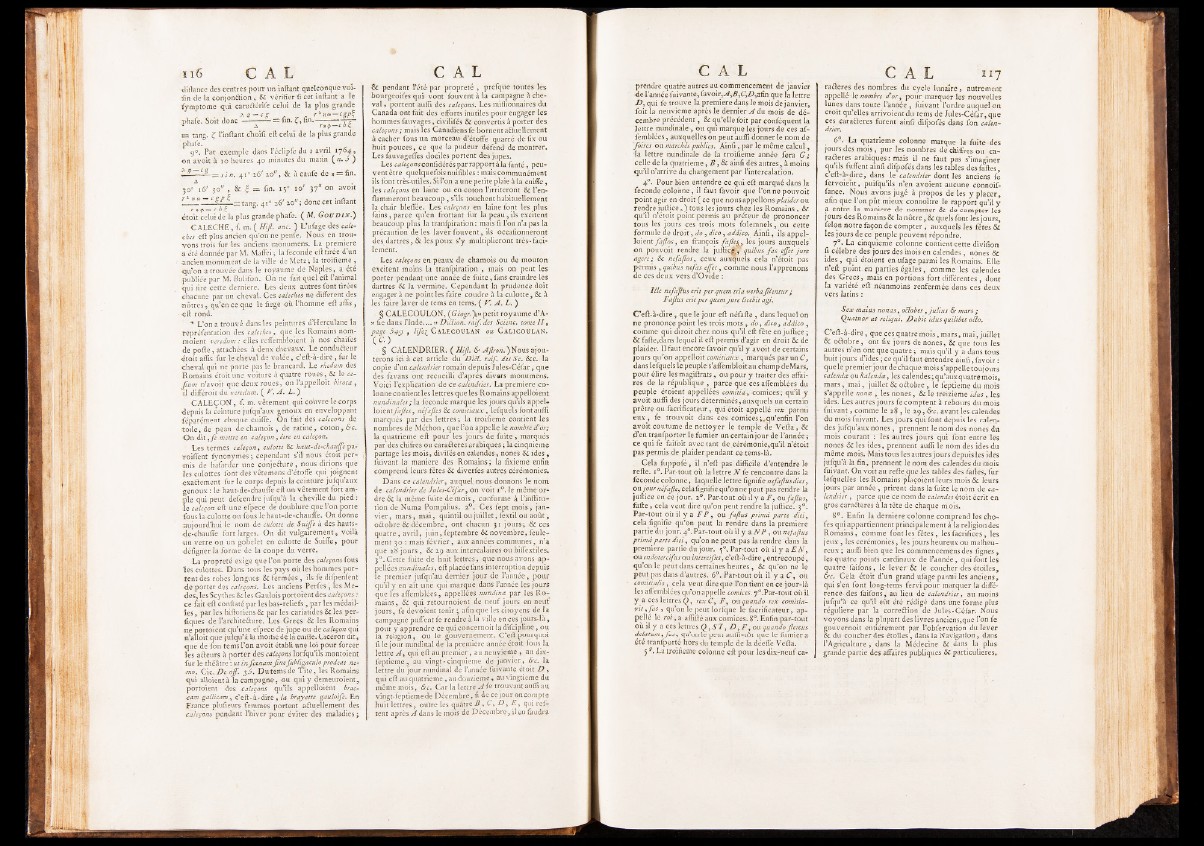
•d-iftance des centres pour un inftant quelconque voisin
de la conjon&ion , 8c vérifier fi cet inftant a le
fymptome qui caraétérife celui de la plus grande
* &<p — cg „ r 2 nu-'Cgpt
phafe. Soit d o n c ...........— — un, ç ,lin .-----------r-?—
* a r« «p—«Aç,
= tang. Ç I’inftant choifi eft celui de la plus grande
phafe.
9°. Par exemple dans l’éclipfe du i avril 1704,
on avoit à 10 heures 40 minutes du matin ( n. 5 )
* <p — c g
in. 41016' xo", & àcaufe de « = fin.
, & I = fin. 150 10' 37" on avoit
o° 16' 30" ,
** — cgpÇ
:an». 410 26' 20"; donc cet inftant
r » p — c ht;
«toit celui de la plus grande phafe. ( M. Go u d in J)
CALECHE, fi m. ( Hifi. anc. ) L’ufage des calèches
eft plus ancien qu’on ne penfe. Nous en trouvons
trois fur les anciens monumens. La première
•a été donnée par M. Maffei ; la fécondé eft tirée d’un
■ ancien monument de la ville de Metz; la troifieme ,
qu’on a trouvée dans le royaume de Naples, a^ ete
publiée par M. Bulifon. On ne fait quel eft l’animal
qui tire cette derniere. Les deux autres font tirées
chacune par un cheval. Ces calèches ne different des
nôtres, qu’en ce que le fiege où l’homme eft aflïs,
* L’on a trouvé dans les peintures d’Herculane la
repréfentation des calèches, que lès Romains nom-
moient veredum^ elles reffembloient à nos chaifes
de pofte, attachées à deux chevaux. Le conducteur
«toit aflis fur le cheval de volé e, c’eft-à-dire, fur le
•cheval qui ne porte pas le brancard. Le rhedum des
Romains étoit une voiture à quatre roues, 8c le ce-
fiurn n’avoit que deux roues, on l’appelloit birota ,
il différoit du veredum. ( V. A. L.')
C A L E CO N , fi m. vêtement qui couvre le corps
depuis la ceinture jufqu’aux genoux en enveloppant
féparément chaque cuiffe. On fait des caleçons de
ïo ile , de peau de chamois , de ratine, coton, &c.
On dit J e mettre en caleçon, être en caleçon.
Les termes caleçon, culotte 8c haut-de-chauffe pa-
Toiffent fynonymes ; cependant s’il nous étoit permis
de hafarder une conjeéture, nous dirions que
les culottes font des vêtemens d’étoffe qui joignent
•exactement fur le corps depuis la ceinture jufquaux
genoux : le haut-de-chauffe eft un vêtement fort ample
qui peut defcendre jufqu’à la cheville du pied :
•le caleçon eft une efpece de doublure que l’on porte
fous la culotte ou fous le haut-de-chauffe. On donne
aujourd’hui le nom de culotte de Suiffe à des hauts-
■ de-chauffe fort larges. On dit vulgairement, voilà
tin verre ou un gobelet en culotte de Suiffe, pour
défigner la forme de la coupe du verre.
La propreté exige que l’on porte des caleçons fous
les culottes. Dans tous les pays où les hommes portent
des robes longues 8c fermées , ils fe difpenfent
de porter des caleçons. Les anciens Perfes ', les Me-
des, les Scythes 8c les Gaulois portoient des caleçons :
ce fait eft conftaté par les bas-reliefs , par les médailles
, par les hiftoriens 8c par les cariatides 8c les per-
fiques de l’architeclure. Les Grecs & les Romains
sic portoient qu’une efpece de jupe ou de caleçon qui
n’alloit que jufqu’à la moitié de la cuiffe. Cicéron dit,
que de fion temsl’on avoit établi une loi pour forcer
les a fleurs à porter des caleçons lorfqu’ils montoient
fur le théâtre : ut in fcenam fine fubligaculo prodeat ne-
■ mo. Cic.D e off. j 3 . D u tems de Tite, les Romains
qui alloientà la campagne, ou qui y demeuroient,
portoient des caleçons qu’ils appelloient brac-
cam gallicam, c’ eft-à-dire , la brayette gauloife. En
France plufieurs femmes portent aôuellement des
caleçons pendant l’hiver pour éviter des maladies ;
& pendant l’été par propreté , prefque toutes les
bourgeoifes qui vont fouvent à la campagne à cheval
, portent aufli des caleçons. Les millionnaires du
Canada ont fait des efforts inutiles pour engager les
hommes fauvages, civilités 8c convertis à porter des
caleçons ; mais les Canadiens fe bornent actuellement
à cacher fous un morceau d’étoffe quarré de fix ou
huit pouces, ce que la pudeur défend de montrer.
Les fauvageffes dociles portent des jupes.
Les caleçons confidérés par rapport à la fanté, peuvent
être quelquefois nuifibles : mais communément
ils font très-utiles. Si l’on a une petite plaie à la cuiffe,
les caleçons en laine ou en coton l’irriteront 8c l’enflammeront
beaucoup, s’ils touchent habituellement
la chair bleffée. Les caleçons en laine font les plus
fains, parce qu’en frottant fur la peau, ils excitent
beaucoup plus la tranfpiration : mais fi l’on n’a pas la
précaution de les laver fouvent, ils occafionneront
des dartres, 8t les poux s’y multiplieront très-facilement.
Les caleçons en peaux de chamois ou de mouton
excitent moins la tranfpiration , mais on peut les
porter pendant une année de fuite, fans craindre les
dartres 8c la vermine. Cependant la prudence doit
engager à ne point les faire coudre à la culotte, 8c à
les faire laver de tems en tems. ( V. A . h. )
§ CALECOULON, (Géogr.)\» petit royaume d’A-
» fie dans l’Inde.... » Diction, raif.des Scienc. tome I I ,
.page 64c) , life{ CALECOULAN ou CALICOULAN.
Bü
§ CALENDRIER. ( Hifi. & Afiron.)Nous ajouterons
ici à cet article du Dicl. raif. desSc. 8tc.-la
copie d’un calendrier romain depuis Jules-Céfar, que
des favans ont recueilli d’après divars monumens»
Voici l’explication de ce calendrier. La première colonne
contient les lettres que les Romains appelloient
nundinales ; la fécondé marque les jours qu’ils appelloient
faftes, néfafies 8c comitiaux, lefquels fontauffï
marqués par des lettres ; la troifieme contient les
nombres de Méthon, que l’on appelle le nombre d’or;
la quatrième eft pour les jours de fuite, marqués
par des chifres ou caraéteres arabiques ; la cinquième
partage les mois, divifés en calendes, nones 8c ides,
fuivant la maniéré des Romains; la fixieme enfin
comprend leurs fêtes 8c diverfes autres cérémonies.
Dans ce calendrier, auquefnous donnons le nom
de calendrier de Jules-Céfar, on voit i° . le même ordre
8c la même fuite de mois, conforme à l’inftitu-
tion de Numa Pompilius. 20. Ces fept mois, janvier
, mars, mai, quintil ou juillet, fextil ou août,
oCtobre 8c décembre,.ont chacun 31 jours; & ces
quatre , avril, juin, feptembre 8c novembre, feulement
30 : mais février, aux années communes, n’a
que 28 jours, & 29 aux intercalaires ou biffextiles.
30. Cette fuite de huit lettres, que nous avons app
e l l é e s e f t placée fans interruption depuis
le premier jufqu’au dernier jour de l’année, pour
qu’il y en ait une qui marque dans l’année les jours
que les affemblées, appellées nundinæ par les Romains,
& qui retournoient de neuf jours en neuf
jours, fe dévoient tenir ; afin que les citoyens de la
campagne puffent fe rendre à la ville en ces jours-là,
pour y apprendre ce qui concernoit la discipline, ou
la religion, ou le gouvernement. C ’eft pourquoi
fi le jour nundinal de la première année étoit fous la
lettre A t qui eft au premier, au neuvième , au dix-
feptieme, au vingt-cinquième de janvier, &c. la
lettre du jour nundinal de l’année fuivante etoit D ,
qui eft au quatrième , au douzième, au vingtième du
même mois, &c. Car la lettre A fe trouvant aufli au
vingt-feptiemede Décembre, fi de ce jour on compte
huit lettres., outre les quatre B , C, D , E , qui ref-;
tent après A dans le mois de Décembre, il en faudra
prendre quatte autres au commencement de janvier
•de l’année fuivante, favoir,.<4,2?,G,Z?,afin que la lettre
D , qui fe trouve la première dans le mois de janvier,
foit la neuvième après le dernier ^ du mois de décembre
précédent, 8c qu’elle foit par confisquent la
lettre nundinale , ou qui marque les jours de ces affemblées,
auxquelles on peut aufli donner le nom de
'foires ou marchés publics. Ainfi, par le même calcul,
la lettre nundinale de la troifieme année fera G ;
celle de la quatrième, B , & ainfi des autres, à moins
qu’il n’arrive du changement par l’intercalation.
40. Pour bien entendre ce qui eft marqué dans la
fécondé colonne, il faut favoir que l’on ne pouvoit
point agir en droit ( ce que nous appelions plaider ou
rendre juftice, ) tous les jours chez les Romains , 8c
qu’il n’étoit point permis au préteur de prononcer
tous les. jours ces trois mots folemnels, ou cette
formule de droit', do, dico, addico. Ainfi, ils appel}-
loient fafios, en françois fifie s . les jours auxquels
on pouvoft rendre la juftic®* quibus fas effet jurç
dgere; & nefafios, ceux auxquels cela n’étoit pas
permis , quibus nefas effet, comme nous l’apprenons
de ces deux vers d’Ovide :
Ille nefajliis erit per quem tria verbafilentur ;
Fafius erit per quem jure licebit agi.
C ’eft-à-dire, que le jour eft néfafte , dans lequel on
ne prononce point les trois mots , do, dico, addico ,
comme qui diroit chez nous qu’il eft fête en juftice ;
& fafte,dans lequel il eft permis d’agir en droit & de
plaider. Il faut encore favoir qu’il y avoit de certains
joiirs qu’on appelloit comitiaux, marqués par un C ,
dans lefquels le peuple s’affembloitau champ deMars,
pour élire les magiftrats, ou pour y traiter des affaires
de la république , parce que ces affemblées du
peuple étoient appellées comitia, comices; qu’il y
avoit aufli des jours déterminés, auxquels un certain
prêtre ou facrificateur, qui étoit appellé rex parmi
e u x , fe trou voit dans cescomices ;^qu’enfin l’on
avoit coutume de nettoyer le temple de Vefta, &
d’en tranfporter le fumier un certain jour de l ’année ;
ce qui fe faifoit avec tant de .cérémonie,qu’il n’étoit
pas permis de plaider pendant ce .tems-là.
. Cela fuppofé, il n’eft pas difficile d’entendre le
refte. i°. Par-tout où la lettre N fe rencontre dans la
fécondé colonne, laquelle lettre lignifie nefafiusdies,
ou jour néfafie,cela lignifie qu’on ne peut pas rendre la
juftice en ce jour. 20. Par-tout .où il y a F , ou fafius,
fafte, cela veut dire qu’on peut rendre la juftice. 30.
Par-tout où il y a F P , ou fafius prima parte dieiy
cela lignifie qu’on peut la rendre dans la première
partie du jour. 40. Par-tout où il y a N P , ou nefafius
prima parte diei, qu’on ne peut pas la rendre dans la
première partie du jour. 50. Par-tout où il y a E N ,
ou endotercifus qu intercifus, c’eft-à-dire, entrecoupé,
qu’on le peut dans certaines heures , & qu’on ne le
peut pas dans d’autres. 6°. PaMoùt où il y a G , où
comitialis, cela veut dire que l’on tient en ce jour-là
les affemblées qu’on appelle comices. 70.Par-tout où il
y a ces lettres Q , rex G, F , ou quando rex comitia-
vit^fas , qu’on le peut lorfque le facrificateur, appellé
le roi, a aflifté aux comices. 8°. Enfin par-tout
ou il y a ces lettres Q , S T , D , F y ou quando fiercus
delatum,fas, qu’on le peut aulfi-tôt que le fumier a
été tranfporté hors du temple de la déeffe Vefta.
5 p. La troifieme colonne eft pour les dix-neuf carafteres
des nombres du cycle lunaire, autrement
appellé \e nombre d?or9 pour marquer les nouvelles
lunes dans toute l’année , fuivant l’ordre auquel on
croit qu’elles arrivoientdu tems de Jules-Céfar, que
ces caraûeres furent ainfi difpofés dans fon calen-
69. La quatrième colonne marque la fuite des
jours des mois, pur les nombres de chiffres ou ca-
rafterés arabiques: mais il ne faut pas s’imaginer
qu’ils fuffent ainfi difpofés dans les tables des faftes,
c eft-à-dire, dans le calendrier dont les anciens fe
fervoient, puifqu’ils n’en avoient aucune connoif-
fance. Nous avons jugé à propos de les y placer,
afin que l’on pût mieux connoître le rapport qu’il y
a entre la maniéré de nommer & de compter les
jours des Romains & la nôtre, & quels font les jours,
félon notre façon de compter , auxquels les fêtes ôc
les jours de ce peuple peuvent répondre.
70. La cinquième colonne contient cette divifion
fi célébré des jours des bois en calendes , nones 8c
ides , qui étoient en ufage parmi les Romains. Elle
n’eft point en parties égales, comme les calendes
des Grecs, mais en portions fort différentes , dont
la variété eft néanmoins renfermée dans ces deux
vers latins :
S ex maius nonas, oclober, julius & mars ;
Quatuor at reliqui. Dabit idus quilibet oïto.
C ’eft-à-dire, que ces quatre mois, mars, mai, juillet
& odtobre, ont fix jours de nones, 8c que tous les
autres n’en ont que quatre ; mais qu’il y a dans tous
huit jours d’ides ; ce qu’il faut entendre ainfi, favoir :
que le premier jour de chaque mois s’appelle toujours
calenda ou kalendce, les calendes ; qu’aux quatre mois,
mars, mai, juillet & octobre , le feptieme du mois
s’appelle nonie , les nones, 8c le treizième idus , les
ides. Les autres jours fe comptent à rebours du mois
fuivant, comme le 28 , le 29, &c. avant les calendes
du mois fuivant. Les jours qui font depuis Les calendes
jufqu’aux nones, prennent le nom des nones du
mois courant : les autres jours qui font entre les
nones 8c les ides, prennent aufli le nom des ides du
même mois. Mais tous les autres jours depuis les ides
jufqu’à la fin , prennent le nom des calendes du mois
fuivant. On voit au refte que les tables des faftes, fur
lefquelles les Romains plaçoient leurs mois 8c leurs
jours par année , prirent dans la fuite le nom de calendrier
, parce que ce nom de calendes étoit écrit en
gros carafteres à la tête de chaque ni ois.
8°. Enfin la derniere colonne comprend les cho-
fes-qui appartiennent principalement à la religion des
Romains, comme font les fêtes, les facrifices, les
je u x , les cérémonies, les jours heureux ou malheureux
; aufli bien que les commencemens des Agnes ,
les quatre points cardinaux de l’année, qui font les
quatre faifons, le lev er 8c le coucher des étoiles,
&c. Cela étoit d’un grand ufage parmi les anciens,
qui s’en font long-tems fervipour marquer la diffé-
rence^des faifons, au lieu de calendrier, au moins
jufqu’à ce qu’il eût été rédigé dans une forme plus
régulière par la correétion de Jules-Céfar. Nous
voyons dans la plupart des livres anciens,que l’on fe
gouvernoit entièrement par l’obfervation du lever
8c du coucher des étoiles, dans la Navigation, dans
l’Agriculture , dans la Médecine 8c dans la plus
grande partie des affaires publiques 8c particulières.