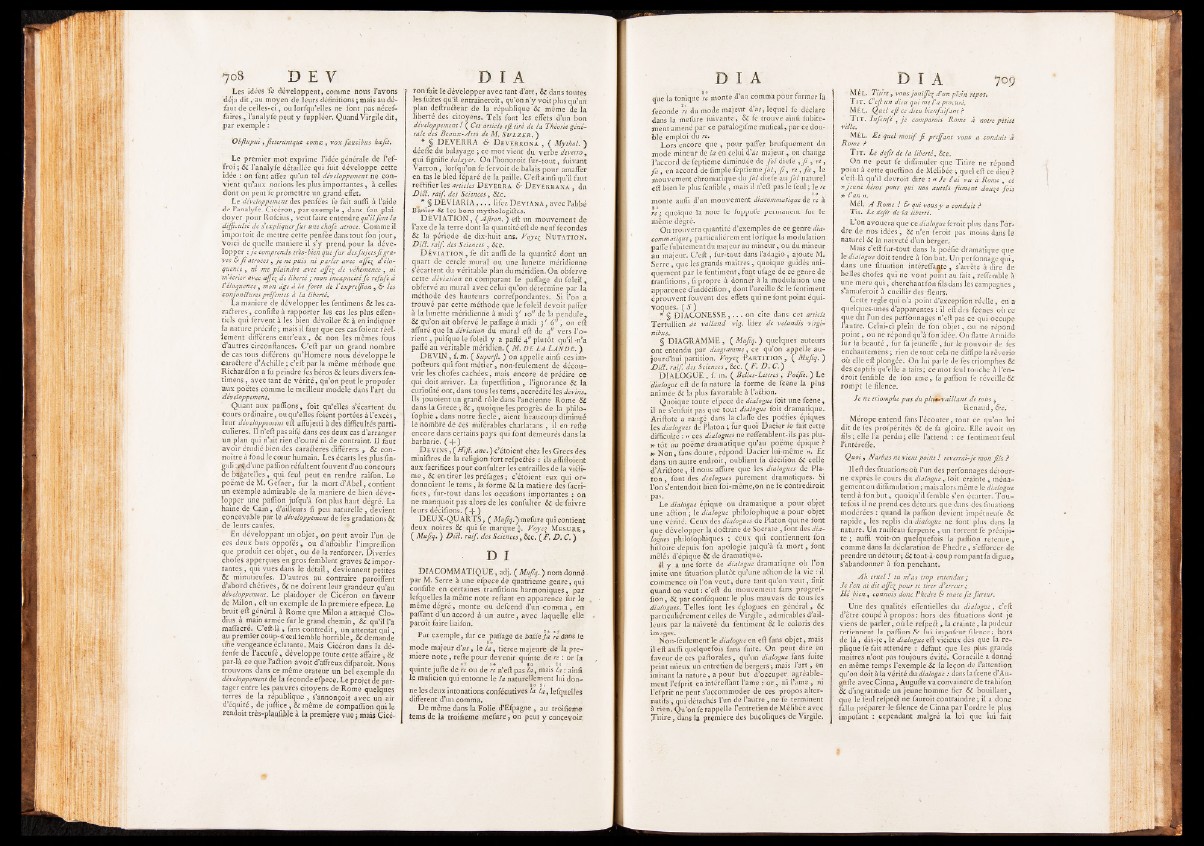
Les idées Te développent, comme hous l'avons
déjà dit ,au moyen de leurs définitions ; mais au défaut
de celles-ci, ou lorfqu’elles ne font pas nécef-
fiaires, l’analyfe peut y fuppléer. Quand Virgile dit,
.par exemple :
Obftupui, fieterüntque c o m a , vox faucibus haßt.
Le premier mot exprime l’idée générale de l’effroi
; 8c l’analÿfe détaillée qui fuit développe cette
idée : on fent affez qu’un tel développement ne convient
qu’aux notions les plus importantes, à celles
dont on peut Te promettre un grand effet.
Le développement des penfées fe fait auffi à l’aide
de l’analyfe. Cicéron, par exemple , dans fon plaidoyer
pourRofcius, veut faire e n te n d re qu’i l fent la
difficulté de £ expliquer fu r une chofe atroce. Comme il
importait de mettre cette penfée dans tout fon jour,
Voici de quelle maniéré il s’y prend pour la développer
: j e comprends très-bien que fu r desfujetsfigra-
'Ves & f i atroces , j e ne puis, ni parler avec affic{ d’ éloquence
, ni me plaindre avec affe£ de véhémence , ni
nü écrier avec affie^ de liberté ; mon incapacité fe refufe à
T éloquence, mon âge à la force dé V expreffion, & les
Conjonctures préfentes à la liberté.
La maniéré de développer les fentimens 8c les ca-
ra&eres, confifte à rapporter les cas les plus effen-
tiels qui fervent a les bien dévoiler & à en indiquer
la nature précife ; mais il faut que ces cas foient réellement
différens entr’eux, 8c non les mêmes fous
d’autres circonftances. C’eft par un grand nombre
de cas tous différens qu’Homere nous développe le
carattere d’Achille ; c’eft par la même méthode que
Richardfon a fu peindre fes héros 8c leurs divers fentimens
, avec tant de vérité, qu’on peut le propofer
aux poètes comme le meilleur modele dans l’art du
développement.
Quant aux pallions, foit qu’elles s’écartent du
cours ordinaire, ou qu’elles foient portées à l’excès,
leur développement eft affujetti à des difficultés particulières.
Il n’eft pas aifé dans ces deux cas d’arranger
un plan qui n’ait rien d’outré ni de contraint. Il faut
avoir étudié bien des caraûeres différens , & con-
iroître à fond le coeur humain. Les écarts les plus fin-
guli ^ d ’une paffion réfultent fouvent d’un concours
de bagatelles, qui féul peut en rendre raifon. Le
poëme de M. Gefner, fur la mort d’Abel, contient
un exemple admirable de la maniéré de bien développer
une paffion jufqu’à fon plus haut dégré. La
haine de Caïn, d’ailleurs fi peu naturelle, devient
concevable par le développement de fes gradations 8c
de leurs caufes.
En développant un objet, on peut avoir l’un de
ces deux buts oppofés, ou d’affoiblir Pimpreffion
que produit cet objet, ou de la renforcer. Diverfes
chofes apperçues en gros femblent graves & importantes
, qui vues dans le détail, deviennent petites
8c minutieufes. D’autres au contraire paroiffent
d’abord chétives, 8c ne doivent leifr grandeur qu’au
développement. Le plaidoyer de Cicéron en faveur
de Milon, eft un exemple de la première efpece. Le
bruit eft général à Rome que Milon a attaqué Clo-
dius à main armée fur le grand chemin, 8c qu’il l’a
maffacré. C’eft-là , fans contredit, un attentat qui,
au premier coup-d’oeil femble horrible, & demande
uîie vengeance éclatante. Mais Cicéron dans la dé-
fenfe de l’accufé, développe toute cette affaire, &
par-là ce que l’aélion avoit d’affreux difparoît. Nous
trouvons dans ce même orateur un bel exemple du
développement de la fécondé efpece. Le projet de partager
entre les pauvres citoyens de Rome quelques
terres^ de la republique , s’annonçoit avec un air
d’équité, de juftice, &même de compaffion qui le
rendoit très-plaufible à la première vue ; mais Cicéton
Tait le développer avec tant d’art, 8c dans toutes
les fuites qu’il entrriînéroit, qu’on n’y voit plus qu’un
plan deftruûeùr de la république 8c même de ïa
liberté des citoyens. Tels font les effets d’un bon
développement ! ( Cet article eft tiré de la Théorie gêné-
raie des Beaux-Arts de M. S u l z e r . )
* $ DÉVERRA & D everrona , ( Mythol. )
déeffe du balayage ; ce mot vient du verbe deverro 9
qui fignifie balayer. On l’honoroit fur-tout, fuivant
Varron, lorfqu’on fe fervoit de balais pour amaffer
en tas le blëd féparé de la paille. C’eftainfi qu’il faut
rettifier les articles D everra & D everrana , du
Dicl. raif. des Sciences, &c.
ß § D E V IA R IA ,. . . lifez D e v ia n a , avec l’abbé
Banier 8c les bons mythologiftes.
DÉVIATION, ( Aßron„ ) eft un mouvement de
l’axe de la terre dont la quantité eft de neuf fécondés
8c la période de dix-huit ans. Voyei Nu ta tio n.
Dict. raif. des Sciences , 8cc.
D é v ia t io n , fe dit aufîi de la quantité dont un
quart de cercle mural ou une lunette méridienne
s’écartent du véritable plan du méridien. On obferve
cette déviation en comparant le paffage du foleil
obfervé au mural avec celui qu’on détermine par la
méthode des hauteurs correfpondantes. Si l’on a
trouvé par cette méthode que le foleil de voit paffer
à la lunette méridienne à midi f îo " de la pendillé,
& qu’on ait obfervé le paffage à midi f 6 " , on eft
affuré que la déviation du mural eft de 4" vers l’orient
, puifque le foleil y a paffé 4" plutôt qu’il *n’a
£affé au véritable méridien. ( M. d e l a L a n d e . )
D E V IN , f. m. ( Superß. ) on appelle ainfi ces im-
pofteurs qui font métier, non-feulement de découvrir
les chofes cachées, mais encore de prédire ce
qui doit arriver. La fuperftition, l’ignorance & la
curiofité ont, dans tous les tems, accrédité les’devins.
Ils jouoient un grand rôle dans l’ancienne Rome 8c
dans la Grece ; 8c, quoique les progrès de la philo-
fophie , dans notre fiecle, aient beaucoup diminué
le nombre de ces miférables charlatans , il en refte
encore dans certains pays qui font demeurés dans la
barbarie. ( + )
D evins , ( Hiß. anc. ) c’étoient chez les Grecs des
miniftresde la religion- fort refpe&és : ils affiftoient
aux facrifices pour confulter les entrailles de la vitti-
me, 8c en tirer l'es préfages ; c’étoient eux qui or-
donnoient le tems, la forme & la matière des facrifices
, fur-tout dans les occafions importantes : on
ne manquoit pas alors de les confulter 8c de fuivre
leurs décifions. ( + )
DEUX-QUARTS, ( Mufiq.j mefure qui contient
deux noires 8c qui fe marque f . Voye7^ Mesu re,
( bAufiq. ) Dict. raif, des Sciences, 8 cc. (T7. D . C. )
D I
DIACOMMATIQUE, adj. ( Mufiq. ) nom donné -
par M. Serre à une efpece de quatrième genre, qui
confifte en certaines -tranfitions harmoniques, par
lefquelles la même note reftant en apparence fur le
meme dégré, monte ou défeend d’un -comma , en
paffant d’un accord à un autre, avec laquelle elle
paroît faire liaifon.
Par exemple, fur ce paffage de baffe fa re dans le
mode majeur d’u t, le la , tierce majeure de la première
note, refte pour devenir quinte de re : or la
quinte jufte de re ou de re n’eft pas la, mais la : ainfi
i f muficien qui entonne le la naturellement lui donne
les deux intonations confécutives la la, lefquelles
different d’un comma.
De même dans la Folie d’Efpagne , au troifieme
tems de la troifieme mefure, on peut y concevoir;
que la tonique re monte d’un comma pour former là
fécondé re du mode majeur d’«/> lequel fe déclare
dans la mefure fuivante, 8c fe trouve ainfi fubite-
ment amené par ce paralogifme mufical, par ce doublé
emploi du re.
Lors encore que -, pour paffer, brufquement du
mode mineur de la en celui d’ut majeur, on changp
l ’accord de feptieme dimimiée de fo l diefe ,fi * ré,
fa y en accord de fimplefeptiemç.j'ol, f i , re , f a , le
mouvement chromatique du fo l diefe au fo l naturel
eft bien le plus fenfible, mais il n’eft pas le feul ; le re
monte aufîi d’un mouvement diacommatique de re à
re; quoique la note le fuppofe permanent fur le
même dégré.
On trouvera quantité d’exemples de ce genre diacommatique,
particuliérement lorfque la modulation
paffe fubitementdu majeur au mineur, ou du mineur
au majeur. C’eft , fur-tout dans l’adagio, ajouté M.
Serre, que les grands maîtres, quoique guidés uniquement
par le fentiment, font ufage de ce genre de
tranfitions, fi propre à donner à la modulation une
apparence d’indécifion, dont l’oreille & le fentiment
éprouvent fouvent des effets qui ne font point équivoques.
( S )
* § DIACONE SSE,. . . on cite dans cet article
Tertullien de valland vig. lifez de velandis virgi-
nïbus.
§ DIAGRAMME , ( Mujtq. ) quelques auteurs
Ont entendu par diagramme , ce qu’on appelle aujourd'hui
partition. yoye^ Pa r t it io n , ( Mujîq.')
Dict. raif. des Sciences, &c. ( F. D. C .)
DIALOGUE , f.' m. ( B elles-Lettres , Poéfie.j Le
'dialogue eft de fa nature la forme de feene la plus
animée 8c la plus favorable à l’a&ion.
Quoique toute efpéce de dialogue foit une fcêne,
il ne s’enfuit pas que tout dialogue foit dramatique.
Ariftote a rangé dans la claffe des poélies épiques
les dialogues de Platon ; fur quoi Dacier fe fait cette
difficulté : « ces dialogues ne reffemblent-ils pas plu-
» tôt au poème dramatique qu’au poëme épique ?
w Non, fans doute, répond Dacier lui-même ». Et
dans un autre endroit, oubliant fa décifion 8c celle
d’Ariftote, il nous affure que les dialogues de Platon
, font des dialogues purement dramatiques. Si
l’on s’entendoit bien foi-même,on ne fe contrediroit
pas.
Le dialogue épique ou dramatique a pour objet
une aftion ; le dialogue philofophique a pour objet
une vérité. Ceux des dialogues de Platon qui ne font
que développer la do&rine de Socrate , font des dialogues
philofophiques. ; ceux qui contiennent fon
hilloirë depuis fon apologie jufqu’à fa mort, font
mêlés d’épique & de dramatique.
11 y a une forte de dialogue dramatique où l’on
imite une fituation plutôt qu’une aftion de la vie :"il '
commence où l’on veut, dure tant qu’on veu t, finit
quand on veut : c ’eft du mouvement fans progréf-
fion, 8c par conféquent le plus mauvais de tous les
dialogues. Telles font les églogues en général, 8c
particuliérement celles de Virgile, admirables d’ailleurs
par la naïveté du fentiment 8c le coloris des
images. . . . ,
Non-feulemenf le dialogue en eft fans objet, mais
il eft auffi quelquefois fans fuite. On peut dire en
faveur de ces paftorales, qu’un dialogue fans fuite
peint mieux un entretien de bergers ; mais l’art , en
imitant la nature, a pour but d’occuper, agréablement
l’efprit èn intéreffant l’ame : o r , ni l’ame , ni
l’efprit ne peut s’accommoder de ces propos alternatifs
,,qui détachés l’un de l’autre, ne fe terminent
à rien. Qu’on fe rappelle l’entretien de Mélibée avec
[Titire > dans la première des bucoliques de Virgile.
M é l . Tit irê, vous jouiffeç tTun plein repos1.
T i t . Ceji un dieu qui me Ca procuré.
M e l . Quel eft ce dieu bienfaifant ?
T i r . 1,iSii.fi , je comparois Borne d notre petite
ville.
M é l . E t quel motif f i preffiant vous a conduit à
Borne ■ ?
T it . Le defirde la liberté, &e.
On né peut fe diffimuler que Titire rie répond
point à cette queftion de Mélibée ; quel eft ce dieu?
c’eft-là qu’il devroit dire : « Je Cal vu a Borne , ce
» jeune héros pour■ qui nos autels, fument dou^e fois
Mel. A Borne ! St qui vous y-a conduit ?
Tit. Le dejîr âe la liberté.
L’on avouera que ce dialogue feroit plus dans l’ordre
de nos idées, 8c n’en feroit pas moins dans le
naturel 8c la naïveté d’un berger.
Mais c’eft fur-tout dans la poéfie dramatique que
le dialogue doit tendre à fon but. Un per Tonnage qui,
dans une fituation intéreffaate , s’arrête à dire de
belles Chofes qui rie vont point au fa it, reflemble à
une mere qui, cherchant Ton fils dans les campagnes ,
s’àmuferoit à cueillir des fléurs.
Cette réglé qui n’a point d’exception réelle, en a
quelques-unes d’apparentes : il eft des fcénes où ce
que dit l’un des perfonnages n’eft pas ce qui occupe
l’autre. Celui-ci plein de fon objet, ou ne répond
point, ou rie répond qu’àTon idée. On flatte Armide
fur fa beauté , fur fa jeunefle , fur le pouvoir de Tes
enchantemens ; rien de tout cela ne diffipe la rêverie
où elle eft plongée. On lui parle de Tes triomphes &
des captifs qu’elle a faits; cemot feul touche à l ’endroit
fenfible de fon ame, fa paffion fe réveille 8c
roriipt le filence.
Je ne triomphe pas du pluè*vaillant de toits ,
Renaud, &ç.
Mérope entend fans l’écôuter, tout ce qu’on lui
dit de Tes profpérités 8c de fa gloire. Elle avoit ün
fils; elle l’a perdu; elle l’attend : cë fentiment feul
l’intérefle.
Quoi, Narbas ne vient point ! reverrai-je mon fils ?
Iieftdesfituationsoù l’un des perfonnages détourne
exprès le cours du dialogue ,.foit crainte , ménagement
ou diffimulation ; mais alors même le dialogue
tend à Ton but, quoiqu’ il femble s’ en écarter. Toutefois
il ne prend ces détours que dans des fituations
modérées : quand la paffion devient impétueufe 8c
rapide, les replis du dialogue ne font plus dans la
nature. Un ruifleau ferpente, un torrent fe précipite
; auffi voit-on quelquefois la paffion retenue,
comme dans la déclaration dé Phedre , s’efforcer de
prendre un détour ; 8c tout-à-coup rompant fa digue,
s’abandonner à fon penchant.
Ah cruel ! tu nias trop entèiidue ;
Je t’en ai dit affie^ pour te tirer d’erreur ;
Hé bien, cannois donc Phedre & toute fa fureur.
Une des qualités effentielles du dialogue, c’eft
d’être coupé à propos : hors des fituations dont je
viens de parler, où le refpeft, la crainte, la pudeur
retiennent la paffion 8c lui impofenirfilence; hors
de là , dis-je, le dialogue eft vicieux dès que la re-
plique fe fait attendre défaut que les pdus grands
maîtres n’ont pas toujours évité. Corneille a donné
en même temps l ’exemple & la leçon de l’attention
qu’on doit à la vérité du dialogue : dans la feene d’Au-
gfifte avecCinna, Augufte va convaincre de trahifon
8c d’ingratitude un jeune homme fier 8c bouillant,
que le feulrefpeft ne fauroit contraindre ; il a donc
fallu préparer-le filence de Cinna par l’ordre le plus
impofànt : cependant malgré la loi que lui fait