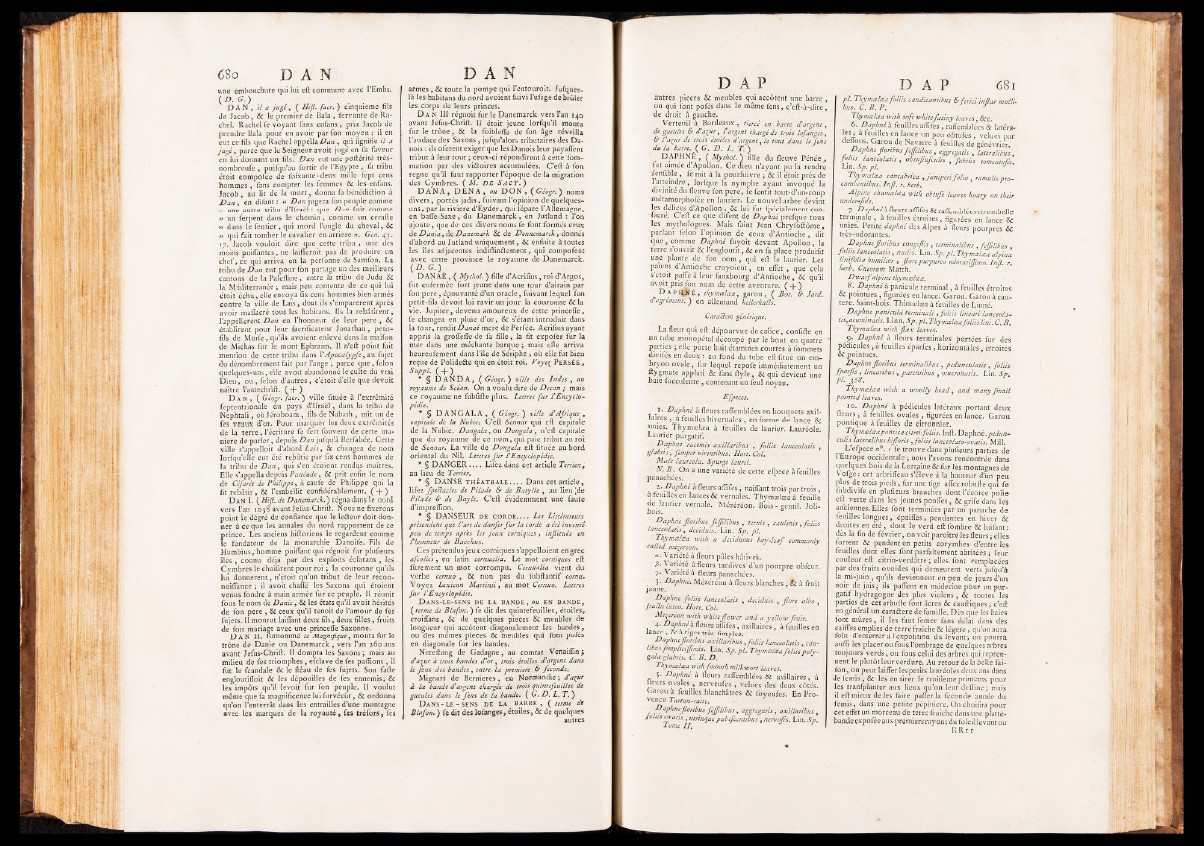
une embouchure qui lui eft commune avec l’Ëmbs.
( D. G. )
D A N , il a ju gé, ( Hift. facr. ) cinquième fils
de Jacob, 6c le premier de Bala , fervante de R-a-
chel. Rachel fe voyant fans enfans , pria Jacob de
prendre Bala pour en avoir par fon moyen : il en
eut ce fils que Rachel appella Dan , qui fignifie il a
ju ge, parce que le Seigneur avoit jugé en fa faveur
en lui donnant un fils. Dan eut une poftérité très-
nombreufe , puifqu’au fortir de l’Egypte, fa tribu
étoit compofée de foixante - deux mille fept cens
hommes , fans compter les femmes 6c les enfans.
Jacob, au lit de la mort, donna fa bénédiûion à
D a n , en difant : « Dan jugera fon peuple comme
» une autre tribu d’Ifraël : que Dan foit comme
» un ferpent dans le chemin , comme un cerafte
» dans le fentier, qui mord l’ongle du cheval, 6c
» qui fait tomber le cavalier en arriéré ». G en. 43.
i j . Jacob vouloit dire que cette tribu , une des
moins puiffantes, ne laifferoit pas de produire un
chef, ce qui arriva en la perfonne de Samfon. La
tribu de Dan eut pour fon partage un d.es meilleurs
cantons de laPaleftine, entre la tribu de Juda 6c
la Méditerranée ; mais peu contente de ce qui lui
étoit échu, elle envoya fix cens hommes bien armés
contre la ville de Laïs, dont ils s’emparèrent après
avoir maffacré tous les habitans. lis la rebâtirent,
l ’appellerent Dan en l’honneur de leur pere , 6c
établirent pour leur facrificateur Jonathan, petit-
fils de Moïfe, qu’ils avoient enlevé dans la maifon
de Michas fur le mont Ephraïm. Il n’eft point fait
mention de cette tribu dans l’Apocalypfe, au fujet
du dénombrement fait par l’ange ; parce que, félon
quelques-uns, elle avoit abandonné le culte du vrai
Dieu , o u , félon d’autres, c’étoit d’elle que devoit
naître l’antechrift. ( + )
D a n , ( Géogr. facr. ) ville fituée à l’extrémité
feptentrionale du pays d’Ifraël, dans la tribu de
Nephtali, oii Jérçboam, fils de Nabath , mit un de
fes veaux d’or. Pour marquer les deux extrémités
de la terre, l’écriture fe fert fouvent de cette maniéré
de parler, depuis Dan jufqu’à Berfabée. Cette
ville s’appelloit d’abord Laïs, & changea de nom
lorfqu’elle eut été rebâtie par fix cens hommes de
la tribu de D an , qui s’en étoient rendes maîtres.
Elle s’appella depuis Panéade, 6c prit enfin le nom
de Cèfarêe de Philippe, à caufe de Philippe qui la
fit rebâtir, 6c l’embellit confidérablement. ( + )
D an I. (H f i de Danemarck.) régna dans le nord
vers l’an 1038 avant Jefus-Chrift. Nous ne fixerons
point le dégré de confiance que le Ieâeur doit donner
à ce que les annales du nord rapportent de ce
prince. Les anciens hiftoriens le regardent comme
le fondateur de la monarchie Danoife. Fils de
Humbius, homme puiffant qui régnoit fur plufieurs
îles , connu déjà par des exploits éclatans , les
Cymbres le choifirent pour roi ; la couronne qu’ils
lui donnèrent, n’ étoit qu’un tribut de leur recon-
noiffance ; il avoit chaffé les Saxons qui étoient
venus fondre à main armée fur ce peuple. H réunit
fous le nom de Danie, 6c les états qu’il avoit hérités
de fon pere , 6c ceux qu’il tenoit de l’amour de fes
fujets. Il mourut laiffant deux fils, deux filles, fruits
de fon mariage avec une princeffe Saxonne.
D a n IL ïurnommé le Magnifique, monta fur le
trône de Danie ou Danemarck, vers l’an 260 ans
avant Jefus-Chrift. Il dompta les Saxons ; mais au
milieu de fes triomphes, efclave de fes pallions , il
fut le fcandale & le fléau de fes fujets. Son fafte
engloutifloit 6c les dépouilles de fes ennemis, &
les impôts qu’il levoit fur fon peuple. Il voulut
même que,fa magnificence lui furvécût, 6c ordonna
qu’on l’enterrât dans les entrailles d’une montagne
avec les marques de la royauté , fes tréfors, fes
armes, & toute la pompe qui l’entouroit. Jufques-
là les habitans du nord avoient fuivi l’ufage de brûler
les corps de leurs princes.
D a n III régnoit fur le Danemarck vers l’an 140
avant Jefus-Chrift. Il étoit jeune lorfqu’il monta
fur le trône, 6c la foibleffe de fon âge réveilla
l’audace des Saxons, jufqu’alors tributaires des Danois
: ils oferent exiger que les Danois leur payaffent
tribut à leur tour ; ceux-ci répondirent à cette fom-
mation par des viûoires accumulées. C ’eft à fon
régné qu’il faut rapporter l’époque de la migration
des Cymbres. ( M. d e S a c y . )
D A N A , D E N A , ou D O N , (Géogr.) noms
divers, portés jadis, fuivant l’opinion de quelques-
uns, par la riviere d’Eyder, qui fépare l’Allemagne,
en baffe-Saxe, du Danemarck, en Jutland : l’on
ajoute, que de ces divers noms fe font formés ceux
de Dania, de Danemark 6c de Dennemarck ,• donnés
d’abord au Jutland uniquement, 6c enfuite à toutes
les îles adjacentes indiftinûement, qui compofent
avec cette province le royaume de Danemarck. ®B0 I D AN AÉ, ( Mythol.) fille d’Acrifius, roi d’Argos,
fut enfermée fort jeune dans une tour d’airain par
fon pere, épouvanté d’un oracle, fuivant lequel fon
petit-fils devoit lui ravir un jour la couronne 6c la
vie. Jupiter, devenu amoureux de cette princeffe,
fe changea en pluie d’o r , 6c s’étant introduit dans
la tour, rendit Danaé mere de Perfée. Acrifius ayant
appris la groffeffe de fa fille, la fit expofer fur la
mer dans une méchante barque ; mais elle arriva
heureufement dans l’île de Sériphe , oh elle fut bien
reçue de Polideéle qui en étoit'roi, Voye£ Persée,
Suppl. ( + )
* § D A N D A , (Géogr.) ville des Indes, au
royaume de Scéan. On a voulu dire de Decan ; mais
ce royaume ne fubfifte plus. Lettres fur VEncyclopédie.
* § D A N G A L A , ( Géogr. ) ville d? Afrique ,
capitale de la Nubie. C’eft Sennar qui eft capitale
de la Nubie. Dangala, ou Dongala, n’eft capitale
que du royaume de ce nom, qui paie tribut au roi
de Sennar. La ville de Dongala eft fituée au bord
oriental du Nil. Lettres fur VEncyclopédie.
* § DANGER . . . . Lifez dans cet article Terrien
au lieu de Terrier.
* § DANSE th é â t r a l e . . . . Dans cet article,
lifez fpectacles de Pilade & de Batylle , au lieu [de
Pilade & de Bayle. C ’eft évidemment une faute
d’impreflïon.
* § DANSEUR de corde. . . . Les Littérateurs
prétendent que l'art de danfer fu t la corde a été invente-
peu de temps après les jeux comiques , injlitués en
Chonneur de Bacchus.
Ces prétendus jeux comiques s’appelloient en grec
afeolies, en latin cernualia. Le mot comiques eft
furement un mot corrompu. Cernualia vient du
verbe cernuo , 6c non pas du fubftantif cornu.
V oyez Lexicon Martimi, au mot Cernuo. Lettres
fur l'Encyclopédie.
D ans-le-sens de la b a n d e , ou en band e,
(terme de Blafon. ) fe dit des quintefeuilles, étoiles,
croifians, 6c de quelques pièces 6c meubles de
longueur qui accotent diagonalement les bandes ,
ou des mêmes pièces 6c meubles qui font pofés
en diagonale fur les bandes.
Nereftang de Gadagne, au comtat Venailîîn ;
cCa^ur à trois bandes d'or, trois étoiles elargent dans
le fens des bandes, entre la première & fécondé.
Mignart de Bernieres, en Normandie ; (Partir
d la bande d'argent chargée de trois quintefeuilles de
gueules dans le fens de la bande. ( G. D. L. T. )
D a n s - l e - sens de la barre , ( terme dt
Blafon.) fe dit des lofanges, étoiles, 6c de quelques
autres
D A P
autres pièces 6c meubles qui accotent une barre ,
ou qui font pofés dans le même fens, c’eft-à-dire,
de droit à gauche.
Verteuil à Bordeaux, tiercé en barre ' cPargent,
de gueules & d'azur, l'argent chargé de trois lofanges,
& L'azur de trois étoiles d'argent, le tout dans le fens
de> la barre. ( G. D . L. T. ) ' '
DAPHNÉ , ( Mythol. ) fille du fleuve Pénée^
fut aimee d’Apollon. Ce dieu n’ayant pu la rendre
fenfible , fe mit à la pourfuivre ; & il étoit prèi de
l’éteindre, lorfque la nymphe ayant invoqué la
divinité du fleuve fon pere', fe fentit tout-d’un-coup
metamorphôfée en laurier. Le nouvel arbre devint
les délices d’Apollon , 6c lui fut fpécialement con.
■ facre. C’eft ce que difent de Daphné prefque tous
les mythologues. Mais faint Jean Chryfoftôme,
parlant félon l’opinion de ceux dvAntioche, dit
q u e , comme Daphné fuyoit devant Apollon, la
terre s’ouvrit 6c l’engloutit, 6c en fa place produifit
line plante de fon nom, qui eft le laurier. Les
païens d’Antioche croyoient, en effet , que cela
s ’étoit paffé à leur fauxbourg d’Antioche, & qu’il
avoit pri^fon nom de cette aventure. ( + )
D A p H N É , thymælæa, garou , ( Bot. & Jard.
£ agrément.) en allemand kellerhqlls.
Caractère générique.
La fleur qui eft dépourvue de calice, confifte en
un tube monopétal découpé par le bout en quatre *
parties ; elle porte huit étamines courtes à fommets
divifés en deux : au fond du tube eft fitué un embryon
ovale, fur lequel repofe immédiatement un
ltygmate applati 6c fans ftyle, & qui devient une
baie fucculente, contenant un feul noyau.
Efpeces.
1. Daphné à fleurs raffemblées en bouquets axillaires
, à feuilles hivernales , en forme de'lance 6c
.Unies. Thymælæa à feuilles de laurier. Lauréole.
Laurier purgatif.
Daphné raceniis axilluribus , foliis lanceolatis ,
glabris, femper virentibus. Hort. Col.
Male laureola. Spurge latirel.
N. B . On a une variété de cette efpece à feuilles
panachées.
r 2* P aphné.kf[eurs afîifes, naiffant trois par trois ,
a feuilles en lances & vernales. Thymælæa à feuille
de laurier vernale. Mézéréon. Bois-gentil. Jolibois.
°
Daphné fioribus feffilibus , ternis , caulinis , foliis
lanceolatis, décidais. Lin. Sp. pl.
hyrnatloea with a deciduàus baf-leaf commonly
called me^èreon.
et. Variété à fleurs pâles hâtives.
£. Variété a fleurs tardives d’un pourpre obfcur.
y. Variété à fleurs panachées.
^ 3. Daphné. Mézéréon à fleurs blanches, 6c à fruit
jaune.
Daphné foliis lanceolatis , décidais , flore albo ,
fruchtluteo. Hort..Col. .
Me^ereon withwhite fiower and a yêllow fniit.
4. Daphné à fleurs aliï fes, axillaires , à feuilles en
lance, & à tiges très-fimples.
Daphné fioribus axiüaribus , foliis lanceolatis, eau-
libus JimpliciJfitms. Lin. Sp.pl. Thymælæa foliis poly-
gala glabris. C. B. D . ' 7 \
Thymælæa with fmooth niilkwort Heaves.
5. Daphné à fleurs raffemblées 6c axillaires, à !
fleurs ovales , nerveufes , velues des deux côçés.
Car où a feuilles blanchâtres 6c foyeufes. En Provence
Tarton-raire.
, P aphnefioribus feffilibus, aggregàtis, axillaribus,
folus ovatis, utrinque pubefeentibus, neryofis. Lin.-Sp.
Tome II.
D A P 681
pl. Thymælæa foliis candicantibus & ferici inflar molli
bus. C. B. P . J
Thymælæa with soft white fatiny leaves 6cci
6. Daphné à feuilles affifes , rafl’emblées & Iatéra-
lesi à feuilles en lance un peu obtüfes , velues par
delious. Garou de Navarre à feuilles de génévrier.
Daphné fioribus fejjîlîbus , aggngtu&i Uttmlihùs,
Mus lanceolatis,; otfibfiufeulis , fubti j tomemdiïs.
Lin. Sp. p l. J
Thymcélcea càntàBnça ,jùmpenWibjramulispro-
cumbentibus. Infi. r. herb.
Alpine chamælæa with obtufe leaves hoary on their
•tinder*fidc.
; 7. paphnï&fleiiçs affifes & raffemblées en ombelle
terminale , à feuilles étroites, figurées en lànée &
unies; Pente iàpKrii des Alpes à fleurs pourpres &
tres-:odorantes. •
Daphné fioribus congefiis , terminalibus , feffilibus ,
folus lanceolatis, nudis. Lin. Sp.pl. Thymælæa alpina.
itnifolia humilior , flore purpureo odoratiffimo. Infl. r.
herb. Cneorum Matth.
Dwarf alpine thymælæa.
8. Daphné à panicule terminal, à feuilles étroites
6c pointues , figurées en lance. Garou. Garou à cautère.
Saint-bois. Thimælæa à feuilles de Linné.
Daphné paniculâ terminale , foliis lineari lanceolatis,
acuminatis. Linn. Sp.pl. Thymælæa foliis lini. C. B .
Thymælæa with fla x leaves.
<). Daphné à fleurs terminales portées fur des
pédicules, à feuilles éparfes, horizontales, étroites
6c pointues.
Daphné fioribus terminalibus , pedunculatis, foliis
fparfis , linearibus, patentibus ,• mucrohatis. Lin. Sp.
Pl- 3 **-■
Thymælæa with a woolly head, and many finall
poihted leaves.
10. Daphné à pédicules latéraux portant deux
fleurs, à feuilles, ovales , figurées en lance.'Garou
pôntique à feuilles de citronnier.
Thymælæapontica citrei-foliis. Inft. Daphné, pedun-
culis laieralibus bfioris, foliis lanceolato-ovatis. Mill.
L efpece n° . / fe trouve dans plufieurs parties de
l’Europe occidentale ; nous l’avons rencontrée dans
quelques bois de la Lorijaine & fur les montagnes de
Vofge: cet arbriffeau s’eleve à la hauteur d’iin peu
plus de trois pieds, fur une tige affez robufte qui fe
fubdivife en plufieurs branches dont l’éëorce polie
eft verte dans les jeunes pouffes, 6c grife dans les
anciennes. Elles font terminées par un panache de
feuilles longues, épaiffes, pendantes en hiver 6c
droites en é té , dont le verd eft fombre 6c luifant :
dès la fin de février, on voit paroître les fleurs ; elles
fortent 6c pendent en petits corymbes d’entre les
feuilles dont elles font parfaitement abritées ; leur
couleur eft citrin-verdâtre ; elles font remplacées
par des fruits ovoïdes qui demeurent verts jufqu’à
la mi-juin , qu’ils deviennent en peu de jours d’un
noir de jais ; ils paffent en médecine pour un purgatif
hydragogue des plus violéns, 6c toutes les
parties de cetarbufte font âcres & cauftiques ; c’eft
en général un caractère de famille. Dès que les baies
font mûres, il les faut femer fans délai dans des
caiffes emplies de terre fraîche & légère, qu’on aura
foin d’enterrer à l’expofition du levant; on pourra
auffi les placer ou fous l’ombrage de quelques afbres
toujours verds, ou fous celui des arbres qui reprennent
le plutôt leur verdure. Au retour de la belle fai-
fon, on peut laiffer les petits lauréoles deux ans dans
Jefemis’, 6c les en tirer lé troifieme printems pour
les tranfplanter aux lieux qu’on leur deftine ; mais
il eft mieux de les faire paffer la fécondé année du
femis, dans une petite pépinière. On choifira pour
cet effet un morceau de terre fraîche dans une plattebandeexpofée
aux premiers rayons du foleil levant ou
R R r r