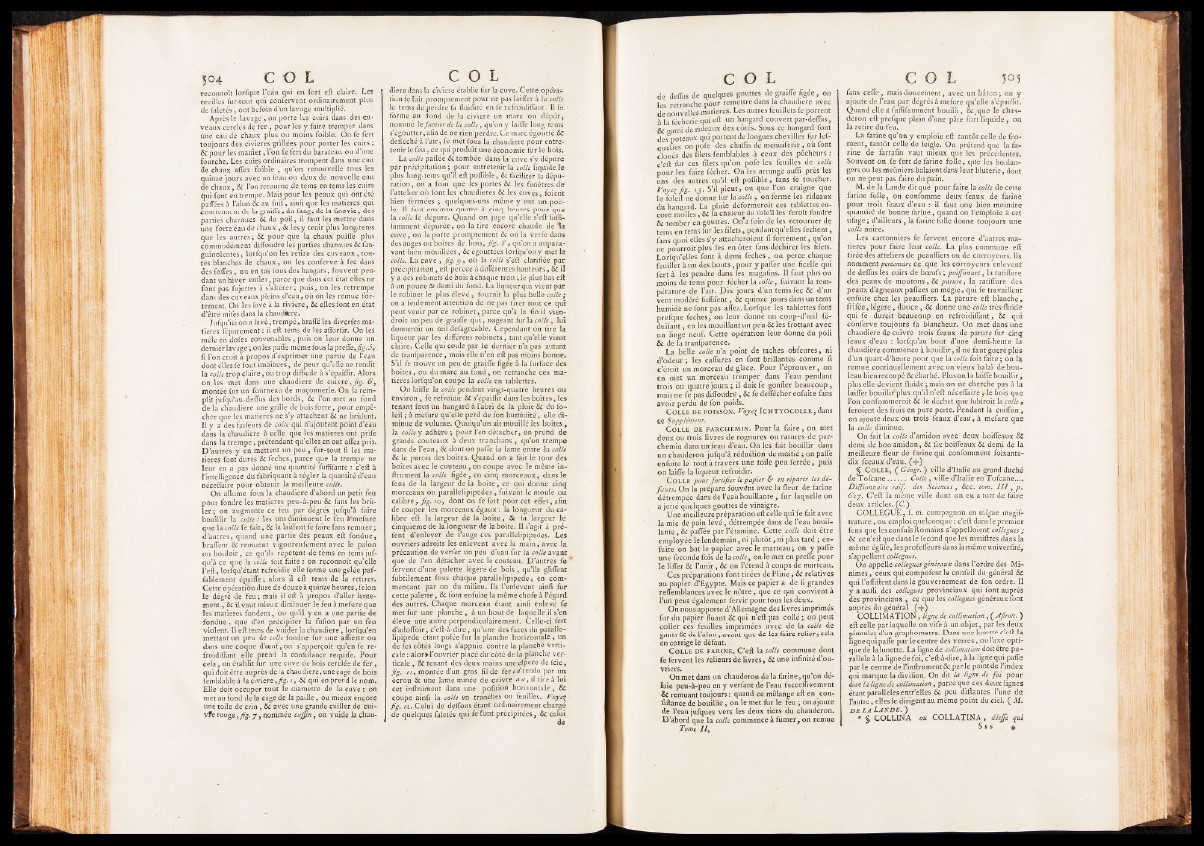
reconnoît Iorfque l’eau qui en fort eft claire. Les
oreilles fur-tout qui confervent ordinairement plus
de faletés, ont befoin d’un lavage multiplié.
Après le lavage , on porte les cuirs dans des cuveaux
cerclés de fe r , pour les y faire tremper dans
Une eau de chaux plus ou moins foible. On fe fert
toujours des civières grillées pour porter les cuirs ;
& pour les manier, l’on fe fert du barateau ou d’une
fourche. Les cuirs ordinaires trempent dans une eau
de chaux affez foible , qu’on renouvelle tous les
quinze jours avec un feau ou deux de nouvelle eau
de chaux & l’on retourne de tems en tems les cuirs
qui font en trempe. Mais pour les peaux qui ont été
paflees à l’alun & au fuif, ainfi que les matières qui
-Contiennent de la graiffe, du fang, de la finovie, des
parties charnues & du poil, il faut les mettre dans
une forte eau de chaux, & les y tenir plus long-tems
que les autres; & pour que la chaux puifl'e plus
commodément diffoudre les parties charnues & fan-
guinolentes, lorfqu’on les retire des cuveaux, toutes
blanches de chaux, on les conferve à fec dans
des foffes , ou en tas lous des hangars, fôuvent pendant
un hiver entier, parce que dans cet état elles ne
font pas fujettes à s’altérer; puis, on les retrempe
dans des cuveaux pleins d’eau, où on les remue fortement.
On les lave à la riviere, & elles font en état
d''être mifes dans la chaudière.
Jufqu’icion a lavé, trempé, braffé les diverfes ma;
tiereS féparément : il eft tems de les affortir. On les
mêle en dofes convenables, puis on leur donne un
dernier lavage ; on les paffe même fous la preffe, fig. S,
li l’on croit à propos d’exprimer une partie de l’eau
dont elles fe font imbibées, de peur qu’elle ne rendît
là colle trop claire,ou trop difficile à s’épaiflir. Alors
on les met dans une chaudière de cuivre, fig. G,
montée fur un fourneau de maçonnerie. On la remplit
jufqu’aü-deffus des bords, & l’on met au fond
de la chaudière une grille de bois forte, pour empêcher
que les matières ne s’y attachent & ne brûlent.
Il y a des faifeurs de colle qui n’ajoutent point d’eau
dans la chaudière à celle que les matières ont prife
dans la trempe, prétendant qu’elles en ont affez pris.
D ’autres y en mettent un peu, fur-tout li les matières
font dures & feches, parce que la trempe ne
leur en a pas donné une quantité fuffifante : c’eft à
l’intelligence du fabriquant à régler la quantité d’eau
néceffaire pour obtenir la meilleure colle»
On allume fous la chaudière d’abord un petit feu
pour fondre les matières peu-à-peu & fans les brûler
; on augmente ce feu par dégrés jufqu’à faire
bouillir la colle : les uns diminuent le feu à*mefure
que la colle fe fait, & la laiffent fe faire fans remuer ;
d’autres, quand une partie des peaux eft fondue,
braffent & remuent vigoureufement avec le palon
ou bouloir, ce qu’ils répètent de tems en tems jufqu’à
ce que la colle foit faite : on reconnoît qu’elle
l ’eft, lorfqu’étant refroidie elle forme une gelée paf-
fablement épaiffe; alors il eft tems de la retirer.
Cette opération dure de douze à quinze heures, félon
le dégré de feu ; mais il eft à propos d’aller lentement
, & il vaut mieux diminuer le feu à mefure que
les matières fondent, ou qu’il y en a une partie de
fondue, que d’en précipiter la fufion par un feu
violent. Il eft tems de vuider la chaudière, lorfqu’en
mettant un peu de colle fondue fur une affiette ou
dans une coque d’oeuf, on s’apperçoit qu’en fe re-
froidiffant elle prend la confiftance requife. Pour
cela, on établit fur une cuve de bois cerclée de fe r ,
qui doit être auprès de ia chaudière, une cage de bois
femblable à la civiere ,fig. /, & qui en prend le nom.
Elle doit occuper tout le diamètre de la-cuye : on
met au fond de la cage de la paille, ou mieux encore
une toile de crin , & avec une grande cuiller de cui-
vfe rouge, fig. y , nommée cajfin, on vuide la chaudiere
dans la civiere établie fur la cuve. Cette opérai
tion fe fait promptement pour ne pas laiffer à la colU
le tems de perdre fa fluidité en fe refroidiffant. Il fe
forme au fond de la civiere un marc ou dépôt $
nommé 1 e fumier de la colle, qu’on y laiffe long -tems ;
s’égoutter, afin de ne rien perdre. Ce marc égoutté Se
delféché à l’a ir, fe met fous la chaudière pour entretenir
le feu, ce qui produit une économie fur le bois.
La colle paflée & tombée dans la cuve s’y dépure
pâr précipitation ; pour entretenir, la colle liquide le
plus long-tems qu’il eft poflible, & faciliter la dépuration,
on a foin que les portes & les fenêtres de
l’attelier où font les chaudières & les cuves, loient
bien fermées ; quelques-uns même y ont un poêle.
Il faut environ quatre à cinq heures pour que
la colle fe dépure. Quand on juge qu’elle s’eft fuffi-
famment dépurée, on la tire encore chaude de *la
cuve, on la porte promptement & on la verfe dans
des auges ou boîtes de bois, fig. 8 , qu’on a auparavant
bien mouillées, & égouttées lorfqu’on y met la
colle. La cuve , .fig.$ , où la colle s’eft clarifiée, par
précipitation, eft percée à différentes hauteurs, & i!
y a des robinets de bois à chaque trou ; le plus bas eft
à un pouce & demi du fond. La liqueur qui vient par
lè robinet le plus éle.vé y fournit la plus belle colle ;
on a feulement attention de ne pas tirer tout ce qui
peut venir par ce robinet, parce qu’à la fin il vien-
droit un peu de graiffe qui, nageant fur la colle, lui
donneroit un oeil dèfagréable. Cependant on tire la
liqueur par les différens robinets * tant qu’elle vient
claire. Celle qui coule par le dernier n’a pas autant
de tranfparenee, mais elle n’en eft pas riibins bonne*
S’il fe trouve un peu de graiffe figée à la furface des
boîtes , ou du marc au fond * ori retranche ces matières
lorfqu’on coupe la colle en tablettes.
Ort laiffe la colle pendant vingt-quatre heures ou
ënviron, fe refroidir & 's’épaiflir dans les boîtes, les
tenant fous un hangard à l’abri de la pluie & du fo-
lèil ; à mefure qu’elle perd de fon humidité, elle diminue
de volume. Quoiqu’on ait mouillé les boîtes ,
la. colle y adhère ; pour l’en détacher* on prend de
grands couteaux à deux tranchans qu’on trempe
dans de l’eau, & dont on paffe la lame entre la colU
& le parois des boîtes. Quand on a fait le tour des
boîtes avec le couteau, on coupe avec le même infiniment
la colle figée , en cinq morceaux, dans le
fens de la largeur de la boîte, ce qui donne cinq
morceaux ou parallelipipedes , fuivant le moule ou
calibre , fig. 10, dont on fé fert pour cet effet, afin
de couper les morceaux égaux : la longueur du calibre
eft la largeur de la boîte, & fa largeiir le
cinquième de la longueur de la boîte. Il s’agit à pré-
fent d’enlever de l’auge ces parallelipipedes. Les
ouvriers adroits les enlevent avec la main * avec la
précaution de verfer un peu d’eau fur la colle avant
que de l’en détacher avec le couteau. D ’autres fe
fervent d’une palette légère de bois , qu’ils gliffent
fubtilement fous chaque parallelipipede * en commençant
par un du milieu. Ils l’enlevent ainfi fur
cette palette, & font enfuite la même chofe à l’égard
des autres. Chaque morceau étant ainfi enlevé fe
met fur une planche , à un bout de laquelle il s’en
éleve une autre perpendiculairement. Celle-ci fert
d’adoffoir, c’eft-à-dire, qu’une des faces du paralle-
lipipede étant pofée fur la planche horizontale , un
de fes côtés longs s’appuie contre la planche verticale
: alor» l’ouvrier placé du côté de la planche verticale
, & tenant des deux mains uneefpece de fcie,
fig. n , montée d’un gros fil de fer en tendu par un
écrou & une lame mince de cuivre a a , il tire à lui
cet infiniment dans une pofition horizontale , &
coupe ainfi la colle en tranches ou feuilles. Voye£
fig. 12. Celui de deffous étant ordinairement chargé
de quelques faletés qui fe fontprécipitées, & celui
de deffus de quelques gouttes de graiffe figée, on
les retranche pour remettre dans la chaudière avec
de nouvelles matières. Les autres feuillets fe portent
à la fécherie qui eft un hangard couvert par-deffus,
& garni de rideaux des côtés. Sous ce hangard font
des poteaux qui portent de longues chevilles fur lef-
quelles on pofe des chaffis de menuiferie , où font
cloués des filets femblables à ceux des pêcheurs :
c’eft fur ces filets qu’on pofe les feuilles de colle
pour les faire fécher. On les arrange aufli près les
uns des autres qu’il eft poflible, fans fe toucher.
Voye-i fig. ig. S’il pleut, ou que l’on craigne que
le foleil ne donne fur la colle, on ferme les rideaux
du hangard. La pluie déformeroit ces tablettes encore
molles , & la chaleur du foleil les feroit fondre
& tomber èn gouttes. On*a foin de les retourner de
tems en tems fur les filets, pendant qu’elles fechent,
fans quoi elles s’y attacheroient fi fortement, qu’on ne pourroit plus les en ôter fans déchirer les filets.
Lorfqu’elles font à demi feches, on perce chaque
feuillet à un des bouts, pour y paffer une ficelle qui
fert à les pendre dans les magafins. Il faut plus ou
moins de tems pour fécher la colU, fuivant la température
de l’air. Dix jours d’un tems fec & d’un
vent modéré fuffifent, & quinze jours dans un tems
humide ne font pas affez. Lorfque les tablettes font
prefque feches, on leur donne un coup-d’oeil fé-
duifant, en les mouillant un peu & les frottant avec
un linge neuf. Cette opération leur donne du poli
& de la tranfparenee.
La belle colle n’a point de taches obfcures, ni
d’odeur ; les caffures en font brillantes comme fi
c’étoit un morceau de glace. Pour l’éprouver, on
en met un morceau tremper dans l’eau pendant
trois ou quatre jours ; il doit fe gonfler beaucoup,
mais ne fe pas diffoudre, & fe deffécher enfuite fans
avoir perdu de fon poids. ,
C olle de poisson. Voye^ Ic h t y o c o l l e , dans
ce Supplément.
C olle de parchem in. Pour la faire , on met
deux ou trois livres de rognures ou ratures de parchemin
dans urYfeau d’eau. On les fait bouillir dans
un chauderon jufqu’à réduction de moitié ; on paffe
enfuite le tout à travers une toile peu ferrée, puis
on laiffe la liqueur refroidir.
C olle pour fortifier le papier & en réparer les défauts.
On la prépare fouvént avec la fleur de farine
détrempée dans de l’eau bouillante, fur laquelle on
a jette quelques gouttes de vinaigre.
Une meilleure préparation eft celle qui fe fait avec
la mie de pain lev é, détrempée dans de l’ eau bouillante
, & paffée par l’ étamine. Cette colle doit être
employée le lendemain, ni plutôt, ni plus tard ; en-
fuite on bat le papier avec le marteau ; on y paffe
une fécondé fois de la colle, on le met en preffe pour
le liffer & l’unir, & on l’étend à coups de marteau.
Ces préparations font tirées de Pline, & relatives
au papier d’Egypte. Mais ce papier a de fl grandes
reffemblances avec le nôtre, que ce qui convient à
l’un peut également fervir pour tous les deux.
On nous apporte d’Allemagne des livres imprimés
fur du papier fluant & qui n’eft pas collé ; on peut
coller ces feuilles imprimées avec de la colle de
gants & de l’alun, avant que de les faire relier, cela
en corrige le défaut.
C olle de farine. C ’eft la colle commune dont
fe fervent les relieurs de livres, & une infinité d’ouvriers.
On met dans un chauderon de la farine, qu’on délaie
peu-à-peu en y verfant de l’eau fucceflivement
& remuant toujours : quand ce mélange eft en confiftance
de bouillie, on le met fur le feu ; on ajoute
de l’eau jufques vers les deux tiers du chauderon.
D ’abord que la colle commence à fumer, on remue
Tome 11.
fans ceffe, mais doucement, avec un bâton; on y
ajoute de l’eau par dégrés à mefure qu’elle s’épaiffxt.
Quand elle â fuffifamment bouilli, & #que le chan-
deron eft prefque plein d’une pâte fort liquide, on
la retire du feu.
La farine qu’on y emploie eft tantôt celle de froment,
tantôt celle de feigle. On prétend que la farine
de farrafin vaut mieux que les précédentes.
Souvent on fe fert de farine folle, que les boulangers
ou les m.eûniers balaient dans leur bluterie, dont
on ne peut pas faire du pain.
M. de la Lande dit que pour faire la colle de cette
farine folle, on confomme deux féaux de farine
pour trois féaux d’eau : il faut une bien moindre
quantité de bonne farine, quand on l’emploie à cet
ufage ; d’ailleurs, la farine folle donne toujours une
colle noire.
Les cartonniers fe fervent encore d’autres matières
pour faire leur colle. La plus commune eft
tirée des atteliers de peaufliers ou de corroyeurs. Ils
nomment percemure ce que les corroyeurs enlevent
de deffus les cuirs de boeufs ; poijfonure, la ratiffure
des peaux de moutons , ÔC parure, la ratiffure des
peaux d’agneaux paffées en mégie, qui fe travaillent
enfuite chez les peaufliers. La parure eft blanche,
frifée, légère, douce , & donne une colle très-fluide
qui fe durcit beaucoup en refroidiffant, & qui
conferve toujours fa blancheur. On met dans une
chaudière de cuivre trois féaux de parure fur cinq
féaux d’eau : lorfqu’au bout d’une demi-heure la
chaudière commence à bouillir, il ne faut guere plus
d’un quart-d’heure pour que la colle foit faite ; on la
remue continuellement avec un vieux balai de bouleau
bien recoupé & ébarbé. Plus on la laiffe bouillir ,
plus elle devient fluide ; mais on ne cherche pas à la
laiffer bouillifplus qu’il n’eft néceffaire * le bois que
l’on confommeroit &: le déchet que fubiroit la colle ,
feroient des frais en pure perte. Pendant la cuiffon ,
on ajoute deux ou trois féaux d’eau, à mefure que
la colle diminue.
On fait la colle d’amidon avec deux boiffeaux 8c
demi de bon amidon, & fix boiffeaux & demi de la
meilleure fleur de farine qui confomment foixante-
dix fceaux d’eau. (+ )
§ C olle, ( Géogr. ) ville d’Italie au-grand duché
de Tofcane......... Colle, ville d’Italie en Tofcane....
Dictionnaire raif. des Sciences. , & c . tom. I I I , p.
Giy. C ’eft la même ville dont on eu a tort de faire
deux articles. (C.)
COLLEGUE, f. m. compagnon en même magif-
trature, ou emploi quelconque : c’eft dans le premier
fens que les confulsRomains s ’appelloient collègues ;
& ce n’eft que dans le fécond que les miniftres dans la
même églife, les profeffeurs dans la même univerfiré,
s’appellent collègues.
On appelle collègues généraux dans l’ordre des Minimes
, ceux qui compofent le confeil du général &
qui l’afliftent dans le gouvernement de fon ordre. Il
y a aufli des collègues provinciaux qui font auprès
des provinciaux , ce que les collègues généraux font
auprès du général. (+ )
COLLIMATION, ligne de collimation, ( AJlron. )
eft celle par laquelle on vife à un objet, par les deux
pinnules d’un graphometre. Dans une lunette c’eft la
ligne qui paffe par le centre des verres, ou l’axe optique
de la lunette. La ligne de collimation doitetre parallèle
à la ligne de foi, c’eft-à-dire, à la ligne qui paffe
par le centre del’inftrument& parle point de l’index
qui marque la divifion. On dit la ligne de foi pour
dire la ligne de collimation, parce que ces deux lignes
étant parallèles entr’elles & peu diftantes l’une de
l’autre, elles fe dirigent au même point du ciel. ( M.
d e l a La n d e . )
* § COLLIN A ou COLLATINA , dèeffe qui
S s s o