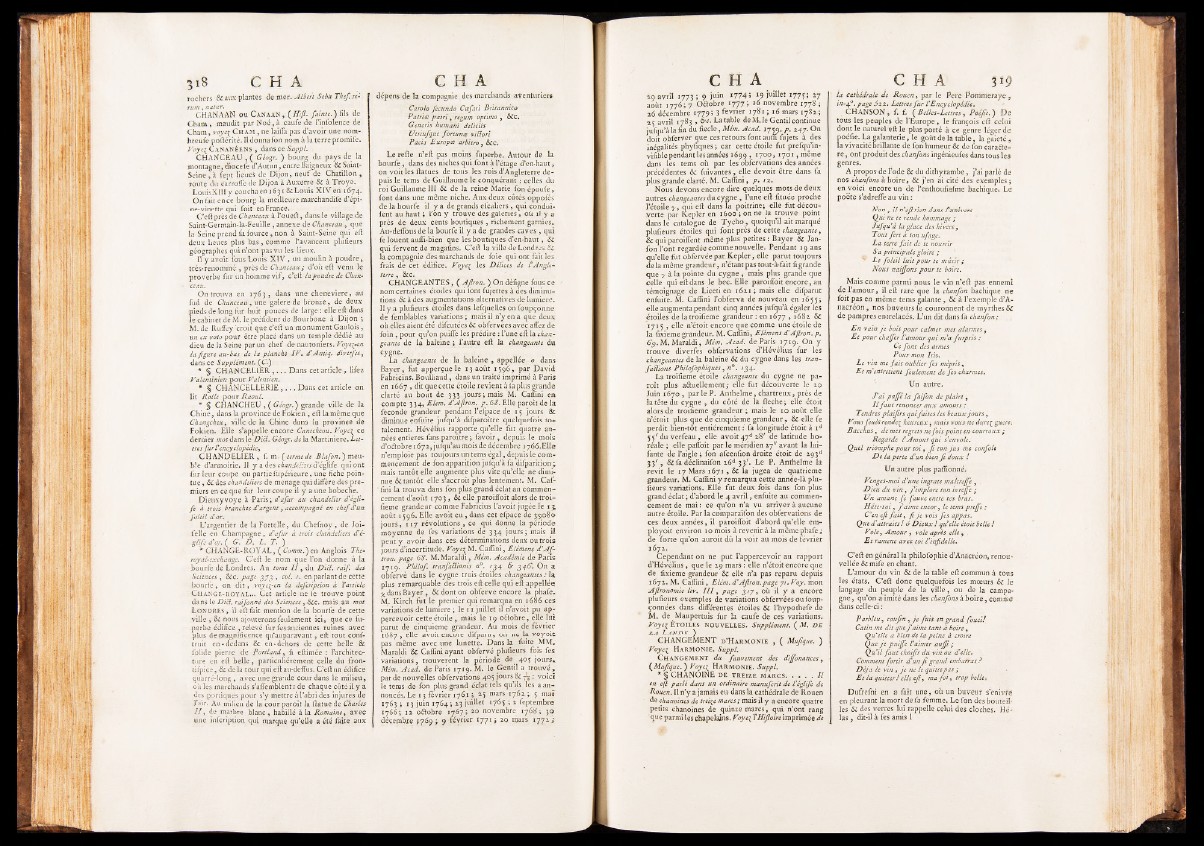
rochers & au x plantes de mer. Albert Sebü Thef.re-
rum, natur.
CHANAAN ou C an a an , {Hifl. fdinte.) fils de
Cham , maudit par N o é, à çaufe de l’infol'ence de
Chain, voye[ C h AM, ne laiffa pas d’avoir une nom-
breufe poftérité. Il donnafon nom à la terre promife.
Voye{ C ananéens , dansee Suppl. •
CHANCEAU, ( Géogr. ) bourg du pays de la
montagne, diocefe d’Autun, entre Baigneux & Saint-
Seine , à fept liéueè de Dijon, neuf de Chatillon ,
route du carroffe de Dijon à Auxerre & à Troyè.
LouisXUIy coucha en 1631 & Louis X IV en 1674.
On fait en ce bourg la meilleure marchandife d’épine
vinette qui foit en France.
C’eft près de Chanceau à l’oueft, dans le village de
Saint-Germain-la-Feuille , annexe de Chanceau, que
la Seine prend fa fource, non à Saint-Seine qui eft
deux lieues plus bas, comme l’avancent plufieurs
géographes qui n’ont pas vu les lieux.
Il y avoit fous Louis XIV , un moulin à poudre,
très-renommé , près de Chanceau ; d’où eft venu le
proverbe fur un homme v if , c’eft la poudre de Chart*
'ceau.
On trouva en 176 3 , dans une çhen'eviere, au
fud de Chanceau, une galere de brôhze, de deux
pieds de long fu? huit pouces de large : elle eft-dans
le cabinet de M. lepréfident de Bourbone à Dijon ;
M. de Ruffey'croit que é’eft un monument Gaulois;
un ex voto pour être placé dans un temple dédié au
dieu de la Seine par un chef de nautoniers. Voye^-en
La figure au-bas de la planché IV . c£ Antiq. diverses,
dans ce Supplément. (C.")
* § CHANCELIER, . . . Dans cet article, lifez
Valentinien pour Valtntien.
* § CHANCELLERIE, . . .Dans cet article on
lit Roi le pour Raoul.
* § CHANCHEU, ( Géogr.) grande ville de la
Chine, dans la province de Fokien, eft la même que
Changcheiiy ville de la Chine dans la province de
Fokien. Elle s’appelle encore Cantcheou. Voye[ ce
dernier mot dans le Dicl. Géogr,. de la Martiniere.^«-
tres fur C encyclopédie,
CHANDELIER , f. m. { termede Blafon.) meuble
d’armoirie. Il y a des chandeliers d’églife qui ont
fur leur coupe ou partieftipérieure, une fiche pointue
, & des chandeliers de ménagé qui diffère des premiers
en ce que fur leur coupe il y a une bobeche.
Dieuxyvoye à Paris; d’afur au chandelier cCégli-
fc à trois branches d'argent, accompagné en chef £ un
foleil d’or.
L’argentier de la Fortelle, du Chefnoy, de Joi-
felle en Champagne, d'afur à trois chandeliers dé-
glife d'oy. ( G. D . L. T. )
* CHANGE-ROYAL, {Commuen Angîois Tke-
royal- ex change. C ’eft le nom que l’on donne à la
bourfe de Londres. Au tome ƒ / , du Dicl. raif. des
Sciences y & c . page 3 / 3 , col. 1. en parlant de cette
bourfe , on d i t , . voyeç-en la defeription à Y article
C h a n g e - r o y a l ... Cet article ne fe trouve point
dans le Dicl. raifonné des Sciences 3-8cc. mais .au mot
L o n d r e s , il eft fait mention de la bourfe de cette
ville , & nous ajouterons feulement ici, que ce fu-
perbe édifice , relevé fur fes anciennes ruines avec
plus de magnificence qu’auparavant, eft tout conf-
truit en-dedans & en-dehors de cette belle &
lolide pierre de Portland, -fi eftimée : l’architecture
en eft belle, particuliérement celle du fron-
tifpice, & de là tour qui eft au-deffus. C ’eft un édifice
quarré-long , avec une grande cour dans le milieu,
oii les marchands s’aflemblent : de chaque côté il y a
des portiques pour s’y mettre à l’abri des injures de
1 air. Au milieu de la cour paroîtla ftatuede Charles
i l , de marbre blanc, habillé à la Romaine y avec
une infeription qui marque qu’elle a été faite aux
dépens de la compagnie, des marchands aventuriers
Carolo fecundo Ccefari Britannica
Patrice patri y'reéum optimo , &C.'
Generis' humahi deiiciis
Utriufque fortunes viclori
Pacis Europce àrbitro, &c.
Le refte n’eft pas moins îuperbe. Autour de la
bourfe, dans des niches qui font à l’étage d’en-haut,
on voit les ftatues de tous les rois d’Angleterre depuis
le tems de Guillaume le; conquérant ; celles du
roi Guillaume III 8c de la reine Marie fon époufe,
font dans une même niche. Aux deux côtés oppofés
de la bourfe il y a de grands efcaliers , qui condui-
fent au haut ; l’on y trouve des galeries, où il y a
près de deux cents boutiques , richement garnies.
Au-deffousde la bourfe il y a de grandes caves , qui
• fe louent aufli-bien que les boutiques d’en-hàut, 8c
qui fervent de magafins. C’eft la ville de Londres 8c
la compagnie des marchands de foie qui ont fait les
frais de cet édifice. Voye%_ les Délices de tAngleterre
y &C.
CHANGEANTES, ( AJlron. ) On défigne fous ce
nom certaines étoiles qui font fujettes à des diminutions
8c à des augmentations alternatives de lumière.
Il y a plufieurs étoiles dans lefcjuelles on foupçonne
de femblàbles variations ; mais il n’y en a que deux
où elles aient été difeutées 8c obfervées avec affez de
foin , pour qu’on puiffe les prédire : l’une eft la changeante
de la baleine ; l’autre eft la changeante du
cygne. .
La changeante de la baleine , appellée o, dans
Bayer, Fut apperçue le 13 août 1596, par David
Fabricius. Boùlliaud, dans un traité imprimé à Paris
en 1667 , dit que cette étoile revient à la plus grande
clarté au bout de 333 jours; mais M. Calfini en
compte 334, Elem. d.'AJlron. p. 68. Elle paroît de la
fécondé grandeur pendant l’efpace de 15 jours &
diminue enfuite jufqu’à difparoître quelquefois to+
talement. Hévélius rapporte qu’elle fut quatre années
entières fans paroître ; favoir, depuis le mois
d’o£lobrei67z,jufqu’aumois de décembre i j 66.E[[q
n’emploie pas toujours.un tems égal, depuis le commencement
de fon apparition jufqu’à fa difparition ;
mais tantôt elle augmente plus vite qu’elle ne diminue
& tantôt elle s’accroît plus lentement. M. Cal-
‘ fini la trouva dans fon plus grand éclat au commencement
d’août 1703, & elle paroiffoit alors de .troi-
fietne grandeur comme Fabricius l’avoit jugée le 15,
août 1596. Elle avoit e u , dans cet efpace de 39080
jours, 117 révolutions, ce qui donne la période
moyenne de fes variations de 334 jours; mais il
peut y avoir dans ces déterminations deux ou trois
jours d’incertitude. Voys{ M. Calfini, Elémens d'Af-
tron. page 68. M.Maraldi, Mém. Académie de Pans
1715. Philof. tranfaclionis n°. 134 & 346. On a
obfervé dans le cygne trois étoiles changeantes : la
plus remarquable des trois eft celle qui eft appellée
y dans Bayer , & dont on obferve encore la phafe.
M. Kirch fut le premier qui remarqua en ié8 6 ces
variations de lumière ; le 11 juillet il n’avoit pu ap-
percevoir cette étoile , mais le 19 o&obre, elle lui.
parut de cinquième grandeur. Au mois de février
1687, elle avoit encore difparu, on ne la voyoit
pas même avec une lunette. Dans la fuite MM.
Maraldi & Calfini ayant obfervé plufieurs fois fes
variations, trouvèrent la période de 40$ jours*
Mém. Acad, de Paris 1719. M. le Gentil a trouvé,
par de nouvelles obfervations 405 jours 8c -L : voici
le tems de fon plus grand éclat tels qii’ilsAes a annonces.
Le 13 février 1761 ; 2.5 mars 17^7- * 5 ma*
1763 ; 13 juin 1764; 23 juillet 1765 ; 2 feptembre
1766; 12 o&obre 1767; 2-0 novembre 1768; 39
décembre *769» 9 lévrier l 7 7 l » 10 Oîars 1 7 7 2 ;
io avril 1773 ; 9 juin *7 7 4 ; <■9 *775 : *7
août 1776; 7 Oûobre 1777 ; 16 novembre 1778 ;
26 décembre 1779 i 3 février 1781 ; 16 mars 1782;
2.5 avril 1783 , Gc. La table de M.le Gentil continue
jufqu’à la fin du fiecle, Mém. Acad. 1759. p. 247. On
doit obferver que ces retours font auffi fujets à des
inégalités phyuques ; car cette étoile fut prefqu’in-
vifible pendant les années 1699 , 1700, 170 1 , même
dans les tems où par les obfervations des années
précédentes & fuivantes, elle devoir être dans fa
plus grande clarté. M. Calfini, p. 12.
Nous devons encore dire quelques mots de deux
autres changeantes du cygne , l’une eft fituée proche
l’étoile y y qui eft dans la poitrine; elle fut découverte
par Kepler en 1600 ; on ne la trouve point
dans le catalogue de T y ch o , quoiqu’il ait marque
plufieurs étoiles qui font près de cette changeante,
& qui paroiffent même plus petites : Bayer & Jan-
fon l’ont regardée comme nouvelle. Pendant 198ns
qu’elle fut obiervée par.Kepler, elle parut toujours
delà même grandeur, n’étant pas tout-à-fait fi grande
que y à la pointe du cygne , mais plus grande que
celle qui eft dans le bec. Elle paroiffoit encore, au
témoignage de Liceti en 16 21 ; mais elle difparut
enfuite. M. Caflini l’obferva de nouveau en 1655;
elle augmenta pendant cinq années jufqu’à égaler les
étoiles de latroifieme grandeur : en 16 7 7 ,16 8 2 6L
1 7 1 5 , elle n’étoit encore que comme une étoile de
la fixieme grandeur. M. Caflini, Elémens d'Aflron. p.
6c). M. Maraldi, Mém. Acad, de Paris 1719. On y
trouve diverfes obfervations d’Hévélius fur les
changeantes de la baleine & du cygne dans les tran-
factions Philofophiques y n°. 134.
La troifieme étoile changeante du cygne ne paroît
plus actuellement; elle fut découverte le 20
Juin 1670 , par le P. Anthelme, chartreux, près de
la tête du cygne , du côté de la fléché ; elle étoit
alors de troifieme grandeur ; mais le 10 août elle
n’étoit plus que de cinquième grandeur, & elle fe
perdit bien-tôt entièrement : fa longitude étoit à i d
5 5' du verfeau, elle avoit 47d 28' de latitude boréale
; elle paffoit par le méridien 27" avant la lui-
fante de l’aigle ; fon afeenfion droite étoit de 293d
3 3 ', & fa declinaifon 26d 33'. Le P. Anthelme la
revit le 17 Mars 1671 , & la jugea de quatrième
grandeur. M. Caflini y remarqua cette année-là plu-
iieurs variations. Elle fut deux fois dans fon plus
grand éclat ; d’abord le 4 avril, enfuite au commencement
de mai : ce qu’on n’a vu arriver à aucune
autre étoile. Par la comparaifon des obfervations de
ces deux années, il paroiffoit d’abord qu’elle em-
ployoit environ 10 mois à revenir à la même phafe ;
de forte qu’on auroit dû la voir au mois de février
1672.
Cependant on ne put l’appercevoir au rapport
d’Hévélius, que le 29 mars : elle n’étoit encore que
de fixieme grandeur & elle n’a pas reparu depuis
1672. M. Calfini, Elém. d'AJlron.page yt. Voy. mon
AJlronomie liv. II Iy page 3 / 7 , où il y a encore
plufieurs exemples de variations obfervées ou foup-
çonnées dans différentes étoiles & l’hypothefe de
M. de Maupertuis fur la caufe de ces variations.
Voyei Étoiles nouvelles. Supplément. ( M. d é
l a La n d e . )
CHANGEMENT d’Ha rmonie , ( Mufique. )
Voye1 Harmonie. Suppl.
CHANGEMENT du fauvement des dijfonatices,
{Mufique.') Voye\ Harmonie. Suppl.
* § CHANOINE de treize Ma rcs.............. I l
en eft parlé dans un ordinaire manuferit de l'églife de
Rouen. Il n’y a jamais eu dans la cathédrale de Rouen
de chanoines de treize marcs ; mais il y a encore quatre
petits chanoines de quinze marcs, qui n’ont rang
que parmi les chapelains. V‘oyjjjfât YHifloire imprimée de
la cathédrale de Rouen, par le Pere Poninieraye,
in-40. page 622. Lettres fur L'Encyclopédie.
CHANSON j f. f. {Belles-Lettres y Poéjîe.) Dé
tous les peuples de l’Europe, le françois eft celui
dont le naturel eft le plus porté à ce genre léger de
poéfie. La galanterie, le goût de la table, la gaieté ,
la vivacité brillante de fon humeur & de fon caraâe-
re , ont produit des chanfons ingénieufes dans tous les
genres.
A propos de l’ode & du dithyrambe, j’âi parié dé
nos chanfons à boire, & j’en ai cité des exemples ;
en voici encore un de l’enthoufiafme bachique* Lé
poëte s’adrefle au vin :
Non y il n'ejl rien dans P univers
Qui ne te fende hommage ;
Jufqu'à la glace des hivers ,
Tout fert à ton ufage.
La terre fait de te nourrir
Sa principale gloire' ;
? Le foleil luit pour te mûrir ;
Nous- naiffons pour te boire.
Mais comme parmi noüs le vin n’eft pas ennemi
de l’amour, il eft rare que la chanfon bachique ne
foit pas en même tems galante, & à l’exemple d’Anacréon
, nos buveurs fe couronnent de myrthes 8c
de pampres entrelacés. L’un dit dans fa chanfoni . .
En vain je bois pour calmer mes alarmes y
Et pour chaffer l'amour qui ma furpris :
Ce font des armes
Pour mon Iris.
Le vin me fait oublier fes mépris,
Et m'entretient feulement de fes charmes.
Un autre.
J'ai paffé la faifon de plaire ,
I l faut renoncer aux amours :
Tendres plaijirs qui faites les beaux jours ,’
■ Vous feuls rendes heureux, mais vous ne dure{ guère.
Bacckus y de mes regrets ne fois point en courroux ;
Regarde l'Amour qui s'envole.
Quel triomphe pour toi y J i ton ju s me confolt
De la perte d'un bien f i doux !
Un autre plus paflionné.
Vmges-moi d'une ingrate maitreffe , .
Dieu dû vin, j'implore ton ivrejfe ;
Un amant fe fauve entre tes bras.
Hâte-toi y j'aime encor y le tems prejfe :
C'en efi fa it , Ji je vois fes appas.
Que d'attraits ! ô Dieux ! quelle étoit belle !
Voie 9 Amour ; vole après elle, .
E t ramene avec, toi l'infidelle.
C’eft en général là philofophie d’Anàcréon, renou-
vellée & mife en chant.
L’amour du vin & de la tablé eft commun à tous
les états. C ’eft donc quelquefois les moeurs & le
langage du peuple de la v ille , ou de la campagne
, qu’on a imité dans les chanfons à boire, commé
dans celle-ci :
Parbleu y cotifin, je fuis en grand foucif
Catin me dit que j'aime tant cl boire,
Qu elle a bien de la peine d croire
Que je puiffe l'aimer aujji ;
Qu'il faut choifir du vin du d'elle.
Cômment fortir d'un f i grand embarras. ?
Déjà le vin , je ne le quitte pas ;
Et la quitter! elle efi y ma foi y trop belle-.
Dufrefni en a fait une, où un buveur s’enivré
en pleurant la mort de fa femme. Le fon des bouteilles
& des verres lui rappelle celui des cloches* Hé-3
las ) dit-il à fes amis 1