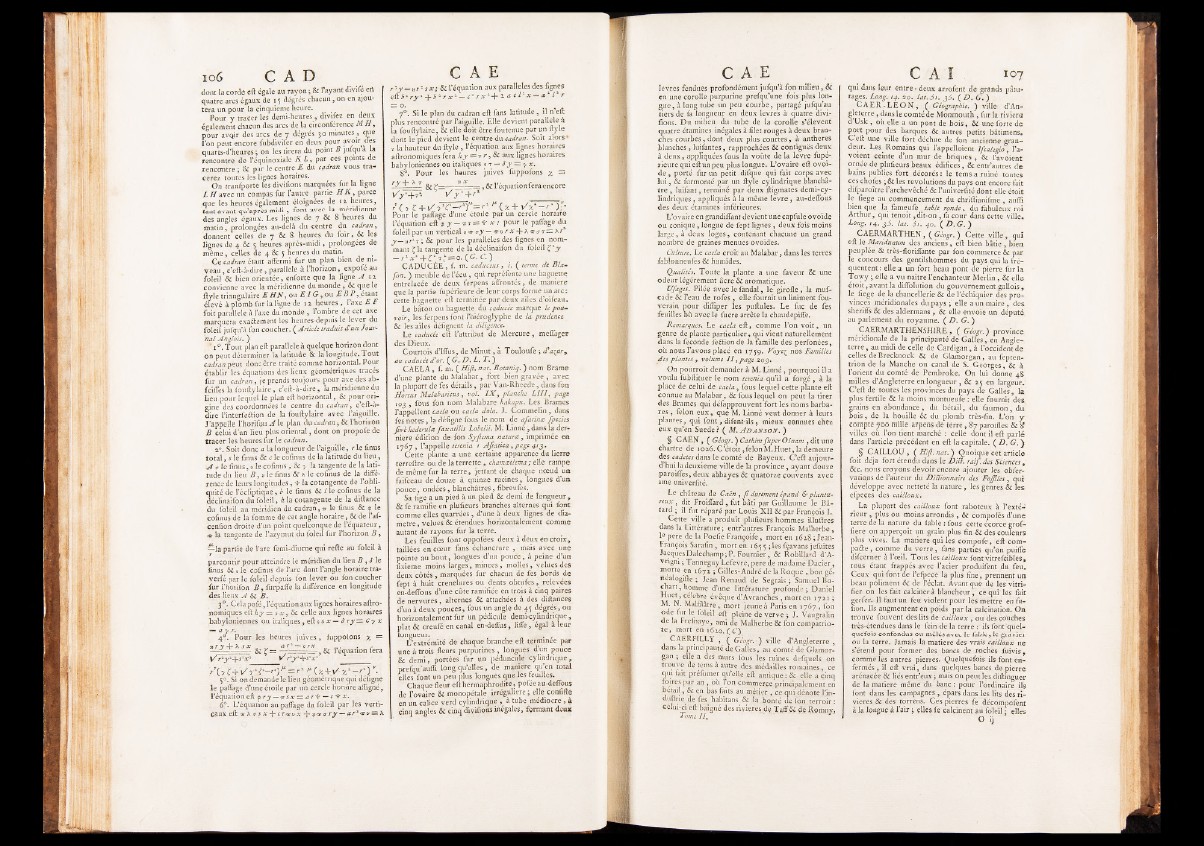
dont la corde eft égale au rayon ; & l’ayant divife efl
quatre arcs égaux de 15 dégrés chacun, on en ajoutera
un pour la cinquième heure.
Pour y tracer les demi-heures , divifez en deux
également chacun des arcs de la circonférence M H ,
pour avqir des arcs de 7 dégrés 30 minutes , mie
l’on peut encore fubdivifer en deux pour avoir des
quarts-d’heures ; on les tirera du point B julqu a la
rencontre de l’équinoxiale K L , par ces points de
rencontre ; & par le centre E du cçdran vous tracerez
toutes les lignes horaires. ^
On tranfporte les divifions marquées fur la ligne
L H avec un compas fur l’autre partie H K , parce
que les heures également éloignées de 1 heures,
tant avant qu’après midi, font avec la méridienne
des angles égaux. Les lignes de 7 & 8 heures du
matin, prolongées au-delà du centre du cadran, j
donnent celles de 7 '& 8 heures du foir, 8c les |
lignes de 4 & 5 heures après-midi, prolongées de j
même, celles de 4 & 5 heures du matin. # j
Ce cadran étant affermi fur un plan bien de ni- :
veau , c’eft-à-dire, parallèle à l’horizon, expofé au
foleil & bien orientée, enforte que la ligne A 12
convienne avec la méridienne du monde, 8c que le
ftyle triangulaire E H N , ou E I G , ou E B P , étant
élevé à plomb fur la ligne de 1 1 heures , l’axe E F
foit parallèle à l’axe du monde , l’ombre de cet axe
marquera exaftement les heures depuis le lever du
foleil jufqu’à fon coucher. ( Article traduit £ un Journal
Anglois. ) . ■ 1
* 1 °. Tout plan eft parallèle à quelque horizon dont
on peut déterminer la latitude & la longitude. Tout
cadran peut donc être traité comme horizontal. Pour
établir les équations des lieux géométriques tracés
fur un cadran, je prends toujours pour axe des ab-
fciffes la fouftylaire , c’eft-à-dire, la méridienne du
lieu pour lequel le plan eft horizontal, 8c pour origine
des coordonnées le centre du cadran, c’eft-à-
dire l’interfeôion de la fouftylaire avec l’aiguille.
J’appelle l’horifon A le plan du cadran, 8c l’horizon
B celui d’un lieu plus oriental, dont on propofe de
tracer les heures fur le cadran.
a°. Soit donc a la longueur de l’aiguille, r le finus
to ta l, s le finus 8c c le cofinus de la latitude du lieu,
A <r le finiis, 0 le cofinus, & y la tangente de la latitude
du lieu B , » le lïnus & a le cofinus de la différence
de leurs longitudes, la cotangente de l’obliquité
de l’écliptique, b le finus 8c l le cofinus de la
déclinaifon du foleil, h la cotangente de la diftance
du foleil au méridien du cadran, m le finus 8c <p le
cofinus de la fomme de cet angle horaire, 8c de l’af-
cenfion droite d’un point quelconque de l’équateur,
<sr la tangente de l’azymut du foleil fur l’horizon B ,
— la partie de l’arc femi-diurne qui refte au foleil à
parcourir pour atteindre le méridien du lieu B , S le
finus 8c e le cofinus de l’arc dont l’angle horaire tra-
.verfé par le foleil depuis fon lever ou fon coucher
fur i’horifon B , furpaffe la différence en longitude
des lieux A & B.
3 °. Cela pofé, l’équation aux lignes horaires aftro-
nomiques eft hy=z s x ,8 c celle aux lignes horaires
babyloniennes ou italiques, eft e s * — S r y — C y x
— a y r .
4*?. Pour les heures juives, fuppofons % =:
•J-Zi ± £ f . & "C, — ~7— > & l’équation fera
V r 'y '+ s -x '-______Y ry-^s-x- _
r \ y Z + V ’■
50. Si on demande le lieu géométrique qui defigne
le paffage d’une étoile par un cercle horaire afïigné,
l’équation eft 9 ry — v s x = a r 'F — c y x.. ...
.... 6?. L’équation au paffage du foleil par les verticaux
eft: ® A <rs x + cr&vx + a ry — ar^/ao = A
r i y - » r * s x ; 8c l’équation aux paralleles des fignes
e fD v ^ ' + i V x 1 — c ’ r x 1 -{-1 & c l* x — a 1 /* r
= ° .
70. Si le plan du cadran eft fans latitude, il n’eft
plus rencontré par l’aiguille. Elle devient parallele à
la fouftylaire, 8c elle doit être foutenue par un ftyle
dont le pied devient le centre du cadran. Soit alors*
r la hauteur du ftyle , l’équation aux lignes horaires
aftronomiques fera h y = t r , 8c aux lignes horaires
babyloniennes ou italiques t t — S'y = y x.
8°. Pour les heures juives fuppofons x =
ry i — & Ç= — — ^-----, 8c l’équationfera encore
V/y*+r* + ,
■ /(»<:+✓ '*(*+E E £ i Pour le paffage d’une etoile par un cercle horaire
l’équation eft <p y — ttt — * x : pour le paffage du
foleil par un vertical w ry — ®wra;-f-A®(rT=Ar
y — „ r- t ; 8c pour les paralleles des lignes en nommant
Ç la tangente de la déclinaifon du foleil Çxy
- r ^ ’ + r ^ o . C 'G - C ’O
C A D U C É E , f. m. caduceus , i. ( terme de Bla-
fon. ) meuble de l’écu , qui repréfente une baguette
entrelacée de deux ferpens affrontes, de maniéré
que la partie fupérieure de leur corps forme un arc:
cette baguette eft terminée par deux ailes d’oifeau.
Le bâton ou baguette du caducée marque le pouvoir,
les ferpens font l’hiéroglyphe de la prudence
8c les ailes défignent la diligence.
Le caducée eft l’attribut de Mercure, meffager
des Dieux.
Courtois d’Iffus, de Minut, à Touloufe ; d’azur y
au caducée dyor. ( G. D. L. T. )
CAELA , f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) nom Brame
d’une plante du Malabar, fort bien gravée, avec
la plupart de fes détails, par Van-Rheede, dans foa
Hortus Malabaricus, vol. I X , planche L U I , page
107 , fous fon nom Malabare kakapu. Les Brames
l’appellent caela ou caela dolo. J. Commelin , dans
fes notes, la défigne fous le nom de afarinte fptcïes
fiv ï hederulce faxatilis Lobelii. M; Linné , dans la dernière
édition de fon Syßema natura, imprimée en
1 76 7 , l’appelle «renia / Afiatica, page 4/3.
Cette plante a une certaine apparence du lierre
terreftre ou de laterrette , chamceelema; elle rampe
de même fur la terre, jettant de chaque noeud un
faifceau de douze à quinze racines, longues d’un
pouce, ondées, blanchâtres, fibreufes.
Sa tige a un pied à un pied 8c demi de longueur,
& fe ramifie en plufieurs branches alternes qui font
comme elles quarrées, d’une à deux lignes de diamètre
, velues 8c étendues horizontalement comme
autant de rayons fur la terre.
Les feuilles font oppofées deux à deux en croix,
taillées en coeur fans échancrure , mais avec une
pointe au bout, longues d’un pouce, à peine d’un
fixieme moins larges, minces , molles, velues des
deux côtés, marquées fur chacun de fes bords de
fept à huit crenelures ou dents obtufes, relevées
en-deffous d’une côte ramifiée en trois à cinq paires
de nervures, alternes 8c attachées à des diftances
d’un à deux pouces, fous tin angle de 45 dégrés, ou
horizontalement fur un pédicule demi-cyjindrique ,
plat 8c creufé en canal en-deffus, liffe, égal à leur
longueur. . ,
L’ extrémité de chaque branche eft terminée par
une à trois fleurs purpurines , longues d’un pouce
8c demi, portées fur un péduncule cylindrique,
prefqu’auffi long qu’elles, de manière qu’en total
elles font un peu plus longues que les feuilles.
Chaque fleur eft hermaphrodite, pofée au-deffous
de Fovaire & monopétale irrégulière ; elle confifté
en un calice verd cylindrique à tube médiocre , à
cinq angles 8c cinq divifions inégales, formant deux
Ievres fendues profondément jufqu’à fon milieu, &
en une corolle purpurine prefqu’une fois plus longue,
à long tube un peu courbe, partagé jufqu’au
tiers de fa longueur en deux Ievres à quatre divifions.
Du milieu du tube de la corolle s’élèvent'
quatre étamines inégales à filet rouges à deux branches
courbes, dont deux plus courtes, à anthères
blanches, luifantes, rapprochées & contiguës deux
à deux, appliquées fous la voûte de la levre fupérieure
qui eft un peu plus longue. L’ovaire eft ovoïde
, porté fur un petit difque qui fait corps avec
lu i , 8c furmonté par un ftyle cylindrique blanchâtre
, luifant, terminé par deux ftigmates demi-cylindriques
, appliqués à la même le v re , au-deffous
des deux étamines inférieures.
L’ovaire en grandiffant devient une capfule ovoïde
ou conique, longue de fept lignes , deux fois moins
large, à deux loges, contenant chacune un. grand
nombre de graines menues ovoïdés.
Culture. Le caela croît au Malabar, dans les terres
fablonneufes 8c humides.
Qualités. Toute la plante a une faveur & une
odeur légèrement âcre & aromatique.
Ufages. Pilée avec le fandal, le girofle , la muf-
cade 8c l’eau de rofes , elle fournit un Uniment fou-
verain pour difliper les pullules. Le fuc de fes^
feuilles bû avec le fucre arrête la chaudepiffe.
Remarques. Le caela eft, comme l’on v o it , un
genre de plante particulier, qui Vient naturellement
dans la fécondé leélion de la famille des perfonées,
où nous l ’avons placé en 1759. Voye^ nos Familles
des plantes , volume I I , page 20c).
On poürroit demander à M. Linné, pourquoi il a
voulu fubftituer le nom terenia qu’il a forgé , à la
place de celui de caela, fous lequel cette plante eft
connue au Malabar, 8c fous lequel on peut la tirer
des Brames qui défapprouvent fort les noms barbares
, félon eu x, que M. Linné veut donner à leurs
plantes, qui fon t, difent-ils, mieux connues chez
eux qu’en Suede ? ( M. A d a n so n . )
§ CAEN , ( Géogr. ) Cathim fuperOlnam , dit une
chartre de 1026. C ’étoit,félon M. Huet, la demeure
des cadetes dans le comté de Bayeux. C ’eft aujourd’hui
la deuxieme ville de la province, ayant douze
paroiffes, deux abbayes 8c quatorze couvents avec
iine univerfité. •'
Le château de Caen , j î durement épand 6*plantu-
reux, dit Froiffard , fut bâti par Guillaume le Bâtard
; il fut réparé par Louis XII 8c par François I.
Cette ville a produit plufieurs hommes illuftres
dans la Littérature; entr’autres François Malherbe,
le pere de la Poëlie Françoife, mort en 1628 ; Jean-
François Sarafin , mort en-165 5 ; les fçavans jefïiites
Jacques Dalechamp; P. Fournier, 8c Robillard d’A-
vrigni ; Tanneguy Lefevre, pere de madame Dacier,
morte en 1671 ; Gilles-André de la Roqué , bon gér
nealogifte ; Jean Renaud de Segrais ; Samuel Bo-
chart, homme d’une littérature profonde ; Daniel
Huet, célébré évêque d’Avranches , mort en 1721 ;
M. N. Malfilâtre, mort jeune à Paris en 1767 , fon
ode fur le foleil eft pleine de verve ; J. Vaugralin
de la Frefnaye, ami de Malherbe 8c fon compatriot
e , mort en 1620. (C )
CAÉRFILLY , ( Géogr.’ y^ ville d’Angleterre,
dans la principauté de Galles, au.comté de Glamor-
gan ; elle a des murs fous les ruines defquels on
trouve de tems à autre des médailles romaines, ce
qui fait préfumer qu’elle .eft antique : 8c elle a cinq
foires par an , ou l’on commerce principalement en
1 n*' ’ ^ en ^as faits au métier , ce qui dénote l’in-
“ “ " r ô d e fes habitans & . la bonté de fon terroir:
■ ■ ■ baigné des rivières dç TaffSt de ïfomny,
Tomi II.
qui dans leur entre-deux arrofent de grands pâturages.
Long. 14. 2Q. la t.5r. j 5. ( D . G .}
C A E R - L E O N , ( Géographie. ) ville d’Angleterre
, dans le comté de Monmouth , fur la riviero
d Usk , oii elle a un pont de bois, 8c une forte de
port pour des barques 8c autres petits bâtimens.
C’eft une ville fort déchue de fon ancienne grandeur.
Les Romains qui l’appelloient Ifcalegio, l’a-
voient ceinte d’un mur de briques., & l’avoient
ornée de plufieurs beaux édifices, 8c entr’autres de
bains publics fort décorés: le tems a ruiné toutes
ces chofes ; 8c les révolutions du pays ont encore fait
difparoître l’archevêché 8c l’umverfité dont elle étoit
le fiege au commencement du chriftianifme , aufli
bien que la fameufe table ronde, du fabuleux roi
Arthur, qui tenoit, dit-on , fa cour dans cette ville.
Long. 14. 35. lat. 5t. 40. ( D . G. )
CAERMARTHEN , ( Géogr. ) Cette ville , qui
eft le Maridunum des anciens, eft bien bâtie , bien
peuplée & très-floriffante par fon commerce & par
le concours des gentilshommes du pays qui la fréquentent:
elle a un fort beau pont de pierre fur la
Towy ; elle a vu naître l’enchanteur Merlin , 8c elle
étoit, avant la diffolution du gouvernement gallois ,
le fiege de la chancellerie 8c de l’échiquier des provinces
méridionales du pays elle a un maire , des
sheriffs 8c des aldermans , 8c elle envoie un député
au parlement du royaume. ( D . G .)
CAERMARTHENSHIRE , ( Géogr.') province
méridionale de la principauté de Galles, en Angleterre
, au midi de celle de Cardigan^, à l’occident de
celles de Brecknock 8c de Glamorgan, au fepten-
trion de la Manche ou canal de S. Georges, 8c à
l’orient du comté de Pembroke. On lui donne 48
milles d’Angleterre en longueur , 8c 25 en largeur.'
C’eft de toutes les provinces du pays de Galles, la
plus fertile 8c la moins montueufe : elle fournit des.
grains en abondance, du bétail, du faumon, du
bois, de la houille 8c du plomb très-fin. L’on y
compte 700 mille arpens de terre, 87 paroiffes & S
villes où l’on tient marché : celle dont il eft parlé
dans l’article précédent en eft la capitale. ( D . G. )
§ C AILLOU , ( Hiß. nat. ) Quoique cet article
foit déjà fort étendu dans le Dicl. raif. des Sciences i
8cc. nous croyons devoir encore ajouter les obfer-
vations de l’auteur du Dictionnaire des Foßiles, qui
développe avec netteté la nature, les genres 8c les
efpeçes des caillouxï
La plupart des cailloux font raboteux à l’extérieur
, plus ou moins arrondis , 8c compofés d’une
terre de la nature du fable : fous cette écorce grofi-
fiere on apperçoit un grain plus fin & des couleurs
plus vives. La matière qui les compofe, eft comp
a r e , comme du verre , fans parties qu’on puiffe
difeerner à l’oeil. Tous les cailloux font vitrefcibles,
tous étant frappés avec l’acier produifent du feu.
Ceux qui font de l’efpecè la plus fine , prennent un
beau poliment 8c de l’éclat. Avant que de les vitrifier
on les fait calciner à blancheur, ce qui lès fait
gerfer. Il faut un feu violent pour les mettre en fu-
fion. Ils augmentent en poids parla calcination. On
trouve fouvent des lits de- cailloux,' ou des ço'uches
très-étendues dans le fein de la terre : ils font‘quelquefois
confondus ou mêlés avec le fable, le gravier
ou la terre. Jamais la matière des vrais cailloux ne
s’étend pour former des bancs de roches fui v is ,
commelès autres pierres. Quelquefois ils font enfermés
, il eft vrai, dans quelques bancs de pierre
arénacée 8c liés entr’eux ; mais on peut les diftinguer
de la matière même du banc : pour l’ordinaire ils
font dans’ les campagnes , épars dans les lits des rivières
& des torrens. Ces pierres fe dëcoiripofent
à la longue à l’air ; çlles fe calcinent aii foleil ; elles