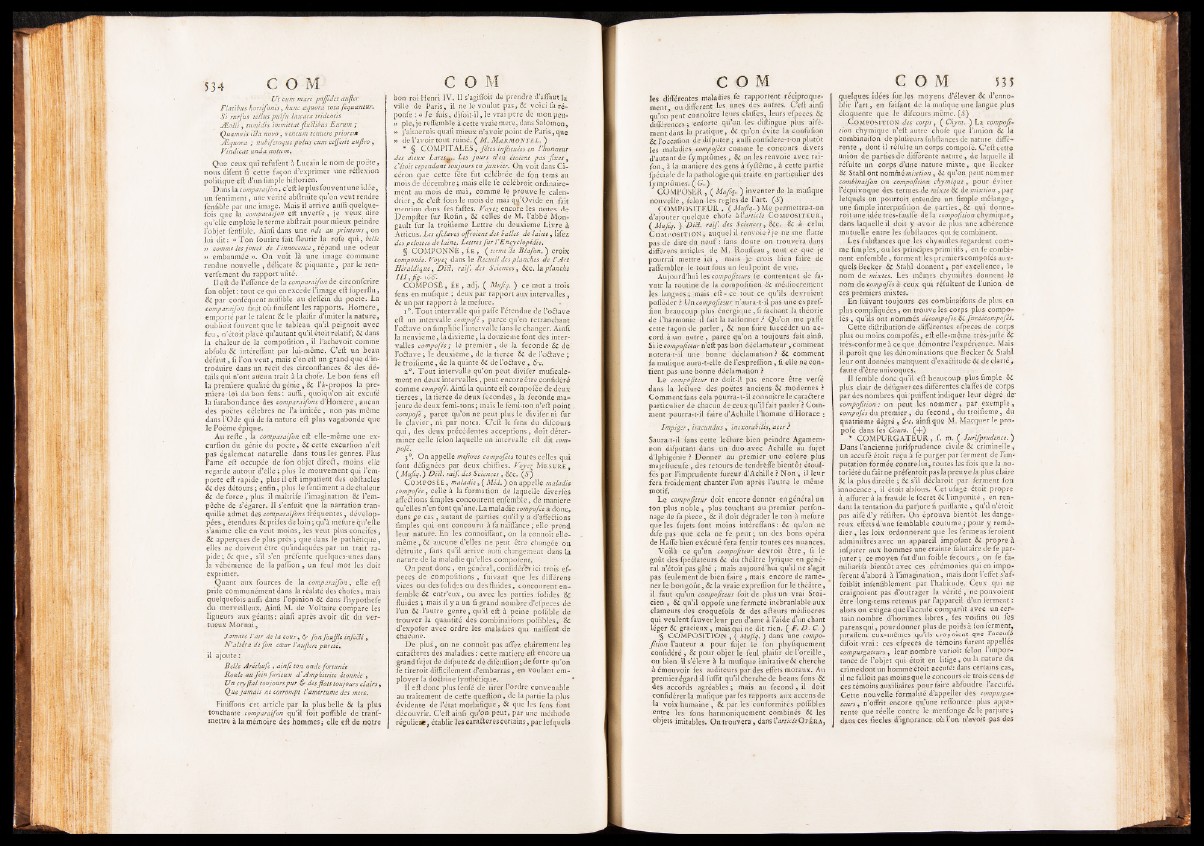
| ll | '
KH
I
r lË I
Ut cum mare pöffidet außer
Flatibus horrifonis, hune cequora tota fequuntur.
Si rurfus tclius pulfu laxdta tridentis
Æolii, tunûdis irtimittatfiuclibus Eurum ;
Quamvis iclu novo, ventum tenutre priorer»
Æquora ; nubiferoqiie polus cum ceßerit außro ,
Vindicat unda no tu m. •
Que ceux qui refufent à Lucain le nom de^ poëte,
nous difent fi cette façon d’exprimer une réflexion
politique eft d’un fimple hiftorien.
Dans la comparaifon, c’eft le plus fou vent une idée,
un fentiment, une vérité abftraite qu’on veut rendre
fenfible par une image. Mais il arrive aufli quelquefois
que la comparaifon efl inverfe , je veux dire
qu’elle emploie le terme abftrait pour mieux peindre
l’objet fenfible. Ainfi dans une odi au printems, on
lui dit: «Ton fourire fait fleurir la rofe qui, belle
» comme les joues de l'innocence, répand une odeur
» embaumée ». On voit là une image commune
rendue nouvelle , délicate 6c piquante, par le ren-
verfement du rapport ufité.
Il efl: de l’effence de la comparaifon de circonfcrire
fon objet : tout ce qui en excede l’image efl fuperflu,
& par conféquent nuifible au deflein du poëte. La
comparaifon finit où finiffent les rapports. Homere,
emporté par le talent 6c le plaifir d’imiter la nature,
oublioit fouvent que le tableau qu’il peignoit avec
feu , n’étoit placé qu’autant qu’il étoit relatif; & dans
la chaleur de la compofition , il l’achevoit comme
abfolu & intéreffant par lui-même. C ’eft un beau
défaut, fi l’on v eu t, mais c’en efl un grand que d’introduire
dans un récit des circonftances 6c des détails
qui n’ont aifcun trait à la chofe. Le bon lens efl
la première qualité du génie , 6c l’à-propos la première
loi du bon fens: aufli, quoiqu’on ait exeufé
la furabondance des comparaifons d’Homere, aucun
des poètes célébrés ne l’a imitée, non pas même
dans l’Ode qui de fa nature efl plus vagabonde que
le Poeme épique.
Au refte , la comparaifon efl elle-même une ex-
curfion du génie du poëte, 6c cette excurfion n’eft
pas également naturelle dans tous les genres. Plus
l’ame efl occupée de fon objet direél, moins, elle
regarde autour d’elle ; plus le mouvement qui l’emporte
efl rapide, plus il efl impatient des obftacles
& dçs détours ; enfin, plus le fentiment a de chaleur
6c de force, plus il maîtrife l’imagination 6c l’empêche
de s’égarer. Il s’enfuit que la narration tranquille
admet des comparaifons fréquentes, développées
, étendues & prifes de loin ; qu’à mefure qu’elle
s’anime elle en veut moins, les veut plus concifes,
& apperçues de plus près ; que dans le pathétique,
elles ne doivent être qu’indiquées par un trait rapide
; & que, s’il s’en préfente quelques-unes dans
la véhémence de la paflion, un feul mot les doit
exprimer.
Quant aux fources de la comparaifon, elle efl
prilè communément dans la réalité des chofes, mais
quelquefois aufli dans l’opinion 6c dans l’hypothefe
du merveilleux. Ainfi M. de Voltaire compare les
ligueurs aux géants : ainfi après avoir dit du vertueux
Mornai,
Jamais î'air de la cour, & fon foufße infecté ,
N’altéra de fon coeur Cäußere pureté.
il ajoute :
Belle Aréthiife * ainfi ton onde fortunée
Roule au fein furieux d'Amphitrite étonnée ,
Un cryßal toujours pur & des flots toujours clairs,
Que jamais ne corrompt l'amertume des mers. - - .
Finiflons cet article par la plus belle & la plus
touchante comparaifon qu’il foit poflible de tranf-
mettre à la mémoire des hommes ; elle efl de notre
bon roi Henri IV. 11 s’agifloit de prendre d’aflaut la
ville de Paris, il ne le voulut p a s ,& voici fa ré-
ponfe : « Je fuis, difoit-il, le vrai pere de mon peu-
» pie, je reflemble à cette vraie mere, dans Salomon,
» j’aimerois quafi mieux n’avoir point de Paris,que
» de l’avoir tout ruiné. ( M. Ma r m ONTEL. )
* § COMPITALES , fêtes inflituées en l ’honneur
des dieux Lares«... Les jours rien étaient pas fixes ,
c étoit cependant toujours en janvier. On voit dans Cicéron
que cette fête fut célébrée de foq tems au
mois de décembre ; mais elle fe célébroit ordinairement
au mois de mai, comme le prouve le calendrier
, & c’eft fous le mois de mai qu’Ovide en fait
mention dans fes faites. Voye^ encore les notes de
Dempfter fur Rofin, & celles de M. l’abbé Mon-
gault fur la troifieme Lettre du deuxieme Livre à
Atîicus. Les efclaves ojfroient des balles de laine, lifez
des pelottes de laine. Lettres fur L’Encyclopédie.
§ COMPONNÉ , ÉE, ( terme "de Blafon. ) croix
componée. Voye{ dans le Recueil des planches de l ’Art
Héraldique, D i cl. raif. des Sciences, &c. laplanche
I I I , f i g . /o6V
COMPOSÉ, ée , adj. ( Mufiq. ) ce mot a trois
fens en mufique ; deux par rapport aux intervalles,
6ç un par rapport à la mefure.
i° . Tout intervalle qui paffe l’étendue de l’o&ave
eft un intervalle compofé , parce qu’en retranchant
l’oâa ve on fimplifie l’intervalle fans le changer. Ainfi
la neuvième, la dixième, la douzième font des intervalles
compofés; le premier, de la fécondé & de'
l’oftave ; le deuxieme, de la tierce & de l’odave ;
le troifieme, de la quinte 6c de l’oétave , &c.
z ° . Tout intervalle qu’on peut divifer muficale-
ment en deux intervalles , peut encore être confidéré
comme compofé. Ainfi la quinte eft compofée de deux
tierces , la tierce de deux fécondés , la fécondé majeure
de deux femi-tons; mais le femi-ton n’eft point
compofé, parce qu’on ne peut plus le divifer ni fur
le clavier, ni par notes. C ’eft le fens du difeours
' q ui, des deux précédentes acceptions, doit déterminer
celle félon laquelle un intervalle eft dit compofé.
3°. On appelle mefures compofées toutes celles qui
font défignées par deux chiffres. Joyei Mesure ,
( Mufiq.) Dicl. raif. des Sciences , &c. (fi)
C omposée, maladie, (Méd.) on appelle maladie
compofée, celle à la formation de laquelle diverfes
affeûions fimples concourent enfemble, de maniéré
qu’elles n’en font qu’une. La maladie compofée a donc,
dans £e cas , autant de parties qu’il y a d’afteélions
fimples qui ont concouru à fa naiflànce ; elle prend
leur nature. En les connoiflant, on la connoît elle-
même , & aucune d’elles ne peut être changée ou
détruite, fans qu’il arrive aulîi changement dans la
nature de la maladie qu’elles compofenr.
On peut donc, en général, confidcret ici trois ef-
peces de compofitions , fuivant que les différens
vices ou des folides ou des fluides, concourent en-
femblc 6c entr’eux, ou avec les parties folides 6c
fluides ; mais il y a un fi grand nombre d’efpeces de
l’un & l’autre genre, qu’il eft à peine poflible de
trouver la quantité des combinaiîbns poflibles, 6c
d’expofer avec ordre les maladies qui naiffent de
chacune.
De plus, on ne connoît pas aflez clairement les
carafteres des maladies: cette matière eft encore un
grand fujet de difpute 6c de difcullion ; de forte qu’on
fe tireroit difficilement d’embarras, en voulant employer
la doûrine fynthétique.
11 eft donc plus fenfé de tirer l’ordre convenable
au traitement de cetle queftion, de la partie la plys
évidente de l’état morbifique, & que les fens font
découvrir. C ’eft ainfi qu’on peut, par une méthode
régulière, établir les cara&eres certains, par lefquels
les différentes maladies fe rapportent, réciproque*
ment., ou different les. unes des autres. C’eft ainfi
qu’on peut connoître leurs c|affes, leurs efpeces 6c
différences; enforte qu’on les diftingue plus aifé-
mentdans la pratique, & qu’on évite la cpnfufion
& l’occaftan de difputer ; aufli cpnfidere-t-on plutôt
les .maladies compojéts comme le concours div.ers
d’autant de fym:ptômes , .& on les renvoie avec rai-
fon, à la maniéré des gens à fyftêijie, à cette partie
fpéciale de la pathologie qui traite en particulier des
fymptômes. (' G .)
COMPOSER , ( Mufiq. ) inventer de la mufique
nouvelle , félon les regies.de l’art. (S)
COMPOSITEUR , ,( Mufiq* ) Me permettra-t-on
d’ajouter quelque chofe.àl’article Compositeur,
( Mufiq, ) , Di&. ra f . des Sciences, Sçç. $ç à- celui
C omposit ion , auquel il renvoie ? je ne me flatte
pas de dire dijt neuf : fans doute on trouvera <fôns
différens articles de M. Rouffeau, tout ce que je
pourrai mettre ici > mais je crois bien faire de
raffembler je, tout fous un feul point de vue.
Aujourd’hui 1 es compofiteucsfe contentent d e fa-
votr la routine de la compofition 6c médiocrement
les langues ; mais eft r ce. tout ce qu’ils devroient
pofleder } Un compafiteur n’aura-t-il pas une expref-
fion beaucoup plus énergique,. fi fa chant; la théorie
de l ’harmonie il fait la raifonner ? Qu’on me paffe
cette façon de parler , & non faire fuccéder un accord
à un autre, parce qu’on a toujours fait ainfi.
Si le Gompofitsur n’eft pas bon déçlamateur » comment
notera-t->il. une bonne déclamation ? & comment
fa mufique aura-t-elle de.l’expreffion , fi elle ne contient
pâjStUine bonne déclamation ?
Le compcfiteur ne doit-il pas encore être yerfé
dans la lefture des poètes ;aneièiis & modernes ?
Comment fans cela pourra-t-il connoître le cara&ere
particulier de chacun deeeux qu’il fait parler ? Comment
pourra-t-il faire d’Achille l’homme d’Horace :
Impiger, iraçundus, inexorabifts, açer j .
Saura-t-il fans cette lefture bien peindre Agamem-
non difputant dans un duo avec Achille au fujet
d’Iphigônie ? Donner au premier une eoljere plus
maj,eftuenfe , des retours de tendrèfiè.bientôt étouffés
par l’imprudente furçur d’Aehillé ? N o n i l leur
fera froidement chanter Tun après l’autre le même
motif.
Le compofiteitr doit encore donner en général un
ton plus noble, plus touchant au premier perfon-
nage de fa piece, & il doit dégrader le ton à mefure
que les fujets font moins intéreffans : & qu’on ne
dife pas que cela ne f e peut; un des bons opéra
de Haffe bien exécuté fera fentir toutes ces nuances.
Voilà ce qu’un compofiteur devroit être, fi le
goût des fpeftateurs & du théâtre lyrique en général
n’étoit pas gâte ; mais aujourd’hui qu’iln e s’agit
pas feulement de bien faire , mais encore de ramener
le bon gôut, & la vraie expreflion fur lé théâtre,
il faut qu’un compofiteur foit de plus un vrai Stoïcien
, & qu’il oppofe une fermeté inébranlable aux
clameurs des croquefols & des a&eurs médiocres
qui veulent fauverleur peu d’ame à l’aide d’un chant
léger & gracieux , mais.qui ne dit rien. ( F. D. C. )
§ COMPOSITION , ( Mufiq. ) dans une compofition
l’auteur a pour fujet le fon phyfiquement
confidéré , & pour objet le.feul plaifir dé l’oreille,
ou bien il s’élève à la mufique imitative & cherche
à émouvoir fes auditeurs par des effets moraux. Au
premier égard il fuffit qu’il cherche de beaux fons &
des accords agréables ; mais au fécond , il doit
confidérer la mufique par fes rapports aux accens de
la voix humaine , & par lès conformités poflibles
entre les fons harmoniquement combinés & les
objets imitables. On trouvera, dans [’article Opéra,
quelques idées fur ies moyens d’élever & d’ennoblir
l’art, en fiiifant de la mufique une langue plus
éloquente que le difeours même. (5)
.Composit ion des corps, ( Chym. ) La compofi-
don chymique n’eft autre chofe que l’iinion 6c la
combinaifon de plufieurs fubftançes de nature différente
, dont il réfulte un corps compofé. C ’eft cette
union de parties de différente nature , de laquelle il
réfulte un corps d’une nature mixte, que Becker
6c Stahl ont nommé mixtion, & qu’on peut nommer
combinaifon ou compofition chymique , pour éviter
l’équivoque des termes-de mixte 6c de mixtion , par
lefquels on pourroit.entendre un fimple mélange,
une fimple interpofitipn de parties , & qui donne?
roit une;idée très-faufle de la- compofition chymique,
dans laquelle il doit y-avoir de plus une adhérence
mutuelle entre les fubftançes qui fe combinent.
Les fubftançes que les chymiftes regardent comme
fimples, ou leS'.principes primitifs , en fe combinant
enfemble, forment les premiers compofés auxquels
Becker &:St'ahl donnent, parexçelience, le
nom de mixtes. Les mêmes chymiftes donnent le
nom d e eompofés à; ceux qui réfultent de l’union de
c es premiers mixtes. •
En fuivant toujours ces combinaifons de plus en
plus compliquées, pn trouve les corps .plus ço-mpo-
fés , qu’ils ont nommés décompofès 6c furdécompofes.
Cette diftributionde différentes efpeces de corps
plus ou moins compofés, eft elle-mçme très-jufte 6t
très-.CQnforme à ce que démontre l’e^péfieneç. Mais
il paroît que les dénominations que Becker 6c Stahl
leur ont données manquent d’exa&itudç & de clarté,
faute d’être univoques»......
Il femble donc qu’il eû beaucoup plus fimple 6c
plus clair de défignef ces différentes clafles de corps
par des nombres qui'puiflent indiquer leur dégré de*
compofition : on peut .fies nommer, par exemple ,
compojés du pr.emier ., du fécond , du'troifieme, du
quatrième degré., &e. ainfi que M. Macquer le pro-
p.ofe dans fes Cours. (+ )
* ÇOMPURGATEUR , f . m. ( Jurifprudence. )
Dans l’ancienne jurifprudence civile 6c criminelle:,
un accule étoit reçu à fe purger par ferment de l’im'
putation formée contre lui, toutes les fois que la notoriété
du fait ne préfentoit pas la preuve la plus claire
& la plusdireâe ; &.s’il déclaroit par ferment fon
innocence , il étoit abfous. Cet ufage, étoit propre
à. aflurer à la.fraude le fecret & l'impunité , en rendant
la tentation du parjure fi puiflante , qu’il n’ étoit
pas aifé d’y réfifter. On éprouva bientôt les dangereux
effets d'une fçmblable coutume ; pour y remér
dier , les loix ordonnèrent que les fermens feroient
adminiftrés avec un appareil impofant 6c propre à
infpirer aux hommes une crainte falutaire de fe parjurer
; ce moyen fut d’un foible fecours , on fe fa-
miliarifa bientôt avec çes cérémonies qui en impor
ferent d’abord à l’imagination, mais.dont l’effet s’af-
foiblit infenfiblçm.ent par l’habitude. Ceux qui ne
craignoient pas d’outrager la vérité ne pouvoient
être long-tems retenus par l’appareil d’un ferment:
alors on exigea que l’accufé comparût avec un certain
nombre .d’hommes libres, fes voifins ou fes
parens qui, pour donner plus de poids à fon ferment,
juraffent eux-mêmes qu’ils croyoient que l’aceufé
difoit vrai : ces efpeces de témoins furent appellés
compurgateurs, leur nombre varioit félon l’importance
de l’objet qu.i étoit en litige, ou la nature du
crimedorit un hommeétoit accufé: dans certains cas,
il ne fajloit pas moins que le concours de trois cens de
nés témoins auxiliaires pour faire abfoudre l’acctife.
Cette nouvelle formalité d’appelief des compurgateurs
, n’offrit encore qu’une reflbur.ee plus apparente
que réelle contre le menfpnge 6c le parjure ;
daoscës fie des d’ignoraneç. où l’oà tfavoit pas des