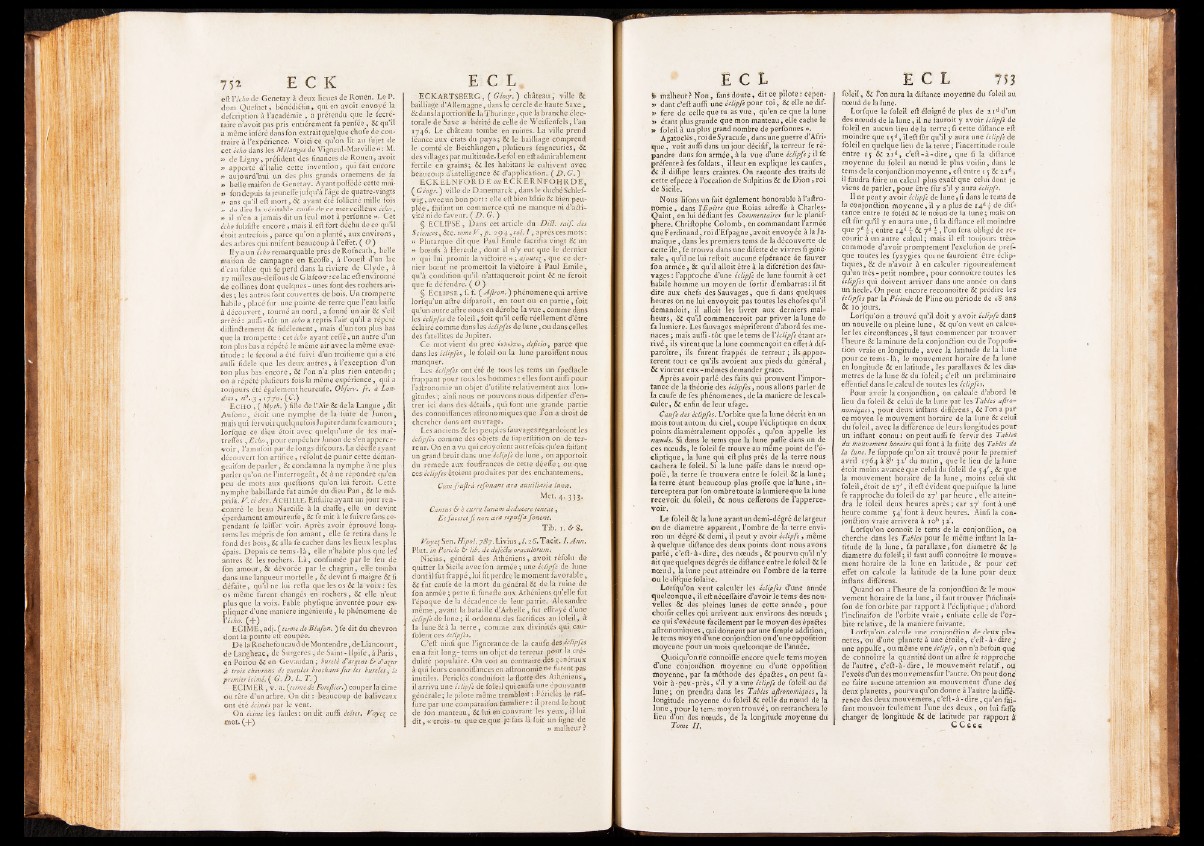
eft l'écho de Genetay à deux lieues de Rouen. Le P.
dom Qitefnet, bénédictin, qui en avoit envoyé la
description à l’académie , a prétendu que le Secrétaire
n’avoit pas pris entièrement fa penfée, & qu’il
a même inféré dansfon extrait quelque chofe de contraire
à l’expérience. Voici ce qu’on lit au Sujet de
cet écho dans les Mélanges de Vigneul-Marville « : M.
« de Ligny, président des finances de Rouen* avoit
» apporté d’Italie cette invention, qui fâit encore
» aujourd’hui un des plus grands ornemens de fa
» belle maifon de Genetay. Ayant pofféde cette mai-
» fon depuis fa jeuneSTe julqu’à l’âge de quatre-vingts
» ans qu’il eft mort, & ayant été follicité mille fois
» de dire la véritable caufe de ce merveilleux écho,
» il n’en a jamais dit un feul mot à perfonne ». Cet
écho fubfifte encore, mais il eft fort déchu de ce qu’il
étoit autrefois , parce qu’on a planté, aux environs,
des arbres qui nuifent beaucoup à l’effet. ( O )
Il y a un écho remarquable près de Rofncath, belle
maifon de campagne en Ecoffe, à l’oueft d’un lac
d’eau falée qui feperd dans la riviere de C lyd e , à
i y milles au-déffous de Glafcow : ce lac eft environne
de collines dont quelques - unes font des rochers arides
; les autres font couvertes de bois. Un trompette
habile, placé fur une pointe de terre que l’ eau laiffe
à découvert, tourné au nord, a fonné un air & s’eft
arrêté : aufti-tôt un écho a repris l’air qu’il a répété
diftinâement & fidèlement, mais d’un ton plus bas
que la trompette : c et écho ayant ceffé,un autre d’un
ton plus bas a répété le même air avec la même exactitude
: le fécond a été fuivi d’un troifieme qui a été
auffi fidele que les deux autres, à l’exception d’un
ton plus bas encore, & l’on n’a plus rien entendu ;
on a répété plufieurs fois la même expérience, qui a
toujours été également heureufe. Obferv. fr. à Londres
, /z0..3 , iyyo. (C.)
E cho , ( Myth. ) fille de l’Air & delà Langue , dit
Aüfone, étoit une nymphe de la fuite de Junon,
mais qui fervoit quelquefois Jupiter dans fes amours ;
lorfque ce dieu étoit avec quelqu’une de fes maî-
treffes , Echo, pour empêcher Junon de s’enapperce-
v o ir , l’amufoit par de longs difeours. La déeffe ayant
découvert fon artifice, réfolut de punir cette déman-
geaifon de parler, & condamna la nymphe à ne plus
parler qu’on ne l’interrogeât, & à ne répondre qu’en
peu de mots aux queftions qu’on lui feroit. Cette
nymphe babillarde fut aimée du dieu Pan, & le mé-
prifa. V. ci dev. A chille. Enfuite ayant un jour rencontré
le beau Narciffe à la chaffe,elle en devint
éperdument amoureufe, & fe mit à le fuivrefans*ce-
pendant fe laiffer voir. Après avoir éprouvé long-
tems les mépris de fon amant, elle fe retira dans le
fond des bois, & alla fe cacher dans les lieux les plus
épais. Depuis ce tems-là, elle n’habite plus que le^
antres & les rochers. Là , confumée par le feu de
fon amour, & dévorée par le chagrin, elle tomba
dans une langueur mortelle, & devint fi maigre & fi
défaite, qu’il ne lui refta que les os & la voix : fes
os même furent changés en rochers, & elle n’eut
plus que la voix. Fable phyfique inventée pour expliquer
d’une maniéré ingénieufe, le phénomène de
Yécho, ( “h)
ECIME, adj. ( terme de Blafon. ) fe dit du chevron
dont la pointe eft coupée.
De la Rochefoucaud de Montendre, de Liancourt,
de Langheac, de Surgeres , de Saint - Ilpife, à Paris,
en Poitou & en Gevaudan ; burelè d'argent & d’azur
d trois chevrons de gueules brochans fur les bureles, le
premier écimé. ( G. Ù . L.T .')
ECIMER, v. a. (terme de Forejlier.) couper la cime
ou tête d’un arbre. On dit : beaucoup de baliveaux
ont été écimés par le vent.
On écime les faules : on dit auffi étêter. Voye{ ce
mot. (+ )
ECKARTSBERG, ( Géogr. ) château; ville &
bailliage d’Allemagne, dans le cercle de haute Saxe ,
& dans-la portion de laThuringe, que la branche électorale
de Saxe a hérité de celle de "NYeiffenfels, l’an
1746. Le château tombe en ruines. La ville prend
féance aux états du pays ; & le bailliage comprend
le comté de Beiehlingen, plufieurs feigneuries, &
des villages par multitude. Le fol en eft admirablement
fertile en grains ; & les habitans le cultivent avec
beaucoup d’intelligence & d’application. ( D . G . j
E C K E L N F O R D E ù a E C K E R N F O H R D E ,
( Géogr. ) ville de Danemarck, dans le duché Schlef-
wig, avec un bon port : elle eft bien bâtie & bien peuplée,
faifant un commerce qui ne manque ni d’aCti-
vité ni de faveur. ( D . G. )
§ ECLIPSE, Dans cet article du Dicl. raif. des
Sciences, &c. tome V , p. 2 $ 4 , col. I , après ces mots :
« Plutarque dit que Paul Emile facrifia vingt & un
» boeufs à Hercule, dont il n’y eut que le dernier
» qui lui promit la victoire » ; ajoutej , que ce dernier
boeuf ne promettoit la victoire à Paul Emile,
qu’à condition qu’il- n’attaqueroit point & ne feroit
que fe défendre. ( O )
§ E g l i p s e , f. f. ( Aflron. ) phénomène qui arrive
lorfqu’un aftre difparoît, en tout ou en partie, foit
qu’un autre aftre nous en dérobe la v u e , comme dans
les éclipfes de foleil, foit qu’il ceffe réellement d’être
éclairé comme dans les éclipfes de lune, ou dans celles
des fatellites de Jupiter.
Ce mot vient du grec »kAs/ww, deficio, parce que
dans les éclipfes, le foleil ou la lune paroiffent nous
manquer.
Les éclipfes ont été de tous les tems un fpe&acle
frappant pour tous les hommes : elles font auffi pour
l’aftronomie un objet d’utilité relativement aux longitudes;
ainfinous ne pouvons nous difpenfer d’entrer
ici dans des détails, qui font une grande partie
des connoiffances aftronomiques que l ’on a droit de
chercher dans cet ouvrage.
Les anciens & les peuples fauvagesregardoient les
éclipfes comme des objets de fuperftition on de terreur.
On en a vu qui croyoient autrefois qu’en faifant
un grand bruit dans une éclipfe de lune, on apportoit
du remede aux fouffrances de cette déeffe ; ou que
ces éclipfes êtoient produites par des enchantemens.
Cum fruflrà refonant cera auxilia'ria lunce.
Met. 4. 333-
Cantus & è curru lunam deducere tentât,
Etfaceret J i non ara repulfa fonent.
Tib. i. £ 8 .
Voye\ Sen. Hipol. ySy. Livius, I.26. Tacit. I.Ann.
Plut, in Pericle & lib. de defectu oraculorum:
Nicias, général des Athéniens, avoit réfolu de
quitter la Sicile avec fon armée ; u n e écjipfe de lune
dont il fut frappé, lui fit perdre le moment favorable,
& fut caufe de la mort du général & de là ruine de
fon armée ; perte fi funefte aux Athéniens qu’elle fut
l’époque de la décadence de leur patrie. Alexandre
même , avant la bataille d’A rbelle, fut effrayé d’une
éclipfe de lune ; il ordonna des facrifices au loleil, à
la lune & à la terre, comme aux divinités qui, caUf
foient ces éclipfes.
C ’eft ainfi que l’ignorance de la caufe.des 1 eclipfes
en a fait long - tems un objet de terreur pour la cré-
dulité populaire. On voit au contraire;dés.généraux
à qui leurs connoifl'ances en aftronomie ne furent pas
inutiles. Periclès conduifoit la flotte des Athéniens,
il arriva un e éclipfe de folfeil quicaufa une épouvante
générale; le pilote même trembloit:.Periclès le raf-
fure par une comparaifon familière : il prend le bout
de fon manteau, & lui en couvrant les yeux, il lui
dit, « crois - tu que ce que j.e fais là foit un fignè dé
» malheur ?
%
fe malheur? Non, ïaftS doute, dit ce piloteî cèpe'rt-
» dânt c’eft auffi une éclipfe pour to i, & elle ne dif-
* fere de celle que tu as Vue, qu’en ce que la lune
»> étant plus grande que mon manteau, elle cache le
v foleil à un plus grand nombre de perfonnes ».
Agatoclès, roi de Syracufe, dans une guerre d’Afrique
, voit auffi dans un jour décifif, la terreur fe répandre
dans fon armée, à la Vue d’une éclipfe; il le
préfente à fes foldats, il leur en explique les caufes,
& il diffipe leurs craintes. On raconte des traits de
cette efpece à l’occafion de Sulpitius & de D ion , roi
de Sicile.
Nous lifons un fait également honorable à l’aftrO-
homie, dans XEpître que Roias adreffe à Charles-
Quint, en lui dédiant fes Commentaires fur le plan’if-
j»here. Chriftophe Colomb, en commandant l’armée
que Ferdinand, roid’Efpagne, avoit envoyée à la Jamaïque
, dans les premiers tems de la découverte de
cette île, fe trouva dans une difette de vivres fi génék
ra ie , qu’il ne lui reftoit aucune efpérance de fauver
fon armée, & qu’il alloit être à la diferétion des fau-
vages : l’approche d’une éclipfe de lune fournit à cet
habile homme un moyen de fortir d’embarras : il fit
dire aux chefs des Sauvages, que fi dans quelques
heures On ne lui envoyoit pas toutes les chofes qu’il
demandoit, il alloit les livrer aux derniers malheurs,
& qu’il commenceroit par priver la lune de
fa lumière. Les fauvages méprilerent d’abord fes menaces
; mais auffi-tôt que le tems de Y éclipfe étant arrivé
, ils virent que la lune commençoit en effet à dif-
paroître, ils furent frappés de terreur ; ils apportèrent
tout ce qu’ils avoient aux pieds du général,
& vinrent eux - mêmes demander grace^
Après avoir parlé des faits qui prouvent l’importance
de la théorie des éclipfes, nous allons parler de
la caufe de fes phénomènes, de là maniéré de les calculer,
& enfin de leur ufage.
Caufe dei éclipfes. L’orbite que la lune décrit en un
mois tout autour du ciel, coupe l’écliptique en deux
points diamétralement oppofés , qu’on appelle les
noeuds. Si dans le tems que la lune paffe dans un de
ces noeuds, le foleil fe trouve au meme point de l’é-
cliptiquè, la lune qui eft plus près de la terre nous
cachera le foleil. Si la lune paffe dans le noeud op-
pofé, la terre fe trouvera entre le foleil & la lune ;
la terre étant beaucoup plus groffe que la*’hine, interceptera
par fon ombre toute la lumière que la lune
recevoir du foleil, & nous cefferons de l’apperce-
Voir.
Le foleil & la lune ayant un demi-dégré de largeur
Ou de diametrè apparent, l’ombre de la terre environ
un dégré & demi, il peut y avoir éclipfe , même
à quelque diftance des deux points dont nous avons
parlé, c’eft-à-dire, des noeuds , & pourvu qu’il n’y
âit que quelques dégrés de diftance entre le foleil & le
noeud, la lune peut atteindre ou l’ombre de la terre
ou le difque folaire.
Lorfqu’on veut calculer les éclipfes d’une année
quelconque, il eft néceffaire d’avoir le tems des nouvelles
& des pleines luttes de cette année , pouf
choifir celles qui arrivent aux environs des noeuds ;
ce qui S’exécute facilement par le moyen des épaftes
aftronlomiques, qui donnent par une fimple addition,
le tems moyen d’une conjonélion ou d’une Oppofition
moyenne pour un mois quelconque de l’annee.
Quoiqu’on rie connoiffe encore que le tems moyen
d’une conjorfftiOn moyenne ou d’une oppofition.
moyenne, par la méthode des épaftès, on peut fa-
voir à-pêü-près, s’il y a une éclipfe de fôléilOu de
lune; On prendra dans les Tables àflrorioiniqués, la-
longitude .moyenne du foleil & celle du noeud dê la
lune, pour lé tems moyen trouvé ; on retranchera le
lieu d’un des noeuds, de la longitude moyenne du
Tome II,
foleil, & l’on aura la diftanCe moyenne du foleil au
noeud de la lune.
Lorfque le foleil eft éloigné de plus de x 1d d’un
des noeuds de la lune, il ne iàuroit y avoir éclipfe de
foleil en aucun lieu de la terre ; fi cette diftance eft
moindre que 15d, il eft fur qu’il y aura une éclipfe de
foleil en quelque lieu de la terre ; l'incertitude roule
entre 15 & 2 id, c’e f t-à -d ire , que fi la diftance
moyenne du foleil au noeud le plus voifin, dans le
tems de la conjonélion moyenne, eft entre 15 & x 1d,
il faudra faire un calcul plus exaû que celui dont je
viens de parler, pour être fur s’il y aura éclipfe-.
Il ne peut y avoir éclipfe de lune, fi dans le tems de
la conjonâion moyenne, il y a plus de i4 d £ de dif-*
tance entre le foleil & le noeud de la lune ; mais on
eft fur qu’il y en aura une, fi la diftance eft moindre
que 7d £ ; entre 14e1 \ & 7 d 7 , l’on fera obligé de recourir
à un autre calcul; mais il eft toujours très*
commode d’avoir promptement l’exclufion de pref-
que toutes les fyzygies qui ne fauroient être écliptiques,
& de n’avoir à en calculer rigoureufement
qu’un très - petit nombre, pour connoitre toutes les
éclipfes qui doivent arriver dans une année ou dans
un fiecle. On peut encore reconnoître & prédire les
éclipfes par la’Période de Pline ou période de 18 ans
& 10 jours.
Lorfqu’on a trouvé qu’il doit y avoir éclipfe dans
un nouvelle ou pleine lune, & qu’on veut en calcu*
1er les circonftances, il faut commencer par trouver
l’heure & la minute de la eonjonâion ou de l’oppofi-
tion vraie en longitude, avec la latitude de la lune
pour ce tems-là, le mouvement horaire de la lune
en longitude & en latitude, les parallaxes & les diamètres
de la lune & du foleil ; c’eft un préliminaire
effentiel dans le^alcul de toutes les éclipfes.
Pour avoir la conjon&ion, on calcule d’abord le
lieu du foleil & celui de la lune par lés Tables agronomiques
, pour deux inftans différens, & l’on a par
ce moyen le mouvement horaire de la lune & celui
dri foleil, avec la différence de leurs longitudes pour
un inftant connu : on peut auffi fe fervir des Tables
du mouvement horaire qui font à la fuite des Tables de
la lune. Je fuppofe qu’on ait trouvé pour le premier
avril 1764 à 8h 32' du matin, que le lieu de la lune
étoit moins avancé que cëluidu foleil de 54% & que
la riiouvement horaire de la lune, moins celui du
foleil, étoit de 2 7 ', il eft évident quepuifque la lune
fe rapproché du foleil de 27* par heure , elle atteindra
le foleil deux heures après ; car 27' font à unè
heure comme 54' font à deux heures. Ainfi la con-
jonéfion vraie arrivera à io h 32'.
Lorfqu’ôn connoît le tems de la conjonftion, on
cherche dans les Tables pour le même inftant la latitude
de la lune, fa parallaxe, fort diametrè & le
diamètre du foleil ; il faut auffi connoître le mouvement
horaire de la lune en latitude, & pour cet
effet ori calcule la latitude de la lune pour deux
inftans différens.
Quand on a l’heure de la conjonéüon & le mou*
vement horaire de la lune, il faut trouver l’îriclinai-
fon de fon orbite par rapport à l’écliptique; d’abord
l’incïinaifon de l’orbite vraie , enfuite celle de l’orbite
relative, dé la maniéré (uivante.
Lorfqu’o'm calcule une conjonction de deux planètes,
ou d’une planere à une étoile, c’eft-à -d ire ,
une àppulfe, ôü même une éclipfe, on n’a befoin que
de connoîttè la quantité dont un aftre fe rapproche
de l’atrtrè, c’ eft-à-diré, le mouvement relatif, où
l’eXeèS d*Uïï des mouVemensfur l’autre. On peut donc
ne faire aucune attention au mouvement d’une des
deux pîattetes, pOirt-vu qu’on donne à l’autre la différence
des deux moüvémèns, c ’eft - à - dire, qu*en faifant
mouvoir feulement l’une des deux, on lui faffe
changer dè longitude U de latitude par rapport à'