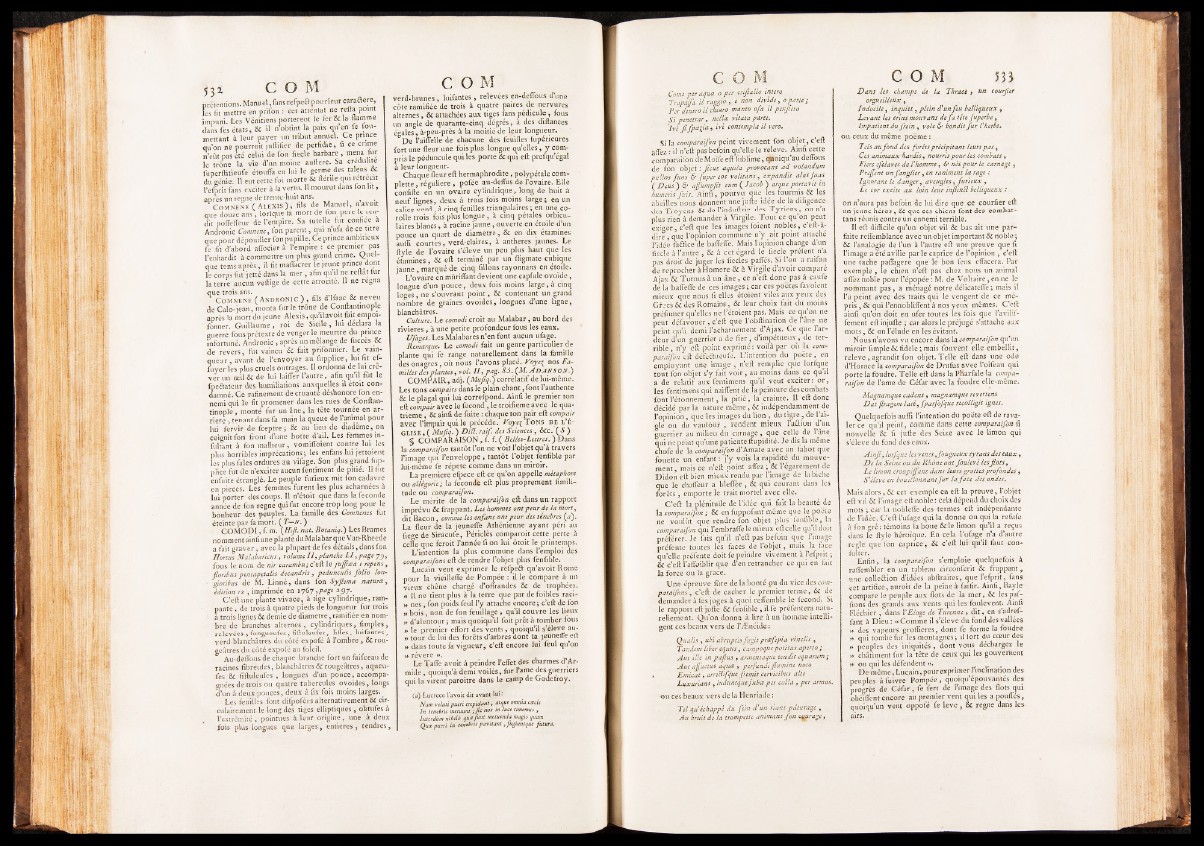
prétentions. Manuel .fenstefpeä pourleur carailere,
lés fit mettre en prifon I eet attentat ne refta point
impuni. Les Vénitiens portèrent le fer & la flamme
dans fes états, 8c il n’obtint la paix quen le lon-
mettant à leur parer un tribut annuel. Ce prince
qu’on ne pourrait jufliSer de perfidie, fi ce crime
n’eût pas été celui de fön fiecle barbare, mena lur
le trône la vie f a n moine auflere. Sa crédulité
fuperflitienfe étouffe en lui le germe des talens 8c
du génie. 11 eut Sette foi morte 8c ftenle .qui rétrécit
l’efprit fans exciter à la vertu. 11 mourut dans fon ht.,
après un regne de trentedlliit ans. ,
Comnene ( Alexis)-, fils de Manuel, navoit
que douze ans -, lorfque la mort de fon pere le rendit
poffefleur de l’empire. Sa tutelle fut confiée à
Andronic Comnene, fon parent, qui n ufa de ce titre
que pour dépouiller fon pupille. Ce prince ambitieux
fe fit d’abord affocier à l’empire : ce premier pas
l’enhardit à commettre un plus grand crime. Quel-
que tems. après, il fit maffacrer le jeune prince dont
le corps fut jette dans la mer, afin qu’il ne reliât lur
la terre aucun veftige de cette atrocité. 11 ne régna
que trois ans. ^ I „
C omnene (A ndronic ) , fils dlfaac & neveu
de Calo-jean, monta furie trône de Conftantinople
après la mort du jeune Alexis, qu ilavoit fait empoi-
fonner. Guillaume, roi de Sicile, lui déclara la
guerre fous prétexte de venger lemeurtre du prince
infortuné. Andronic , après un mélange de fuccès 6c
de revers, fut vaincu 6c fait prifonnier. Le vainqueur
, avant de l’envoyer au fupplice, lui fit ef-
fuyer les plus cruels outrages. Il ordonna de lui crê-
ver un oeil 6c de lui laiffer l’autre, afin qu’il fût le
fpe&ateur des humiliations auxquelles il étoit condamné.
Ce rafinement de cruauté déshonore fon ennemi
qui le fit promener dans les rues de Conftantinople
, monté fur un âne, la tête tournée en arriéré
, tenant dans fa main la queue de l’animal pour
lui fervir de feeptre ; 6c au lieu de diademe, on
ceignit fort front d’une botte d’ail. Les femmes infusant
à fon malheur, vomiffoient contre lui les
plus horribles imprécations; les enfans lui jettoient
les plus fales ordures au vifage. Son plus grand fupplice
fut de n’exciter aucun fentiment de pitié. 11 fut
enfuite étranglé. Le peuple furieux mit fon cadavre
en pièces. Les femmes furent les plus acharnées à
lui porter des coups. Il n’étoit que dans la fécondé
année de fon regne qui fut encore trop long pour le
bonheur des peuples. La famille des Comnenes fut
éteinte par fa mort. ( T—N. )
COM O D I, f. m. {Hiß. nat. Botaniq.) Les Brames
nomment ainfiune plante du Malabar que Van-Rheede
a fait graver , avec la plupart de fes détails, dans fon
Hortus Malabaricns, volume 11, planche L I , page 79,
fous le nom de nir carambu; c’eft le juffioea / repens,
floribus pentapetalis decandris , pedunculis folio lon-
Jgioribus de M. Linné, dans fon Syßema natura,
édition 12 , imprimée en 1767 ,page zc)y.
C ’eft une plante vivace, à tige cylindrique, rampante
, de trois à quatre pieds de longueur fur trois
à trois lignes 6c demie de diamètre, ramifiée en nombre
de branches alternes , cylindriques, Amples,
relevées , fongueufes, fiftuleufes, liftes, luifantes, verd blanchâtres du côté expofé à l’ombre, & rougeâtres
du côté expofé au foleil.
Au-deflous de chaque branche fort un faifeeau de
racines fibreufes, blanchâtres & rougeâtres, aqueu-
fes 6c fiftuleufes , longues d’un pouce, accompagnées
de trois ou quatre tubercules ovoïdes, longs
d’un à deux pouces, deux à fix fois moins larges.
Les feuilles font difpofées alternativement 6c cir-
culairement le long des tiges elliptiques , obtufes à
l’extrêmiré, pointues à leur origine, une à deux
fois plus longues que larges, entières, tendres,
verd-brunes, luifantes , relevées en-deffous d’une
côte ramifiée de trois à quatre paires^ de nervures
alternes, 6c attachées aux tiges fans pédicule, fous
un angle de quarante-cinq dégrés., à des diftances
égales, à-peu-près à la moitié de leur longueur.
De l’aiffelle de chacune des feuilles fupérieures
fortune fleur une fois plus longue qu’elles, y compris
le péduncule qui les porte 6c qui eft prefqu’égal
à leur longueur.
Chaque fleur eft hermaphrodite, polypétale com-
plette, régulière , pofée au-defliis de l’ovaire. Elle
confifte en un ovaire cylindrique, long de huit à
neuf lignes, deux à trois fois moins large; en un
calice verd, à cinq feuilles triangulaires ; en une corolle
trois fois plus longue, à cinq pétales orbicu-
laires blancs, à racine jaune, ouverte en étoile d’un
pouce un quart de diamètre, 6c en dix étamines
aufli courtes, verd-daires, à anthères jaunes. Le
ftyle de l’ovaire s’élève un peu plus haut que les
étamines, 6c eft terminé par un ftigmate cubique
jaune , marqué de cinq filions rayonnans en étoile.
L’ovaire en muriffant devient une capfule ovoïde,
longue d’un pouce, deux fois moins large, à cinq
loges, ne s’ouvrant point, &c contenant un grand
nombre de graines ovoïdes, longues d’une ligne,
blanchâtres.
Culture. Le comodi croît au Malabar, au bord des
rivières, à une petite profondeur fous les eaux.
U f âges. Les Malabares n’en font aucun ufage.
Remarque. Le comodi fait un genre particulier de
plante qui fe range naturellement dans la famille
des onagres , où nous l’avons placé. Voye{ nos Familles
des plantes, vol. I I , pag. 86. {M. A D AN S ON.)
COMPAIR, adj. {Mujiq.) corrélatif de lui-même.
Les tons compairs dans le plain-chant, font 1 authente
& le plagal qui lui correfpond. Ainfi le premier ton
eft compair avec le fécond, le troifieme avec le quatrième
, 6c ainfi de fuite : chaque ton pair eft compair
avec l’impair qui le précédé. Foye^ToNS d e l ’ é -
G L IS E , ( Mujiq. ) DiB. raif. des Sciences, 6cc. ( S )
§ COMPARAISON, f. f. ( Belles-Lettres. ) Dans
la comparaifon tantôt l’on ne voit l’objet qu’à travers
l’image qui l’enveloppe, tantôt l’objet lenfible par
lui-même fe répété comme dans un miroir.
La première efpece eft ce qu’on appelle métaphore
ou allégorie; la fécondé eft plus proprement fimili-
tude ou comparaifon.
Le mérite de la comparaifon eft dans un rapport
imprévu Sc frappant. Les hommes ont peur de la mort,
dit Bacon, comme les enfans ont peur des tenebres {a).
La fleur de la jeunefle Athénienne ayant péri au
fiege de Siracufe, Périclès comparoit cette perte à
celle que feroit l’année fi on lui ôtoit le printemps.
L’intention la plus commune dans l’emploi des
comparaifons eft de rendre l’objet plus fenfible.
Lucain veut exprimer le refpeft qu’avoit Rome
pour la vieilleffe de Pompée : il le compare k u n
vieux chêne chargé d’offrandes 6c de trophées.
« Il ne tient plus à la terre que par defoibles raci-
» nés, fon poids feul l’y attache encore ; c’eft de fon
» bois, non de fon feuillage, qu’il couvre les lieux
» d’alentour ; mais quoiqu’il foit prêt à tomber fous
» le premier effort des vents, quoiqu’il s’élève au-
» tour de lui des forêts d’arbres dont la jeunefle eft
» dans toute fa vigueur, c’eft encore lui feul qu’on
» révéré ». H | „ .
Le Taffe avoit à peindre l’effet des charmes d’Ar-
mide, quoiqu’à demi voilés, fur l’ame des guerriers
qui la virent paroître dans le camp de Godefroy.
(a) Lucrèce l’avoit dit avant lui :
Nam veluti pueri trépidant, atque omnia ctecis
In tenebris metuunt ; f i c nos tn ^uce ùmemus ,
Interdhrn nihilb quafimt metuenda magis quant
Quaputri in tenebris pavitant ,fugiuntque futura.
Corne per ac[ua 0 per cri f allô intero
Trqpajja il raggio , « non divide, 0paru'; ,
Per dentro il chiaro manto ofa il penfiero
Si penetrar, nella vitata parte.
Ivi J i fpafta, ivi contempla il vero.
Si la comparaifon peint vivement fon objet, ç’eft
affez : il n’eft pas befoin qu’elle le releve. Ainfi cette
comparaifon de Moïfe eft fublime, qaoiqu’au deffous
de Ion objet : Jicut aquila provocans ad volandum
putlos fuos & fupereos volitans, expandit alas fuas
( Dcus ) & affumpjit eum ( Jacob ) atque portavie in
humeris fuis. Ainfi, pourvu que les fourmis & les
abeilles nous donnent une jufte idee de la diligence.
desTroyens 6c de rinduftrie des Tyriens , on n’a
plus rien à demander à Virgile. Tout ce qu’on peut
exiger, c’eft que les images foient nobles, c’eft-à-
dire , que l’opinion commune n’y ait point attaché
l’idée faftice de baffefîe. Mais l'opinion change d’un
fieclé à l’autre , & à cèt égard le fiecle prélent n’a
pas droit de juger les fiecles paffés. Si l’on a raifon
de reprocher à Homere & à Virgile d’avoir comparé
Ajax 6c Turnus à un âne, ce n’eft donc pas à caufe
de la baffeffe de ces images ; car ces poètes favoient
mieux que noüs fi elles étoient viles aux yeux des
G f ecs 6c des Rohiains, 6c leur choix fait du moins
préfumer qu’elles ne l’étoient pas. Mais ce qu on ne
peut défavouer, c’eft que l ’obftination de l’âne ne
peint qu’à demi l’acharnement d’Ajax. Ce que l’ardeur
d’un guerrier a de fier, d’impétueux, de terrible
, n’y eft point exprimé : voilà par où la com~
paraifon eft défettueufe. L’intention du poète, en
employant une image , n’eft remplie.que lorfque
tout fon objet s’y fait v o ir , au moins dans^ ce qu il
a de relatif aux fentimens qu’il veut exciter : o r ,
les fentimens qui naiffent de la peinture des combats
font l’étonnement, la pitié, la çrainte. Il eft donc
décidé par la nature même, 6c indépendamment de
l’opinion, que les images du lion , du tigre, de l’aigle
ou du vautour , rendent mieux l’aftion d’un
guerrier au milieu du carnage, que celle de l’âne/
qui ne peint qu’une patiente ftupidité. Je dis la même
chofe de la comparaifon d’Amate avec un fabot que
fouette un enfant : j’y vois la rapidité du mouve-
■ ment, mais ce n’eft point affez ; 6c 1 égarement de
Didon eft bien mieux rendu par l’image de la biche
que le chaffeur a bleffée , 6c qui courant dans les
forêts, emporte le trait mortel avec elle.
C ’eft la plénitude de l’idée qui fait la beauté de
l a comparaifon ; 6c en fuppofant meme que le poète
ne voulut que rendre fort objet plus lenfible, la
comparaifon qui l’embraffe le mieux eft celle qu il doit
préférer. Je fais qu’il n’eft pas befoin que l’image
préfente toutes les faces de l’o bjet, mais la face
qu’elle préfente'doit fe peindre vivement à l’efprit ;
& c’eft l’affpiblir que d’en retrancher ce qui en fait
l a force ou la grâce.
Une épreuve fure de la bonté pu du vice des comparaifons
, c’eft de cacher le premier terme, 6c de
demander à fes juges à quoi reffemble le fécond. Si
le rapport eft jufte 6c fenfible , il fe préfentera naturellement.
Qu’on donna à lire à un homme intelligent
ces beaux vers de l’Ænéide :
1 Qualis , ubi abruptis fitgit preefepia vinclis ,
Tandem liber equus, carnpoque potitus aperto ;
Aut ille in pajîus , armentaque tendit cquarum ;
Aut ajfuetus' aquat , perfundi famine noto
. Emicat, arreclifquc frémit çervicibus alte
Luxurians , luduntquejubce per colla, per armos.
ou ces beaux vers de la Henriade :
Tel qu’échappe du fein d'un riant pâturage ,
Au bruit de la trompette animant fon c.çfurage,
Vans les çhfimps de la Thraci > Un courfet
orgueilletix,
Indocile, inquiet, plein à? un feu belliqueux ,
Levant les crins mouv ans de fa tête fuperbe ,
Impatient du frein , vole & bondit fur l ’herbe*
o,u ceux du même poème :
Tels au fond des forêts précipitant leur S pas j
Ces animaux hardis , nourris pour les combats f
Fiers efclaves de l ’homme , & nés pour le carnage $
Prefent un fanglier, en raniment la rage :
Ignorant le danger, aveugles, furieux ,
Le cor excite au loin leur in fin it belliqueux *
on n’aura pas befoin de lui dire que ce courfier eft
un jeune héros, 6c que c e s chiens font des combat-
tans réunis contre un ennemi terrible.
»11 eft difficile qu’un objet vil 6c bas ait une parfaite
reffemblance avec un.objet important 6c noble ;
6c l’analogie de l’un à l’autre eft une preuve que fi
l’image a été avilie par le caprice de l’opinion , c’eft
une tache paffagere que le bon fens effacera. Pat
exemple, le chien n’eft pas chez nous un animal
affez noble pour l’épopée : M. de Voltaire, en ne le
nommant pas, a ménagé notre délicateffe ; mais il
l’a peint avec des traits qui le vengent de ce mépris
, 6 c qui l’ennobliffent à nos yeux mêmes. C’eft
ainfi qu’on doit en ufer toutes les fois que l’avilif-
fement eft injufte ; car alors le préjugé s’attache aux
mots, 6c on l’élude en les évitant.
Nous n’avons vu encore dans la comparaifon qu’un
miroir fimple 6c fidele ; mais fouvent elle embellit,
releve, agrandit fon objet. Telle eft dans une ode
d’Horace la comparaifon de Drufus avec l’oifeau qui
porte la foudre. Telle eft dans la Pharfale la comparaifon
de l’ame de Céfar avec la foudre elle-même.
Magnamque cadens , magnamque revertens
Dat f ragent latè, fparfqfque recolligit ignés.
Quelquefois àufli l’intention du poète eft de ravaler
ce qu’il peint, comme dans cette comparaifon fi
nouvelle 6c fi jufte des Seize avec le limon qui
s’élève du fond des eaux.
Ainfi, lorfque Us vents, fougueux ty farts des eaux ,
De la Seine ou du Rhône ont foultvè lesflots,
Le limon croupifane dans leurs grottes profonde^ ,
S’élève en bouillonnant fur la face des ondes.
Mais alors, 6c cet exemple en eft la preuve, l’objet
eft vil 6c l’image eft noble : cela dépend du choix des
mots ; car la nobleffe des termes eft indépendante
de l’idée. C’eft l’ufage qui la donne ou qui la refufe
à fon gré: témoins la boue & le limon qu’il a reçus
dans le ftyle héroïque. En cela 1’ufage n’a d’autre
réglé que fon caprice, 6c c’eft lui xju’il faut con-
fulter.
Enfin, la comparaifon s’emploie quelquefois à
raffembler en un tableau .circonfcrit 6c - frappant,
une collettion d’idées abftraites, que l’efprit, fans
cet artifice, auroit de la peine à faifir. Ainfi, Bayle
compare le peuple aux flots de la mer, 6c les paf-
fions des grands aux vents qui les foulevent. Ainfi
Fléchier , dans Y Eloge de Turenne, dit, en s’adref-
fant à Dieu : « Comme il s’élève du fond des vallées
>> des vapeurs groflieres, dont fe forme la foudre
» qui tombe fur les montagnes; il fort du coeur des
» peuples des iniquités , dont vous déchargez le
» châtiment fur la tête de ceux qui les gouvernent
» ou qui les défendent
De même, Luc.ain, pour exprimer l’inclination des
peuples à fuivre Pompée , quoiqu épouvantés des
progrès de Céfar, fe fert de l’image des flots qui
obéiffent encore au premier vent qui les a pouffés,
quoiqu’un vent oppofé fe le v e , & régné dans les
airs.