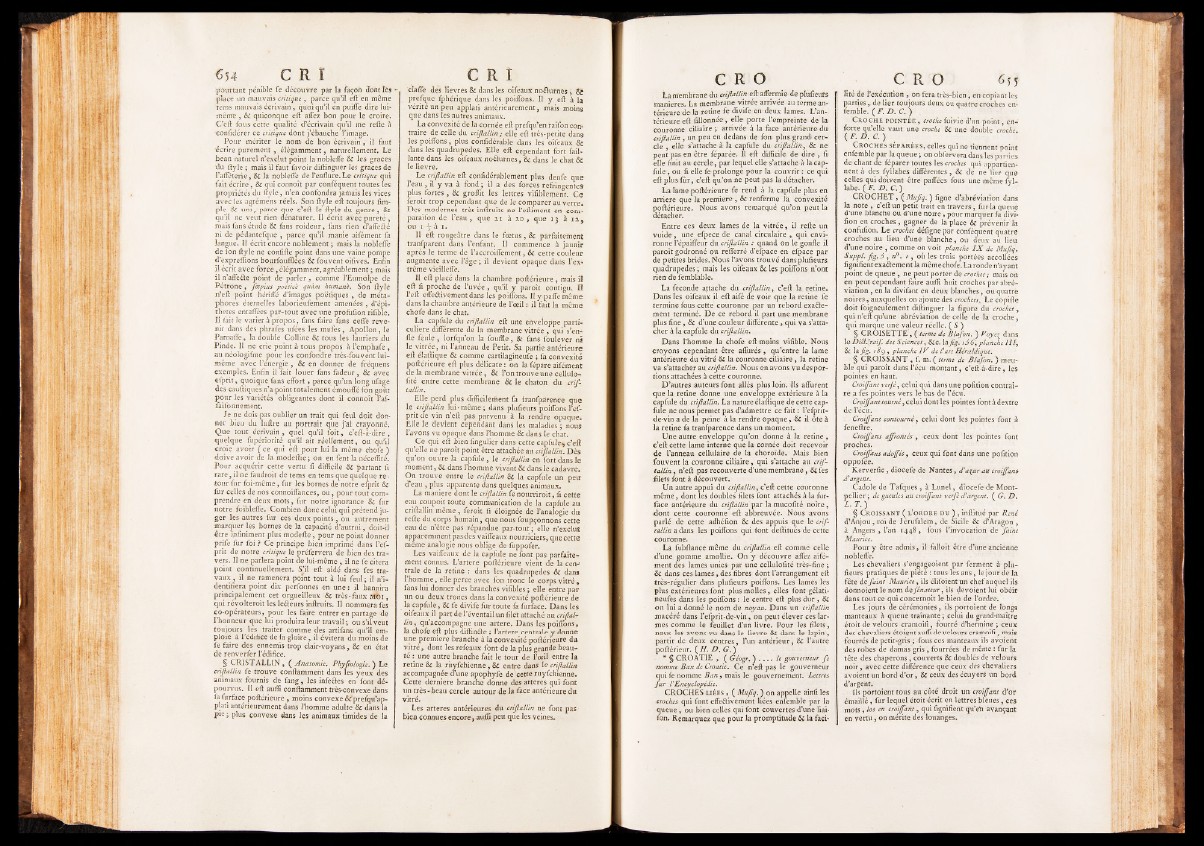
pourtant pénible fe découvre par la façon dont lès *-
place un mauvais critique , parce qu’il eft en même
îems mauvais écrivain, quoi qu’il en puiffe dire lui-
même , 8c quiconque eft affez bon pour le croire.
C’eft fous cette qualité d’écrivain qu’il me refte à
confidérer ce critique dont j’ébauche l’image.
Pour mériter le nom' de bon écrivain, il faut
'écrire purement ,. élégamment, naturellement. Le
beau naturel n’exclut point la noblefle 8c les grâces
du ftyle ; mais il faut favoir diftinguer les grâces de
l’afféterie, & la noblefle de l’enflure.Le critique qui
fait écrire, 8c qui connoît par conféquent toutes les
propriétés du ftyle, n’en confondra jamais les vices
avec les agrémens réels. Son ftyle eft toujours Ample
& uni,'parce que c’ eft le ftyle du genre, 8c
qu’il ne veut rien dénaturer. Il écrit avec pureté,
mais fans étude & fans roideur, fans rien d’affe&é
ni de pédantefque , parce qu’il manie aifément fa
langue. Il écrit encore noblement ; mais la noblefle
de fon ftyle ne conftfte point dans une vaine pompe
d’expreflions bourfoufflées 8c fouvent oiflves. Enfin
il écrit avec force , élégamment, agréablement ; mais
il n’affeâe point de parler, comme l’Eumolpe de
Pétrone, foepius poëticè quant humanè. Son ftyle
n’eft point hériffé d’images poétiques , de métaphores
éternelles Iaborieufement amenées, d’épi-
îhetes entaffées par-tout avec une profuflon riflble.
Il fait le varier à propos, fans faire fans ceffe revenir
dans des phrafes ufées les mufes, Apollon, le
Parnaffe, la double Colline 8c tous les lauriers du
Pinde. II ne crie point à tous propos à l’emphafe ,
au néologifme pour les confondre très-fou vent lui-
même avec l’énergie, & en donner de fréquens
exemples. Enfin il fait louer fans fadeur, & avec
efprit, quoique fans effort, parce qu’un long ufage
des cauftiqués n’ a point totalement émouffé fon goût
pour les variétés obligeantes dont il connoît l’af-
faifonnement.
Je ne dois pas oublier un trait qui feul doit donner
bien du luftre au portrait que j’ai crayonné'.
Que tout écrivain , quel qu’il loit., c’eft-à-dire ,
quelque fupériorité qu’il ait réellement, ou qu’il
croie avoir ( ce qui eft pour lui la même chofe )
doive avoir de la modeftie ; on en fent la néceflïte.
Pour acquérir cette vertu fi difficile 8c partant fi
rare, il ne faudroit de tems en tems que quelque re -
tour fur foi-même, fur les bornes de notre efprit 8c
fur celles de nos connoiffances, ou , pour tout comprendre
en deux mots, fur notre ignorance & fur
notre foibleffe. Combien donc celui qui prétend juger
les autres fur ces deux points , ou autrement
marquer les bornes de la capacité d’autrui, doit-il
être infiniment plus modefte, pour ne point donner
prife fur foi ? Ce principe bien imprimé dans l’ef-
prit de notre critique le préfervera de bien des travers.
Il ne parlera point de lui-même , il ne fe citera
point continuellement. S’il eft aidé dans fes travaux
, il ne ramènera point tout à lui feul ; il n’identifiera
point dix perfonnes en une : il bannira
principalement cet orgueilleux 8c très-faux nit)i,
qui révolteroit les le&eurs inftruits. Il nommera fes
co-opérateurs, pour les faire entrer en partage de
l ’honneur que lui produira leur travail ; ou s’il veut
toujours lés traiter comme des artifans qu’il emploie
a Pedifice de fa g loire, il évitera du moins de
le faire des ennemis trop çlair-voyans, 8c en état
de renverfer l’édifice.
§ CRISTALLIN, ( Anatomie. Phyfiologie.') Le
crifiallin fe trouve conftamment dans les yeux des
animaux fournis de fang, les infe&es en font dépourvus.
Il eft auflï conftamment très-convexe dans
fa furface poftérieure , moins convexe &fprefqu’ap-
plati antérieurement dans l’homme adulte & dans la
pie ; plus convexe dans les animaux timides de la
, clafle des lievres 8c dans les oifeaux no&ufrtës \ 8è
prefque fphérique dans les poiflons. Il y eft à la
vérité un peu applati antérieurement, mais moins
que dans les autres animaux. .
La convexité de la cornée eft prefqu’en raifon contraire
de celle du crifiallin; elle eft très-petite dans
les poiflons, plus confidérable dans les oîfeaux 8c
dans les quadrupèdes. Elle eft cependant fort Caillante
dans les oifeaux notturnes, 8c dans le chat 8c
le lievre.
Le crifiallin eft confidérablement plus denfe que
l’eau, il y va à fond ; il a des forces réfringentes
plus fortes , 8c groflit les lettres vifiblement. Ce
feroit trop cependant que de le comparer au verre*
Des modernes très-inftruits ne l’eftimént en, com-
paraifon de l’e a u , que 21 à 2 0 , que 13 à 1 2 ,
ou 1 -5- à 1.
Il eft rougeâtre dans le foetus, 8c parfaitement
tranfparent dans l’enfant. Il commence à jaunir
après le terme de l’aecroiffement, 8c cette couleur
augmente avec l’âge ; il devient opaque dans l’extrême
vieilleffe.
Il eft placé dans la chambre poftérieure, mais il
eft fi proche de l’u vé e , qu’il y paroît contigu. II
l’eft effectivement dans les poiflons. II y-paffe même
dans la chambre antérieure de l’oeil : il fait la même
chofe dans le chat.
La capfule du crifiallin eft uné enveîoppe particulière
différente de la membrane vitrée , qui s’enfle
feule, lorfqu’on la fouffle, 8t fans foulever ni
le vitrée, ni l’anneau de Petit. Sa partie antérieure
eft éJaftique 8c comme cartilagineufe ; fa convexité
poftérieure eft plus délicate : on la fépare aifément
de la membrane vitré e, 8c l’on trouve une cellulo-
fité entre cette membrane 8c le chaton du crif-
taliin.
Elle perd plus difficilerfïent fa tranfpàfenCe que
1 & crifiallin lui-même; dans plufieurs poiflons l’ef-
prit de vin n’eft pas parvenu à la rendre opaque.
Elle le devient cependant dans les maladies ; nous
l’avons vu opaque dans l’homme 8c dans le chat.
Ce qui eft bien fingulier dans cette capfule^ c’eft
qu’elle ne paroît point être attachée au crifiallin. D ès
qu’on ouvre la capfule, le crifiallin en fort dans le
moment, 8c. dans l’homme vivant 8c dans le cadavre.
On trouve entre le crifiallin 8c la capfule un peu
d’eau , plus apparente dans quelques animaux.
La maniéré dont le crifiallin fe nourriroit, fi cette
eau coupoit toute communication de la capfule au
crifiallin même , feroit fi éloignée de l’analogie du
refte du corps humain, que nous foupçonnons cette
eau de n’être pas répandue par-tout ; elle n’exclut
apparemment pas des vaiffeaux nourriciers, que cette
même analogie nous oblige de fuppofer.
Les vaiffeaux de la capfule ne font pas parfaitement
connus. L’artere poftérieure vient de la cen-f
traie de la retine : dans les quadrupèdes 8c dans
l’homme, elle perce avec fon tronc le corps v itré ,
fans lui donner des branches vifibles ; elle entre par
un ou deux troncs dans la convexité poftérieure de
la capfule, 8c fe divife fur toute fa furface. Dans les
oifeaux il part de l ’éventail un filet attaché au crifiaU-
lin9 qu’accompagne une artere. Dans les poiflons,
la chofe eft plus diftinéte ; l’artere centrale y donne
une première branche à la convexité poftérieure du
vitré, dont les refeaux font de la plus grande beau*
té : une autre branche fait le tour de l’ceü entre la
retine 8c la ruyfchienne, 8c entre dans le crifiallin
accompagnée d’une apophyfe de cette ruyfchienne.
Cette derniere branche donne des arteres qui font
lin très-beau cercle autour.de la face antérieure du
vitré.
Les arteres antérieures du crifiallin ne font pas
bien connues encore, auflï peu que les veines.
La membrane du crifiallin eÇc affermie de piûfieuïs
hianieres. La membrane vitrée arrivée-au terme antérieure
d e la retine fe divife en; deux lames. L’antérieure
eft fillonnée, elle porte l’empreinte de la
couronne ciliaire ; arrivée à la face antérieure du
crifiallin , un peu en dedans de fon. plus grand' cercle
, elle s’attache à la capfule du< crifiallin-, 8c ne
peut pas en être féparée. Il eft difficile de- dire , fi*
elle finit au cercle, par lequel elle s'attache-à là-cap-
fule, ou fi elle fe prolonge pour la couvrir : ce qui
eft plus, fur, c’eft qu’on ne peut pas la détacher.
La lame poftérieure fe rend à là capfule plus en
arriéré que la- première , 8c renferme la convexité
poftérieure. Nous avons remarqué qu’on peut la
détacher.
Entre ces deux lames de la vitrée, il refte un
vuid e, une efpece de canal circulaire , qui. environne
l’épaiffeur du crifiallin : quand on le gonfle il
paroît godronné ou refferré d’efpace en efpace par
de petites brides. Nous l’avons trouvé dans plufieurs
quadrupèdes ; mais les oifeaux 8c les poiflons n’ont
rien de femblable.
La fécondé attache du crifiallin,. c’eft la retine.
Dans les oifeaux il eft aifé de voir que la retine fe
termine fous cette couronne par un rebord exactement
terminé. De ce rebord il part une membrane
plus fine, 8c d’une couleur d ifférentequi va s’attacher
à la capfule du crifiallin.
Dans l’homme la chofe eft moins vifible. Nous
croyons cependant être affurés , qu’entre la lame
antérieure du vitré 8c la couronne ciliaire, la retine
v a s’attacher au crifiallin. Nous en avons vu despôr-
tions attachées à cette couronne.
D ’autres auteurs font allés plus loin. Ils afîurent
que la retine donne une enveloppe extérieure à la
capfule du crifiallin. La nature élaftique de cette capfule
ne nous permet pas d’admettre ce fait : l’efprit-
de-vin a de la peine à la rendre opaque, 8c il ote à
la retine fa tranfparence dans un moment.
Une autre enveloppe qu’on donne à la retine ,
c’eft cette lame interne que la cornée doit recevoir
de l’anneau cellulaire de la choroïde. Mais bien
fouvent la couronne ciliaire, qui s’attache au crif-
tallin, n’eft pas recouverte d’une membrane, 8c fes
filets font à découvert.
Un autre appui du crifiallin, c’eft cette couronne
même , dont les doubles filets font attachés à la fur-
face antérieure du crifiallin par la mucofité noire,
dont cette couronne eft abbreuvée. Nous avons
parlé de cette adhéfion 8c des appuis que le crif-
tallin a dans les poiflons qui font deftitués de cette
couronne.
La fubftance même du crifiallin eft commé celle
d’une gomme amollie. On y découvre affez aifément
des lames unies par une cellulofité très-fine ;
8c dans ces lames, des fibres dont l’arrangement eft
très-régulier dans plufieurs poiflons. Les lames les
plus extérieures font plus molles, elles font gélati-
neufes dans les poiflons : le centre eft plus dur, 8c
on lui a donné le nom de noyau. Dans un crifiallin
macéré dans l’eforit-de-vin, on peut élever ces larmes
comme le feuillet d’un livre. Pour les filets,
nous les avons vu dans le lievre 8c dans le lapin,
partir de deux centres, l’un antérieur, 8c l’autre
poftérieur. ( H. D. G. )
* § CROATIE , ( Géogr. ) . . . . le gouverneur fe
nomme Ban de Croatie. Ce n’eft pas le gouverneur
qui fe nomme Ban, mais le gouvernement. Lettres
fur l'Encyclopédie.
CROCHES liées , ( Mufiq. ) on appelle ainfi les
croches qui font effectivement liées enlemble par la
queue , ou bien celles qui font couvertes d’une liaison.
Remarquez que pour la promptitude & la facilité
de l’exécution , on fera très-bien, en copiant les
parties,, de lier toujours deux ou quatre croches en-
femble. ( F. D . C. )
’ Croche pointée , croche fuivie d’un point, en-
forte qu’elle vaut une croche 8c une double croche.
( F. D . C. )
Croches separees, celles qui ne tiennent point
enfemble par la queue ; on obfervera dans les parties
de chant de féparer toutes les croches qui appartiennent
à des fyllabes différentes, 8c de ne lier que
celles qui doivent être paffées fous une même fyl-
labe. ( F. D. G. )
C RO CH E T , ( Mufiq. ) figne d’abréviation dans
la note ,. c’eft un petit trait en travers, fur la queue
d’une blanche ou d’une noire , pour marquer la divi-
fion en croches, gagner de la place 8c prévenir la
çonfufion. Le crochu défigne par conféquent quatre
croches au lieu d’une blanche, ou deux au lieu
d’une noire , comme on voit planche I‘X de Mufiq.
Suppl, fig. 6 , n°. 1 , oit les trois portées accollèes
lignifient exa&ement la même chofe. La ronde n’ayant
point de queue , ne peut porter de crochet ; mais oh
en peut cependant faire auflï huit croches par abréviation
, en la divifant en deux blanches, ou quatre
noires, auxquelles on ajoute des crochets. Le copifte
doit foigneufement diftinguer la figure du crochet,
qui n’eft qu’une abréviation de celle de là croche ,
qui marque une valeur réelle. ( S )
§ CRQISETTE , ( terme de Blafon. ) Voyeç dans
le DiB.\raif. des Sciences, &c. la fig-, tSS, planche IIP,
8c la fig. /<?9 , planche I F de Part Héraldique.
§ CROISSANT , f. m. ( terme de Blafon. j meuble
qui paroît dans l’écu montant, c’eft-à-dire, les
pointes en haut.
Croijfant verfé, celui qui dans une pofition eôntrai-
ré a fes pointes vers le bas de l’écu.
Croijfant tourné, celui dont les pointes font à dextre
de .■ l’écu.
Croijfant contourne, celui dont les pointes font à
feneftre.
Croijfans affrontés , ceux dont les pointes font
proches.
Croijfans adoffés-, ceux qui font dans une pofition
oppofée.
Kerverfic, diocefe de Nantes, d'azur au croijfans
d'argent.
Cadole de Tafques , à Lunel, diocefe de Montpellier
; de gueules au croijfant verfé chargent. ( G. D .
L. T . )
§ Croissant ( l’ordre du ) , inftitué par René
d’Anjou, roi de Jérufalem} de Sicile 8c d’Aragon,
à Angers , l’an 1448, fous l’invocation de faint
Maurice.
Pour y être admis, il falloit être d’une ancienne
noblefle.
Les chevaliers s’engageoient par ferment à plufieurs
pratiques de piété : tous lés ans , le jour de la
fête de faint Maurice, ils élifoient un chef auquel ils
donnoient le nom defénateur, ils dévoient lui obéir
dans tout ce qui concernoit le bien de l’ordre.
Les jours de cérémonies, ils portoient de longs
manteaux à queue traînante ; celui du grand-maître
étoit de velours cramoifi, fourré d’hermine ; ceux
des chevaliers étoient aufli de velours cramoifi, mais
fourrés de petit-gris ; fous ces manteaux ils avoient
de$ robes de damas gris , fourrées de même : fur la
tête des chaperons, couverts 8c doublés de velours
noir, avec cette différence que ceux des chevaliers
avoient un bord d’o r , 8c ceux des écuyers un bord
d’argent.
Ils portoient tous au côté droit un croiffant d’otf
émaillé , fur lequel étoit écrit en lettres bleues, ces
mots ,los en croiffant, qui lignifient qu’eh avançant
en vertu, on mérite des louanges.