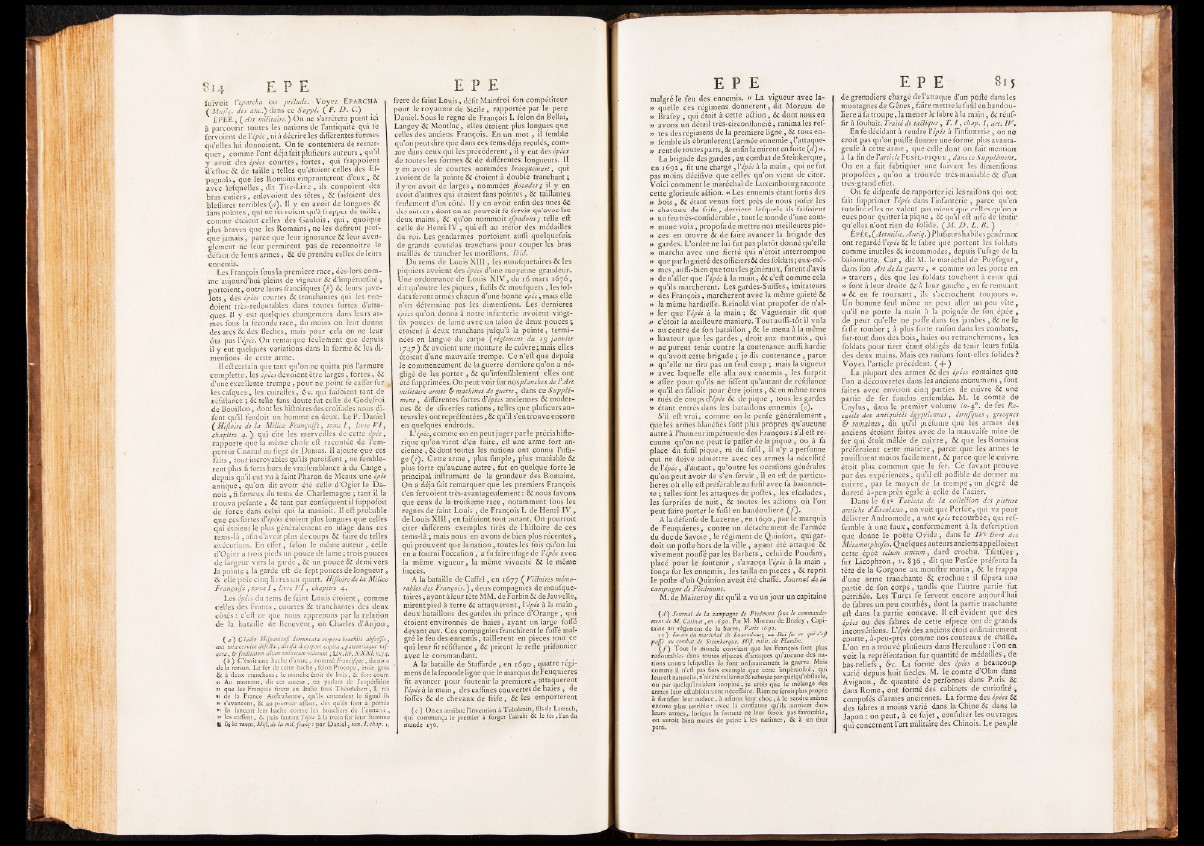
lui voit Yeparcha ou prélude. Voyez EPARCÜA
/ Mujîq. des anc.) dans ce Suppl. ( F. D . C.)
ÉPÉE, {Art militaire.) On ne sVrrêtera point ici
à parcourir toutes les nations de l’antiquité qui le
fervoient de Yépée, ni à décrire les différentes-formes
qu’elles lui donnoient. On le contentera de remarquer
, comme l’ont déjà fait plusieurs auteurs, qu’il
y avoit des épées courtes, fortes, qui frappoient
id’eftoc S t de taille ; telles qu’étoient celles des Ef-
pagnols, que les Romains empruntèrent d’eux , &
avec lefquelles, dit Tite-Live , ils coupoient des
bras-entiers, enlevoient des têtes » S t faifoient des
bleffures terribles (<*). Il y en avoit de longues S t
fans pointes, qui ne fervoient qu’à frapper de taille,
comme étoient celles des Gaulois, q u i, quoique
plus braves que les Romains, ne les défirent pref-
que jamais-, parce que leur ignorance S t leur aveuglement
ne leur permirent pas de reconnoître le
•défaut de leurs armes, S i de prendre celles de leurs
ennemis.
Les François fous la première race, dès-lors côm-
'ïne aujourd’hui pleins de vigueur & d’impétuofite ,
portoient, outre leurs franciiques {b j S t leurs javelots
, des épées courtes S t tranchantes qui les renvoient
très-redoutables dans toutes fortes d’attaques.
II y eut quelques changemens dans leurs armes
fous la fécondé race, du moins ôn leur donna
des arcs S& des fléchés, mais pour cela on ne leur
ôta pas l’épée. On remarque feulement que depuis
il y eut quelques variations dans la forme S t les di-
menfions de cette arme.
Il eft certain que tant qu’on ne quitta pas l’armure
complette, les épées dévoient être larges, fortes, S i
d’une excellente trempe, pour ne point fe cafferfur^|j
les calques , les cuiraffes, &c. qui faifoient tant de
réfiftance ; St telle fans doute fut celle de Godefroi
de Bouillon, dont les hiftoires des croifades nous di-
fent qu’il fendoit un homme en deux. Le P. Daniel
{Hijloire de la Milice Françoife, tome 1 , livre V I ,
chapitre 4. ) qui cite les merveilles de cette épée,
rapporte que la même chofe eft racontée de l’empereur
Conrad au fiege de Damas. Il ajoute que ces
•faits , tout incroyables qu’ils paroiffent, ne femble-
rent plus fi forts hors de vraifemblance à du Cange ,
depuis qu’il eut vu à faint Pharon de Meaux une épée
antique, qu’on dit avoir été celle d’Ogier le Danois
, fi fameux du tems de Charlemagne ; tant il la
trouva pelante , S t tant par conféquent il fuppofoit
de force dans celui qui la manioit. Il eft probable
que ces fortes d'épées étoient plus longues que celles
qui étoient le plus généralement en ufage dans ces
tems-ïà , afin d’avoir plus de coups S t faire de telles
exécutions. En effet, félon le même auteur, celle
d’Ogier a trois pieds un pouce de lame ; trois pouces
de largeur vers la garde , & un pouce S t demi vers
Ja pointe ; la garde eft de fept pouces de longueur,
& elle pele cinq livres un quart. Hijloire de la Milice
Françoife , tome I , livre V I , chapitre 4.
Les épées du tems de faint Louis étoient, comme
celles des Francs, courtes S t tranchantes des deux
côtés : c’eft ce que nous apprenons par la relation
de la bataille de Benevent, où Charles d’Anjou,
( a ) Gladio Hïfpahienji detruncala corpora brachiis abfcijfis,
■ àut tôt a cervice defefla , divifa à corpore c api ta , patiéntiaque vif-
cera, & fceditatem allant vulnerum videront ; Liv. lib. XXXI. n.34.
( i ) C ’étoitune hache d’armé, nommé Francïfque, du nom
de la nation. L e fer de cette hache , félon P rocope, étoit gros
& à deux tranchans ; le manche étoit de bo is , & fort court.
Au moment, dit cet auteur, en parlant de l’expédition
o) que les François firent en Italie fous Théodebert, I. roi
*> de la France Auftrafienne, qu’ils entendent le lignai ils
»> s’avancent, & au premier afiaut, dès qu’ils font à portée
®> ils lancent leur hache contre les boucliers de l’ennerni,
5» les caftent, & puis fautant Y épée à la main fur leur homme
t i ils le tuent, Hijl. de la mil. franc : par Daniel, tom. I. chap. /.
frere de faint Louis, défit Mainfroi fon compétiteur
pour le royaume de Sicile, rapportée par le pere
Daniel. Sous le règne de François I. félon du Bellai,
Langey St Montlue, elles étoient plus longues que
celles des anciens François. En un mot , il femble
qu’on peut dire que dans ces tems déjà reculés, comme
dans ceux qui les précédèrent, il y eut des épées
de toutes les formes St de différentes longueurs. Il
y en avoit de courtes nommées bracquemart, qui
avoient de la pointe St étoient à double tranchant ;
il y-en avoit de larges, nommées Jlocades; il y en
avoit d’autres qui étoient fans pointes, St taillantes
feulement d’un côté. Il y en avoit enfin des unes Si
des autres, dont on ne pouvoit fe fervir qu’avec les
deux mains, St qu’on nommoitefpadons; telle eft
celle de Henri IV , qui eft au tréfor des médailles
du roi. Les gendarmes portoient aufli quelquefois
de grands coutelas tranchans pour couper les bras
maillés St trancher les morillons. Ibid.
Du tems de Louis X I I I , les moufquetaires & les
piquiers avoient des épées d’une moyenne grandeur*
Une ordonnance de Louis X IV , du 16 mars 1676,
dit qu’outre les piques, fufils St moufquets, lesfol-
dats feront armés chacun d’une bonne épée, mais elle
n’en détermine pas les dimenfions. Les dernieres
épées qu’on donna à notre infanterie avoient vingt-
fix pouces de lame avec un talon de deux pouces ;
étoient à deux tranchans jufqu’à la pointe, terminées
en langue de carpe {réglement du ig janvier
St avoient une monture de cuivre;mais elles
étoient d’une mauvaife trempe. Ce n’eft que depuis
le commencement de la guerre derniere qu’on a négligé
de les porter , St qu’infenfiblement elles ont
été fupprimées. On peut voir fur no splanches de F Art
militaire armes & machines de guerre, dans ce Suppléa
ment, différentes fortes d’épées anciennes St modernes
St de diverfes nations, telles que plufieurs auteurs
les ont repréfentées, St qu’il s’en trouve encore
en quelques endroits.
U épée, comme on en peut juger parle précishifto-
rique qu’on vient d’en faire, eft une arme fort ancienne
, & dont toutes les nations ont connu l’ufa-
ge (c). Cette arme, plus fimple, plus maniable Si
plus forte qu’aucune autre, fut en quelque forte le
principal infiniment de la grandeur des Romains.
On a déjà fait remarquer que les premiers François
s’en fervoient très-avantageufement : & nous favons
que ceux de la troifieme race, notamment fous les
régnés de faint Louis , de François I. de Henri IV ,
de Louis X III, en faifoient tout autant. On pourroit
citer différens exemples tirés de l’hiftoire de ces
tems-là ; mais nous en avons de bien plus récentes ,
qui prouvent que la nation, toutes les fois qu’on lui
en a fourni l’occafion, a fu faire ufage de Y épée avec
la même vigueur, la même vivacité Si le même
fuccès.
A la bataille de C affel, en 1677 ( Victoires mémorables
des François, j , deux compagnies de moufquetaires,
ayant à leur tête MM. deForbin&deJauvelle,
mirent pied à terre St attaquèrent, Y épée à la main ,
deux bataillons des gardes du prince d’Orange , qui
étoient environnés de haies, ayant un large foffe
devant eux. Ces compagnies franchirent le foffé malgré
le feu des ^ennemis, taillèrent en pièces, tout ce
qui leur fit réfiftance, St prirent le refte prifonnier
avec le commandant.
A la bataille de Staffarde , en 1690, quatre régi-
mens delà fécondé ligne que le marquis de Feuquieres
fit avancer pour foutemr la première, attaquèrent
Yépée à la main, des cafîines couvertes de haies , de
foffés St de chevaux de frife, St les emportèrent
( c ) On en attribue l’invention à Tubalcairt,fils de Lantech,
qui commença le premier à forger l’airain & le fer, l’an çlu
monde 130.
malgré le feu des ennemis. « La vigueur avec la-
» quelle ces régimens donnèrent, dit Moreau de
» Brafey, qui étoit à cette aélion, S t dont nous en
» avons un détail très-circonftancié, ranima les ref-
» tes des régimens de la première ligne, S i tous en-
» femble ils ébranlèrent l’armée ennemie, l’attaque-
» rentde toutes parts, & enfin la mirent en fuite {d) ».
La brigade des gardes, au combat deSteinkerque,
en 1692, fit une charge, Y épée à la main, qui ne fut
pas moins décifive que celles qu’on vient de citer.
Voici comment le maréchal de Luxembourg raconte
cette glorieufe a&ion. « Les ennemis étant fortis des
» bois , S t étant venus fort près de nous pofer les
» chevaux de frife, derrière lefquels ils faifoient
» un feu très-confidérable, tout le monde d’une com-
» mune v oix, propofade mettre nos meilleurespie-
» ces en oeuvre & de faire avancer la brigade des
» gardes. L’ordre ne lui fut pas plutôt donné qu’elle
» marcha avec une fierté qui n’étoit interrompue
» que par la gaieté des officiers S t des foldats; eux-mê-
» mes, aufli-bien que tous les généraux, furent d’avis
» de n’aller que Y épée à la main, S t c’eft comme cela
» qu’ils marchèrent. Les gardes-Suiffes, imitateurs
» des François, marchèrent avec la même gaieté S i
» la même hardieffe. Reinold vint propofer de n’al-
» 1er que Y épée à la main ; & Vaguenair dit que
» c’étoit la meilleure maniéré. T out aufli-tôt il vola
» au centre de fon bataillon , & le mena à la même
» hauteur que les gardes, droit aux ennemis, qui
» ne purent tenir contre la contenance aufli hardie
» qu’avoit cette brigade ; je dis contenance , parce
» qu’elle ne tira pas un feul coup ; mais la vigueur
» avec laquelle elle alla aux ennemis , les furprit
>* affez pour qu’ils ne fiffent qu’autant de réfiftance
» qu’il en falloit pour être joints , & en même tems
» tués de coups d'épée S t de pique , tous les gardes
» étant entrés dans les bataillons ennemis (e).
S’il eft vrai, comme on le penfe généralement,
que les armes blanches font plus propres qu’aucune
autre à l’humeur impétueufe des François : s’il eft reconnu
qu’on ne peut fe pafler delà pique , ou à fa
place du fufil pique, ni du fufil, il n’y a perfonne
qui ne doive admettre avec ces armes la nécefîité
de Y épée, doutant, qu’outre les occafions générales
qu’on peut avoir de s’en fervir, il en eft de particulières
où elle eft préférable au fufil avec fa baïonnette
; telles font les attaques de poftes, les efcalades,
les furprifes de nuit, S t toutes les aêtiôns où l’on
peut faire porter le fufil en bandoulière (ƒ ) . .
A la défenfe de Luzerne , en 1690, par le marquis
de Feuquieres, contre un détachement de-l’armee
du duc de Savoie, le régiment de Quinfon, quigar-
doit un pofte hors de la ville , ayant été attaqué S t
vivement pouffé parles Barbets, celui de Poudins,
placé pour le foutenir, s’avança Yépée à la main y
fonça fur les ennemis, les tailla en pièces , S i reprit
le pofte d’où Quinfon avoit été chaffé. Journal de là
campagne de Piedmont.
M. de Maizeroy dit qu’il a vu un jour un capitaine
( d~) Journal de la campagne de Piedmont fous le commandement
de M. Caùnat, en 1690. Par M . Moreau de B ra fe y , Capitaine
au régiment de la Sarre, Paris 1692.
( e ) Lettre du maréchal de Luxembourg au Roi fur ce qui s’efi
pajfé au combat de Steenkerque. Hijl. milit. de Flandre.
( ƒ ) Tout le monde convient que les François font plus
redoutables dans toutes e(p.eçes: d’Pftaques qu’aucune des nations
contre lefquelles ils font ordinairement la guerre. Mais
comme il n’eft pas fans exemple que cette impétuofité.qui
leur eft naturelle, n’ait été rallentie & rebutée par quelqu’obftacle,
ou par quelqu’incident inopiné, je crois que le mélange des
armes leur ellabfolument néceffaire. Rien neferoitpluspropre
à fortifier leur.audace, à aflurer leur ch o c , à le rendre même
encore plus terrible : avec là confiance qu’ils auroient dans
leurs armes, lorfque la fortune ne leur fero it1 pas favorable,
on auroit bien moins de peine à les ranimer, & à en tirer
parti.
de grenadiers chargé de l’attaque d’un pofte dans les
montagnes de Gênes, faire mettre le fufil en bandoulière
à fa troupe, la mener le fabre à la main, St réuf*
fir à fouhait. Traité de tactique , T. I , chap. /, art. IV•
En fe décidant à rendre Y épée à l’infanterie , on ne
croit pas qu’on puiffe donner une forme plus avanta-
geufe à cette arme, que celle dont on fait mention
à la fin de Y article Fusil-pique , dans ce Supplément.
On eh a fait fabriquer une fuivant les dimenfions
propofées, qufon a trouvée très-maniable St d’un
très-grand effet.
On fe difpenfe de rapporter ici lesraifons qui ont
fait fupprimer Yépée dans l’infantèrie , parce qu’en
totalité elles ne valent pas mieux que celles qu’on a
eues pour quitter la pique , St qu’il eft aifé de fentir.
quelles n’ont rien de folide. ( M. D . L. R. ^
ÉPÉE, {Artmilit. Antiq. ) Plufieurs habiles généraux
ont regardé Y épée St le fabre que portent les foldats
comme inutiles St incommodes, depuis l’ufage de la
baïonnette. C a r , dit M. le maréchal de Puyfegur ,
dans fon Art de la guerre , « comme on les porte en
» travers, dès que les-foldats touchent à ceux qui
» font à leur droite St à leur gauche, en fe remuant
» St en fe tournant, ils s’aiccrochent toujours ».
Un homme feul même ne peut aller un peu vite ,
qu’il ne porte la main à la poignée de fon épée ,
de peur qu’elle ne paffe dans fes jambes , & ne le
faffe tomber ; à plus forte raifon dans les combats,
fur-tout dans des bois, haies ou retranchemens, les
foldats pour tirer étant obligés de tenir leurs fufils
des deux mains. Mais ces raifons font-elles folides
Voyez l ’article précédent. ( + )
La plupart des armes St des épées romaines que
l’on a découvertes dans les anciens monumens , font
faites avec environ cinq parties de cuivre St une
partie de fer fondus enfemble. M. le comte de
Caylus, dans le premier volume in-af. de fes Recueils
des antiquités égyptiennes , étrufques , grecques
& romaines, dit qu’il préfume que les armes des
anciens étoient faites avec de la mauvaife mine de
fer qui étoit mêlée de cuivre, St que les Romains
préféroient cette matière, parce que les armes fe
rouilloient moins facilement, St parce que le cuivre
étoit plus commun que le fer. Ce favant prouve
par des expériences, qu’il eft poflïble de donner au
cuivre, par le moyen de la trempe, un ,^égré de
dureté à-peu-près égale à celle de l’acier.
Dans le 61e Tableau de la collection des pitture
antiche dYErcolano, on voit que Perfée, qui va pour
délivrer Andromède, a une épée recourbée; qui ref-
femble à une fau x, conformément à la defeription
que donne le poëte Ovid e, dans le IVe Livre des
Métamorphofes. Quelques auteurs anciens appelloient
cette épée telum . unciim, dard crochu. Tfetfées ,
fur Licophron, v. 836 , dit que Perfée préfenta la
tête de la Gorgone au monftre marin, & le frappa
d’une arme tranchante & crochue : il fépàra une
partie de fon corps, tandis que l’autre partie fut
pétrifiée. Les Turcs fe fervent encore aujourd’hui
de fabres un peu courbés, dont la partie trâpchante
eft dans la partie concave. Il eft évident que des
épées ou des fabres de cette efpeçe ont de grands
inconvénïèns. Uépée des anciens étoit ordinairement
courte, à-peu-près comme nos couteaux de chaffe.
L’on en a trouvé plufieiirs dans Herculàne : l’on en
voit la repréfentation fur quantité de médailles, de
bas-reliefs, &c. La forme des épées a beaucoup
varié depuis huit fiecles. M. le comte d’Olan dans
Avignon, St quantité de perfonnes dans Paris Si
dans Rome, ont formé dès cabinets de curiofité ,
compofés d’armes anciennes. La forme des épées Si
des fabres a moins varié dans la Chine S i . dans le
Japon : on peut, à ce fujet, confulter les ouvrages
qui concernent l’art militaire des Chinois. Le peuple