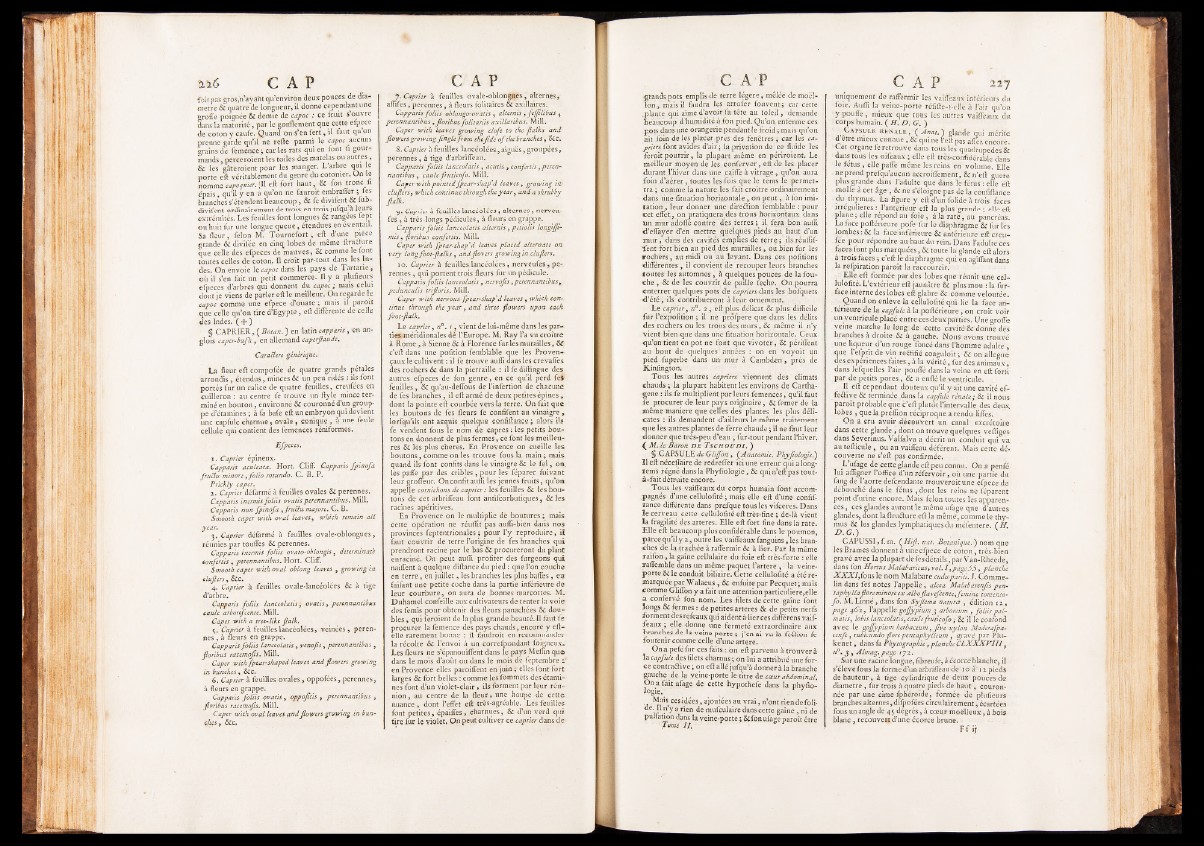
îôit pa's gros,n’aÿafit qu’envirôn deux pouces de dra- j
metre & quatre de longueur,il donne cependant une J
groffe poignée & demie de capoc : ce fruit s’ouvre |
dans la maturité, par le gonflement que cette efpece
de coton y caufe. Quand on s’en fert, il faut qu on
prenne gardé qu’il ne refte parmi le capoc aucuns
grains de femenCe; caries rats qui en font fi gourmands
, perceroient les toiles des matelas ou autres,
& les gâteroient pour les manger. L arbre qui le
porte eft véritablement du genre du cotomer. On le
nomme capoquier. [Il eft fort haut, & fon tronc fi
épais, qu’il y en a qu’on ne fauroit embrafler ; les
branches s’étendent beaucoup, & fe divifent & fub-
divifent ordinairement de trois en trois jufqu’à leurs,
extrémités. Les feuilles font longues & rangées fept
ou huit fur une longue queue, étendues en éventail.
Sa fleur, felon M. Tournefort, eft^d’une piece
grande & divifée en cinq lobes de même ftrufture
que celle des efpeces de mauves, & comme le font
toutes celles de coton. Il cr'oît par-tout dans les Indes.
On envoie le capoc dans les pays de Tartarie,
où il s’en fait un petit commerce. Il y a plufieurs
efpeces d’arbres qui donnent du capoc ; mais celui
dont je viens de parler eft le meilleur. On regarde le
capoc comme une efpece d’ouate ; mais il parort
que celle qu’on tire d’Egypte, eft différente de celle
des Indes. ( + )
§ CAPRIER, ( Botan. ) en latin capparis, en an-
glois caper-bufh , en allemand caperjiaude.
Caractère générique.
La fleur eft compofée de quatre grands pétales
arrondis , étendus, minces & un peu ridés : ils font
portés fur un calice de quatre feuilles, creufées en
cuilleron : au centre fe trouve un ftyle mince terminé
en bouton, environné & couronné d’un group-
pe d’étamines ; à fa bafe eft un embryon qui devient
une capfule charnue, ovale , conique , à une feule
cellule qui contient des femences réniformes.
Efpeces.
1. Câprier épineux.
Capparis aculeata. Hort. Cliff. Capparis fpinofa
fruciu minore y folio rotundo. C. B. P.
Prickly caper.
2. Câprier défarmé à feuilles ovales & perennes.
Capparis inermis foliis ovatis perennantibus. Mill.
Capparis non fpinof a , fruciu. majore. C. B.
Smooth caper with oval leaves, which remain all
year. < '
3. Câprier défarmé à feuilles ovale-oblongues,
réunies par touffes & perennes.
Capparis inermis foliis ovato-oblongis, determinate
confertis, perennantibus. Hort. Cliff.
Smooth caper with oval oblong leaves , growing in
clujiers, &c.
4. Câprier à feuilles ovale-lancéolées & à tige
d’arbre.
Capparis foliis lanceolatis j ovatis, perennantibus
caule arborefcente. Mill.
Caper with a tree-like jlalk.
5. Câprier à feuilles lancéolées, veinées, perennes
, à fleurs en grappe.
Capparis foliis lanceolatis, venofis, perennantibus,
floribus racemofis. Mill.
Caper with fpear-shaped leaves and flowers growing
in bunches, &c.
6. Câprier à feuilles ovales, oppofées, perennes.,
à fleurs en grappe.
Capparis foliis ovatis, oppofltis , perennantibus ,
floribus racemofis. Mill.
; Caper with oval leaves andflowers growing in bun-
çhes f ÔCC,
Câprier à feuilles ovale-oblongues, alternes*
affifes, perennes, à fleurs folitaires & axillaires.
Capparis foliis oblongo-ovatis, alternes , feffilibus ,
perennantibus, floribus folitards axillaribus. Mill,
Caper with leaves growing clofe to the flalks and
flowers growing fingle from the fide o f the branches, &c.
8- Câprier à feuilles lancéolées, aiguës, groupées,
perennes , à tige d’arbriffeau.
Cappafis foliis lanceolatis , aciuis , confertis, peren-
nantibus, caule frùticofo. Mill.
Caper with pointed fpear-shap'd leaves, growing in>
clufiers, which continue thtough the y car, and a shrubby
fialk.
9. Câprier à feuilles lancéolées, alternes, nerveu-
fe.s , à très-longs pédicules, à fleurs en grappe.
Capparis foliis lanceolatis altérais, petiolis longiffi-
mis, floribus confertis'. Mill.
Caper with fpear-shap'd leaves placed alternate on
very lohgfoot-flalks , andflovers growing in cluflers.
10. Câprier à feuilles lancéolées, nerveufes, perennes
, qui portent trois fleurs fur un pédicule.
Capparis foliis lanceolatis, nervojis, perennantibus%
pedunculis trifloris. Mill.
Caper with nervous fpear-shap’d leaves , which continue
through the year, and three flowers upon each
foot-flalk.
Le câprier, n°. 1 , vient de lui-même dans les parti
es ^méridionales dè l’Europe. M. Ray l’a vu croître
à Rome , à Sienne & à Florence furies murailles,
c’eft dans une pofition femblable que les Provençaux
le cultivent : il fe trouve aufli dans les crevafies
des rochers & dans la pierraille : il fe diftingue des
autres efpeces de fon genre, en ce qu’il perd fe9
feuilles, & qu’au-deffous de l’infertion de chacune
de fes branches, il eft armé de deux petites épines ,
dont la pointe eft courbée vers la-terre. On fait que
les boutons de fes fleurs fe confifent au vinaigre ,
lorfqu’ils ont acquis quelque confiftance ; alors ils
fe vendent fous le nom de câpres : les petits boutons
en donnent de plus fermes, ce font les meilleures
& les plus cheres. En Provence on cueille les
boutons, comme on les trouve fous la main; mais
quand ils font confits dans le vinaigre & le fe l, on.
les pafl’e par des cribles , pour les féparer fuivant
leur groffeur. On confit aufli les jeunes fruits, qu’on
appelle cornichons de câprier : les feuilles & les boutons
de cet arbriffeau font antifeorbutiques, & les
racines âpéritives.
En Provence on le multiplie dé boutures ; maïs
cette opération ne réuflit pas aufli-bien dans nos
provinces feptentrionaies ; pour l’y reproduire, iî
faut couvrir de terre l’origine de fes branches qui
prendront racine par le bas & procureront du plant
. enraciné. On peut aufli profiter des furgeons qui
naiffent à quelque diftance du pied : que l’on couche
en terre, en juillet, les branches les plus baffes, eu
faifant une petite coche dans la partie inférieure de
leur courbure, on aura de bonnes marcottes. M.
Duhamel confeille aux cultivateurs de tenter la voie
des femis pour obtenir des fleurs panachées &c doubles,
qui feroient de la plus grande beauté. Il faut le
procurer la femence des pays chauds, encore y eft-
elle rarement bonne : il faudroit en recommander
la récolte & l’envoi à un correfpondant foigneux.
Les fleurs ne s’épanouiffent dans le pays Meflïn qu©
dans le mois d’août ou dans le mois de feptembre C
en Provence elles paroiffent en juin ; elles font fort
larges & fort belles : comme les fommets des étamines
font d’un violet-clair, ils forment par leur réunion,
au centre de la fleur, une houpe de cette,
nuance, dont l’effet eft très-agréable. Les feuilles
font petites, épaiffes, charnues, & d’un verd qui
tire fur le violet. On peut cultiver ce câprier dans de
grands pots emplis de terre légère, mêlée de moello
n , mais il faudra les arrofer fou vent; car cette
.plante qui aime d’avojrfa tête au foleil, demande
beaucoup d’humidité àfon pied. Qu’on enferme ces
pots dans une orangerie pendant le froid ; mais qu’on
ait foin de les placer près des fenêtres ; car les câpriers
font avides d’aii: ; la privation de ce fluide les
feroit pourrir, la plupart, même en périroient. Le
meilleur moyen de les.çpnferver, eft.de les placer
durant l’hiver dans une .câiffe à v itrage, qu’on aura
foin d’aérer, toutes les -fois que le tems le permettra
; comme la nature, les fait croître ordinairement
dans,'une fituation horizontale, on peut., à fon imitation,
leur donner une direction femblable : pour
cet effet, on pratiquera des trous horizontaux dans
un mur àdoffé contre des, terres ; il. fera J>on aufli
d ’eflayer d’én mettre, quelques pieds 311. haut d’un
mu r, dans des cavités emplies de terre; Us réuflif-
Tent fort bien au pied d.es murailles', ou bien fur les
rochers, au midi ou au levant. Dans ces ppfitions
différentes , il convient dé recouper leurs branches
toutes les automnes, à quelques pouces de la fou-
che , & de les couvrir de paille feche. On pourra
enterrer quelques pots de câpriers daris les bofquets
d ’ëté'i'ils; contribueront à.leur ornement, j
Le câprier ,72°. 2 , èft plus délicat & plus difficile
fur l’éxpofition ; il né prôfpere que dans les délits
des rochers ou ïes trous des murs, & même il n’y
vient bien que dans ùhè fituation horizontale. Ceux
qu’on tient en pot ne font que vivoter, & périffent
.au bout de quelques ' annéès : on en. voyoit qn
pied fuperbe dans un- mur à Cambden, près de
Kiniington.
Tous les autres câpriers viennent des climats
chauds ; la plupart habitent les environs de Cartha-
gene : ilsde multiplient par leurs femences, qu’il faut
fe procurer de leur pays originaire, &femer de la
même maniéré que celles des plantes les plus délicates
: ils demandent d’ailleurs le même traitement
que lès-autres plantes de ferre chaude ; il ne faut leur
donner que très-peu d’eau , fur-tout pendant l’hiver.
( M. le Baron DE Ts c h o u d i . )
§ CAPSULE de Gliffon, (Anatomie. Phyfîologie.)
Il eft néceffaire de redreffer ici une erreur qui.along-
lems régné dans la Phyfîologie, & quin’eftpas tout-
à-fait détruite encore.
Tous.les vaiffeauxdu corps humain font accom-
.pagnés d’une cellulofité ; mais elle eft d’une confif-
tance différente dans prafque tous les vifeeres. Dans
le cerveau cette cellulofité eft très-fine ; de-là vient
la fragilité des artères. Elle eft fort fine dans la rate.
Elle eft beaucoup plus confidérable dans le poumon,
parce qu’il y a , outre les vaiffeaux fanguins, les branches
de la trachée à raftèrmir & à lier. Par la même
raifon, la gaîne cellulaire du foie eft très-forte : elle
raffemble dans un même paquet l’artere , la veine-
porte & le conduit biliaire. Cette cellulofité a été remarquée
par "Walaeus , & enfuitépar Pecquet; mais
comme Gliffon y a fait une attention particulière,elle
a conferve fon nom. Les filets de cette gaîne font
longs & fermes : de petites arteres & de petits nerfs
forment des refeaux qui aident à lier ces différens vaiffeaux
; elle donne une fermeté extraordinaire aux
branches de la veine-porte ; j’en ai vu la feétion fe
foutenir comme celle d’une artere.
Onapeféfur ces faits: on eft parvenu à trouver à
la capfule d.es filets charnus ; on lui a attribué une force
contraftive ; on eft allé jufqu’à donner à là branche
gauche de la veine-porte le titre de coeur abdominal.
On a fait ufage de cette hypothefe dans la phyfio-
logie. ' ^ . .
Mais cesidées, ajoutées au v ra i, n’ont rien de foliir
a rhm de mufculaire dans cette gaîne , ni de
pulfation dans la veine-porte ; & fon ufage paroît être
Tome IJ.
tmîquèmeht de raffermit les vaiffeatix intérieurs du
• foie. Aufli la veine-porte réfifte-t-eilë à l’air qu’on
y pouffe, mieux que tous les autres vaiffeaux du
corps humain. ( H. D. G. )
C àpsule ren ale, ( Anat. ) glande qui mérite
d etre mieux connue, & qui ne l’eft pas affez encore.
Cet organe fe retrouve dans tous les quadrupèdes &
dans tous les oifeaux ; elle eft très-COnfidérable dans
le fétus , elle paffe même les reins en volume. Elle
ne prend prefqu’aucnn accroiffement, & n ’eft guere
plus grande dans l ’adulre que dans le fétus : elle eft
molle à cet âge , & ne s’éloigne pas de la confiftance
du thymus. La-figure y eft d’un folide à trois faces
irrégulières : l’antérieur eft la plus grande; elle eft
plane;- elle répond au fo ie , à la rate, au pancréas.
La face pofterieure pofe fur fè diaphragme & fur lés
lombes : & la face inferieure & antérieure eft creu-
. fée pour répondre au haut du rein, DàrîsTadulte ces
faces font plus marquées, & toute la glande eft alors
à trois faces ; c’eft le diaphragme .qui én agiffant dans
la refpiration paroît la raccourcir.
Elle eft formée par des lobes que féunit Une cellulofité.
L’extérieur èft jaunâtre & plus mou : la fur-
face interne des lobes eft glabre & comme veloutée.
• Quand on enleve la cellulofité qui lie la face an-
. térieure de la capfule k\a poftérieure, on croit voir
unyentrjcule placé entre ces deux pâïties. Une groffe
veine marche le long-, de cette cavité & donne des
branches à droite & à gauche. Nous avons trouvé
une liqueur d’un rouge foncé dans l’homme adulte ,
que .I’ffprit de vin reâifié coaguloit ; & on allégué
des expériences.faites ,.à la vérité, fur desanimaux-,
dans lefquelles l’air pouffé dans la veine en eft ferti
par de petits pores., & a enflé le ventricule.
Il eft cependant douteux qu’il y ait une cavité ef-
feâive & terminée/lans la capfule rénale ; & il nous
paroît probable que c’eft plutôt l’intervalle des deux
, lobes i que la preflïon réciproque a rendu liffes.
On a cru avoir .découvert un canal excrétoire
dans cette glande, dont on trouve quelques veftiges
dans Severinus. Valfalva a décrit un conduit qui va
au tefticule, ou au vaiffeau déférent. Mais cette découverte
ne s’eft pas confirmée. ;
L’ufage de cette glande eft peu connu. On a penfé
lui aflîgner l’office d’un réfervoir, où une partie du
fang de l ’aorte defeendante trouveroitune efpece de
débouché dans le fétus ,dont les reins ne féparent
point d’urine encore. Mais félon toutes les apparences,
ces glandes auront le même ufage que d’autres
glandes, dont laftru&ure eft la mêmè, .comme le thymus
& les glandes lymphatiques du méfentere. (H .
D . G .)
CAPUSSI, f. m. (^Hifll. nat. Botanique.?) nom que
les Brames donnent à une efpece de coton, très-bien
gravé avec la plupart de fes détails, par Van-Rheede,
dans fon Hortus Malabaricus, vol. f page 5 6 , planche
X X X I fo u s le nom Malabare cudupariti. J. Comme-
lin dans fes notes l’appelle, alcea Malabarenjîs pen-
taphy lia flore minore ex alboflavefcente,femine tomento-
fo. M. Linné, dans fon Syflema naturoe , édition 12 ,
page 462, l’appelle goffypium 3 arboreum , foliis pair
matis, lobis lanceolatis, caule frùticofo ; & il le confond
avec le goffypium. herbaceum, Jive xylon Maderafpa-
tenfe, rubicundo florepentaphylleum , gravé par PIu-
kenet, dans fa Phytographie, planche C LX X X V I I I ,
n°. j , Almag. page. t jx .
Sur une racine longue, fibreufe, à écorce blanche, il
s’élève fous la forme d’un arbrifleaude 10 <1 12 pieds
de hauteur, à tige cylindrique de' deux pouces dè
diamètre , fur trois à quatre pieds de-h a u t c o u ro n née
par une cime fphéroïde, formée de plufieurs
branches alternes*difpofées circulairement j écartées
fous un angle de 4 5 dégrés, à coeur m oelleux, à bois
blanc, recouvert d’une écorce brune. -
F f ij