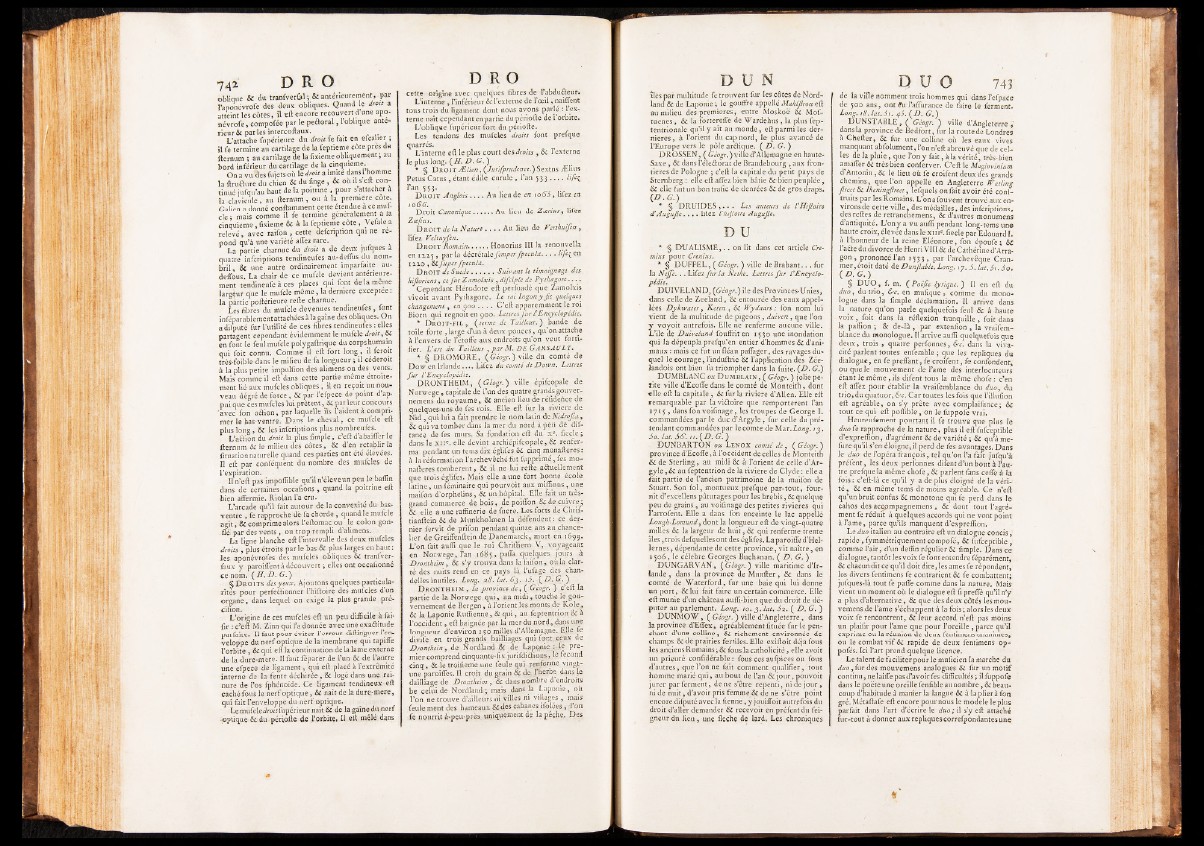
oblique & du tranfverfel ; 6c antérieurement, pur
l’aponévrofe des deux obliques. Quand le droit a
atteint les côtes, il «ft encore recouvert d’une aponévrose,
compofée par le p é ro ra i, l’oblique anterieur
& parles intercoftaux. , . . .
L’attache Supérieure du droit fe fait en elcalier ;
il Se termine au cartilage de la Septième côte près du
fternum ; au cartilage de la Sixième obliquement; au
bord inférieur du cartilage de la cinquième.
On a vu t e s Sujets où le droit a imite dans l homme
la ftruûure du chien 6c du finge , 6c oii il s eft continué
jufqu’au haut de la poitrine , pour s attacher à
la clavicule, au fternum, ou à la première cote.
Galien a donné conftamment cette étendue à ce muf-
cle ; mais comme il Se termine généralement à la
cinquième, Sixième & à la Septième cô te, Velale a
relevé, avec raifon , cette description qui ne répond
qu’à une variété affez rare. .
La partie charnue du droit a de deux jufques a
quatre infcriptions tendineufes au-deffus du nomb
r il, & une autre ordinairement imparfaite au-
deffous. La chair de ce mufcle devient antérieurement
tendineufe à ces places qui font de la meme
largèur que le mufcle même, la derniere exceptee.
la partie poftérieure refte charnue. '
Les fibres du mufcle devenues tendineufes, lont
inséparablement attachées à la gaine des obliques. On
a difputé fur l’utilité de ces fibres tendineufes : elles
partagent cependant évidemment le mufcle droite &
en font le Seul mufcle polygaftrique du corps humain
qui Soit connu. Comme il eft fort lon g , il feroit
très-foible dans le milieu de fa longueur ; il céderoit
à la plus petite impulfion des alimens ou des vents*
Mais comme il eft dans cette partie même étroitement
lié aux mufcles obliques , il en reçoit un notw
veau degré de force, & par l’efpece de point d’appui
que ces mufcles lui prêtent, 6c par leur concours
'avec fon aâ ion, par laquelle il‘s 1 aident à comprimer
le bas-ventre. Dans le cheval, ce mufcle eft
plus long, & les infcriptions plùs riombreufes.
L’aftion du droit la plus Simple , c’eft d’abaiffer le
fternum & le milieu des côtes, & d’en rétablir la
Situation naturelle quand ces parties ont été élevées.
Il eft par conféquent du nombre des mufcles de
l ’expiration.
Il n’eft pas impoflible qu’il n’éleveun peu le baflin
dans de certaines occafions , quand la poitrine eft
bien affermie. Riolan l’a cru. # t
L’arcade qu’il fait autour de la convexité du bas-
ventre , fe rapproche de fa chorde , quand le mufcle
agit, & comprime alors l’eftomacou le colon gon-
.flé! par des vents, ou trop rempli d’alimens.. :
La ligne blanche eft l’intervalle des deux mufcles
droits , plus étroits parle bas 6c plus largesen haut :
les aponévrofes des mufcles .obliques 6c tranfver-
faux y paroiffent à découvert ; elles ont occafioriné
ce nom. ( H .D .G . ) i
§ D roits des yeux. Ajoutons quelques particularités
pour perfectionner l’hiftoire des mufcles d’un
organe, dans lequel on exige la plus grande, pre-
cifion.
L’origine de ces mufcles eft un peu difficile .à- fai-
fir : c’eft M. Zinn qui l’a donnée avec une exactitude
parfaite. Il faut pour éviter l’ erreur diftin'guer l’enveloppe
du nerf optique de la membrane qui tapiffe
l’orbite , & qui eft la continuation de la lame externe
de la dure-mere. Il faut féparër.de l’un 6c de l’autre
une efpece de ligament, qui eft placé à L’extrémité
interne de la fente déchirée , & logé dans une, .'rainure
de l’os Sphénoïde. Ce ligament tendineux-eft
caché fous le nerf optique, 6c naît de la dure-mere,
qui fait l’enveloppe du nerf optique. ^ , ; ■ r- ■ ■ ■
Le mufcle droit Supérieur naît & de la gàîne dû nerf
optique 6c du pér j,ofte de l’orbite. II elt mêlé dans
cette origine avec quelques fibres de l’abduCteur.
L’interne , l’inférieur 6c l’externe de l’oe il, naiffent
tous trois du ligament dont nous avons parie : l’externe
naît cependant enpartie dupériofte de l’orbite.
L’oblique Supérieur fort du période.
Les tendons des mufcles droits font prefque
quarres.
L’interne eft le plus court des droits , &C l’externe
le plus long. (H . D. G. )
* § D r o i t Æ lien,(JuriJprudence.)Sextws Ælius
Petus Catus, étant édile curule , l’an 5 3 3 . . . . Hfel
l’an 553.
D roit Anglois . . . . Au lieu de en iq0 , lifez en
1066. 1
Droit Canonique..........Au lieu de Zcerius, lifez
Zoefius.
lifez Veltuyftn.
D ro it Romain........ . Honorius III la renouvella
en 1115 , par la décrétale femper fpecula. . . . Hfel en
I z 10 , & fuper fpecula.
DROIT de Suede............Suivant le témoignage* des
hijloriens, ce fut Zamolxis , difciple de Pythagore.. . .
' Cependant Hérodote eft perfuadé que Zamolxis
vivoit avant Pythagore. Le roi In g on y fit quelques^
changemens , en C)o.o . . . . C ’eft apparemment le roi
Biorn qui regnoit en 900. Lettres fu r CEncyclopédie,
* D ro it -fil , ( terme de Tailleur. ). bande de
toile forte , large d’un à deux pouces, qu’on attache
à l’envers de l’étoffe aux endroits qu’on veut fortifier.
L'art du Tailleur , par M . DE GARS AU LT.
* § DROMORE, ( Géogr, ) ville du comté de
Dow en Irlande.... Lifez du comté de Down. Lettres
fur l'Encyclopédie.
DRONTHEIM, (Géogr.) ville épifcopale de
Norwege, capitale de l’un des, quatre grands gouver-
nemens du royaume, & ancien lieu de réfidence de
quelques-uns de fes rois. Elle eft fur la riviere de
N id, qui lui a fait prendre le nom latin de Nidrojla,
& qui va tomber dans la mer du nord à peu de dif-
tance de Ses murs,. Sa fondation eft du X e. fiecle ;
dans le x i i e. elle devint archiépiscopale, 6c renferma
pendant un tems dix églifes 6c cinq monafteres :
à la réformation l’archevêché fut fupprimé, fes monafteres
tombèrent, 6c il ne lui refte actuellement
que trois églifes. Mais elle aune fort bonne école
latine , unfeminaire qui pourvoit aux millions, une
maifon d’orphelins, & un hôpital. Elle fait un très-
grand commerce de bois, de poiffqn &:de cuivre;
& elle a une raffinerie de fucre. Les forts de Chrif-
tianftein & de Munkholmen la défendent: ce,dernier
fervit de prifon pendant quinze ans au chancelier
de Greiffenftein de Danemarpk, mort en 1699.
L’on fait auffi que le roi Chriftiern V , voyageant
en Norwege,.l’an 16,8:5, paffa quelques jours à
Drontheim, 6c s’y trouva dans la faifqn oh la clarté
des nuits rend en ce pays là; l’ufage des chandelles
inutiles. Long. z8filpt. C^. T)- Gl. )
D r o n th e im , la province de, ( Géogr. ) ,ç’eft la
partie de la Norwegequi, au midi, touche le gouvernement
de Bergen, à l’orientées monts de Kolç,,
& la Laponie Ruffienne, & q u i, au feptentriqn;&£à
l ’occident, eft baignée par la mer du nord^daps une
longueur d’environ 150 milles d’Allemagne. Elle fe
divife en trois grands bailliages qui font, epux de
Dronthein, de Nordland de Lapqnie : :le premier
comprend cinqua^te-fix.jurifdiâions^ le .Second
cinq, & le troifieme une feule qui rep.fertne vingt-
une paroiffes. 11 crqît du grain 6ç de. l’heçbp dans,le
dailliage de Drontheim ,-6c dans nombre d endroits
be celui de Nordland ; mais dans la Laponie, ou
l ’on ne trouve d’ailleurs ni villes ni villages , mais -
feule ment des hameaux 6c4es cabanes ifolees, fFou
fe nourrit à-peu-près, uniquement de lapeche. Des
îlës par multitude fe trouvent fur les côtes de Nordland
& de Laponie ; le gouffre appelle Mahljlron eft
au milieu des premières, entre Moskoë Sc Mof-
toenes, & la rortereflé de Wardehtis , la plus Septentrionale
qu’il y ait au monde, eft parmi les dernières,
à l’orient du cap nord, le plus avancé dé
l’Europe vers le pôle ardique. ( D . G. )
DROSSÈN, ( Géogr.) ville d’Allemagne en haute-
Saxe, & dans l’éleftorat de Brandebourg , aux frontières
de Pologne ; c’eft la capitale du petit pays de
Sternberg : elle eft affez bien bâtie &-bien peuplée,
&c elle fait un bon trafic de denrées & de gros drap's.
( " •< ? • )
* § DRUIDES, . . . Les auteurs de l'HiJloire
cLAugufle.. . . lifez Thiftoire Augujle.
D U
* § DUALISME,. . onN lit dans cet article Cre-
mius pour Crenius.
* § DUFFEL, (Géogr. ) ville de Brabant.. . fur
la Nejfe. . . Lifez fur la Ne thé. Lettres fur TEnCy cio-,
pedie.
DUIVELAND, (Géogr.) île des Provinces-Unies,
dans celle de Zeeland, & entourée des eaux appel-
lées Dykwater, Keten , & Wydaars : fon nom lui
vient de la multitude de pigeons, duiven, que l’on
y voyoit autrefois. Elle ne renferme aucune ville.
L’île de Duivtband fouffriten 1530 une inondation
qui la dépeupla prefqu’en entier d’hommes & d’animaux
: mais ce fut un fléau paffager, des ravages duquel
le courage, l’induftrie & l’application des Zée-
landois ont bien fu triompher dans la fuite. (D . G.)
DUMBLANC ou D umblain , ( Géogr. ) jolie petite
ville d’Ecoffe dans le comté de Monteith, dont
«lie eft la capitale , & fur la riviere d’Allen. Elle eft
remarquable par la viôoire que remportèrent l’an
1715 , dans fon voifinage, les troupes de George I.
commandées par le duc d’Argyle, fur celle du prétendant
commandées par le colnte de Ni.Rr.Long. 13.
So. lat. 11. (D . G. )
DUNBARTON ou Lenox comté de, (Géogr.)
province d’Ecoffe, à l’occident de celles de Monteith
6c de Sterling, au midi 6c à l’orient de celle d’Argyle
,6c au feptentrion de la riviere de Clyde : elle a
fait partie de l’ancien patrimoine de la maifon de
Stuart. Son fo l, montueux prefque par-tout, fournit
d’excellens pâturages pour les brebis, 6c quelque
peu de grains , au voifinage des petites rivières qui
l ’arrofent. Elle a dans fon enceinte le lac appellé
Lough-Lomund, dont la longueur eft de vingt-quatre
milles 6c la largeur de huit, 6c qui renferme trente
îles, trois defquelles.ont des églifes. La paroiffe d’Hel-
lernes, dépendante de cette province, vit naître, en
1506, le célébré Georges Buchanan. ( D . G .)
DUNGARVAN, ( Géogr. ) ville maritime d’Irlande
, dans la province de Munfter, 6c dans le
comté de, "Waterford, fur une baie qui lui donne
lin port; & lui !fait faire un certain commerce. Elle
eft munie d’un château auffi-bien que du droit de députer
au parlement. Long. 10. 3. lat. 62. ( D . G. )
DUNMOW , ( Géogr. ) ville d’Angleterre, dans
la province d’Effex, agréablement fituée fur le penchant
d’une colline, 6c richement environnée de
champs 6c de prairies fertiles. Elle exiftoit déjà fous
les anciens Romains ; 6c fous la catholicité, elle avoit
un prieuré confidérable : fous ces aufpices ou fous
d’autres, que l ’on ne fait comment qualifier, tout
homme marié qui, au bout de l’an 6c jour, pouvoit
jurer par ferment, de ne s’être repenti, ni de jou r ,
ni de huit, d’avoir pris femme^& de ne s’etre point
encore difputé avec la fienne, y jouiffoit autrefois du
droit d’aller demander 6c recevoir en préfentdu fei-
gneur du lieu , une fléché de lard. Les chroniques
de la ville nomment trois hommes qui dans l’efpâCe
de 500 ans, ont Ai l’affurance de faire le ferment.
Long. 18. lat.5 t. 4$. (D . G .)
DUNSTABLE, ( Géogr. ) ville d’Angleterre ,
dans la province de Bedfort, fur la route de Londres
a Chefter, 6c fur une colline oîi les eaux vives
manquant abfblument, l’on n’eft abreuvé que de Celles
de la pluie, cjue l’on y fait, à la vérité, très-bien
amaffer 6c très-bien conferver. C ’eft le Magiovinium
d’Antonin, 6c le lieu où fe croifent deux des grands
chemins, que l’on appelle en Angleterre Watling
Jlreet 6c Ikeningflreet, lefquels on fait avoir été conf-
truits par les Romains. L’on a fou vent trouvé aux environs
de cette v ille, des médailles, des infcriptions,
desreftes de retranchemens, 6c d’autres monumens
d antiquité. L o n y a vu auffi pendant long-tems uns
haute croix, élevée dans le xm e. fiecle par Edouard I.
a l’honneur de la reine Eléonore, fon époufe; 6c
Fade du divorce de Henri VIII & de Cathérine d’Arra-
gon , prononcé l’an 1533, par l’archevêque Cran-
mer, étoit daté de D un fiable. Long. 17. 3 . lat. 5\. i o .
( D. G. )
§ D U O , f. m. ( Poë/îe lyrique. ) Il en eft du
duo, du trio, &c. en mufique, comme du monologue
dans la fimple déclamation. II arrive dans
la nature qu’on parle quelquefois feul & à haute
v o ix , foit dans la réflexion tranquille, foit dans
la paffion ; & de-Ià , par extenfion , la vraifem-
blance du monologue. Il arrive auffi quelquefois que
deux, trois , quatre perfonnes, &c. dans la vivacité
parlent toutes enfemble ; que les répliqués du
dialogue, en fe preffant, fe croifent, fe confondent,
ou que le mouvement de l’ame des interlocuteurs
étant le même, ils difent tous la même chofe : c’en
eft affez pour établir la vraifemblance du duo, du
trio, du quatuor, &c. Car to.utes les fois que l’illufion
eft agréable, on s’y prête avec complaifance; 6c
tout ce qui eft poffible, on le fuppofe vrai.
Heureufement pourtant il fe trouve que plus le
duo fe rapproche de k nature, plus il eft fufceptible
d’expreffion, d’agrément 6c de variété ; 6c qu’à me-
fure qu’il s’en éloigne, il perd de fes avantages. Dans
le duo de l’opéra françois, tel qu’on l’a fait jufqu’à
préfent, les deux perfonnes difent d’un bout à l’autre
prefque la même chofe, 6c parlent fans ceffe à la
fois : c’eft-là ce qu’il y a de plus éloigné de la vérit
é , & en même tems de moins agréable. Ce n’eft
qu’un bruit confus 6c monotone qui fe perd dans le
cahos des acqpmpagnemens, 6c dont tout l’agrément
fe réduit à quelques accords qui ne vont point
à l’ame, parce qu’ils manquent d ’expreffion.
Le duo italien au contraire eft un dialogue concis,'
rapide , fymmétriquement compofé, & lufceptible ,
comme l’air, d’un deffin régulier & fimple. Dans ce
dialogue, tantôt les voix fe font-entendre féparément,
6c chacun dit ce qu’il doit dire, les âmes fe répondent,
les divers fentimens fe contrarient 6c fe combattent;
jufques-là tout fe paffe comme dans la nature. Mais
vient un moment où le dialogue eft fi preffé qu’il n’y
a plus d’alternative, & que des deux côtés lesmou-
vemens de l’ame s’échappent à la fois ; alors les deux
voix fe rencontrent, 6c leur accord n’eft pas moins
un plaifir pour l’ame que pour l’oreille , parce qu’il
exprime ou la réunion de deux fentimens unanimes,
ou le combat v if 6c rapide de deux fentimens op-
pofés. Ici l’art prend quelque licence.
Le talent de faciliter pour le muficien la marche du
duo, fur des mouvemens analogues & fur un motif
continu, ne laiffe pas d’avoir fes difficultés ; il fuppofe
dans le poète une oreillfe fenfible au nombre ,6c beaucoup
d’habitude à manier la langue & à la plier à fon
gré. Métaftafe eft encore pour nous le modèle le plus
parfait dans l’art d’écrire le duo ; il s’y eft attaché
fur-tout à donner aux répliqués correfpondantesune
i
«