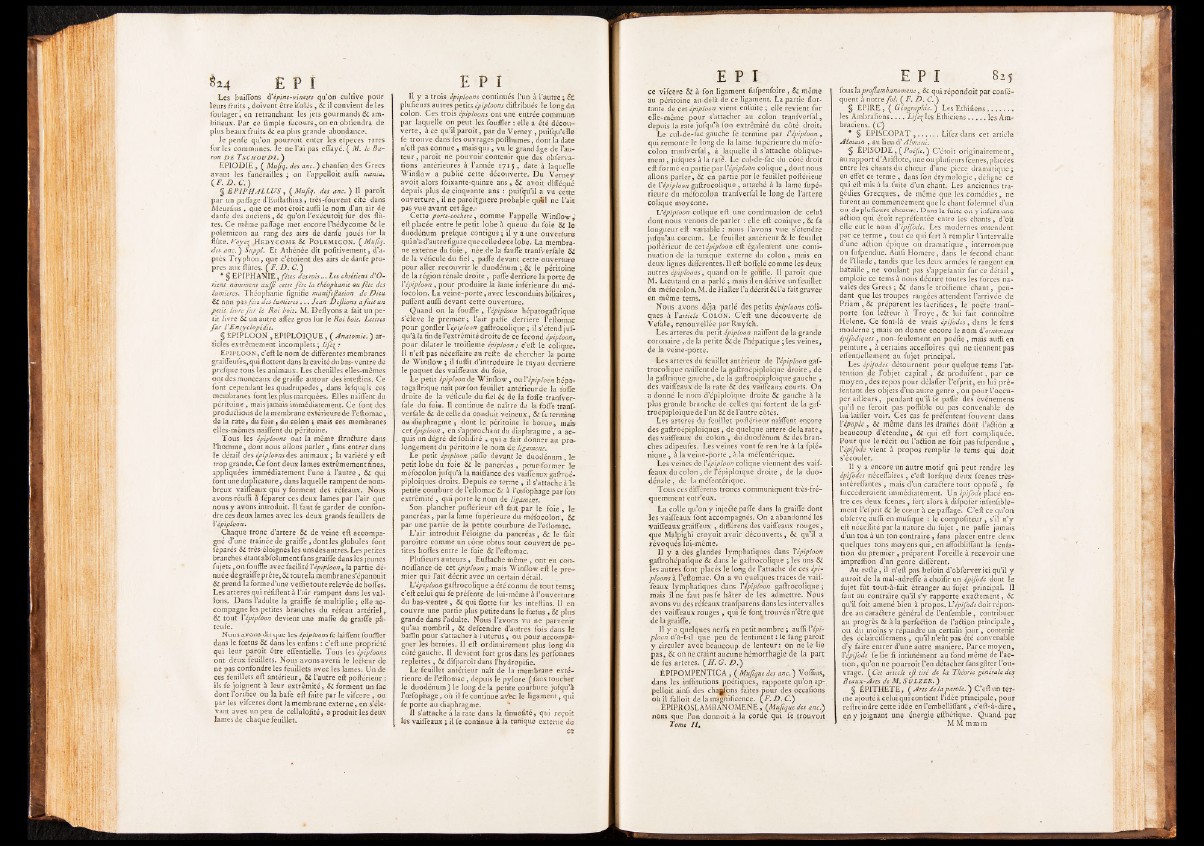
8*4 E P î
Les buiflons d'épine-vinette qu’on Cultive poür
leurs fruits, doivent être ifoles, & il convient de les
foulager \ en retranchant les jets gourmands & ambitieux.
Par ce fimple fecours, on en obtiendra de
plus beaux fruits & en plus grande abondance.
Je penfe qu’on pourroit enter les efpeces rares
fur les communes. Je ne rai pas effayé. ( M. le Baron
d e Ts c h o u d i . )
EPIODIE , ( Mufiq. des anc.) chanfon des Grecs
avant les funérailles ; on l’appelloit auffi nania.
( F. D . C. )
§ EPIPH A LLUS, ( Mufiq. des anc. ) Il parait
par un paflage d’Euftathius, très-fouvent cité dans
Meurfius , que ce mot étoit auffi le nom d’un air de
da nie des anciens, & qu’on l’exécutoit fur des flûtes.
Ce même paffage met encore l’hédycorne & le
polemicon au rang des airs de danfe joués fur la
flûte. P'oyeiJrlEDYCOME & POLEMICONv (Mufq.
des anc. ) Suppl. Et Athénée dit pofitivement, d’après
Tryphon, que c’étoient des airs de danfe propres
aux flûtes. ( F. D . C. )
* § EPIPHANIE, fêtes des rois... Les chrétiens d’o rient
nomment auffi cette fête la théophanie ou fête des
lumières. Théophanie lignifie manifejlation de Dieu
& non pas fête des lumières. . . Jean Défiions a fait un
petit livre fur le Roi boit. M. Deflyons a fait un petit
livre & un autre allez gros fur le Roi boit. Lettres
fur l'Encyclopédie.
§ ÉPIPLOON , EPIPLOÏQUES ( Anatomie. ) articles
extrêmement incomplets ; Hfe{ :
Epiploon , c’eft le nom de différentes membranes
graiffeufes, qui flottent dans la cavité du bas-ventre de
prefque tous les animaux. Les chenilles elles-mêmes
ont des monceaux de graille autour des inteftins. Ce
font cependant les quadrupèdes, dans lefquels ces
membranes font les plus marquées. Elles naifl'ent du
péritoine, mais jamais immédiatement. Ce font des
productions de la membrane extérieure de l’eftomac,
de la rate, du foie , du colon ; mais ces membranes
elles-mêmes naiflent du péritoine.
Tous les épiploons ont la même ftruClure dans
l’homme, dont nous allons parler , fans entrer dans
le détail des épiploons des animaux ; la variété y eft
trop grande. Ce font deux lames extrêmement fines,
appliquées immédiatement l’une à l’autre, & qui
. font une duplicature, dans laquelle rampent de nombreux
vaifleaux qui y forment des réfeaux. Nous
avons réuffi à féparer ces deux lames par l ’air que
nous y avons introduit. Il faut fe garder de confondre
ce,s deux lames avec les deux grands feuillets de
Y épiploon.
Chaque tronc d’artere & de veine eft accompagné
d’une traînée de graiffe , dont les globules font
féparés & très-éloignés les uns des autres. Les petites
branches étant abfolument fans graiffe dans les jeunes
fujets, on fouflle avec facilité Y épiploon, la partie dénuée
de graiffe prête, & toute la membrane s’épanouit
& prend la forme d’une veffie toute relevée de boffes.
Les arteres qui réfiftent à l’air rampent dans les vallons.
Dans l’adulte la graiffe fe multiplie ; elle accompagne
les petites branches du réfeau artériel,
& tout Yèpiploon devient une maflre de graiffe pâ-
teufe.
Nous avons dit-que les épiploons felaiffent fouffler
dans le foetus & dans les enfans : c’eft une propriété
qui leur paroît être effentielle. Tous les épiploons
ont deux feuillets. Nous avons averti le leâeur de
ne pas confondre les feuillets avec les lames. Un de
cès feuillets eft antérieur, & Tautre eft poftérieur :
ils fe joignent à leur extrémité, & forment un fac
dont l’orifice ou la bâfe eft faite par le vifcere , ou
par les vifceres dont la membrane externe, en s’élevant
avec un peu de cellulofité, a produit les deux
lames de chaque feuillet.
Ë P I
Il y à trois épiploons continués l’un à l’autre ; &
plufieurs autres petits épiploons diftribués le long du
colon. Ces trois épiploons ont une entrée commune
par laquelle on peut les fouiller : elle a été découverte
, à ce qu’il paroît, par du Vemey , puifqu’ellé
fe trouve dans fes ouvrages pofthumes, dont la daté
n’eft pas connue, mais q u i, vu le grand âge de l’auteur
, paroît nè pouvoir contenir que des obferva-
tions antérieures à l’année 1715, date à laquelle
Winflow a publié cette découverte. Du Verney
avoit alors foixante-quinze ans , & avoit difféqué
depuis plus de cinquante ans : puifqu’il a vu cette
ouverture, il ne parofyguere probable ne l’ait
pas vue avant cet âge.*
Cette porte-cochere, comme l’appelle Winflow ^
eft placée entre le petit lobé à queue du foie & le
duodénum prefque contigus ; il y a une ouverture
qui n’a d’autre figure que celle dexe lobe. La membrane
externe du foie , née de la fauffe tranfverfàle &
de la véficule du f ie l, paffe devant cette ouverture
poür aller recouvrir le duodénum & le péritoine
de la région rénale d roite, paffe derrière la porte de
Yèpiploon, pour produire la lame inférieure du mé-
focolon. La veine-porte, avec les conduits biliaires*
paffent auffi devant cette ouverture.
Quand on la fouflle , Yèpiploon hépatogaftfique
s’élève le premier; l’air paffe derrière l’eftomac
pour gonfler Yèpiploon gaftrocolique ; il s’étend jufi-
qu’à la fin de l’extrémité droite de ce fécond épiploon,
pour dilater le troifieme épiploon : c’eft le colique.
Il n’eft pas néceffaire au refte de chercher la porte
de Winflow ; il fuffit d’introduire le tuyau derrière
le paquet des vaifleaux du foie.
Le petit épiploon de W in flo v , ou Yèpiploon héoa-
togaftrique naît par fon feuillet antérieur de la fofle
droite de la véficule du fiel & de la fofle tranfver-
fale du foie. Il continue de naître de la fofle tranf*
verfale & de celle du conduit veineux, & fe termine
au diaphragme , dont le péritoine le borne ; mais
cet épiploon, en s’approchant du diaphragme, a acquis
un dégré defolidité , qui a fait donner au prolongement
du péritoine le nom de ligament.
Le petit épiploon paffe devant le duodénum, le
petit lobe du foie & le pancréas , pour* former le
méfocolon jufqu’à la naiffance des vaifleaux gaftroé-
piploïques droits. Depuis ce terme , il s’attache à la
petite courbure de l’eftomac & à l’oefophage par foi*
extrémité , qui porte le nom de ligament.
Son. plancher poftérieur eft fai; par le foie , le
pancréas, par la lame fupérieure du méfocolon", &
pâr une partie de la petite courbure de l’eftomac.
L’air introduit l’éloigne du pancréas, & le fait
paraître comme un cône obtus tout couvert de petites
boffes entre le foie & l’eftomac.
Plufieurs auteurs, Euftache m ême, ont eu con-
noiffance de cet épiploon ; mais Winflow eft le premier
qui l’ait décrit avec un certain détail.
L’épiploon gaftrocolique a été connu de tout tems;
c’ eft celui qui fe préfente de lui-même à l’ouverture
du bas-ventre , & qui flotte fur les inteftins. Il en
couvre une partie plus petite dans le foetus , & plus
grande dans l’adulte. Nous l ’avons Vu ne parvenir
qu’au nombril, & defeendre d’autres fois dans le
baffin pour s’attacher à l’utérus, ou pour accompagner
les hernies. Il eft ordinairement plus long du
côté gauche. Il devient fort gros dans les perfonnes
replettes , & difparoît dans l’hydropifie. (
Le feuillet antérieur naît de la membrane extérieure
de l’eftomac, depuis le pylore ( fans toucher
le duodénum) le long delà petite courbure jufqu’à
l’oefophage, oii il fe continue av’ëc le ligament, qui
fe porte au diaphragme.
Il s’attache à la rate dans la finuofité, qui reçoit
les vaifleaux ; il fe continue à la tunique externe de
E P I
ce vifcere & à fon ligament fufpenfoire, & même
au péritoine au-delà de ce ligament. La partie flottante
de cet épiploon vient enfuite ; elle revient fur
elle-même pour s’attachér au colon tranfverfal,
depuis la rate jufqu’à fon extrémité du côté droit.
Le cul-de-fae gauche fe termine par Üépiploon,
qui remonte le long de la lame fupérieure du méfocolon
tranfverfal, à laquelle il s ’attache obliquement,
jufques à la rate. Le, çul*de-fac du côté droit
eft formé en partie par Yépiplobn colique , dont nous
allons parler, & en partie par le feujllet poftérieur
de Yèpiploon gaftrocolique , attaché à la lame fupérieure
du méfocolon tranfverfal le long de l’artere
colique moyenne.
\Jépiploon colique eft une continuation de celui
dont nous venons de parler : elle eft conique, & fa
longueur eft variable : nous l’avons vue s’étendre
jufqu’au cæcum. Le feuillet antérieur & le feuillet
poftérieur de cet épiploon eft également une continuation
de la tunique externe du colon, mais en
deux lignes differentes. Il eft boflelé comme les deux
autres épiploons, quand on le gonfle. Il paroît que
M. Lieutaud en a parlé ; mais il en dérive un feuillet
du méfocolon. M. de Haller l’a décrit & l’a fait graver
en même tems.
Nous avons déjà parlé des petits1 épiploons coliques
à Y article C olon. C ’eft une découverte de
Vefale, renouvellée parRuyfch.
Les arteres du petit épiploon naiflent de la grande
coronaire , de la petite & de l’hépatique ; les veines,
de la veine-porte.
Les arteres du feuillet antérieur de Yèpiploon gaftrocolique
naiflent de la gaftroépiploïque droite, de
la gaftrique gauche, de la gaftroépiploïque gauche ,
des vaifleaux de la rate & des vaifleaux courts. On
a donné le nom d’épiploïque droite & gauche à la
plus grande branche de. celles qui fortent de la gaftroépiploïque
de l’un & de l’autre côtés. -
Les arteres dii feuillet poftérieur naiflent encore
des gaftroépiploïques , de quelque artere de la rate,
des vaifleaux du colon , du duodénum & des branches
adipeufes. Les veines vontfe renJre à la fplé-
tiique, à l'a veine-fiorte , à.la méfentérique.
Les veines de Yèpiploon colique viennent des vaif-
feaux du colon , de l’épiploïque droite , de la duo-
dénale , de la méfentérique.
Tous cesdifférens troncs communiquent très-fréquemment
entr’eux.
La colle qu’on y inje&e pafle dans la graifle dont
les vaifleaux font accompagnés. On a abandonné les
vaifleaux graiffeux , différens des vaifleaux rouges,
que Malpighi croyoit avoir découverts, & qu’il a
révoqués lui-même.
Il y a des glandes lymphatiques dans Yèpiploon
gaftrohépatique & dans le gaftrocolique ; les uns &
les autres font placés le long de l’attache de ces épiploons
à l’eftomac. On a vu quelques traces de vaif-
feaux lymphatiques dans Yèpiploon gaftrocolique;
mais il ne faut pas fe hâter de les admettre. Npus
avons vu des réleaux tranfparens dans les.intervalles
des vaifleaux rouges , qui fe font trouvés n’être que
de la graifle.
Il y a quelques nerfs en petit nombre ; auffi Y épiploon
n’a-t-il que peu de fentiment : le fang paroît
y circuler avec beaucoup de lenteur : on ne le lie
pas, & on ne craint aucune hémorrhagie de la part
de fes arteres. ( H. G. Z>.)
ÉPIPOMPENTICA, ( Mufique des anc.) Voffius,
dans les inftitutions poétiques, rapporte qu’on ap-
pelloit ainfi des chanfons faites pour des occafions
où il falloit de la magnificence. (F . D . C.)
ÊPIPROSLAMBANOMENE, (Mufique des anc.)
nom que l’on donnoitù la corde qui fe trou voit
Tome ƒ/»
E P I 825
fous laprofambanomene, & qui répondoit par confé-
quent à notre fol. ( F. D . C.)
§ ÉPIRE , ( Géographie. ) Les Ethifiens..............
les Ambraîiens. . . . Life{ les Ethiciens.........les Ambraciens.
( C)
* § ÉPISCOPAT , ........ . Lifez dans cet article
Almain , au lieu d’ ALmanh
§ ÉPISODE , ( Poéfie. ) C’étoit originairement,
au rapport d’Ariftote,une ou plufieurs feenes, placées
entre les chants du choeur d’une piece dramatique ;
en effet ce terme , dans fon étymologie, défigne ce
qui eft mis à la-fuite d’un chant. Les anciennes tragédies
Grecques, de même que.les comédies, ne
furent au commencement que le chant folemnel d’un.
ou de plufieurs choeurs. Dans la fuite on y inféra une
aôion qui étoit repréfentée entre les chants, d’où
elle eut le nom d’épifode. Les modernes entendent
par ce terme, tout ce qui fert à remplir l’intervalle
d’une aâîion épique ou dramatique, interrompue
ou fufpendue. Ainfi Homere, dans le fécond chant
de l’Iliade, tandis que les deux armées fe rangent en
bataille , ne voulant pas s’appefantir fur ce détail,
emploie ce tems à nous décrire toutes les forces navales
des Grecs ; & dans le troifieme chant, pendant
que les troupes rangées attendent l’arrivée de
Priam , & préparent les facrifices, le poète-transporte
fon leéleur à T ro y e , & lui fait connoître
Helene. Ce fonl-là de vrais èpifodes , dans le fens
moderne ; mais on donne encore le nom d'ornemens
épifodiques , non-feulement en poéfie, mais auffi en
peinture , à certains aCceffoires qui ne tiennent pas
effentiellement au füjet principal. '
Les épij.odes détournent pour quelque tems l’attention
de l’objet capital , & produifent, par ce
moyen, des repos pour délaffer l’efprit, en lui pré-
fentant des objets d’un autre genre , ou pour l’occù-
per ailleurs, pendant qu’il fe paffe des événemens
qu’il ne ferait pas poflible ou pas convenable de
lui laiffer voir. Cès cas fe préfentent fouvent dans
Yèpopèe , & même dans les drames dont l’aftion a
beaucoup d’étendue, & qui eft fort compliquée.
Pour que le récit ou l’aétion ne foit pas fufpendue ,
Yèpifode vient à propos remplir le tems qui doit
s’écouler.
Il y a encore un autre motif qui peut rendre les
èpifodes néceffaires , c’eft lorfque deux feenes très-
intëreffantes , mais, d’un caraftere tout oppofé, fe
fuccéderoient immédiatement. Un épifode placé entre
ces deux feenes, fert alors à tTifpofer infenfible-
ment l’efprit & le coeur à ce paffage. C ’eft ce qu’on
oblervq auffi en mufique : le compofiteur, s’il n’y
eft néceffité par la nature du fu je t, ne paffe jamais
d’un ton à un ton contraire , fans placer entre deux
quelques tons moyens qui, enaffoibliffant la fenfa-
tion du premier, préparent l’oreille à recevoir une
impreflion d’un genre différent.
Au refte, il n’eft pas befoin d’obfervet ici qu’il y
aurait de la mal-adreffe à choifir un épifode dont le
fujet fût tout-à-fait étranger au fujet principal. Il
faut au contraire qu’il s’y rapporte exaftement, ôc
qu’il foit amené bien à propos. \Jépifode doit répondre
au caraûere général de l’enfemble, contribuer
au progrès & à la perfection de l’aftion principale,
ou du moins y répandre un certain jour , contenir
des éclairciffemens , .qu’il n’eût pas été convenable
d’y faire entrer d’une autre maniéré. Parce moyen,
Yèpifode fe lie fi intimément au fond même de l’action
, qu’on ne pourroit l’en détacher fans gâter l’ouvrage.
( Cet article efi tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. SuLZER. )
§ ÉPITHETE, ( Ansde la parole. ) C’eftun terme
ajouté à celui qui contient l’idée principale, pour
reftreindre cette idée en l’embelliffant, c’eft-à-dire ,
en y joignant une énergie efthétique. Quand par
M M mm m