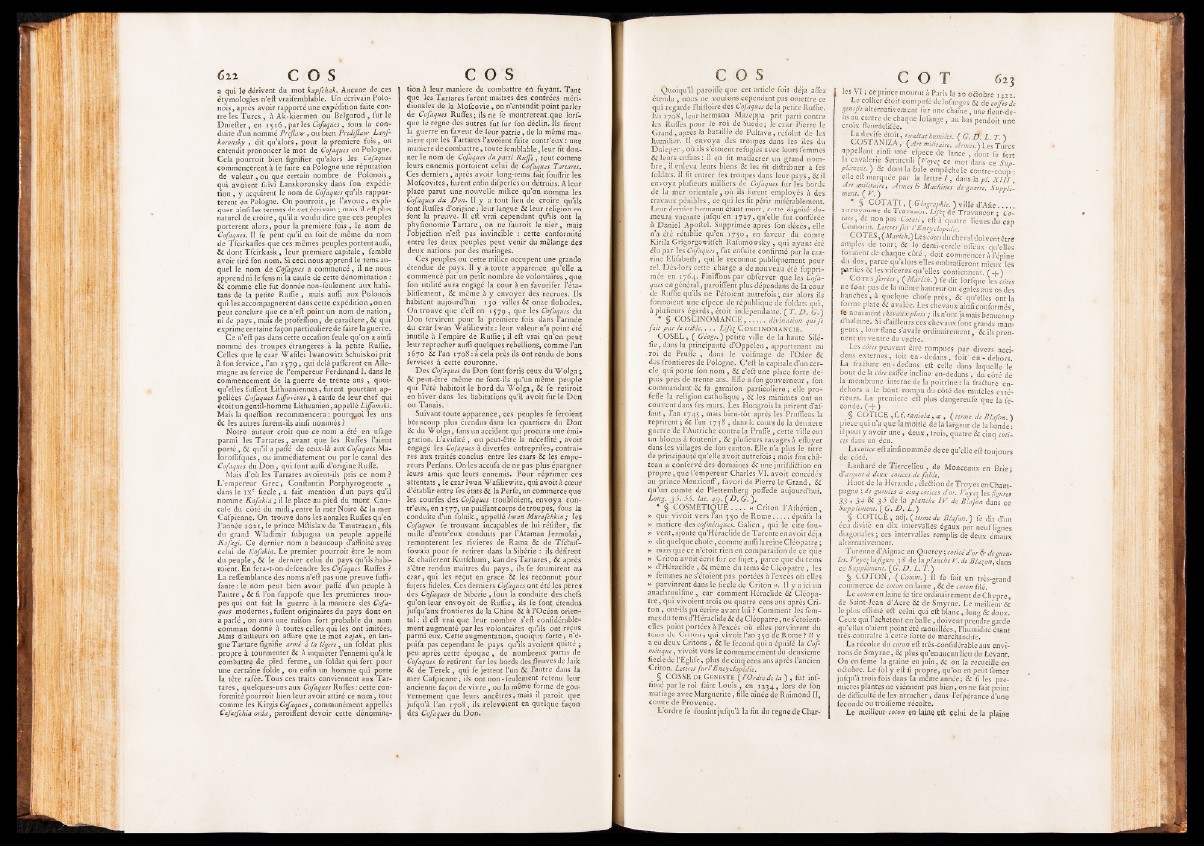
a qui le dérivent du mot kapfckak. Aucune de ces
étymologies n’eft vraifemblable. Un écrivain Polo-
nois, après avoir rapporté une expédition faite contre
les Turcs , à Ak-kiermen ou Belgorod, fur le
Dniefter, en 15 16 , par les Cojaques, lous la conduite
d’un nommé Prejlaw, ou bien Pred'flaw Lanf-
koronsky , dit qu’alors, pour la première fois, on
entendit prononcer le mot de Cojaques en Pologne.
Cela pourroit bien fignifier qu’alors les Cofaques
commencèrent à le faire en Pologne une réputation
de valeur , ou que certain nombre de Polonois,
qui avoient fuivi Lanskoronsky dans fon expédi-,
lion , y acquirent le nom de Cofaques qu’ils rapportèrent
en Pologne. On pourroit, je l’avoue, expliquer
ainfi les termes de cet écrivain ; mais il eft plus
naturel de croire, qu’il a voulu dire que ces peuples
portèrent alors, pour la première fois , le nom de
Cofaques. Il fe peut qu’il en foit de même du nom
de Tfcirkaffes que ces mêmes peuples portent auffi,
& dont T fcirkask, leur première capitale , femble
avoir tiré fon nom. Si ceci nous apprend le tems auquel
le nom de Cofaques a commencé, il ne nous
apprend ni le fens ni la caufe de cette dénomination :
& comme elle fut donnée non-feulement aux habi-
tans de la petite Ruffie , mais-auffi aux Polonois
qui les accompagnèrent dans cette expédition ,on en
peut conclure que ce n’eft p©int un nom de nation,
ni de pays, mais de profeffion, de caraftere, & qui
exprime certaine façon particulière de faire la guerre.
Ce n’eft pas dans cette occafion feule qu’on a ainfi
nommé des troupes étrangères à la petite Ruffie.
Celles que le czar Vafilei Iwanowitz Schuiskoi prit
à fon fervice, l’an 1579, qui delà pafferent en Allemagne
aufervice de l’empereur Ferdinand I. dans le
commencement de la guerre de trente ans , quoiqu’elles
fuffent Lithuaniennes, furent pourtant app
e lle s Cofaques Lijfoviens, à caufe de leur chef qui
étoit un gentil-homme Lithuanien, appellé Liffomski.
Mais la queftion recommencera : pourquoi les uns
& les autres furent-ils ainfi nommés ?
Notre auteur croit que ce nom a été en ufage
parmi les Tartàres, avant que les Ruffes l’aient
porté , & qu’il a paffé de ceux-là aux Cofaques Ma-
loroffifques, ou immédiatement ou par le canal des
Cofaques du D ori, qui font auffi d’origine Ruffe.
Mais d’oii les Tartares avoient-ils pris ce nom ?
L ’empereur G re c, Conftantin Porphyrogenete ,
dans le i x e fiecle, a fait mention d’un pays qu’il
nomme Kafakia ; il le place au pied du mont Cau-
cafe du côté du midi, entre la mer Noire & la mer
Cafpienne. On trouve dans les annales Ruffes qu’en
l ’année 1021, le prince Mftislawde Tmutracan, fils
du grand Vladimir fubjugua un peuple appellé
Kofagi. Ce dernier nom a beaucoup d’affinité avec
celui de Kofakia. Le premier pourroit être le nom
du peuple, & le dernier celui du pays qu’ils habi-
toient. En fera-t-on defcendre les Cofaques Ruffes ?
La reffemblance des noms n’eft pas une preuve fuffi-
fante : le nom peut bien avoir paffé d’un peuple à
l’autre , & fi l’on fuppofe que les premières troupes
qui ont fait la guerre à la maniéré des Cofaques
modernes, fuffent originaires du pays dont on
a parlé , on aura une raifon fort probable du nom
commun donné à toutes celles qui les ont imitées.
Mais d’ailleurs on affure que le mot kajak, en langue
Tartare lignifie armé à la légère, un foldat plus
propre à tourmenter & à inquiéter l’ennemi qu’à le
combattre de pîed ferme, un foldat quifert pour
«ne certaine folde, ou enfin un homme qui porte
la tête rafée. Tous ces traits conviennent aux Tartares
, quelques-uns aux Cofaques Ruffes : cette conformité
pourroit bien leur avoir attiré ce nom, tout
comme les Kirgis Cofaques, communément appellés
Cafatfchia orda, paroiffent devoir cette dénommation
à leur maniéré de combattre en fuyant. Tant
que les Tartares furent maîtres des contrées méridionales
de la Mofcovie, on n’entendit point parler
de Cofaques Ruffes; ils ne fe montrèrent.que lorf-
que le régné des autres fut fur fon déclin. Ils firent
la guerre en faveur de leur patrie, de la même maniéré
que les Tartares l’avoient faite contr’eux : une
maniéré de combattre, toute femblable, leur fit donner
le nom de Cofaques du parti Ruffe, tout comme
leurs ennemis portaient celui de Cofaques Tartares.
Ces derniers, après avoir long-tems fait fouffrir les
Mofcovites, furènt enfin difperfés ou détruits. A leur
place parut une nouvelle milice qu’on nomma les
Cofaques du Don. Il y a tout lieu de croire qu’ils
font Ruffes d’origine ; leur langue & leur religion en
font la preuve. 11 e’ft vrai cependant qu*ils ont la
phyfionomie Tartare, on ne fauroit le nier, mais
l’objeûion n’eft pas invincible : cette conformité
entre les deux peuples peut venir du mélange des
deux nations par des mariages.
Ces peuples ou cette milice occupent une grande
étendue de pays. Il y a toute apparence qu’elle a
commencé par un petit nombre de volontaires , que
fon utilité aura engagé la cour à en favorifer l’éta-
bliffement, & même à y envoyer des recrues. Ils
habitent aujourd’hui 130 villes & onze flobodes.
On trouve que c’eft en 15 79 , que les Cofaques du
Don fervirent pour la première fois dans l’armée
du czar Ivan Vafiüewitz: leur valeur n’a point été
inutile à l’empire de Ruffie ; il eft vrai qu’on peut
leur reprocher auffi quelques rebellions, comme l’an
1670 & l’an 1708 : à cela près ils ont rendu de bons
fervices à cette couronne.
Des Cofaques du Don font fortis ceux du V o lg a j
& peut-être même ne font-ils qu’un même peuple
qui l’été habitait le bord du V o lg a , & fe retiroit
en hiver dans les habitations qu’il avoit fur le Don
ou Tanaïs. ■
Suivant toute apparence, ces peuples fe feroient
beaucoup plus étendus dans les quartiers du Don
& du V o lg a , fans un accident qui procura une émigration.
L’avidité , ou peut-être la néceffité , avoit
engagé les Cofaques àdiverfes entreprifes, contraires
aux traités conclus entre les czars & les empereurs
Perfans. On les accufa de ne pas plus épargner
leurs amis que leurs ennemis. Pour réprimer ces
attentats , le czar Ivan Vafiliewitz, qui avoit à coeur
d’établir entre fes états & la Perfe, un commerce que
les courfes des Cofaques troubloient, envoya contr’eux,
en 1577, un puiffant corps de troupes, fous la
conduite d’un folnik, appellé ïwan Murafchkin; les
Cofaques fe trouvant incapables de lui réfifter, fix
mille d’entr’eux conduits par l’Ataman Jermolai,
remontèrent les rivières de Rama & de Tfchuf-
fowaia pour fe retirer dans la Sibérie : ils défirent
& chafferent Kutfchum, kan des Tartares, & après
s’être rendus maîtres du pays, ils fe fournirent au
czar, qui les>reçut en grâce & les reconnut pour
fujets fideles. Ces derniers Cofaques ont été les pferes
des Cofaques de Sibérie , fous la conduite des chefs
qu’on leur envoyoit de Ruffie, ils fe font étendus
jufqu’aux frontières de la Chine & à l’Océan oriental
: il eft vrai que leur nombre s’eft confidérable-
ment augmenté par les volontaires qu’ils ont reçus
parmi eux. Cette augmentation, quoique forte, n’e-
puifa pas cependant le pays qu’ils avoient quitté ;
peu après cette époque , de nombreux partis de
Cofaques fe retirent fur les bords des .fleuves de Jaïk
& de Terek , qui fe jettent l’un &. l’autre dans la
mer Cafpienne ; ils ont non - feulement retenu leur
ancienne façon de v iv re , ou la même forme de gouvernement
que leurs ancêtres, mais il paroît que
jufqu’à l’an 1708, ils relevoipnt en quelque façon
de.$ Cofaques du Don.
Quoiqu’il paroiffe que cet article foit déjà /iffez
étendu , nous ne voulons cependant pas omettre ce
qui regarde l’hiftoire des Cofaques de la petite Ruffie.
En 1708, leur hetmann Mazeppa prit parti contre
les Ruffes pour le roi de Suède ; le czar Pierre le
Grand, après la bataille de Pultava, réfolut de les
humilier. Il envoya des troupes dans les îles du
Dnieper, où ils s’étoient réfugiés avec leurs femmes
& leurs enfans : il en fit maffacrer un grand nombre
, il enleva leurs biens & les fit diftribuer à fes
foldats. Il fit entrer fes troupes dans leur pays., & il
envoya plufieurs milliers de Cofaques fur les bords
de la mer orientale, où ils furent employés à des
travaux pénibles, ce qui les fit périr miférablernent.
Leur dernier hetmann étant mort, cette dignité demeura
vacante jufqu’en 1727, qu’elle fut conférée
à Daniel Apoftel. Supprimée après fon décès, elle
n’a été rétablie qu’en 1750, en faveur du comte
Kirila Grigorgewitfch Rafurriôwsky , qui ayant été
élu par les Cofaques y fut enfuite confirmé par la cza-
rine Elifabeth , qui le reconnut publiquement pour
tel. Dès-lors cette charge a de nouveau été fuppri-
mée en 1764. Finiflons par obferver que lés Cofaques
en général, paroiffent plus dépendans de la cour
de Ruffie qu’ils ne l’étaient autrefois ; car alors ils
formoient une efpece de république de foldats qui,
à plufieurs égards, étoit indépendante. ( T. D . G . )
* § COS CINQ MANCE , . . . . . divination qui Je
fait par le crible. .. . . Life^ C oscinomancie.
COSEL j ( Géogr. ) petite ville de la haute Silé-
fie , dans la principauté d’Oppelen, appartenant au
roi de Pruffe , dans, le voifinage de l’Oder &
des frontières de Pologne. C ’eft la capitale d’un cercle
qui porte fon nom, & c’eft une place forte depuis
près de trente ans. Elle a fon gouverneur, fon
commandant & fa garnifon particulière ; elle pro-
feflè la religion catholique , & les minimes ont un
couvent dans fes murs. Les Hongrois la prirent d’af-
faut, l’an 1745 , mais bien-tôt après les Pruffiens. la
reprirent ; & l’an 1758 , dans le cours de la derniere
guerre de l’Autriche contre la Pruffe , cette ville eut
un blocus à foutenir, & plufieurs ravages à effuyer
dans les villages de fon canton. Elle n’a plus le titre
de principauté qu’elle avoit autrefois ; mais fon château
a confervé des domaines & une jurifdi&ion en
propre, que l’empereur Charles VI. avoit concédés
au princeMenzicoff, favori de Pierre le Grand, &
qu’un comte de Plettemberg poffede aujourd’hui.
Long. ÿ 5l 55. lat. 49 .(2?. G. ).
* § COSMÉTIQUE . . . . « Criton l’Athénien,
» qui' vivoit vers l’an 3 50 de Rome........ épuifa la
» matière des cofmètiques. Gsééxen , qui le cite fou-
» vent, ajoute qu’Héraclide de Tarente en avoit déjà
» dit quelque chofe, comme auffi la reine Cléopâtre ;
» mais que ce n’étoit rien en comparaifon de ce que
» Criton avoit écrit fur ce fujet, parce que du tems
» d’Héraclide , & même du tems de Cléopâtre , les
» femmes ne s’étoient pas portées à l’excès où elles
» parvinrent dans le fiecle de Criton ». Il y a ici un
anachronifme , car comment Héraclide & Cléopâtre
, qui vivoient trois ou quatre cens ans après Criton
, ont-ils pu écrire avant lui ? Comment les femmes
du tems d’Héraclide & de Cléopâtre, ne s’étoient-
elles point portées à l’excès où elles parvinrent du
tems de Criton, qui vivoit l’an 3 50 de Rome ? Il y
a eu deux Critons , & le fécond qui a épuifé la Cof-
métique, vivoit vers le commencement du deuxieme
fiecle de l’Eglife, plus de cinq cens ans après l’ancien
Criton. Lettres furCEncyclopédie.
§ COSSE d eGeneste ( V Ordre de la') y fut inf-
titué par le roi faint Louis y en 1234, lors de fon
mariage avec Marguerite, fille aînée de Raimond II,
comte de Provence.
L’ordre fe fouiint jufqu’à la fin du régné de Charles
VI ; ce prince mourut à Paris le 10 oftobre 1412.
! Lc colller compofé de lofanges & de cofcs de
genejte alternativement fur une chaîne, une fleur-de-
. lis au centre de chaque lofange, au bas pelïdoit une
croix fleurdelifée.
La devife était, exàltat Immiles. ( G .Ü .L T 1
COSTANlZAy ^ré-nii&airfe Armes?) Lete Turcs
appellent ainfi une efpece de lan ce, dont fe fort
la cavalerie Seratcult (Fbycj ce mot dans ce Sup-
planent. ) & dont la baie empêche le contre-coup :
elle eft marquée par la le tt re / , dans la pi. X I I I ,
Ait «nilitairey Armes & Machines de guerre. Supplément.
( F . ) V 6
* § C O T A T I , ( Géographie. ) ville d’Afie . . . . ;
au royaume j
de Travanor. Life{ de Travancor ; Co- •
tate y & non pas ^Cotati , eû à quatre lieues du cap
Gomorin. Lettres fur l'Encyclopédie. •
COTES yMaféch.) Lës côtes du cheval doivent être
amples dé tou r; & le demi-cercle offeux qu’elles
foi ment de chaque coté , doit commèncér à l’épine
du dos, parce qu’alors elles embràfferont mieux les
parties & les vifceres qu’elles 'contiennent. ( + )
COTES ferrées, ( Maréch. ) fe dit loffque lés côtes
ne font pas de la même hauteur ou égalés aux os des
hanches , à quelque chofe près, & qu’elles ont la
forme plate & avalée. Les chevaux ainfi conformés,
fe nomment chevaux plats ; ils n’ont jamais beaucoup
d haleine. Si d’ailleurs ces chevaux font grands mangeurs
, leur flanc s’avale ordinairement, & ils pren-
nent'un ventre de vache. . • r
Les côtes peuvent être rompues par divers acci-
dens externes, foit en - dedans, foit ‘ en - dehors.
La frafture en - dedans eft celle dans laquelle lé
bout de la côte caffée incline en-dedans , du côfé de
la membrane interne de la poitrine : la fraôure en-
dehors a le bout rompu du côté des mufcles extérieurs.
La première eft plus dangerèufe que la fécondé.
(4 -)
§ COTICE ,f. î.toeniola, ce , ( terme de Blafon. )
piece qui n’a que la moitié de la largeur de la bande :
il peut y avoir une, deux-, trois, quatre & cinq codées
dans un écu.
La co'tice eft ainfinommée dece qu’elle eft toujours
de côté. . • •
_ Lanharé de Tiercelieu , de Monceaux en Brie ;
dé argent à deux cotices de fable. ■
Huot de la Héraude, éleftion de Troyes en Champagne
; de gueules à cinq cotices dé or. Voye^ les figures
33 » 3j ^ 3~* k* planche 1F de Blafon dans ce
Supplément. ( G. D . L. )
§ CO T IC É , adj. ( terme de Blafon. ) fe dit d’un
écu divifé en dix intervalles égaux par neuf lignes
diagonales ; ces intervalles remplis de deux émaux
alternativement.
T urenne d’Aignac en Quercy ; coticé dé or & de gueu•
les. yoyti la.figure J 8 de la planche V. de Blason,-fans
ce Supplément. (G. D. L .T .)
■ § C O TO N , ( Cornm.) Il fe fait un très-grand
commerce de coton en laine , & dé coton filé.
Le coton en laine fe tire ordinairement de Chypre,
de Saint-Jean d’Acre & de Smyrne. Le meilleur &
le plus eftimé eft celui qui eft blanc, long & doux.
Ceux qui l’achetent en balle, doivent prendre garde
qu’elles n’aient point été mouillées, l’humidité étant
très-contraire à cette forte de marchandife.
La récolte du coton eft très-confidérable aux environs
de Smyrne, & plus qu’en aucun lieu du Levant.
On en feme la graine en juin, & on la recueille.en
oftobre. Le fol y eft fi propre, qu’on en peut femer
jufqu’à trois fois dans la même année; & fi les premières
plantes ne viennent pas bien, on ne fait point
de difficulté de les-arracher, dans Tefpérance d’une
fécondé ou troifieme récolte.
Le meilleur- coton en laine eft celui delà plaine