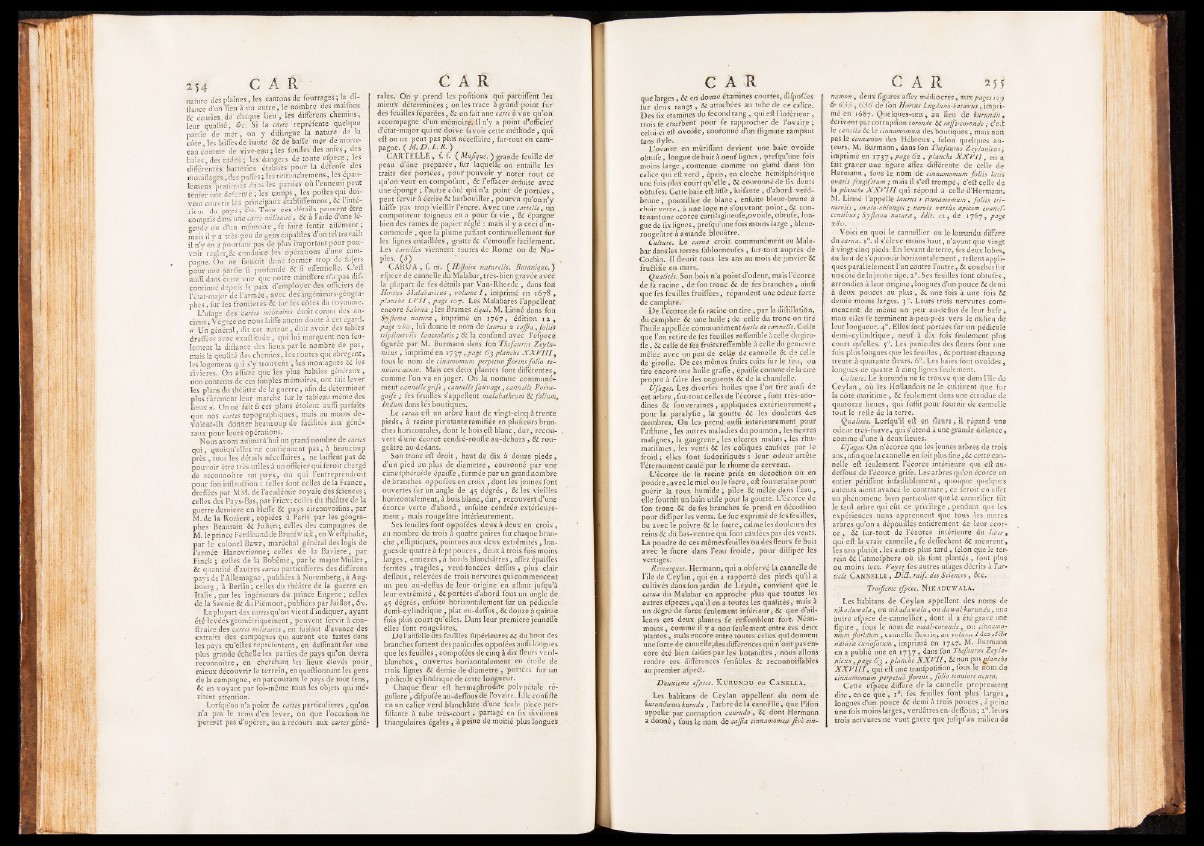
nature des plaines, les cantons de fourrages ; la di-
fiance d’un lieu à un autre, le nombre dés maiions
& écuries dé chaque lieu ,' les’ différens chemins,
leur qualité, &c; Si la càne repréfente quelque
partie de mer, oh y diftirigùe la nature de la
côte, les laiffësde haute & de baffe mer de morte-
eau comme de vive-eau ; les fondes' des anfes, des
baies, des radës ; les dangers de toute elpéce; les
différentes' batteries établies' pour la défenfe des
mouillages', dés-paffes ? fes'retfarfehemens, les epau-
lemeris pratiqués5 dans lés. parties où 1 ennemi peut
tenter une defccnte ; les' camps x les polies qui doivent
couvrir les principaux établiffemens, 6t '"intérieur
du pays', &c. Tous ces; details^ peuvent etre
compris dans unècàrte mlïtkiri, 6c à l’aide d’une légende
ou d’un mémoire ,-fè faire fentir aifemént ;
mais il f à très-peu de gens1 capables d’un tehravail:
il n’y en a pourtant pas de pliis important pour pouvoir
régler.& conduire lés opérations d’une campagne.
On*ne fauroît dbU'c former trop de fuféts
pour u'ne partie fi profonde 6c fi effentielle. C’eft
aufii dans cetté vue que notre mïniffere n a pas discontinué
depuis la paix d’employer des officiers dé
l’état-major de l’armée, avec des ingénieurs-géographes
, fur les frontières & lur lés côtés du royaume1.'
L’ ufa^e des: cartes militaires étoit connu des anciens
j Vévece në nous laiffë aùcun doute a cet egard.
« Un général, dit,cet aùteùr ,,doit avoir des tables
dreffées a!vec eXaârtude , qui lui marquent non feulement
la diftance des lieux .par lé nombre de pas,
mais la qualité des.chèmins, les routes qui abrègent,
les logemens qui s’ÿ trouyeùt, les montagnes 6c les
rivières. On affUré que lès pins habiles généraux,
non contents de ces fini pie s mémoires, ont fait lever
les plans dû théâtre de là gnèrre , afin de déterminer
plus-fûremerit leur marche fur lé tableau même des
lieux »'. On né fait fi ces plans éfoient auffi parfaits
que nos cartes topographiques, mais au moins dévoient
ils donner beaucoup de facilités aux généraux
poiTr lent 6 opëratiÔris.
Nous avons aujourd'hui nh grand nombre de cartes
qui, quoiqu’elles né contiennent pas, à beauebup
près , tous lès détails neceflaires , ne laiffent pas de
pouvoir êtrè très-utiles à un officier qui feroit chargé
de reconnoître un pays, bu qui l’entreprendrait
pour fort iriftfuêïion : telles font celles de la France,
dreffées pat MM. dé l’académie royale des fciences;
celles des Pays-Bas, par Fricx; celles du théâtre de la
guerre derniere en Heffe 6c pays circonvoifins, par
M. de la Roziere, copiées à Paris par les géographes
Beaurain & Julien; céllës dés campagnés de
M. le prince Ferdinand de Brunfv/ick, en W eftphalie,
par le colonel Bawr, maréchal général des logis de
l’arméè Hanovrienne; celles dé la Bavière, par
Finck ; celles dé la Bohême, parle major Millier,
& quantité d’autres cartes particulières des différens
pays de l’Allemagne, publiées à Nuremberg, à Aug-
bourg , à Berlin; celles du théâtre de la guerre en
Italie , par les ingénieurs du prince Eugene ; celles
de la Savoie & du Piémont, publiées par Jaillot, &c.
La plupart dès cartes qu’ori vient d’indiquer, ayant
été levées géométriquement, peuvent fervir à con-
ftruire des cartes militaires , ën faifânt d’avance des
extraits des campagnes qui auroht été faites dans
les pays qu’éllés repréfentent, en deflinahtfur une
plus grande échelle les parties de pays qu’oh devra
reconnôître, en cherchant les lieux élevés pour,
mieux découvrir le terrein, enqueftronnant les gens
de la campagne, en parcourant lé pâys de tout féns,
6c en voyant par foi-même tôu$ les objets qui méritent
attentio’n.
Lorfqu’on 'n’a point de cartes particulières , qü’o'ri
n’a pas le te'ms d’en lever, où que l’occafion né
permet pas d’opérer, on a recours aux cartes gériéraies.
Ôn y prénd les pofitiôhs qui paroiffent les
mieux déterminées ; on les trace à grarid-point .fur’
des feuilles féparées, & on fait une cafte à vue qu’om
accompagne d’un mémoire: Il n’y a pbint d’officieF
d’état-niâjor qui né doive fâvoir cette méthode, qui
eft on ne peut pas plus néceffaire, fur-tout evri carii-
pagne. ( M. D . L. R. )
.CARTÉLLE, f.-f.- ( Müjzque:') grande feuille dé
peau d’âné préparée, fur laquelle on entaille les’
traits dès portées, pôui*pouvoir y noter tout ce
qu’on Veut en compofant , & l’effacer enfuite avec
une éponge ; l’autre côté qui n’a point de portées ,
peut fèrvif à écrire & barbouiller, pourvu qu’on n’y
laifle pas- trop vieillir l’encre. Avéc une cartelle, un
compofiteur foigneux en a pour fa vie , & épargne'
bien dés rames de papier réglé : mais il y a ceci d’in-
Commodé , que la plume paflant continuellement fur
les lignes entaillées, gratte & s’émoûffe facilement.
Les carte lies viennent toutes de Rome ou de Nah
9 ( f ) ' , I .
CARuA , f. m. ( Hijloire naturelle. Botdriiqüe.')
efpece de cannelle du Malabar, très-bien gravée avec
la plupart de fes détails par Van-Rheede , dans forî
Hortus Malabaricüs , volume1 , imprimé en 16 78,
planche L V l l , page loy. Les Malabafes l’appellent
encore bahena ;lè s Brames tiqui. M. Linné dans fort
Syjlema natures. , imprimé e)i 1 76 7 , édition 12 ,
page z8 ü , lui donne le nom de laurus z cdjjid , foliis
iriplinervïis lanceolans ; & la confond avec l’ efpece'
figurée par M. Burmann dans fon Thefaurtis Zeyla-
nicus , imprimé en 17 3 7 ,/» ^ 63 planche X X V I I I ,
fous le nom de cinamomum perpétua fidrens folio te-
nuiore acuto. Mais ces deux plantes font différentes ,
comme l’on va eh juger. On là nomme cofthnurié'-
ment cannelle grife , cannelle faUvage, càhhclle Portu-
gaife ; fes fe uilles s’appellent malabathrunl & folium,
lndüm dans les boutiques*.
Le carua eft un arbre haut de vingt-cinq à trente
pieds, à racine pivotante ramifiée en. pliifieurs branches
horizontales, dont le bois eft blanc, dur, recouvert
d’une écorce cendré-roufle au-dehors, & rougeâtre
au-dedans.
Son tronc eft droit, haut de dix à douze pieds ,
d’un pied au plus de diamètre, couronné par une
cimelphéroïde épaiffe, formée par un grand nombre
de branches oppofées en croix , dont les jeunes font
, ouvertes fur un angle de 45 dégrés , & lés vieilles
horizontalement, à bois blanc, dur, recouvert d’une
I écorce verte d’abord, enfuite cendrée extériéuré-
ment, mais rougeâtre intérieurement.
Ses feuilles font oppofées deux à deux en croix,
au nombre de trois à quatre paires fur chaque branche
, elliptiques, pointues aux deux extrémités, longues
de quatre à lept pouces , deux à trois fois moins
larges , entières, à bords blanchâtres, affez épaiffes
fermes , fragiles, verd-foncées deffus , plus clair
deffous, relevées de trois nervures qui commencent
un peu au-deffus dè leur origine en allant jufqu’à
leur extrêihité , & portées d’abord fous un angle de
45 dégres, enfuite horizontalement fur un pédicule
demi-cylindrique, plat en-deffus, & douze à quinze
Fois plus court qu’elles. Dans leur première jeunèffe
elles font rougeâtres.
De f aiflëlle des feuilles fiîpérieures & du bout des
branches fortent des pânicules oppofées âuffï longues
que les feuilles, cômpoféës dé cinq à dix fleurs verd-
blanches, ouvertes horizorttâlemeht en etoile dé
trois lignes & demie de diamètre , portées fur un
pédicule cylindrique de cetté longueur.
Chaque fleur eft hermaphrodite polypétalë régulière
, difpofée au-deffous de l’ovaire. Elle confiftë
en un calice verd-blanchâtre d’une feule pièce per-
fiftante à tube très-court, partagé en fix divifions
triangulaires égalés, à peiné dé ihoitié plus longues
qué larges, & en douze étamines courtes, difpofées
fur deux ran<»s , & attachées au tube de ce calice.
Des fix étamines du fécond rang , qui eft l’inférieur,
trois ü cbiifbënf pour fé rapprocher de l’ovaire ;
celui-ci eft ovoïde, cotïfoHtie d’un ftigmatè rampant
fans ftyle* .
L’ôva’irè en mûriffant devient une bâté ovoïde
obtufe, longue de huit à neuf lignes , pfefcjii’tme fois
moins large , contenue comme fin glaftd dans fon
calice qui eft verd , épais , en clpche hémifphérique
une fois-plus court qu’e lle , & COUrOnné dé fix dents
obtufes. Cette baie eft liffè, luifànte , d’abord vefd-
brune, pointillée de -blanc ; enfuite blëue-brune à
chair v erte, à une löge ne s’ouvranr point, & contenant
une écorce cartilagineufe,ovoïde, obtufe, longue
de fix lignes, prefqu’une fois moins large , bleue-
rougeâtre à ahiancfe blëttâfre.
Culture. Le carùd croît’ communément au Malabar
dans'les terres fàblonneufes , fur-tout auprès de
Gochio. Il fleurit toiis les ans au mois de janvier &
fruôifle en mars. _
Qualités. Son bois n’a point d’odeur, mais l’écorcè
de fa racine , de fon tronc & de fes branches , ainft
que fes feuilles froiffées, répandent une odeur forte
de camphfé.
De. l’écorce.de fa racine on tire , par la diftiflatiôn,
du camphre &• une huile ; de celle du tronc on tire'
'fhuiTëappeflée communément huile dé cannelle. Celle
que l’on retire de fes feuilles peflèmbleàcelle du girofle
, & celle de féà fruitsreffemblè à celle du genievre
mêlée, avec itn peu de celte de cannelle & de celle
de girofle. De ces mêmes fruits cuits fur le feu, on
tire encore une huile graffe, épaiffe comme de la ciré
propre à faire des onguents & de la chandelle-
U f âges. Les dïverfés huiles que l’on tireainfi de
cet arbre , fur-tout celles de l’éeôrce , font très-anodines
& fouveraines, appliquées extérieurement,-
pour la paralyfie , la’ goutte & les douleurs des
membres. On les prend, auffi .intérieurement pour
î’afthme, les autres maladies du poumôn, lèsfievres
malignes, la gangrené, les,ulcérés malins,les rhu-
matifmesv fes vëhts 6C lés' coliques câuféès par le
froid; elles -font fudorifiquês : leur .odeur'arrête
l ’éternument çaufé par le rhume de cerveau.
L ’écorce de fa racine prife en décoûion ou en
pOudre, avec le miel ou le fucre, eft fouveraine pour
iguérir la toux humide pilée & .mêlée dans l’eau,
elle fournît un bâin utile pour la goutte. L’ëcorce de
fon tronc & de fes branches fe prend en décoâion
pour diffiper les vents. Le fuc exprimé dé fes feuilles,
bu avec le poivre & le fuere, calme les douleurs des
reins & dit bas-ventre quf font câufees par des vents.
La poudre de ces mêmësfénilles oit des fleurs fè boit
avec le fucre dans l’eau froide, pOUr diffipër les
vertiges. ■
Remarques. Hermann, qui a obfervé la cannelle de
l’île de Ceÿlan, qui ëii a rapporté des pieds qu’il a
cultivés dans fon jardin de Lëydê, convient qué le
carua dû Malabar en approche phts que toutes les
autres ëfpeces yqu’il en a toutes les qualités, mais à
un degré de force feulement inférieur, & que- d’ailleurs
ces deux plantes'fe teflemblent fort. Néanmoins
, comme il y a non feulement entre céS deux
plantes -, mais encore entre toutes celles qui donnent
une fortehle cannelle,des différencies qiii n’orit1 paS encore
été bien faifieS par les bottffiiftes ,> nOUS allons
rendre ces différences fenfibles 6ç reconhbfflhbles
au premier àfpe£l.
jDéuxieme efpece. KURÙ.N.DU- ou CANELLA.
Les hàbitans de Ceylän appellent du nom de
kurundu'ow kurudu , l’ârbfé'de la Cannéllë , que Pifori
appelle par corruption cuürudo-, 6c dont Hermann
a donné, fous lç nom àe oajfia cinnainomeß ßve einnamoTï,
dëttx figures affez médiocres, aux pages 12$
& 656 , (25 6 de Ion Montés Lügduno-batdvus, imprimé
èn 1687. Quelques-uns, au lieu de kurundu,
écrivent par corruption coronde &t ràfjé-coronde y c’eft
le canella Sc le cinnamomurh des boutiques, mais nori
pas lè cinnanibn des Hébreux , félon quelques auteurs.
M. Burmann, dans fon Thefturus Zeylanictts,
imprimé en 173 j -, page 62 , planche X X V I I , en a
fait graver une figure affez différente de celle de
Hermann * fous le nom de cinHamoiiium foliis lads
ovdtis frugifirum ; mais il s’eft trompé, c’eft celle de
la planche X X V LU qui répond â celle d’Hermanil;
M. Linné l’appelle laurus 1 cinndmörhüni, foliis tri-
nerviis, ovato-oblongis ; nervis Versus àpicem evanef-
centibüs; Syfiema natures, édit, i z 9 de 1767, pagé
z8o. -.
Voici en quoi le cannéllier ou le kurundu diffère
du carua. i°. il s’élève moins haut, n’ayant que vingt
à vingt-cinq pieds. En levant de terre, fes deux lobes,
au lieu de s’épanouir horizontalement, relient appliqués
parallèlement l’un contre l’autte, & couchés fur
un côté de la jeune tige. 20. Ses feuilles font obtufes ,
arrondies à leur origine, longues d’un pouce & demi
à déux pouces au plus , & une fois à Une fois 6c
demie moins, larges. 3°-. Leurs trois nervures commencent;
de même, un peu au-deflus de leur bafe ,
mais elles fe terminent à-peu-près vers le milieu de
leur longueur. 40. Elles font portées fur un pédicule
demi-cylindrique, neuf à dix fois feulement plus
court qu’elles. 50. Les pânicules des fleurs font Une
fois plus langues que les feuilles, & portent chacune
trente à quarante fleurs. 6?. Les baies fönt ovoïdes,
longues de quatre à cinq.lignes feulement*
Culture. Le kurundu ne fe trouve que dans l’île de
Ceylan , où les Hoilandois ne le cultivent que fur
la côté maritime , & feulement dans une étendue de
quatorze lieues, qui fuffit pour fournir de cannelle
tout le refte de la terre.
Qualités. Lorfqu’il eft en fleurs, il répand une
odeur très-fuave, qui s’étend à une grande diftance,
comme d’une à deuxlieueSr
Üfag&s. On n’écorce que les jeunes arbres de trois
ans, afin que la cannelle en foit plus fine, & cette cannelle
eft feulement l’écorce intérieure qui eft au-
deffous de l’écorce grife. Les arbres qu’on écorce en
entier périffent infailliblement, quoique quelques
auteurs aient avancé le contraire ; ce feroit en effet
un phénomène bien particulier que lé cannellièr fut
le feul arbre qui eût ce privilège , pendant que les
expériences nous apprennent que tous les autres
arbres qu’on a dépouillés entièrement de leur écor^
c e , & fur-tout dé l’écoree intérieure du liber,
qui eft la vraie cannelle, fe deffechent & meurent,
les uns plutôt, les autres plus tard, félon que le ter-
rein & l’atmofphere où ils font plantés, font plus
ou moins fecs. Voye^fes autres ufages décrits à l’ûr-
ticlè C anne lle, Dicl. raif. des Sciences, &c.
itrffîfieme' efpece. Nik aduw a la .
Les habitans de Cèylan appellent des. noms de
nikaduwala, ou nikadawalu, ou dawal-kurundu, une
autre efpece de -cannéllier , dont il a été gravé une
figure , fous le nom dé maal-eoronde ,k ou. cinnamo-p
muni fLorïdUm, cannelle fleurie, zu. volume I des A cia
riàiÜrk~dùriôforum, imprimé en 1727- M. Burmann
en a publie une en 1737 , dans fon fhefaurus Zeyla-
fiiciis , page 63 , planche X X V I I , & non pas planche
X X V LU , qui eft une tranfpofxtion, fous le nom de
'cinnàmôrhüm perpetùiïfiôrens, folio tenuioré acuto.
Cette èfpèce diffère de la cannelle proprement
dite,,en ce qitè;, r°: fes feuilles font plus làrges ,
longues d’un pouce & demi à trois pouces, à peine
une fois moins larges, verdâtres en- deffous ; z°. leurs
trois nervures ne vont guère que jufqu’au milieu de