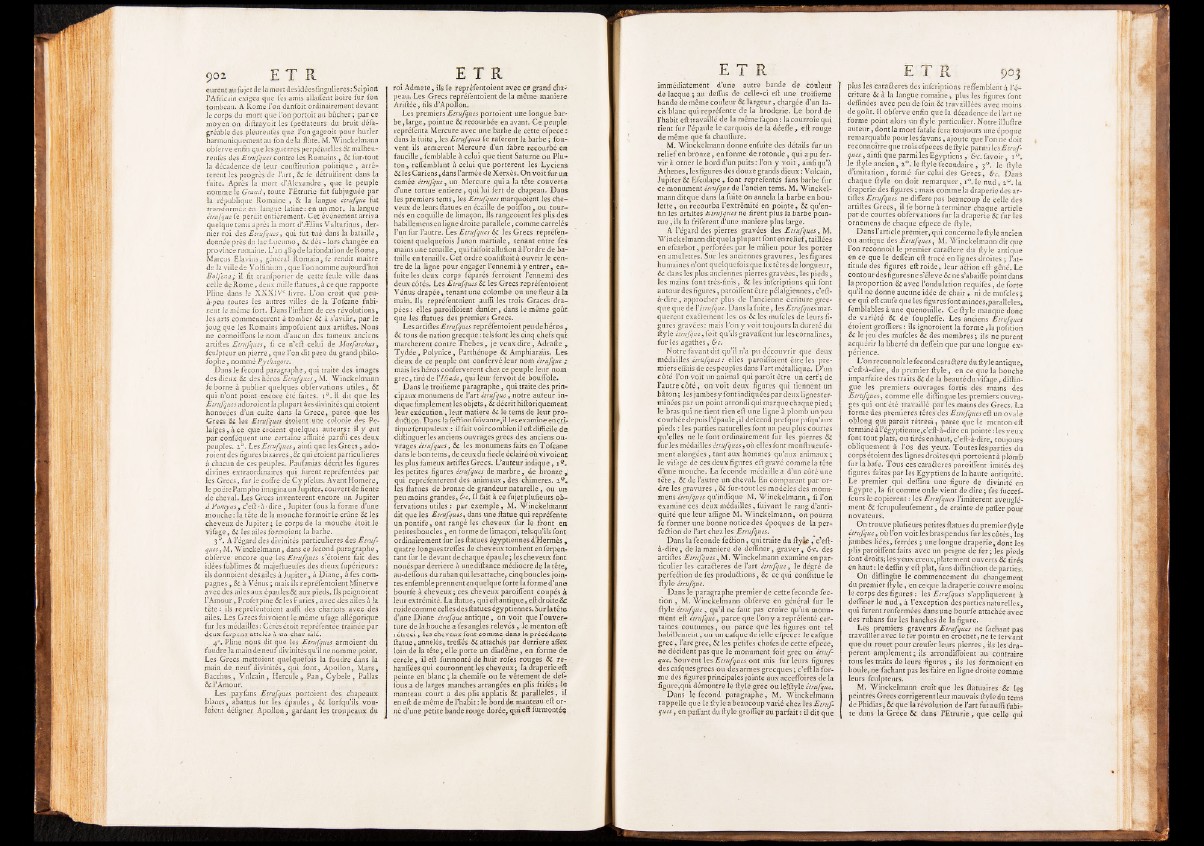
eurent au fujetde la mortdesidéesfingulieres:Scipiofl
l’Africain exigea que fes amis allaffent boire fur fon
tombeau. A Rome l’on danfoit ordinairement devant
le corps du mort que l’on portoit au bûcher ; par ce
moyen on diftrayojt les fpeâateurs du bruit défa-
gréable des pleureufes que l’on gageoit pour hurler
harmoniquement au fon delà flûte. M. Winckelmann
obferve enfin que les guerres perpétuelles & malheu-
reufes des Etrufques contre les Romains , & fur-tout
la décadence de leur conftitution politique , arrêtèrent
les progrès de l’art, & fe détruifirent dans la
fuite. Après la mort d’Alexandre , que le peuple
nomme le Grande toute l’Etrurie fut fubjuguée par
la république Romaine , & la langue étrufque fut
transformée en langue latine: en un mot, la langue
étrufque fe perdit entièrement. Cet événement arriva
quelque tems après la mort d’Æiius Vulturinus, dernier
roi des Etrufques, qui fut tué dans la bataille,
donnée près du lac Lucumo, & dès - lors changée en
province romaine. L’an 489 de lafondation de Rome,
Marcus Elavius, général Romain, fe rendit maître
de la ville de Volfinium, que l’on nomme aujourd’hui
BolJ'ena; il fit tranfporter de cette feule ville dans
celle de Rome, deux mille liâmes, à ce que rapporte
Pline dans le XXXIVe livre. L’on croit que peu-
à-peu toutes les autres villes, de la Tofcane fubi-
rent le même fort. Dans l’inftant de ces révolutions,
les arts commencèrent à tomber à s’avilir, par le
joug que les Romains impofoient aux artifles. Nous
ne connoiffons le nom d’aucun des fameux anciens
artifles Etrufques, fi cè n’efl celui de Mnefarchus,
fcuipteur en pierre, que l’on dit pere du grand philor
fophe, nommé Pythagore.
Dans le fécond paragraphe, qui traite des images
des dieux & des héros Etrufqucs, M. Winckelmann
fe borne à publier quelques obfervations utiles, &
qui n’ont point encore été faites. i° . Il dit que les
Etrufqucs adoroient la plupart des divinités qui étoient
honorées d’un culte dans la Grece,, parce que les
Grecs & les Etrufqucs étoient ; une ^colonie des Pe-
lafges,à ce que croient quelques auteurs: .il y eut
par confisquent une certaine affinité parmi ces deux
peuples. 20. Les Etrufques, ainfi que les Grecs, adoroient
des figures bizarres, & qui étoient particulières
à chacun de ces peuples. Paufanias décrit les figures
divines extraordinaires qui furent repréfentées par
les Grecs, fur le coffre de Cypfelus. Avant Homere,
le poète Pampho imagina un Jupiter, couvert de fiente
de cheval. Les Grecs inventèrent encore un Jupiter
à Pomyos, c’eft-à-dire , Jupiter fous la forme d’une
mouche : la tête de la mouche formoitle crâne & les
cheveux de Jupiter ; le corps de la mouche étoit le
vifage, & les ailes formoient la barbe.
3 A l’égard des divinités particulières des Etruf-
ques, M. Winckelmann, dans ce fécond paragraphe,
obferve encore que les Etrufques s ’étoient fait des
idées fublimes & majeflueufes des dieux fupérieurs:
ils donnoient désailes à Jupiter , à Diane, à fes compagnes
, & à Vénus ; mais ils repréfentoient Minerve
avec des ailes aux épaules & aux pieds. Ils peignoient
l’Amour, Profer pine & les Furies, avec des ailes à la
tête : ils repréfentoient aufîî des chariots avec des
ailes. Les Grecs fuivoient le même ufage allégorique
fur les médailles : Cérès étoit repréfentée traînée par
deux ferpens attelés à un char ailé.
4°. Pline nous dit que les Etrufqucs armoient du
foudre la main de neuf divinités qu’il ne nomme point.
Les Grecs mettaient quelquefois la foudre dans la
main de neuf divinités, qui font, Apollon, Mars,
jBacchus,,. Vulcain, Hercule, Pan, C yb e le , Pallas
& l’Amour.
Les payfans Etrufqucs portoient des chapeaux
blancs, abattus fur les épaules, &C lorfqu’ils vou-
loient défigner Apollon , gardant les troupeaux du
roi Admete, ils le repréfentoient avec ce grand chapeau.
Les Grecs repréfentoient de la même maniéré
Arifiée, fils d ’Apollon.
Les premiers Etrufques portoient une longue barbe,
large, pointue & recourbée en avant. Ce peuple
repréfenta Mercure avec une barbe de cette efpece :
dans la fuite, les Etrufques fe raferent la barbe ; fou-
vent ils armèrent Mercure d’un fabre recourbé en
faucille, femblable à celui que tient Saturne ou Plu-
ton, reflemblant à celui que portèrent les Lyciens
& les Cariens, dans l’armée de Xerxès. On voit fur un
camée ètrufquc, un Mercure qui a la tête couverte
d’une tortue entière, qui lui fert de chapeau. Dans
les premiers tems, les Etrufques marquoient les cheveux
de leurs ftatues en écaille de poiffon , 011 tournés
en coquille de limaçon. Ils rangeoient les plis des
habillemens en ligne droite parallèle, comme carrelés
l’un fur l’autre. Les Etrufques & les Grecs repréfentoient
quelquefois Junon martiale, tenant entre fes
mains une tenaille, qui faifoit allufion à l’ordre de bataille
en tenaille. Cet ordre cohfiftoità ouvrir le centre
de la ligne pour engager l’ennemi à y entrer, en-
fuite les deux corps féparés ferroient l’ennemi des
deux côtés. Les Etrufques & les Grecs repréfentoient
Vénus drapée, tenant une colombe ou une fleur à la
main. Ils repréfentoient auffi les trois Grâces drapées:
elles paroifloient danfer, dans le même goût
que les ftatues des premiers Grecs.
Les artiftes Etrufques repréfentoient peu de héros
& tous de nation grecque : télsfont les cinq chefs qui
marchèrent contre Thebes, je veux dire, Adrafte ,
T yd é e , Polynice, Parthénope & Amphiaraiis. Les
dieux de ce peuple ont confervé leur nom étrufque ;
mais les héros conferverent chez ce peuple leur nom
grec, tiré de l’Iliade, qui leur fervoit de bouffole. i
Dans le troifieme paragraphe, qui traite des principaux
monumens de l’art étrufque, notre auteur indique
Amplement les objets, & décrit hiftoriquement
leur exécution, leur matière & le tems de leur pro-,
duftion. Dans la feftion fuivante,il les examine en critique
fcrupuleux : il fait voir combien il eft difficile de
diftinguer les anciens ouvrages grecs des anciens ouvrages
etrufques, & les monumens faits en Tofcane
dans le bon tems, de ceux du fiecle éclairé où vivoient
les plus fameux artiftes Grecs. L’auteur indique, 1
les petites figures etrufques de marbre, de bronze
qui repréfenterent des animaux, des chimères. 2^.
les ftatues de bronze de grandeur naturelle, ou un
peu moins grandes, &c. Il fait à ce fujet plufieurs ob-,
fervations utiles : par exemple, M. Winckelmann
dit que les Etrufques, dans une ftatue qui repréfente;
un pontife, ont rangé les cheveux fur le front en
petites boucles , en forme de limaçon , telsqu’ils font
ordinairement fur les ftatues égyptiennes d’Hermès ,
quatre longuestreffes de cheveuxtombentenferpen-
tant fur le devant de chaque épaule ; les cheveux font
noués par derrière à une diftance médiocre de la tête,
au-deffous du ruban qui les attache, cinq boucles jointes
enfemble prennent en quelque forte la forme d’une
bourfe à cheveux; ces cheveux paroiffent coupés à
leur extrémité. La ftatue, qui eft antique, eft droite &c
roide comme celles des ftatues égyptiennes. Sur la tête
d’une Diane étrufque antique, on voit que l’ouverture
de la bouche a fes angles relevés , le menton eft:
rétréci, les cheveux font comme dans la précédente
ftatue, annelés, trefles & attachés par derrière affez
loin de la tête ; elle porte un diadème, en forme de
cercle, il eft furmonté de huit rofes rouges & re- -.
hauffées qui couronnent les cheveux; la draperie eft
peinte en blanc ; la chemife ou le vêtement de def-
fous a de larges manches arrangées en plis frifés ; le
manteau court a des plis applatis & parallèles, il
en eft de même de l’habit : le bord du manteau eft or-
ué d’une petite bande rouge dorée, qui eft furmontée;
immédiatement d’une autre bande de couleur
de lacque,; au deffus de celle-ci eft une troifieme
bande de même couleur & largeur, chargée d’un lacis
blanc qui repréfente de la broderie. Le bord de
l’habit eft travaillé de la même façon : la courroie qui
tient fur l’épaule le carquois de la déeffe , eft rouge
de même que fa chauflure.
M. Winckelmann donne enfuite des détails fur un
relief en bronze, en forme de rotonde, qui a pu fer-
vir à orner le bord d’un puits: l’on y v o it , ainfi qu’à
Athènes , les figures des douze grands dieux : Vulcain,
Jupiter & Efculape, font reprefentés fans barbe fur
ce monument étrufque de l’ancien tems. M. Winckelmann
dit que dans la fuite on annela la barbe en boulette
, on recourba l’extrémité en pointe, & qu’en-
fin les artiftes Etrufques ne firent plus la barbe pointue,
ils la friferent d’une maniéré plus large.
A l’égard des pierres gravées des Etrufques, M.
Winckelmann dit que la plupart font en relief, taillées
en efcarbot, perforées par le milieu pour les porter
en amulettes. Sur les anciennes gravurés, les figures
humaines n’ont quelquefois que fix têtes de longueur,
& dans les plus anciennes pierres gravées, les pieds,
les mains font très-finis, & les infcriptions qui font
autour des figures, paroiffent être pélafgiennes, c’eft-
à-dire , approcher plus de l’ancienne écriture grecque
que de Y étrufque. Dans la fuite, les Etrufques marquèrent
exactement les os & les mufcles de leurs figures
gravées: mais l’on y voit toujours la dureté du
ftyle étrufque bit qu’ils gravaffent fur les cornalines,
fur les agathes, & c ..
Notre favant dît qu’il n’a pu découvrir que deux
médailles étrufques: elles paroifloient être les premiers
effais de ces peuples dans l’art métallique. D ’un
côté l’on voit un animal qui paroît être un cerf; de
l’autre cô té, on voit deux figures qui tiennent un
bâton ; les jambes y font indiquées par deux lignes terminées
par un point arrondi qui marque chaque pied ;
le bras qui ne tient rien eft une ligne à plomb un peu
courbée depuis l’épaule, il defcena prefque jusqu’aux
pieds : les parties naturelles font un peu plus courtes
qu’elles ne le font ordinairement fur les pierres &
furies médailles étrufques, où elles font monftru.eufe-
ment alongées , tant aux hommes qu’aux animaux ;
le vifage de ces deux figures eft gravé comme la tête
d’une mouche. La fécondé médaille a d’iin côté une
tê te , & de l’autre un cheval. En comparant par ordre
les gravures , & fur-tout les modèles des monumens
étrufques qu’indique M. Winckelmann, fi l’on
examine ces deux médailles, fuivant le rang d’antiquité
que leur afligne M. Winckelmann, on pourra
fe former une bonne notice des époques de la perfection
de l’art chez les Etrufques.
Dans la fécondé feCtion, qui traite du fty4e ,Veft-
à-dire, de là maniéré de deflîner, graver, &c. des
artiftes Etrufques, M. Winckelmann examine en particulier
les câraCteres de l’art étrufque, le dégré de
perfection de fes productions, ôc ce qui conftitue le
ftyle étrufque.
Dans le paragraphe premier de cette fécondé fec-
tion , M. Winckelmann obferve en général fur le
ftyle étrufque , qu’il ne faut pas croire qu’un monument
eft etrufque, parce que l’on y a repréfenté certaines
coutumes, ou parce que les figures ont tel
habillement, ou un calque de telle efpece : le cafque
g rec , l’arc grec, & le s petifes ehofes.de cette efpece,
ne décident pas que le monument foit grec ou étrufque.
Souvent les Etrufques ont mis fur leurs figures
des cafques grecs ou des armes grecques ; c ’eft la forme
des figures principales jointe aux acceffoires de la
figure,qui démontre le ftyle grec ou Iejftyle étrufque.
Dans le fécond paragraphe, M. Winckelmann
rappelle que le ftyle a beaucoup varié chez les Etrufques
, en paffant du ftyle groflier au parfait : il dit que
plus les èaraéteres dés infcriptions feflembient à l’écriture
& à la langue romaine , plus les figures font
deflinées avec peu de foin & travaillées avec moins
de goût. Il obferve enfin que la décadence de Fart ne
forme point alors un ftyle particulier. Notre illuftre
auteur, dont la mort fatale fera toujours une époque
remarquable pour les favans, ajoute que l’on ne doit
reconnoître que trois efpeces de ftyle parmi les Etrufques
, ainfi que parmi les Egyptiens , &c. favoir, 1
le ftyle ancien, 2°. le ftyle iecondaire, 30. le ftylê
d’imitation , formé fur celui des Grecs, &c. Dans
chaque ftyle on doit remarquer, i° . le nud, i ° . la
draperie des figures ; mais comme la draperie des artiftes
Etrufques ne différé pas beaucoup de celle des
artiftes Grecs, il fe borne à terminer chaque article
par de courtes obfervations fur la draperie & fur les
ornemens de chaque efpece de ftyle.
Dans l’article premier, qui concerne le ftyle ancien
ou antique des Etrufques, M. Winckelmann dit que
l’on reconnoît le premier caraétere du ftyle antique
en ce que le deffein eft tracé en lignes droites ; l’attitude
des figures eft roide, leur aétion eft gênéi Le
contour des figures ne s’élève & né s’abaiffe point dans
la proportion &aVec l’ondulation requifes, de forte
qu’il ne donne aucune idée de chair, ni de mufcles ;
ce qui eft caufe que les figures font minces,parallèles,
femblablës à une quenouille. Ce ftyle manque donc
de variété & de foupleffe. Les anciens Etrufques
étoient groffiers : ils ignoroient la forme ,1a pofitioii
& le jeu des mufcles & des membres; ils ne purent
acquérir la liberté du deffein que par une longue expérience.
L’on reconnoît le fécond caraftere du ftyle antique,’
c’eft-à-dire, du premier ftyle, en ce que la bouché
imparfaite des traits & de la beauté du vifage ,-diftin-
gue les premiers ouvrages fortis des’ mains des
Etrufques, comme elle distingue les premiers ouvrages
qui ont été travaillé parles mains des Grecs. La
forme des premières têtes des Etrufques eft un ovale
oblong qui paroît rétréci, parce que le menton eft
terminé à l’égyptienne,c’eft-à-dire en pointé : les yeux
font tout plats, ou tirés en haut, c’eft-à-dire, toujours
obliquement à l’os des yeux. Toutes les parties du
corps étoient des lignes droites qui portoient à plomb
fur la bafe. Tous ces carafterès paroiffent imités des
figures faites par les Egyptiens de la haute antiquité.
Le premier qui deflina une figure de divinité eri
Egypte, la fit comme on le vient de dire ; fes fuccef-
feùrs le copièrent : les Etrufques l’imiterent aveuglément
& fcrupuleufement, de crainte de paffer pouf
novateurs.
On trouve plufieurs petites ftatues du premier ftylê
étrufque, où l’on Voit les bras pendus fur les côtés, les
jambes liées, ferrées ; une longue draperie, dont les
plis paroiffent faits avec un peigne de fer ; les pieds
font droits; les yeux creux,platement ouverts & tirés
en haut : le defliny eft plat, fans diftinétion de parties';
On diftingùe le commencement du changement
du premier ftyle, en ce que la draperie couvre moins
le corps des figures : les Étrufques s’appliquèrent à
deflîner le nud, à l’exception desparties naturelles,
qui furent renfermées'dans une bourfe attachée avec
des rubans fur les hanches de la figure.
Les premiers graveurs Etrufques ne facliant pas
travailler avec le fer pointu en crochet, ne fe fervant
que dû rouet pour creufer leurs pierres ,nls les drapèrent
amplement ; ils arrondiffoient au contraire
tous les traits de leurs figures , ils les formoient en
boule, ne fachant pas lés faire en ligne droite Comme
leurs fettipteurs.
M. Winckelmann croit que les ftatüaires & les
peintres Grecs corrigèrent leur mauvais ftyle du tems
de Phidias ; & que la révolution de l’art fut aufli fubi-
te dans la Grece & dans l’Etrurie, que celle qui