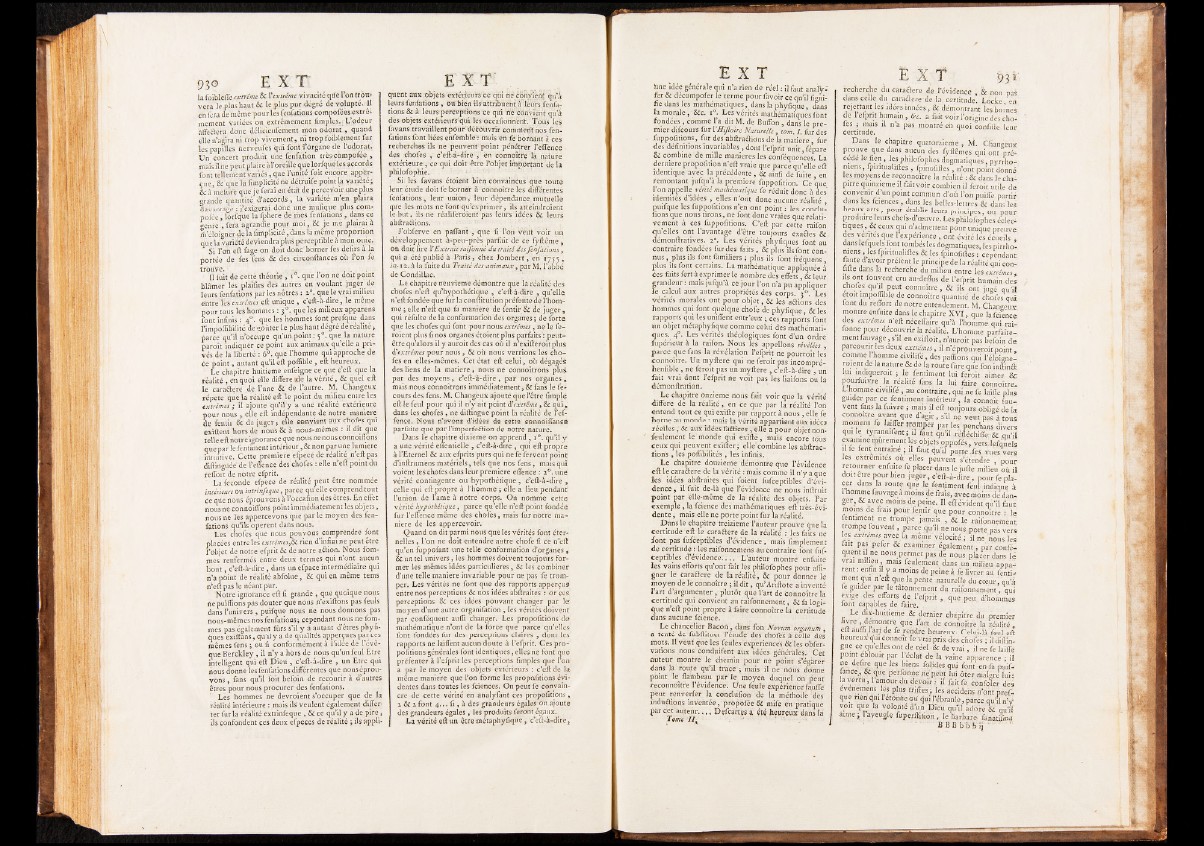
la foibleffe «^rre/we & l’extrême vivacitéqiM Ton tron* I
vera le plus haut & le plus pur dégré de volupté. Il j
en fera de'mêmé'pour les fenfations compoféesextrêv
mement variées ou extrêmement fimples.. L’pdeur
àffe&erà d'onc délicièufement mon odorat , quand
elle n’agira ni trop vivement, rii trop foiblement fiir
les papilles nerveufes qui font l'organe de l’odorat.
Un concert produit une. fenfation très-çampofée ,
mais il né peut plaire à l’oreille que lorfque les accords
font tellement variés, que l’unité foit encore appër-
tu e , & que là üttiplicité néd#rijife point I4, variétés
& à méfüre qlie jë ferai en'état de percevoir,utie plus
orandè quantité d’accôrds, la variété m’ên plaira
davantage : j’èxîgerài donc une mufique plus comp
o s é , lôrfqüè la fphere d émes fenfations.; dans ce
genrefera agrandie pour moi, .& je me plairai à
riféloigner de la fimplicité , dans là même proportion
que là vàri’efé deViendra plüs perceptible à mon ouie.
Si l’oh eft fage on doit donç'.borner fes defirs à la
portée de fes leris & des circonftances oîrlfon le
trouvé. ' ‘ , " . . f. -r, „
Il fuit de cettè théorie , i ■. que 1 on ne doit point
blâmer les plâifirs dés au très en voulant juger de
leurs fenfations par les nôtres : 2°. que le vrai milieu
entre lès extrêmes eft unique , c’eft-à-dire, le meme
pour tous les hommes : 3 0. que les milieux apparens
font infinis; 40. que les hommes font prefque dans
l’impoflibilité dè gôûter le plus haut dégré de réalité
parce qu’il nfoccupe qu’un point :5e. que la nature
paroît indiquer ce point aux animaux qu’elle a privés
de la liberté : 6°; que l’homme qui approche de
te point, autant qu’il eft poflible, eft heureux.
Le chapitre huitième enfeigne ce que c’eft que la
réalité , en quoi elle différé «de la vérité, & quel eft
le câràfteré de l’une & de l’autre. M. Changeux
répété que la réalité eft'le point du milieu entre les
extrêmes ; iî 'ajoute qu’ iî y a une réalité extérieure
pour nous ,,elle eft indépendante de notre maniéré
de fentir & de juger, elle convient aux choies qui
exiftent hors de nous & à nôus-menies : il dit que
telle eft notre ignorance que nous ne nous cônnoiffons
que par le fentiment intérieur, & non par une lumière
intuitive. Cette première efpece de réalité n’eft pas
diftinguéé de l’effence des'ehofes : elle n’eft point du
t effort de notre èfprit.
La fécondé efpece de réalité peut etre nommée
intérieure ou intrinfeque, parce qu’elle comprend tout
Ce que nous éprouvons à l’ocçafion des etres. En effet
nous ne connoiffons point immédiatement les objets,
nous ne lés appercevons que par le moyen des fenfations
qu’ils opefent dans nous.
Les choies que nous pouvons comprendre font
placées entre les extrêmesfic rien d infini ne peut etre
l’objet de notre efprit &c de notre aôion. Nous fouîmes
renfermés entre deux termes qui n’ont aucun
b o u t , c’eû-à-dire, dans un efpace intermédiaire qui
n’â point de réalité abfolue, & qui en même teins
n'eft pas le néant pur. , t
Notre ignorance eft fi grande , que quoique nous
tie puiftions pas douter que nous n’exiftons pas feuls
dans l’univers , puifque nous ne nous donnons pas
fious-mêmes nos fenfations; cependant nous ne forcîmes
pas également fùrs s’il y à autant d’êtres phyfi-
ques exiftans, qu’il y a de qualités apperçues par ces
mêmes fens ; ou fi conformément à l’idée de l’évêque
Berckley , il n’y a hors de nous qu’un feul Etre
intelligent qui eft Dieu , c’eft-à-dire , un Etre qui
nous dPnne les fenfations différentes que nous éprouvons
, fans qu’il foit befoin de recourir à d’autres
êtres pour nous procurer des fenfations.
Les hommes ne devroient s’occuper que de la
réalité intérieure : mais ils' veulent également differ-
ter fur la réalité extrinfeque , & ce qu’il y a de pire »
ils confondent ces deux efpeces de réalité ; ils appliqtient
aux objets extérîeuisfce qui né éHnviënf qu’a
leurs fenfations, ôifbieri ^attribuéiii^lJ^.Tenfa;
tions & à. leurs perceptions “ce qui 'heébrivfënf qu’à
des objets extérieu/à‘qui, lés- occafiotinèiiit. Tous les
favans travaillent pôüf"déëôiivrir commeiït' nos fenfations
font liées enfêïhblë1: mais ‘en fé bornant à ceij
recherches ils ne peuvent point pénétrer l’efTence
des ehofes ;■ c’eft-à-dirë en connoîtt'ç i â nature
extérieure ; ce qui doit être l’objet important de la
philofophie.
Si. les favans étoient bien convaincus que toute
leur étude doitfe borner a connoître les differentes
fenfations, leur union , leur dépendance, mutuelle
que les mots ne font qu’exprimer, ils atteindroient
le but, ils ne réaliferoieht pas leurs idées & leurs
abûraétions.
J’obferve en paffant-, que fi l’on veut voir un
développement à-peu-près parfait de ce fÿflême „
on doit lire M Extrait raifonnê du traité des fenfations 9
qui a été publié à Paris, chez Jombërt, en 17 5 5 ,
in-12. à la fuite du Traité des -animaux, par M. l’abbé,
de CondiUac-.
Le chapitre neuvième démontre que là réalité des
ehofes n’eft qu’hypothétique , c’eft-à-dire , qu’elle
n’eft fondée que fur la conftitution préfente de l’homme
; elle n’eft que fa manière de fentir oc.de juger,
qui réfulte de la conformation dés organes ; de forte
que les ehofes qui font pour nous extrêmes, ne le fe-
roient plus fi nos organes étoient plus parfaits peut-
être qu’alors il y anroit des cas oit il n’exifteroitplus
d'extrêmes pour nous, & ôîi nous verrions les cho-
fes en elles-mêmes. Cet état eft celui, oh dégagée
des liens de la matière * nous ne connoîtrôns plus,
par des moyens, c’eft-à-dire , par nos organes
mais nous connoîtrons immédiatement, & fans le le*
cours des fens. M. Changieux ajouté quel’êtfe fimplè
eft le feul pour qui il n’y ’ait point d'extrême, & qui,
dans les ehofes , ne diftingue point la réalité de l’effence.
Nous n’avons d’idées de cette .connôiffance
parfaite que parrimperféélion de notre nature.
Dans le chapitre dixième on apprend , i° . qu’il y
a une vérité effentielle , c’eft-à-dire , qui éft propre
à l’Eternel & aux efprits purs qui ne fe fervent point
d’inftrumèns matériels, tels que noS fens, mais qui
voient les ehofes dans leur première effence : 20. uné
vérité contingente ou hypothétique, c’eft-à-dire ,
celle qui eft propre à l'homme ; elle a lieu, pendant
l’union de l’ame à notre corps. On nomme cette
vérité hypothétique, parce qu’elle n’eft point fondée,
fur l’effence même des ehofes, mais fur nôtre maniéré
de les appercevoir.
Quand on dit parmi nous que lés vérités font éternelles
, l’on ne doit entendre autre chofe fi cè n’eft!
qu’en fuppofant une telle conformation d’organes i
& un tel univers, les hommes doivent toujoiirs former
les mêmes idées particulières, & les combiner
d’une telle maniéré invariable pour ne pas fe tromper.
Les vérités ne font que des rapports apperçu®
entre nos perceptions & nos idées abftraites : ôr ces
perceptions & ces idées pouvant changer par lô
moyen d’une autre organifation , les vérités dôivent
par conféquent auffi changer. Les propofitions de»
mathématique n’ont de la force que parce qu’elles
font fondées fur des perceptions claires , dont. les
rapports ne laiffent aucun doute à l’efprit. Ces propofitions
générales font identiques, elles ne font que
préfenter à l’efprit les perceptioris fimples que l’on
a par le moyen des objets extérieurs : c’eft de la
même maniéré que l’on forme les propofitions évidentes
dans toutes les fciences. On peut fe convaincre
de cette vérité en aftalyfant ces propofitions,
2 & 2 font 4 ... fi , à des grandeurs égales on.ajoute
des grandeurs égales , les produits feront égaux.
La vérité eft un être métaphyfique, ‘c’eft-à-dire >
hne idée générale qui n’a rien de réel ; il faut analy-
fèr & décompofer le terme pour favoir ce qn’il lignifie
dans les mathématiques, dans la phyfique, dans
la morale, &c. i° ; Les vérités mathématiques font
fondées , comme l’a dit M. de Buffon , dans le premier
difeours fur l'Hiftoire Naturelle, toin. I. fur des
fuppofitions, fur des abftraôiôns de la matière fur
des définitions invariables , dont l’efprit unit, fépare
& combine de mille maniérés les conféquences. La
dernière prôpofition n’eft vraie que parce qu’elle eft
identique avec la précédente, 6c ainfi de fuite , en
remontant jufqu’à la première fuppofition. Ce que ’
l’on appelle vérité mathématique fe réduit donc à des
identités d’idées , elles n’ont donc auéune réalité ,
puifque les ftippofitions n’en ont point : les concluions
que noiis tirons, ne font donc vraies que relativement
à ces fuppofitions. C’eft par cette raifon
qu’elles ont l’avantage d’être toujours éxaéles &
démonftratives. 2*. Les vérités phyfiques font au
Contraire fondées fur des faits , Sc plus ils font connus
, plus ils font familiers ; plus ils font fréquens ,
plus ils font certains. La mathématique appliquée à
Ces faits fert à exprimer le nombre des effets & leur
grandeur : mais jufqu’à ce jour l ’on n’a pu appliquer
fe^ calcul aux autres propriétés des corps. 30. Les
Vérités morales ont pour objet, & les adions des
hommes qui font quelque chofe de phyfique, & les
rapports qui les unifient entr’eux ; ces rapports font
un objet métaphyfique comme celui des mathématiques.
40. Les vérités théologiques font d’un ordre
fupérieur à la raifon. Nous les appelions révélées ,
parce que fans la révélation l’efprit ne pourroit les
connoître. Un myftere qui ne feroit pas incômpré-
, henfible, ne feroit pas un myftere , c’eft-à-dire , un
fait vrai dont l’efprit ne voit pas les liaifons ou la
démonftration.
Le chapitre onzième nous fait voir que la vérité
différé de . la réalité ^ en te que par la réalité l’on
entend tout ce qui exifte par rapport à nous , elle fe
borne au monde : mais la vérité appartient aux idées
réelles, & auk idées fa&ices , elle a pour objet npn-
ieulèméht le monde qui èxiftê, mais encore tous
ceux qui peuvent éxifter; 'elîefCombine les àbftrac-
tions , les pôlîibilités , les infinis.
Le chapitre douzième démontre que l’évidence
eft le caraàere de la vérité : mais comme il n’y a que
les idées abftraitës qui fôient fufceptiblés d’evi-
dence, il fuit de-là que Tévidènce ne nous inftruit
point par elle-même de la réalité des objets. Par
exemple, la frieiice des mathématiques eft très-évidente
, mais elle ne porte point fur la réalité.
Dans le chapitre treizième Tàuteur prouve qtièla
certitude eft le caraftere de la réalité : les faits ne
font pas fufceptibles d’évidence, mais Amplement
de certitude : les raifonnemens au contraire font fuf-
ceptibles d’évidence. ; . . L’autéur montre enfuite
les vains efforts qu’ont fait lès philofophes pour a ligner
le taraélere de la réalité, & pour donner le
moyen de le connoître ; il dit, qu’Ariftote à inventé
l’art d’argumenter, plutôt que l ’art de Connoître la
certitude qui convient au raifonnement, & fa logique
n’eft point propre à faire connoître là cettittide
dans aucune feience.,
Le chançeliér Bacon, dans ibii Novuhi or'ganurn ;
a tenté de fubftiruer l’étude dès ehofes “à celle des
mots. Il veut que les feules1 expériences & les obfer-
vations nous'cqnduifent aux idées générales. Cet
auteur montre le chemin pour nè point s’égarer
dans la rou;te qu’il trace ; mais il ne riôiis donne
point le flambeau par le moyen duquel ôn peut
feconhdîti'e l’évidence. Üne feule expérience'faiuffè
peut renverfer la conclufiôn de la méthode :dès
îndiiéfions inventée,-propôfée & mife en pratique
par cet auteur.. , . Dçfcartes a été fieurçux dans là
Tçme I I i
recherche du caraâere de l’évidence , & non pa^
dans celle du caràaere-de la certitude. Loche, en
rejertant les idées innées, & démontrant lesbornes;
de i eiprit humaiti, &c. a fait voir 1 origine des cho.
fes ; mais il n’â pas montré eh quoi conlifle leur
Certitude. ■
Dans lé chapitre quatôrzienie , ,M. Changeux
prouve que dans aucun des lyttêmes qui ont pre-
('S-^ /ier?, ^es philofophes dogmatiques, pyrrho-
mens, Ipintuahfles , fpinofifles , n’ont point donné'
les moyens dé reconnoitre la réalité. : & dans le chapitre
quinzième il faitxoir combien il feroit utile de
Convenir d’un point commun d’oit l’on puiffe. partir
dans les fciences , dans les belles-lettrés & dans1 les'
Beaux arts, pour établir leurs principes, ou pour
produire leursdjefs-d’oeuvre. Lesphilofpphes éclec-t
tiques , & ceux qui n’admettent pour unique preuve
des vérités que l expérience ,,ont,évité les écueils 4
dans lelquels font tombés les dogmatiques, les pirrho-
ntens, les fpiritualiftes & les fpinofilles : cependant
faute d avoir prerent le principe.delà réalité qui con-
iilte dans la recherche du milieu entre les extrêmes ,
ils ont louvent cru au-defliis de l’efprit humain des .
ehofes, qu’il peut connpâtre , & iis ont jugé qu’il
etoif impoffible de connoître quantité de chqfes qui
■ font du reffort de notre entendement. M. Changeux
mofitre enfuite dans Jé chapitre XV.Î , que iafcience'
des extrêmes n’eft néceffaire qu’à l’homme, qui jai-r
tonqe pour decouvrtr la réalité. L’homme patfaite^i
ment fauvage, s’il en exifioit, n’auroit pas befoin de
parcourir les deux extrêmes, il n’éprouveroit point »
; Comme l’homme civilifé, des payions, qui l’éloigne-
roient de la nature & de la route fûre que fon inftinct
lui indiqueroit ; le fentiment lui feroit. aimer &
ppurfuiyre la réalité fans la lui faire Connoître^
L homme ctvihfé , au contraire, qui ne fe laide plus
guider par ce fentiment intérieur, la connqît fou-
vent fans la fuivre ; mais“il eft. toujoursobligé de ln
c|nno,tre avant que d’agir ,,s’il ne. Veut pas B tous
momens fe laiffer tromper par les’ penchaqs divers
quiie tyranmfent; il Sut Ü W W W ’!
M m M B oppq^s;, Verslkfquels
ilfe fent entraîne ; il faut <4i.’U porte Vés, vues vers
les extrémités dit elles peuvent s’é ten d re 'p o u r
retourner enfuite fe placer dans le jufte milieu bii il
doit etre pour bien juger, c’efl-à -d ire p o u r fe plâ- '
cer dans la route que ,le„fentjment.fenl indique à
1 Homme fauvàge à moins de fra'ié/avec méins dqdln-
|erj & avec mom?. de peine, IV effévidém W Ü faut
mamS .de frais pour fentir que pour connoître : le
fentiment ne trompe jamais , & le raifonnçmént
trompe fouvent, parce qu’il,me nous, porte pas vers
les extrêmes zvèt la même W I H M H
fait fias pefer & examiner également'; paV confé-
quentil ne nous permet p'as,'de nous plâcerdans lé
vfai milieu mais feulement dans un.miÜeuéappé:
t o t i.enhtl il y a moins de peine à fe livrer au fenti-
irierit qui n eft que la peiite naturelle du coeur, qu’à
le guider par le tâtonnement du raifonnement, qui
èxige.des efforts de l’e fp rit, que peu . d’hommes
lont capaôles de faire.
Le dix-hiutieme & defhier chapitre du premier
H , “ montre quç j'att de conrioîtrê'la réalité,
elt auffi 1 art de fe rendre heureux; Celui,là feul eft
heureuxSqm conrtdirleVrai prix des cfioïes ; iî diftin-
gue cç qu’elles ont de réel & de vrai , il ne fe laiffë
point eblodir par l'éclat-de la vaine apparence : il
H nefire .que Ies biens fqlides qui font en fa puif-
ianc^, & que peHdiine'ne peitf lui ôter niàlgré lui;
la vertu ', l'amour du devdîi i il faitfe' épnfoler des
événem^ns lês plus frifïés; les àccidehs n’ont p iéC
que nen 4111 l’etdhne du quiTébrariiè, pàrce qu’il nV
V.01t t S volonté d’iin Dieu qu’il adoré & qu’il
ainiej 1 aveugle fujetftitiôii, lé harhace, fànattfoi«
B B B b b E i j .....