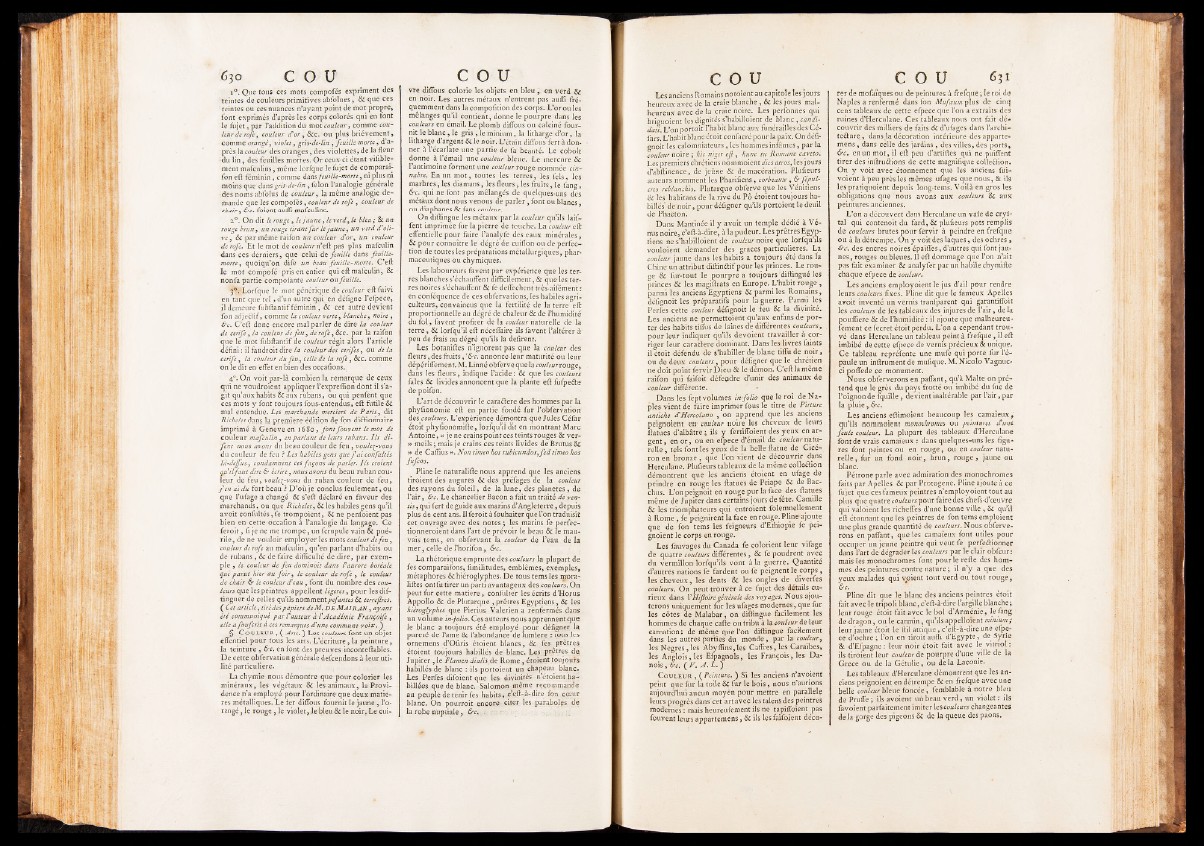
i °. Que tous ces mots compofés expriment des
teintes de couleurs primitives absolues, 6c que ces
: teintes ou ces nuances n’ayant point de mot propre,
font exprimés d’après lés corps colorés qui en font
le fujet, par l’addition du moi couleur, comme couleur
de rofe, couleur (for, &c. Ou plus brièvement,
comme orange, violet, gris-de-lin, feuille morte, d a-
près la couleur des oranges, des violettes, de la fleur
;du lin, des feuilles mortes. Or ceux-ci étant vifible-
ment mafculins, même lorfque le fujet de comparai-
fon eft féminin, comme dan % feuille-morte, ni plus ni
moins que dans gris-de-lin, félon l’analogie générale
dès noms abfolus de couleur, la même analogie demande
que les compofés, couleur de rofe , couleur de
chair, &c. foient aufli mafculins.
2°. On dit le rouge , le jaune, le verd, le bleu ; & un
rouge brunt un rouge tirant fur le jaune, un verd d olive
, 6c par même raifon un couleur d'or, un couleur
de rofe. Et le mot de couleur n’eft pas plus mafculin
dans ces derniers, que celui de feuille dans feuille-
morte , quoiqu’on dife un beau feuille-morte. C’eft
le mot c'ompofé pris en entier qui eft mafculin, 6c
non fa partie compofante couleur ou feuille.
3'*h Lorfque le mot générique de couleur eft fuivi
en tant que t e l , d’un autre qui en défigne l’efpece,
il demeure fubftantif féminin , 6c cet autre devient
fon adjeétif, comme la couleur verte, blanche, noire ,
&c. C’eft donc encore mal parler de dire la couleur
de cerife, la couleur de feu 9 de rofe, & c. par la raifon
que le mot fubftantif de couleur régit alors l’article
■ défini : il faüdroit dire la couleur des cerifes, ou de la
cerife, la couleur du feu9 celle de la rofe , &c. comme
on le dit en effet en bien des occafions.j
4°. On voit par-là combien la remarque de ceux
qui ne voudroient appliquer l’expreflion dont il s’agit
qu’aux habits 6c aux rubans, ou qui penfent que
ces mots y font toujours fous-entendus, eft futile 6c
mal entendue. Les marchands merciers de Paris, dit
Richelet dans la première édition de fon diôiorinaire
imprimé à Geneveen 1680, fontfouvent le mot de
couleur mafculin, en parlant de leurs rubans. Ils di-
fent nous avons du beau couleur de feu , voulez-vous
du couleur de feu ? Les habiles gens que faiconfultés
là-deffus, condamnent ces façons de parler. Ils croient
qfilfaut dire & écrire, nous avons du beau ruban couleur
de feu, voulez-vous du ruban couleur de feu,
f en ai du fort beau ? D ’oîi je conclus feulement, ou
que l’ufage a changé & s’eft déclaré en faveur des
marchands, ou.que Richelet, 6c les habiles gens qu’il
avoit confultés,fe trompoient, 6c ne penloient pas
bien en cette occafion a l’analogie du langage. Ce
feroit, fi je ne me trompe, un fcrupule vain 6c puérile,
de ne vouloir employer les mots couleur de feu,
couleur de rofe au mafculin, qu’en parlant d’habits ou
de rubans, & de faire difficulté de dire, par exemple
, le couleur de feu dominoit dans f aurore boréale
qui parut hier au, fo ir , le couleur de rofe , le couleur
de chair & le couleur d'eau, font du nombre des couleurs
que les peintres appellent légères, pour les distinguer
de celles qu’ils nommentpefantes 6c terreflres.
( Cet article, tiré des papiers de M. DE MAl RAN, ayant
été communiqué par l'auteur à f Académie Françoife ,
elle a foufcrit a ces remarques iP une commune voix. )
§ Couleur , ( Arts. ) Les couleurs font un objet
effentiel pour tous les arts. L’écriture, la peinture,
la teinture , &c. en font des preuves7 inconteftables.
De cette obfervation générale defcendons à leur utilité
particulière.
La chymie nous démontre que pour colorier les
minéraux, les végétaux & les animaux, la Providence
n’a employé pour l’ordinaire que deux matières
métalliques. Le fer diffous fournit le jaune , l’orangé
, le rouge, le violet, .le bleu & le noir. Le cuivre
diffous colorie les objets en bleu en verd 6c
en noir. Les autres métaux n’entrent pas aufli fréquemment
dans la compofition des Corps. L’or ou les
mélanges qu’il contient, donne le pourpre dans les
couleurs en émail. Le plomb diffous ou calciné fournit
le blanc, le gris , le minium, la litharge d’o r , la
litharge d’argent & le noir. L’étain diffous fert à donner
à l’écarlate une partie de fa beauté. Le cobolf
donne à l’émail une couleur bleue. Le mercure 6c.
l’antimoine forment une couleur rouge nommée cin-
nabre. En un mot, toutes les terres, les l'els * les
marbres, les diamans , les fleurs, les fruits, le .fang,
&c. qui ne font pas mélangés de quelques-uns dés
métaux dont nous venons de parler, font ou blancs ,
ou diaphanes & fans couleur.
On diftingue les métaux par la couleur qu’ils laifi-
fent imprimée fur la pierre de touche. La couleur eft
effentielle pour faire l’analyfe des eaux minérales,
& pour connoître le dégré de cuiffon ou de perfection
de toutes les préparations métallurgiques, pharmaceutiques
ou chymiques.
Les laboureurs favent par expérience que les terres
blanches s’échauffent difficilement, & que les terres
noires s’échauffent & fe deffechent très-aifément:
en conféquence de ces obfërvations, les habiles agriculteurs,
convaincus que la fertilité de la terre eft
proportionnelle au dégré de chaleur 6c de l’humidité
du fol, favent profiter de la couleur naturelle de la
terre, & lorfqu’il eft néceffaire ils favent l’altérer à
peu de frais au dégré qu’ils la défirent.
Les botaniftes n’ignorent pas que la couleur des
fleurs, des fruits, r6*c. annonce-leur maturité ou leur
dépériffement. M. Linné obferve que la couleur rouge,
dans les fleurs, indique l’acide : 6c que les couleurs
fales 6c livides annoncent que la plante eft fufpeéte
de poifon.
L’art de découvrir le cara&ere des hommes par la
phyfionomie eft en partie fondé fur l’obfervation
des couleurs. L ’expérience démontra que Jules Céfar
étoit phyfionomifte, lorfqu’il dit en montrant Marc
Antoine, « je ne crains pointées teints rouges & ver-
» meils ; mais je crains ces teints livides de Brutus Sc
» de Caffius ». Non timeo hos rubicundos,fed timeo hos
fufços. ,, .
Pline le naturalifte nous apprend que les anciens
tiroient des augures & des préfages de la couleur
des rayons du foleil, de la lune, des planètes, de
l’air, &c. Le chancelier Bacon a fait un traité de ven-
r«,qui fert de guide aux marins d’Angleterre, depuis
plus de cent ans. Il feroit à fouhaiter que l’on traduisît
cet ouvrage avec des notes ; les marins fe perfec-
tionneroient dans l’art de prévoir le beau 6c le mauvais
tems, en obfervant la couleur de l’eau de la
mer, celle de l’horifon, &c.
La rhétorique emprunte des couleurs la plupart de
fes comparaifons, fimilitudes, emblèmes, exemples,
métaphores & hiéroglyphes- De tous tems les nrora-
liftes ontfu tirer un parti avantageux des couleurs. On
peut fur cette matière , cônfultér les écrits d’Horus
Appollo 6c de Plutarque , prêtres Egyptiens, 6c les
hiéroglyphes que Pierius Valerien a rénferniés dans
un volume in-folio. Ces auteurs nous apprennent que
le blanc a toujours été employé pour défigner la
pureté de l’ame & l’abondance de lumière : tous les
ornemens d’Qfiris étoient blancs, 6c fes prêtres
étoient toujours habillés de blanc. Les prêtres de,
Jupiter, le Flamen dialis de Rome, étoient toujours
habillés de blanc : ils portoient un chapeau blanc.
Les Perfes difoient que les divinités n’étoient-habillées
que de blanc. Salomon :même recommande
au peuple de tenir fes habits, c’eft-à-dire fon coeur
blanc. On pourroit encore citer les paraboles de
la robe nuptiale, &c,.. -,
Les anciens Romains notôient au capitoie tes joufS
heureux avec de la craie blanche , & leÿjburs malheureux
avec de la craie noire. Les perfon'nes qui
briguoient les dignités s’habilloient de blanc , candi-
dati. L’on po/toit l’habit blanc aux funérailles des Cé-
fars. L’habit blanc étoit confacré pour la paix. On défi*
enoit les calomniateurs, les hommes infâmes, par la
couleur noire ; hic niger e jl, hune tu Romane caveto.
Les premiers chrétiens nommoient dies.atros, les jours
d’abftinence, de jeûne 6c de macération. Plufieurs
auteurs nomment les Pharifiens, corbeaux , & fépül-
cres reblanchis. Plutarque obferve que les yénitiens
èc les habitans de la rive du Pô étoient toujours habillés*
de noir, pour défigner qu’ils portoient le deuil
de Phaëton.
Dans Mantinée il y avoit un temple dédié à Vénus
noire, c’eft-à-dire, à la pudeur. Les prêtres Egyptiens
ne s’habilloient de couleur noire que lorfqu’ils
vouloient demander des grâces particulières. La
couleur jaune dans les habits a toujours été dans la
Chine un attribut diftin&if pour les princes. Le rouge
6c fur-tout le pourpre a toujours ''diftingue les
princes 6c les magiftrats en Europe. L’habit rouge ,
parmi les anciens Egyptiens 6c parmi les Romains,
défignoit les préparatifs pour la guerre. Parmi les
Perfes cette couleur défignoit le feu 6c la divinité.
Les anciens ne permettoient qu’aux enfans de porter
des habits tiffus de laines de différentes couleurs,
pour leur indiquer qu’ils dévoient travailler à corriger
leur caradere dominant. Dans les livres faints
il étoit défendu de s’habiller de blanc tiffude noir,
ou de deux couleurs, pour defigner que le chrétien
ne doit point fervir Dieu & le démon. C ’eft la meme
raifon qui faifoit défendre d’unir des animaux de
couleur différente.
Dans les fept volumes in-folio que le roi de Naples
vient de faire imprimer fous le titre de Pitture
antiche (PHercolano , on apprend que les anciens
peignoient en- couleur noire les cheveux de leurs
ftatues d’albâtre ; ils y fertiffoient des yeux en argent,
en o r , ou en efpece d’émail de naturelle
, tels font les yeux de la belle ftatue de Cicéron
en bronze, que l’on vient de découvrir dans
Herculane. Plufieurs tableaux de la même collection
démontrent que les anciens étoient en ufage de
peindre en rouge les ftatues de Priape 6c de Bac-
chus. L’on peignoit en rouge pur la face des ftatues
même de Jupiter dans certains jours de fête. Camille
6c les triomphateurs qui entroient folemnellement
à Rome, fe peignirent la face en rouge. Pline ajoute
que de fon tems les feigneurs d’Ethiopie fe pei-
gnoiènt le corps en rouge.
Les fauvages du Canada fe colorient leur vifage
de quatre couleurs différentes, 6c fe poudrent avec
du vermillon lorfqu’ils vont à la guerre. Quantité
d’autres nations fe fardent ou fe peignent le corps ,
les cheveux, les dents & les ongles de diverfes
couleurs. On peuttrouver à ce fujet des details curieux
dans VHifloire générale des voyages. Nous ajouterons
uniquement fur les ufages modernes, que fur
les côtes de Malabar, on diftingue facilement les
hommes de chaque cafte ou tribu à \a couleur de leur
carnation; de même que l’on diftingue facilement
dans les autres parties du monde, par la- couleur,
les Negres, les Abyflins,les Caffres, les Caraïbes,
les Anglois,lès Elpagnols, les François, les Danois
, &c. ( V. A . L. )
Couleur , ( Peinture. ) Si les anciens n’avoient
peint que fur la toile 6c fur le bois, nous n’aürions
aujourd’hui aucun moyen pour mettre en parallèle
leurs progrès dans'cet art avec les talens des peintres
modernes : mais heureufement ils ne tapiffoient pas
fouvent leurs appartemens, 6c ils les faifoient décoter
de mofaîques ou de peintuf es à fresque ; le roi de
Naples a renfermé dans fon Mufæum plus de cinq
cens tableaux de cette efpece que l’on a extraits des
ruines d’Herculane. Ces tableaux nous ont fait découvrir
des milliers de faits 6c d’ufages dans l’archi-*
te&uire, dans^la décoration intérieure des apparte»
mens, dans celle des jardins , des villes, des ports,
&c. en un mot, il eft peu d’artiftes qui ne puiffent
tirer des inftruéHons de cette magnifique colleâion*
On y voit avec étonnement que les anciens Envoient
à peu près les mêmes ufages que nous, & ils
les pratiquoient depuis long-tems. Voilà en gros les
obligations que 'nous avons aux couleurs 6c aux
peintures anciennes.
L’on a découvert dans Herculane un vafe de cryf-
tal qui contenoit du fard, 6c plufieurs pots remplis
de couleurs brutes pour fervir à peindre en frefque
ou à la détrempe. On y voit des laques, des ochres ,
&c. des encres noires épaiffes, d’autres qui font jaunes,
rouges ou bleues. Il eft dommage que l’on n’ait
pas fait examiner 6c analyfer par un habile chymifte
chaque efpece die couleur.
Les anciens employoient le jus d’ail pour rendre
leurs couleurs fixes. Pline dit que le fameux Apelles
ayoit inventé un vernis tranfparent qui garantiffoit
les couleurs de ies tableaux des injures de l’air, de la
poufliere & de l’humidité : il ajoute que malheureusement
ce fecret étoit perdu. L’on a cependant trouvé
dans Herculane un tableau peint à frefque, il eft
imbibé de cette efpece de vernis précieux & unique.
Ce tableau repréfente une mufe qui porte fur l’épaule
un inftrumentde mufique. M. Nicôlo Vagnuc-
ci poffede ce monument.
Nous obferverons en paffant, qu’à Malte on prétend
que le grès du pays frotté ou imbibe du fuc de
l’oignonde (quille, devient inaltérable par l’air, par
la pluie 9.&c.
Les anciens eftimoient beaucoup les camaïeux
qu’ils nommoient monochromes ou peintures cfune
feule couleur. La plupart des tableaux d’Herculane
font de vrais camaïeux : dans quelques-uns les figures
font peintes ou en rouge, ou en couleur naturelle
, fur un fond noir, brun, rouge , jaune ou
blanc.
Pétrone parle avec admiration des monochromes
faits par Apelles 6c par Protogene. Pline ajoute à ce
fujet que ces fameux peintres n’employoient tout au
plus que quatre couleurs pour faire des chefs-d’oeuvre
qui valoient les richeffes d’une bonne ville , 6c qu’il
eft étonnant que les peintres de fon tems emploient
une plus grande quantité de couleurs. Nous obferverons
en paffant , que les camaïeux font utiles pour
occuper un jeune peintre qui veut fe perfeéHonner
dans l’art de dégrader les couleurs par le clair obfcur:
mais les monochromes font pour le refte des hommes
des peintures contre nature ; il n’y a que des
yeux malades qui voient tout verd ou tout rouge,
&c. I # WÊ
Pline dit que le blanc des anciens peintres étoit
fait avec le tripoli blanc, c’eft-à-dire l’argille blanche;
leur rouge étoit fait avec le bol d’Arménie, le fang
de dragon, ou le carmin, qu’ils appellofènt minium /
leur jaune étoit le ftil attiqué, c’eft-à-dire une efpece
d’ochre ; l’on en tiroit aufli d’Egypte, de Syrie
& d’Efpagne: leur noir étoit fait avec le vitriol:
ils tiroient leur couleur de pourpre d’une ville de la
Grece ou de la Gétulie, ou de là Laconie.
Les tableaux d’Herculane démontrent que les anciens
peignoient en détrempe 6c en frefque avec une
belle couleur bleue foncée, femblable à notre bleu
de Pruffe ; ils avoient un beau v erd , un violet : ils
favoient parfaitement imiter les couleurs changeantes
delà gorge des pigeons 6c de la queue des paons.
1
p