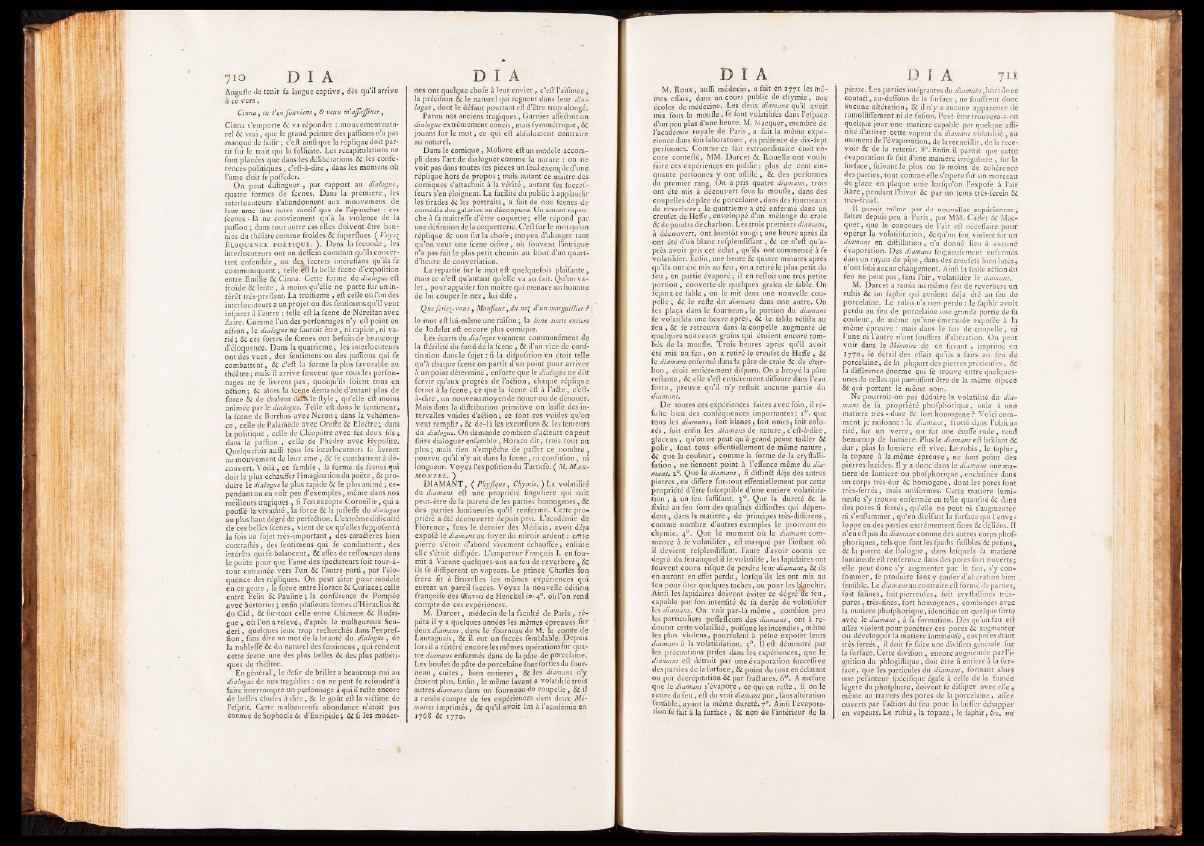
Il]-
n >Î
M !
W J
M i l
710 D I A D I A
Augufte de tenir fa langue captive, dès qu’il arrive
à ce v er s ,
Cinna, tu t'en fouviens, & veux rrC affaffiner, .
Cinna s’emporte & va répondre : mouvement naturel
& vrai, que le grand peintre des paflions n’a pas
manqué de faifir ; c’eft ainfi que la réplique doit partir
fur le trait qui la follicite. Les récapitulations ne
font placées que dans les délibérations & tles conférences
politiques , c’eft-à-dire, dans les momens où
l’ame doit fe pofféder.
On peut diftinguer , par rapport au dialogue,
quatre formes de fcenes. Dans la première , les
interlocuteurs s’abandonnent aux mouvemens de
leur ame fans autre motif que de l’épancher : ces
fcenes - là ne conviennent qu’à la violence de la
palîxon ; dans tout autre cas elles doivent être bannies
du théâtre comme froides & fuperflues ( Voye[
Éloquence poétique. ). Dans la fécondé, les
interlocuteurs ont un deffein commun qu’ils concertent
enfemble, ou de&fecrets intéreffans qu’ils fe
communiquent ; telle eft la belle fcene d’expofition
entre Emilie & Cinna. Cette forme de dialogue eft
froide & lente , à moins qu’elle ne porte fur un intérêt
très-preflant. La troifieme, eft celle où l’un des
interlocuteurs a un projet ou des fentimens qu’il veut
infpirer à l’autre : telle eft la fcene de Néreftan avec
Zaïre. Comme l’un des perfonnages n’y eft point en
ad ion, le dialogue ne fauroit être, ni rapide, ni varié
; & ces fortes de fcenes ont befoin de beaucoup
d’éloquence. Dans h quatrième, les interlocuteurs
ont des vues, des fentimens ou des paflions qui fe
combattent, & c’eft la forme la plus favorable au
théâtre ; mais il arrive fouvent que tous les perfonnages
ne fe livrent pas, quoiqu’ils foient tous en
adion; &. alors la fcepe demande d’autant plus de
force & de chaleur daflfc le f ty le , qu’elle eft moins
animée par le dialogue. Telle eft dans le Sentiment,
la fcene de Burrhus avec Néron ; dans la véhémence
, celle de Palamede avec Orefte & Eledre ; dans
la politique , celle de Cléopâtre avec les deux fils ;
dans la paflion , celle de Phedre avec Hyçolite,
Quelquefois auflî tous les interlocuteurs fe livrent
au mouvement de leur ame, & fe combattent à découvert.
V o ilà , ce femble , la forme de fcenes qui
doit le plus échauffer l’imagination du poète, & produire
le dialogue le plus rapide & le plus animé ; cependant
on en voit peu d’exemples, même dans nos
meilleurs tragiques , fi l’on excepte Corneille, quia
pouffé la vivacité , la force & la jufteffe du dialogue
au plus haut dégré de perfedion. L’extrême difficulté
de ces belles fcenes, vient de ce qu’elles fuppofent à
la fois un fujet très-important, des caraderes bien
contraftés, des fentimens qui fe combattent, des
intérêts quife balancent, & affez de reffources dans
le poète pour que i’ame des fpedateurs foit tour-à-
tour entraînée vers l’un & l’autre parti, par l’éloquence
des répliques. On peut citer pour modèle
en ce genre , la fcene entre Horace & Curiace ; celle
entre Félix & Pauline ; la conférence de Pompée
avec Sertorius ; enfin plufieurs fcenes d’Héraclius &
du C id , & fur-tout celle entre Chimene & Rodrigue
, où l’on a relevé, d’après le malheureux Scu-
d e r i, quelques jeux trop recherchés dans l’expref-
lion , fans dire un mot de la beauté du dialogue , de
la nobleffê & du naturel des fentimens , qui rendent
cette fcene une des plus belles & des plus pathétiques
du théâtre.
En général, le defir de briller a beaucoup nui au
dialogue de nos tragédies : on ne peut fe réfoudrè* à
faire interrompre un perfonnage à qui il refte encore
de belles chofes à dire, & le goût eft la vidime de
l’efprit! Cette malheureufe abondance n’étoit pas
connue de Sophocle & d’Euripide ; 8c fi les modernes
ont quelque chofe à leur envier, c’eft l’aifance
la précifion & le naturel qui régnent dans leur dialogue
, dont le défaut pourtant eft d’être trop alongé.
Parmi nos anciens tragiques, Garnier affedoit un
dialogue extrêmement concis, mais fymmétrique, &
jouant fur le mot, ce qui eft abfolument contraire
au naturel.
Dans le comique, Moliere eft un môdele accompli
dans l’art de dialoguer comme la nature : on ne
voitpas dans toutes fes pièces un feul exemple d’une
réplique hors de propos ; mais autant ce maître des
comiques s’attachoit à la vérité , autant fes fuccef-
feurs s’en éloignent. La facilité du public à applaudir
les tirades & les portraits, a fait de nos fcenes de
comédie des galeries en découpure. Un amant reproche
à fa maîtreffe d’être coquette; elle répond par
une définition de la coquetterie. C ’eft fur le mot qu’on
réplique & non fur la chofe ; moyen d’alonger tant
qu’on veut une fcene oifive , où louvent l’intrigue
n’a pas fait le plus petit chemin .au bout d’un quart-
d’heure de converfation.
La repartie fur le mot eft quelquefois plaifante ,
mais ce n’eft qu’autant qu’elle va au fait. Qu’un valet
, pour appaifer fon maître qui menace un homme
de lui couper le nez, lui dife,
Que feriez-vous, Monjieur, du ne{ d’un marguillier ? \
le mot eft lui-même une ràifon ; la lune toute entiers
de Jodelet eft encore plus comique.
Les écarts du dialogue viennent communément de
la ftérilité du fond de la fcene , &. d’un vice de conf-
titution dans le fujet : fi la difpofition en étoit telle
qu’à chaque fcene on partît d’un point pour arriver
à un point déterminé, enforte que le dialogue ne dût
fervir qu’aux progrès de l’a v io n , chaque réplique
feroit à la fcene, ce que la fcene êft à l’a d e , ç’eft-
à-dire, un nouveau moyen de nouer ou de dénouer.
Mais dans la diftribution primitive on laifle des intervalles
vuides d’adion ; ce font ces vuides qu’oiï
veut remplir, & de-là les excurfions & les lenteurs
du dialogue. On demande combien d’adeurs on peut
faire dialoguer enfemble , Horace dit, trois tout ail
plus ; mais rien n’empêche de pafîèr ce nombre ,
pourvu qu’il n’y ait dans la fcene, ni confufion, ni
longueur. Voyez l’expofition du Tartufe. ( M. M a r -
MONT EL. )
DIAMANT, ( Phyjique, Chymie. ) La volatilité
du diamant eft une propriété finguliere qui naît
peut-être delà pureté de fes parties homogènes, &
des parties lumineufes qu’il renferme. Cette propriété
a été découverte depuis peu. L’académie de
Florence, fous le dernier des Médicis, avoit déjà
expofé le diamant au foyer du miroir ardent : cette
pierre s’étoit d’abord vivement échauffée, enfuite
elle s’étoit diflïpée. L’empereur François I. en fournit
à Vienne quelques-uns-au feu de reverbere. 8c
ils fe difliperent en vapeurs. Le prince Charles Ton
frere fit à Bruxelles les mêmes expériences qui
eurent un pareil fuccès. Voyez la nouvelle édition
françoife des QZuvres de Henckel in-40. où l’on rend
compte de ces expériences.
M. Darcet, médecin de la faculté de Paris , répéta
il y a quelques années les mêmes épreuves fur
deux diamans, dans le fourneau de M. le comte de
Lauraguais, & il eut un fuccès femblable. Depuis
lors il a réitéré encore les mêmes opérations fur quatre
diamans enfermés dans de la pâte de porcelaine.
Les boules de pâte de porcelaine fontfortiesdu fourneau
, cuites , bien entières, & les^ diamans n’y
étoient plus. Enfin, le même favant a volatilifé trois
autres diamans dans un fourneau de coupelle, 8t il
a rendu compte de fes expériences dans deux Mémoires
imprimés, & qu’il avoit lus à l’académie en
1768 8c 1770.
»
D ï A
M. Roux, aufîi médecin* a fait en 1771 les imê-
ïnes effais, dans un cours public de chymie, aux
écoles de médecine. Les deux diamans qu’il avo.it
mis fous la moufle, fe font volatilifés dans l’efpace
d’un peu plus d’une heure. M. Macquer, membre de
l’académie royale de Paris, a fait la même expérience
dans fon laboratoire * en préfence de dix-fept
perfonnes. Comme ce fait extraordinaire étoit encore
contefté* MM. Darcet 8c Rouelle ont voulu
faire ces expériences en public : plus de cent cinquante
perfonnes y ont aflïfté, & des perfonnes
du premier rang. On a pris quatre diamans, trois
ont été mis à découvert fous la moufle, dans des
coupelles de pâte de porcelaine, dans des fourneaux
de reverbere; le quatrième a été,enfermé dans un
creufet de Heffe, enveloppé d’un mélange de craie
& de poudre de charbon. Les trois premiers diamans,
à découvert, Ont bientôt rougi ; une heure après ils
ont été d’un blanc refplendiflànt, & ce n’eft qu’a-
près avoir pris cet éclat, qu’ils ont commencé à fe
volatilifer. Enfin, une heure 8c quinze minutes après
qu’ils ont été mis aü feu , on a retiré le plus petit du
feu , en partie évaporé; il en reftoitune très petite
portion , couverte de quelques grains de fable* On
Sépara ce fable * on le mit dans une nouvelle coupelle
; 8c le refte du diamant dans une autre. On
les plaça.dans le fourneau, la portion du diamant
fe volatilifa une heure après* 8c le fable réfifta au
feu , 8c fe retrouva dans la coupelle augmenté de
quelques nouveaux grains qui étoient encore tombés
de la moufle. Trois heures après qu’il avoit
été mis au feu, on a retiré le creufet de Heffe , 8c
le diamant enfermé dans ta pâte de craie 8c de charbon
, étoit entièrement difparu. On a broyé la pâte
reftante, & elle s’eft entièrement diffoute dans l’eau
fo r te , preuve qu’il n’y reftoit aucune partie du
diamant.
. De toutes ces expériences faites avec foin, il ré-
fulte bien des eonféquenees importantes: i ° . que
tous les diamans, foit blancs, foit noirs, foit colorés
, foit enfin les diamans de nature, c’eft-à-dire,
glaceux, qu’on ne peut qu’à grand peine tailler 8c
p o lir, font tous effentiellement de même nature,
& que la couleur, comme la forme de la cryftalli-
fation , ne tiennent point à l’effence même du diamant.
20. Que le. diamant, fi diftind déjà dès autres.
pierres, en diffère fur-tout effentiellement par cette
propriété d’être fufceptible d’une entière volatilifa-
tion , à un feu fuffifant. 30. Que la dureté 8c la
fixité au feu font des qualités diftindes qui dépendent,
dans la matière , de principes très-différens,
comme nombre d’autres exemples le prouvent en
chymie. 40. Que le moment où le diamant commence
à fe volatilifer, eft marqué par l’inftant où
il devient refplendiflànt. Faute d’avoir connu ce
degré du feu auquel il fe volatilifé, les lapidaires ont
fouvent couru rifque de perdre leur diamant, 8c ils
en auront en effet perdu, lotfqu’ils les ont mis au
feu pour ôter quelques taches, ou pour les blanchir.
Ainfi les lapidaires doivent éviter ce dégré ue feu,
capable par fon intenfité 8c fa durée de volatilifer
les diamans. On voit par-là même , combien peu
les particuliers poffeflèurs des diamans, ont à redouter
cette volatilité, puifque les incendies, même
les plus violens, pourraient à peine expofer leurs
diamans à la volatilifation. çp. Il eft démontré par
les précautions prifes dans les expériences, que le
diamant eft détruit par une évaporation fucceflive
des parties de la furface, 8c point du tout en éclatant
ou par décrépitation 8c par fradures. 6°. A mefure
que le diamant s’évapore , ce qqi en refte, fi on le
retire du feu , eft du vrai diamant pur, fans altération
fenfible, ayant la même dureté. 70. Ainfi l’évaporation
fe fait à la furface, 8c non de l’intérieur de la
D I A 711
pierre. Les parties intégrantes du d i a m a h t c è
eontaâ, au-deffous de la furface * ne fouffrent donc
aucune altération* & il n’y a aucune âppareneè dè
ramolliffement ni de fufiôn. Peut-être trouvera-t-od
quelque jour une matière capable par quelque affinité
d’attirer Cette vapeur du diamant volatilifé , ail
moment de l’évaporation* de la recueillir, de la recevoir
& de la retenir. 8°. Enfin il paroît que cetté
évaporation fe fait d’une mâniere irrégulière , fur la
furface * fuivant le plus ou le moins de cohérencé
des parties, tout comme elle s’opère fut un morceau
de glace en plaque unie lorfqu’on l’expofe à Pair
libre, pendant l’hiver & par Un tems très-ferein ôc
très-froid.
_I1 parent même par de nouvelles expériences £
faites depuis peu à Pans, par MM. Cadet & Macquer
, que le concours de l’air eft néceffaire pouf
opérer la volatilifation* & q u ’iin feu. violent fur un
diatnant en diftillation, n’a donne lieu à aucune
évaporation. Des diamans foigneufement .enfermés»
dans un tuyau de pipe, dâns des c.reufet's bien lutés*
n’ont fiibi aucun changement. Ainfi la feule aûion du
feu ne peut pas, fans l’a ir , volatilifer le diamant.
M. Darcet a remis au même feu de,reverbere uit
rubis & un faphir qui avoient déjà été au feu dé
porcelaine. Le rubis n’a rien perdu : le faphir avoit
perdu au feu de porcelaine une grande partie de fà
couleur, de même qu’une émeraude expôfée à lu
même épreuve : mais dans le feu de coupelle, ni
l’une ni l’autre n’ont fouffert d’altération. On peut
voir dans le Mémoire dè cè favant , imprimé en
1770, le détail dès éflais qu’ils a faits au feu dé
porcelaine, de la plupart des pierres précieufes, 6c
la différence énorme qui fe trouve entre quelques-
unes de celles qui paroiflent être de la même efpece
& qui portent le même nom;
Ne pourroit-on pas déduire la volatilité dm diamant
de fa propriété phofphorique, unie à une
matière très-dure & fort homogène ? Voici comment
je raifonne : le diamant, frotté dans l’obfcu-
rité, fur un verre* ou fur une étoffe rude, rend
beaucoup de lumière; Plus le diamant eft brillant 6c
dur, plus la lumière eft vive. Le rubis , ie faphir*
la topaze à la même épreuve, ne font point des
pierres lucides. Il y a donc dans le diamant une matière
de lumière ou phofphorique, enchaînée dans
un corps très-dur & homogène, dont les pores font
très-ferrés, mais uniformes. Cette matière iumi-
neufe s’y trouve enfermée en telle quantité & dans
des pores fi ferrés, qu’elle ne peut ni s’augmenter
ni s’enflammer, qu’en divifant la furface qui l’enver
loppe en des parties extrêmement fines & déliées. II
n’en eftpas du diamant comme des autres corps phof1
phoriques , tels que font les fpaths fufibies &pefans,
& la pierre de Bologne, dans lefquels ià matieré
lumineufe eft renfermée dans des pores fort ouverts ;
elle peut donc s’y augmenter par le feu, s’y con-
fommer, fe produire lan sy cauler d’altération bien ,
fenfible. Le diamant au contraire eft formé de parties*
foit falines, foit pierreufes, foit cryftallines très-
pures , très-fines, fort homogènes , combinées avec
la matière phofphorique, identifiée en quelque fortç
avec le diamant, à fa formation. Dès qu’un feu eft
affez violent pour pénétrer ces pores & augmenter
ou développer la matière lumineufe, ces pores étant
très-ferrés, il doit fe faire une divifion générale fur
la furface. Cette divifion, encore augmentée par Fi-;
gnition du phlogiftique, doit être fi entière à la fur-
face, que les particules du diamant, formant alors
une pefanteur Spécifique égale à celle de la fuméd
légère du phofphore, doivent fe difliper avec elle*
même au travers des pores de la porcelaine, affez
ouverts par l’adion du feu pour la laiffer échapper
en vapeurs. L e rubis, la topaze, le faphir, &e. nè