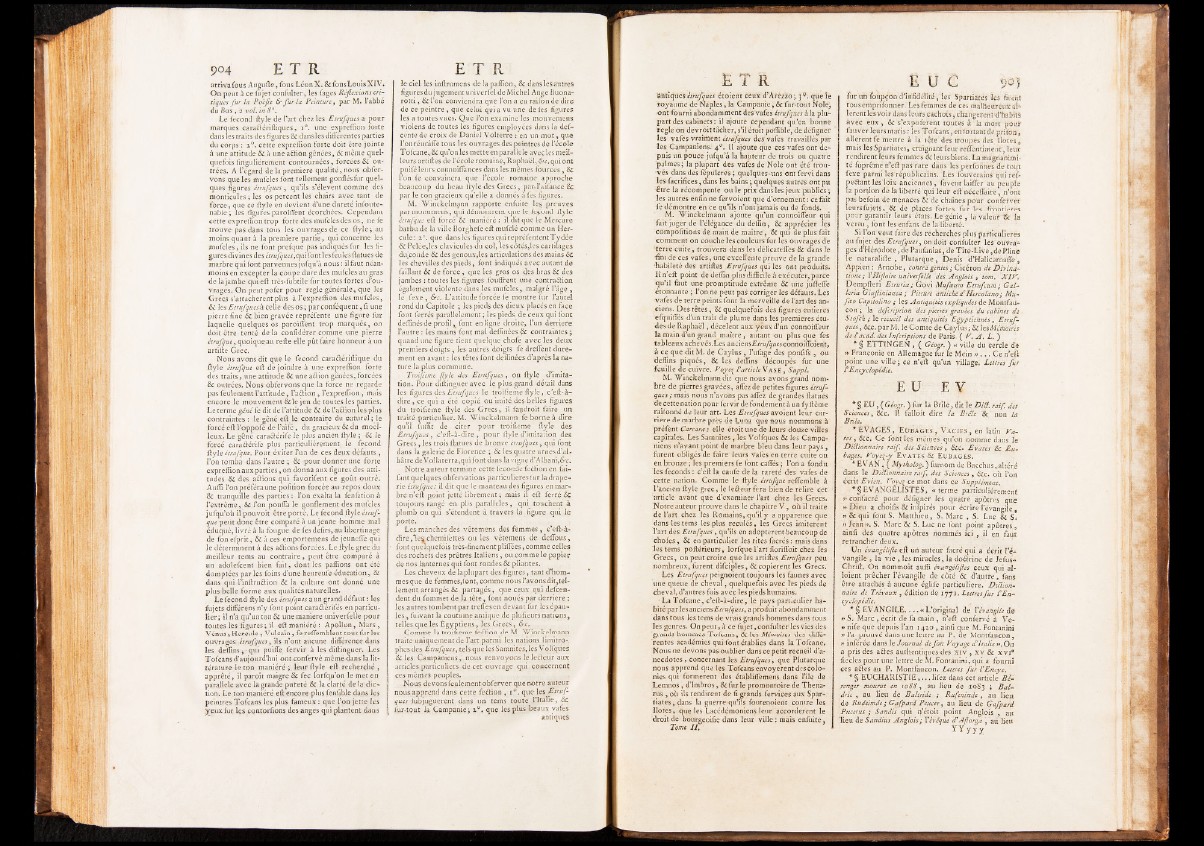
arriva fous A ugufle, fous Léon X. & fous Louis XIV«
On peut à ce fujet confulter, Les fages Réflexions critiques
fur la Po'èjie & far La Peinture, par M. l’abbé
du Bos , 2 vol. in 8°.
Le fécond ftyle de l’art chez les Etrufques* pour
marques caraétériftiques, x°. une expreflion forte
dans les traits des figures & dans les différentes parties
du corps : 2°. cette expreflion forte doit être jointe
à une attitude & à une adion gênées , & même quelquefois
finguliérement contournées, forcées & outrées.
A l’égard de la première qualité , nous obfer-
vons que les mufcles font tellement gonflés fur quelques
figures étrttfques, qu’ils s’élèvent comme des
monticules ; les os percent les chairs avec tant de
force, que ce ftyle en devient d’une dureté infoute-
nable ; les figures paroifîent écorchées. Cependant
cette expreflion trop forte des mufcles des o s , ne fe
trouve1 pas dans tous les ouvrages de ce ftyle ; au
moins quant à la première partie, qui concerne les
mufcles, ils ne font prefque pas indiqués fur les figures
divines des étrufques,qn\ font les feules ftatues de
marbre qui font parvenues jufqu’à nous : il faut néanmoins
en excepter la coupe duredes mufcles au gras
de la jambe qui eft très-fubtile fur toutes fortes d’ouvrages.
On peut pofer pour réglé générale, que les
Grecs s’attachèrent plus à l’expremon des mufcles,
& les Etrufques à celle des os par conféquent, fi une
pierre fine & bien gravée repréfente une figure fur
laquelle quelques os paroiflfent trop marqués, on
doit être tenté de la confidérer comme une pierre
étrufque, quoique au refte elle pût faire honneur à un
artifte Grec.
Nous avons dit que le fécond cara&ériftique dti
ftyle étrufque eft de joindre à une expreflion forte
des traits, une attitude & une action gênées, forcées
& outrées. Nous obfervons que la force ne regarde
pas feulement l’attitude, l’action, l’expreflion, mais
encore le mouvement ôcle jeu de toutes les parties.
Le terme gêné fe dit de l’attitude & de l’aûion les plus
contraintes : le gêné eft le contraire du naturel; le
forcé eft l’oppofé de l’aifé, du gracieux & du moelleux.
Le gêné caraclérife le plus ancien ftyle ; & le
forcé cara&érife plus particuliérement, le fécond
ftyle étrufque. Pour éviter l’un de ces deux défauts ,
l’on tomba dans l’autre ; & pour donner une forte
expreflion aux parties, on donna aux figures des attitudes
& des aôions qui favorifent ce goût outré.
Aufli l’on préféra une pofition forcée au repos doux
& tranquille des parties : l’on exalta la fenfation à
l’extrême, & l’on pouffa le gonflement des mufcles
jufqu’où il pouvoit être porté. Le fécond ftyle ètruf-
que peiit donc être comparé à un jeune homme mal
éduqiié, livré à la fougue de fesdefirs,au libertinage
de fon efprit, & à ces emportemens de jeunefl'e qui
le déterminent à des aérions forcées. Le ftyle grec du
meilleur tems au contraire, peut être comparé à
un adolefcent bien fait, dont les partions ont été
domptées par les foins d’une heureufe éducation, &
dans qui l’inftruérion & la culture ont donné une
pluS'belle forme aux qualités naturelles.
Le fécond ftyle des etrufques a un grand défaut : les
fujets différens n’y font point caraâérifés en particulier;
il n’a qu’un ton & une maniéré univerfelle pour
toutes lès figures ; il eft maniéré : Apollon, Mars ,
Vénus, Hercule, Vulcain, fe reffemblent tous fur les
ouvrages etrufques, ils n’ ont aucune différence dans
les deflins.j -qui puiffe feryir à les diftinguer. L e s ,
Tofcans d’aujourd’hui ont confervé même dans'la littérature
le ton maniéré ; leur ftyle eft recherché ,
apprêté, il paroît maigre & fec lorfqp’on le met en
parallèle avec la grande pureté & la clarté de la diction.
Le ton maniéré eft encore plus fenfible dans les
peintres Tofcans les plus fameux : que l’on jette les
yeux fur les contorfions des anges qui plantent dans
le ciel les inftrumens de la paflion, & dans les autres
figures du jugement univerfel de Michel Ange Buona-
rotti, & l’on conviendra que l’on a eu raifon de dire
de ce peintre , que celui qui a vu une de les figures
les a toutes vues. Que l’on examine lès mouvemens.
violens de toutes les figures employées dans la def-
cente de croix de Daniel Volterre : en un mot, que
l’on réunifie tous les ouvrages des peintres de l’école
Tofcane, & qu’on les mette en parallèle avec les meilleurs
artiftes de l’école romaine, Raphaël, &c. qui ont
puifé leurs connoiffances dans les mêmes fources, &
l’on fe convaincra que Bécole romaine approche
beaucoup du.beau ftyle des Grecs, par.l’ailànce Sc
par le ton gracieux qu’elle a donnés à les figures.
M. Winckelmann rapporte enfuite le/î preuves
par monumens, qui démontrent que le leçond ftyle
étrufque eft forcé & maniéré : il dit que le Mercure
barbu de la ville Borghefe eft mufclé comme un Hercule:
2°. que dans les figures quirepréfententTydée
& Pelée,les clavicules du col, les côtés,les cartilages
du coude & des genoux,les articulations des mains &
les chevilles des pieds, font indiqués avec autant de
faillant & de force, que les gros os des bras & des
jambes : toutes les figures fouffrent une contraérion
également violente dans les mufcles, malgré l’âge ,
le fexe , &c. L’attitude forcée fe montre fur l’autel
rond du Capitole ; les pieds des dieux placés en face
font ferrés parallèlement; les pieds de ceux qui font
deflinésde profil^ font en ligne droite, l’un derrière
l’autre : les mains font mal deflinées & contraintes ;
quand une figure tient quelque chofe avec les deux
premiers doigts , les autres doigts fe dreffent durement
en avant : les têtes font deflinées d’après la nature
la.plus commune.
Troifieme ftyle des Etrufques, ou ftyle d’imitation.
Pour diftinguer avec le plus grand détail dans
les figures des Etrufques le troifieme ftyle, c ’eft-à-
dire, ce qui a été copié ou imité des belles figures
du troifieme ftyle des Grecs, il faydroit faire un
traité particulier. M. Winckelmann fe borne à dire
qu’il fuflït de citer pour troifieme ftyle des
Etrufques, c’eft-à-dire , pour ftyle d’imitation des
Grecs, les trois ftatues de bronze etrufques, qui font
dans la galerie de Florence ; & les quatre urnes d’albâtre
deVollaterra,qui font dans la vigne d’Albani,6*c.
Notre auteur termine cette fécondé'fedion en fai-
fant quelques obfervations particulières fur la draperie
étrufque: il dit que le manteau des figures en marbre
n’eft point jetté librement ; mais il eft ferré &
toujours rangé en plis parallèles, qui touchent à
plomb ou qui s’étendent à travers la figure qui le
porte.
Les manches des. >yêtemens des femmes, c’eft-à-
dirê ,*le^ chemifettes ou les vêtemens de deffous,
font quelquefois très-finement pliffées, comme celles
des rochers des prêtres Italiens ,.ou comme le papier
de nos lanternes qui font rondes & pliantes.
Les cheveux de la plupart des figures, tant d’hommes
que de femmes,font, comme nous l’avons dit,tellement
arrangés & partagés, que ceux qui defçen-
dent du fommet de la,tête, font noués par derrière :
les autres tombent par treffesen devant fur les épaule
s , fuivant la coutume antique de plufietirs nations,
telles que les Égyptiens., les Grecs, &c..
Comme la troifieme fedion de M. Winckelmann
traite uniquement de l’art parmi les nations limitrophes
des, Etrufques, tels que IesSamnités,les Volfques
& les Campaniens, nous renvoyons le leûeur aux
articles particuliers de cet ouvrage qui concernent
ces mêmes peuples.
Nous devons feulement obferver que notre auteur
nous apprend dans cette fedion , i° . que les Etrufques
fubjuguerent dans un tems toute l’Italie, .&
fur-tout la Campanie; 2°. que les plus beaux vafes
antiques
antiques etrufques étoiènt ceux d’Arèzzo ; 3Q. qtie le
royaume de Naples, la Campanie, & fur-tout Nole^
ont fourni abondamment des vafes étrufques k\* plupart
des cabinets : il ajouté cependant qu’en bonné
réglé on de vroit tâcher, s’il étoit poflîble, de défigner
les vafes vraiment étrufques des' vafes travaillés par
les Campaniens. 40. Il ajoute que ces vafes ont depuis
un pouce jufqu’à la hauteur de trois oit quatre
palmes; la plupart des vafes de Noie ont été trouvés
dans des fépulcres ; quelques-uns ont fervi dans
les facrifices, dans lés bains ; quelques autres ont pu
être la récompenle ouïe prix dans les jeux publics;
;les autres enfin ne fervoient que d’ornement: ce fait
fe démontre en ce qu’ils n’ont jamais eu de fonds*
M. "NVinckelmann ajoute qu’un connoiffeur qui
Tait juger de l’élégance du deflin, & apprécier l£s
compofitions de main de maître, & qui dé plus fait
comment on couche les couleurs fur les ouvragés dé
terre cuite, trouvera dans les délieateffes & dans le
fini de ces vafes, une excellente preuve de la grande
■ habileté des artiftes Etrufques qui les ont produits*
Il n’eft point de deflin plus difficile à exécuter, parce
qu’il faut une promptitude extrême & uhe jufteffe
étonnante ; l’on ne peut pas corriger les défauts. Les
vafes de terre peints font la merveille de l’art des anciens.
Des têtes, & quelquefois des figures entières
efquiffés d’un trait de plume dans les premières études
de Raphaël , décelent aux yeux d’un connoiffeur
la main d’un grand maître , autant ou plus que fes
tableaux achevés.Les anciens£/r«/ÿtt«conrioiffoieht,
à ce que dit M. de Caylus , l’ufage des ponfifs , ou
deflins piqués, & les deffins découpés fur une
feuille de cuivre. Voye^ VarticleV a SE, Suppl.
M. Winckelmann dit que nous avons grand nombre
de pierres gravées, affezde petites figures étrufques
; mais nous n’avons pas affez de grandes ftatues
de cette nation pour fer vir de fondement à un fy ftême
railonné de leur art. Les Etrufques avoient leur carrière
de marbre près de Luna que nous nommons à
préfent Carrara : elle étoit une de leurs doiize villes
capitales. Les Samnites, les Volfques & les Câmpa-
niens 11’ayant point de marbre bleu dans leur pays,
furent obligés de faire leurs vafes en terre cuite ou
en bronze ; les .premiers fe font cartes ; l ’on a fondu
les féconds : c’eft la caufe de la rareté des vafes de
cette nation. Comme le ftyle étrufque rêffemble à
l ’ancien ftyle grec, le leéteur fera bien de relire cet ■
article avant que d’examiner l’art chez les Grecs.
Notre auteur prouve dans le chapitre V , oîi il traite
de l’art chez les Romains, qu’il y a apparence que
dans les tems les plus reculés, les Grecs imitèrent
l’art des Etrufques , qu’ils en adopterentbeaucôüp de -
chofes, & en particulier les rites facrés : mais dans
les tems poftérieurs, lorfque l’art florifloit chez les
Grecs, on peut croire que lés artiftes Etrufques peu .
nombreux, furent difciples, & copièrent les Grecs*
Les Etrufques peignoient toujours les faunes avec
une queue de cheval, quelquefois avec les pieds de
cheval, d’autres fois avec les pieds humains.
* La Tofcane, c’eft-à-dire , le pays particulier ha* ;
bité par les ancien s Etrufques, a produit abondamment ;
dans tous les tems de vrais grands hommes dans tous !
les genres. On peut, à ce fujet, confulter les vies des I
grands hommes Tofcans, & les Mémoires des différentes
académies qui font établies dans la Tofcane.
Nous ne devons pas oublier dans ce petit recueil d’a*
iiecdotes, concernant les.Etrufques, que Plutarque
nous apprend que les Tofcans envoyèrent des colonies
qui formèrent des établiffemens dans l’île de
Lemnos, d’Inihros, &fur le promontoire de Thena-
rus , oh ils rendirent de fi grands fervices aux Spartiates,
dans la guerre qu’ils foutenoient contre les
Ilotes, que les Lacédémoniens leur accordèrent le
droit de bourgeoifie dans leur ville ; mais enfuite,
Tome II,
fur un loûpçôn d’infidélité, les Spartiates les firent
tousemprifonner. Lesfemmés dé ces malheureux allèrent
les voir dans leurs cachots, changerent'd’habits
avec eux > & s’expbferent toutes à la mort pOuf
fauver leurs maris: les Tofcans', enlörtaht.de prifôh,
allèrent fe mettre à la tête des tïoupés clés Ilotes *
mais lés Spartiates, craignant leur reflentimentr, leur
rendirent leurs femmes & leurs bierts. La magnanimité
fuprême n’eft paTrare dans les perfonhies de toyt
fexe parmi les républicains. Les fouveràins qui réf-
peftant lesdbix anciennes, favent laiffer au peuple
la portion dé la liberté qui leur eft néceflairë \ n’ont
pas befoin de mènaces & de chaînes pour cohfefve-f
leurs fujets, & de places fortes fur les • frontières
pour garantir leurs états. Le'génie , là valeur t e la
vertu , font les enfads de ia-lib'értë.
Si l’on veut faire des recherches' plus particuüerës
au fujet des Etrufques9 on doit corifultër les'oUvra-
ges d’Hérodote, de Paufanias, dé T ite-Livé, de Plinè
le naturalifte , Plutarque , Denis d’Haücârnafîe *
Appien : Arnobè, coHira génies ; Cicéron de Divinà-
tione; l’Hifloire univerfelle des Anglais , tofn, XIV0
Dempfteri Etruria; Govi Mufaurn Etrufcurn ; G aliéna
Giuftitiianed ; Pittürë aritichëd’Hertoldnç Mii-
fz o Capitolino ; les Antiquités expliquées de Montfaii-
con'J ‘la déferiptioh despierres gravées du cabinet de.
S tóf ch ; le recueil des antiquités Egyptiennes , Etrufques
, &c. pàr M. le Comte de Caylus ; & izsMémoirés
de ràcad. des In/criptions de Paris. ( V. A . L. )
* § ETTINGEN, ( Géogr.y « ville du cercle de
» Franconie en Allemagne fur le Mein » . . . Ce n’eft
point une ville ; ce n’eft qu’un village. Lettres fut
VEncyclopédie.
EU E Y
* § EU , ( Géogr. ) fur là Brile, dit le Dicl. raif. des
Sciences, & c . Il falloit dire la Brêle & non la
Brile.
* ÉVAGÈS, E ü b a g e s , V a c i e s , en latin Va -
tes, Sic. Ce font les mêmes qu’on nomme dans le
Dictionnaire raif dés Sciences, & c . Evates & Eu-
bages. Voyefy E v a t e s & EuBAGÉ S.
* E V AN , ( Mythûlqg. ) furnom de Bacchus, altér.é
dans le Dictionnaire raif. des Sciences , &c. oîi l’on
écrit Evien. Voyë[ ce mot dans ce Supplément.
* § EVANGELISTES * «terme particuliérement
» confacré pour défigner les quatre apôtres que
» Dieu a choifis & infpirés pour écrire l’évangile,
» & qui font S. Matthieu, S. Marc , S. Luc & S*
» Jean». S. Marc & S. Luc.ne font point apôtres,
àinfi des quatre apôtres nommés ici , il en faut
retrancher deux.
Un évangélijlc eft un auteur facré qui a écrit l’évangile
, la vie , les miracles, la doôrine de Jefus-
Chrift. On nommoit aufli év an gélifies ceux qui al-
Joient prêcher l’évangile de côté & d’autre, fans
être attachés à aucune églife particuliere. Diction*
naire de Trévoux , édition de 1771. Lettres fur P En*
cyclopèdie.
* § EVANGILE.. . .« L ’origifial de Vévatigile dë
» S. Marc * écrit de fa main , n’eft confervé à Ve-
» nife que depuis l’an 1420 , ainfi que M. Fontaninî
» l’a prouvé dans une lettre au P. de Montfaueon,
» inférée dans le Journal de fon Voyage dTtalie ». On
a pris des aâes authentiques des x ï v , x v & xvi®
fiecles pour Une lettre de M. Fontanini, qui a fourni
ces aéles au P. Montfaueon. Lettres fur l'Encyc.
* § EUCHARISTIE,. f. lifez dans cet article Bérenger
mourut en 1088, au lieu de -1083 ; Bal-
dric , au lieu de Baltride. ; Rufeninde , au lieu
de Rudeimde; Gafpard Peucer, au lieu de Gafpard
Pucerus ; Sandis qui n’étbit point Anglois , au
lieu de Sandius Anglois; Yévêqué d’Afiorga 1 ait lieu
Y V y y j r