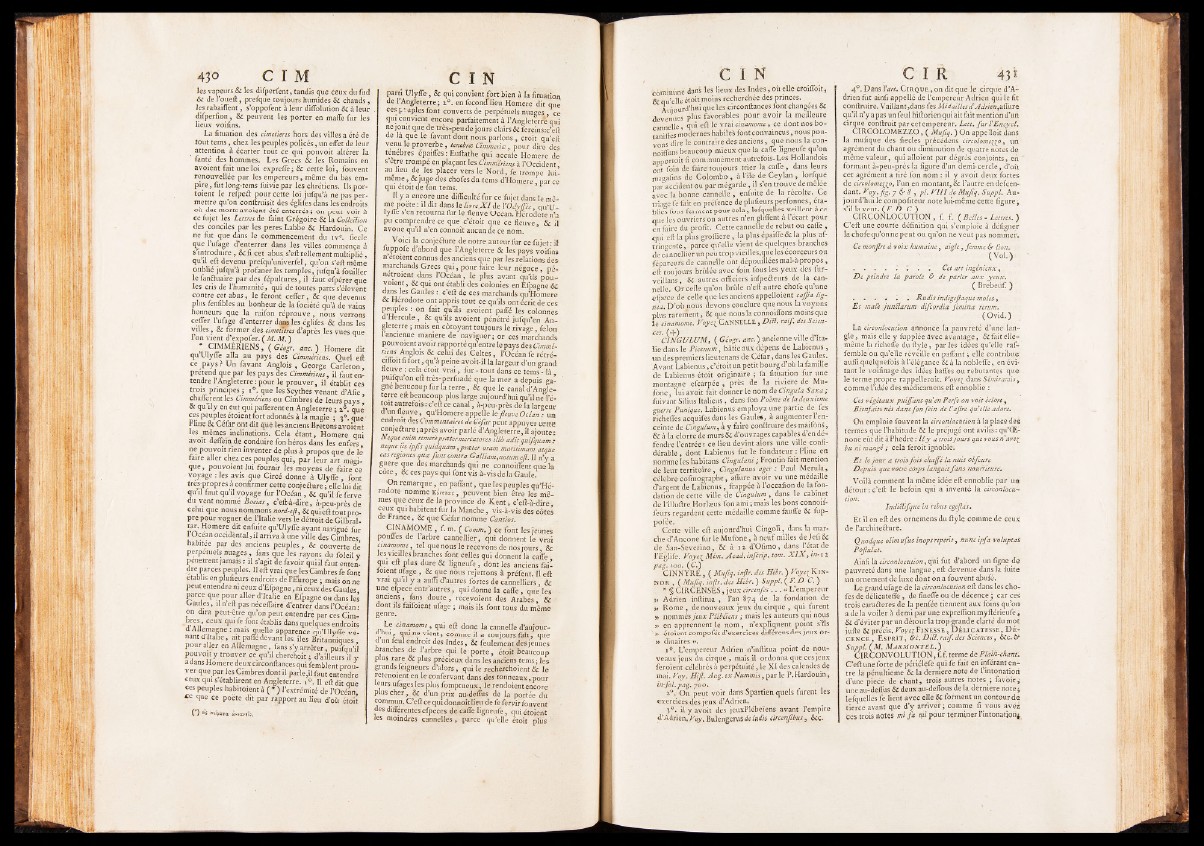
les vapeurs & les difperferit, tandis que ceux du fud
(te de l’oiieft, prefque toujours humides & chauds,
les rabaiffent, s’opposent à leur diffolution & à leur
difperfion, & peuvent les porter , en maffe fur les
lieux voifîns.
La fituation des cwttticrts hors des villes a été de
tout tems, chez les peuplés policés, un effet de léur
attention à-écarter .tout ce -qui pouvoit altérer la,
fanté des hommes. Les Grecs ,& les Romains en
avoient fait une loi expreffe; & cette lo i, Souvent
renouvellée par les empereurs, même du bas empire
, fut long-tems Suivie par les chrétiens. Ils por-
toient le refpeft pour cette loi jufqu’à ne pas permettre
qu'on condruisit des églifes dans les endroits
où des morts avoient été enterrés ; on peut voir à
ce Sujet les Lettres de Saint Grégoire & la ColLcüon
des conciles par les peres Lahbp & Hardouin. Ce
ne fut que dans le commencement du iv e. liecle
que l’ufage d’enterrer dans les villes commença à
s introduire , Si fi cet abus s’eft tellement multiplié,
qu’il eft devenu prefqu'univerfel, qu’on s’ellmême
oublié jufqu’à profaner les temples, jufqu’à fouiller
le fanétuaire par des Sépultures, il faut efpérër que
les cris de l’humanité, qui de toutes parts s’élèvent
contre qetabus, le feront ceffer, & que devenus
plut fenfibles au bonheur de la Société qu'à de vains
honneurs que la raifpn, réprouve, nous verrons
ceffer l’ufage d’enterrer dmæ les églifes & dans les
villes, ,& former des cimetoetes d’après les vues que
l’on tuent d’expofer. ( Af. Af. )
^ CIMMERIENS, ( Géegr. etne. ) 1 lomere dit
qu’Ulyffe alla au pays des Cimmèriens. Quel eft
çé pays? Un Savant Anglois , George Çarleton,
prétend que par les pays des Cimmèriens, il faut entendre
l’Angleterre : pour le prouver, il établit ces
principes ; i° . que les Scythes venant d’Afte,
chafferentles Cimmèriens ou Cimbres de leurs pays
& qu’i ly en eut qui pafferenten Angleterre ; i®. que
ces peuples étoient fort adonnés à la magie ; J°. que
Pline .& Cefar ont dit que les anciens Bretons avoient
les mêmes inclinations. Cela étant, Homere qui
avoit deffein de conduire Son héros dans les enfers
ne pouvoit fièn inventer de plus à propos que de le
faire aller chez ces peuples qui, par leur art magique,
pottvoient lui fournir les moyens de faire ce
voyage : les avis que Circé donne : à Ulyffe , font
très-propres à confirmer cette conjefture ; elle lui dit
qu’il faut qu’il voyage fur l’Océan , & qu’il Se Serve
du vent nommé Boeias, c’eft-à-dire, à-peu-près de
celui que nous nommons nori-ejl, & qnieft tout propre
pour voguer de l’Italie vers le détroit de Gilbral-
tar. Homere dit enfuite qu’Ulyffe ayant navigué fur
1 Océan occidental, il arriva à une ville, des Cimbres
habitée par des anciens peuples , & couverte de
perpétuels nuages , fans que les rayons du Soleil y
pénétrent jamais : il, s’agit de Savoir quiil faut enten-
dre parces peuples. I eft vrai que les Cimbres Se font
établis en plufieurs endroits de I’Ëurope ; mais on ne
peut entendre ni peux d’Efpagne , ni ceux des Gaules
parce que pour aller d’Italie en Efpagne oit dans les
fa u te s , il n eft pas neceffaire d’entrer dans l’Océan :
on dira peut-être qu’on peut entendre par ces Cim-
K M E .ceux j S font établis dans quelques endroits j
a Allemagne : mais quelle apparence qu’Ulyffe v enant
d’Italie, ait paffé. devant les, iles Britanniques , i
pour aller en Allemagne, fans sly a rrêter, puifqu’il '
pouvoit y trouver ce qu’il cherchoit ; d’ailleurs il y
adans Homere deux circonftances qui Semblent prouver
que parles Cimbresdont il parle,il faut entendre
ceux qui s’établirent en Angleterre. i °. I eft dit que
ces peuples habitoient à ( * ) l’extrémité de l’Océan,
V e ce poëte dit par rapport au lieu d’où étoit
0 ) f ï mipa,« èrturtïi.
parti Ülyffe, & qui convient fort bien à la fituation
de l’Angleterre ; 2°. en fécond lieu Homere dit que
ces peuples font couverts de perpétuels nuages, ce
qui convient encore parfaitement à l’Angleterrl; qui
ne jouit que de très-peu de jours clairs & fereins:c’eft
de la que le favant dont nous parlons , croit qu’eft
venu le proverbe, tenebm Cimmerice, pour dire des
tenebres epaiffes : Euftathe qui accufe Homere de
s etre trompé en plaçant les Cimmèrien^k l’Occident:
au lieu de les placer vers le Nord, fe trompe lui-
meme, &juge des chofesdu tems d’Homere par ce
qui etoit de fon tems. .... r
Il y a encore une difficulté fur ce fujet dans le mê-
me poète : il dit dans le livre jX I de YOdyJfée, qu’Ulyffe
s’en retourna fur le fleuve Océan. Hérodote n’a
pu comprendre ce que c’étoit que ce fleuve, & il
avoue qu’il n’en connoît aucun de ce nom.
Voici la conje&ure de notre auteur fur ce fujet: il
fuppofe d’abord que l’Angleterre & les pays voifîns
n’etoîent connus des anciens que par les relations des
marchands Grecs q ui, pour faire leur négoce, pé-
nétroient dans l’Océan, le plus avant qu’ils pou-
voienf, & qui ont établi des colonies en Efpagne &
dans les Gaules : c’eft de ces marchands qu’Homere
& Hérodote ont appris tout ce qu’ils ont écrit de ces
peuples : on fait qu’ils avoient paffé les colonnes
d’Hercule, & qu’ils avoient pénétré jufqu’en Angleterre
; mais en côtoyant toujours le rivage, félon
l’ancienne maniéré de naviguer ; or ces marchands
pouvoient avoir rapporté qu’entre le pays des Cimmé-
nens Anglois & celui des Celtes, l’Océan fe rétré-
ciffoitfifort, qu’à peine avoit-il la largeur d’un grand
fleuve : cela étoit v ra i, fur - tout dans ce tems- là
puisqu’on eft très-perfuadé que la mer a depuis gagne
beaucoup fur la terre , & que le canal d’Angleterre
eft beaucoup plus large, aujourd’hui qu’il ne l’é-
toit autrefois : c’eft ce canal, à-peu-près de la largeur
d’un fleuve, qu’Homere appelle le fleuve Océan: un
endroit des Commentaires de Céflar peut appuyer cette
conjeéture ; après avoir parlé d’Angleterre, il ajoute:
Ncquc enim temerïpmtermercatores illà adit.qui/quam .-
neque iis ipfis quidquam , prêter omm mariiimam atqùe
cas regiones quæ funt qonlra Gallïam,notum eft. Il n’y a
guere que des marchands qui ne connoiffent que la
cô te, & ces .pays qui font vis à-vis de IaGauIe?
On remarque, en paffant, qùélespeuples qù’Hé-
rodote nomme KdW uî , peuvent bien être les mê—
mes-que ceux de la province de Kent , c’eft-à-dire ,
ceux qui habitent fur la Manche, vis-à-vis des côtes
de France, & que Céfar nomme Cantios.
CI MA MOME, f. m. ( Comm. ) ce font les jeunes
pouffes de l’arbre cannellier, qui donnent le vrai
cinamome, tel que nous le recevons de nos jours, &
les vieilles branches font celles qui donnent la caffe
qui eft plus dure & ligneufe , dont les anciens fai-
ioient Ufage., & que noiis rejettons à préfent. Il eft
vrai qu’il y a aufli d’autres fortes de cannelliers, &
une efpece entr’autrês, qui donne la caffe , que les
anciens, fans doute , récevoient des Arabes, & '
dont ils farfoieht ufage ; mais ils font tous du même
genre.
Le cinamome, qui eft donc la cannelle d’aujour-
dhiu qui ne vient, comme il a toujours fait, que
d un mul endroit des Indes, & feulement,des jeunes
branches de l’arbre qui le porte, étoit beaucoup
plus rare & plus précieux dans les anciens tems; les
grands feigneurs d’alors, qui le recherchoient & le
retenoient en le confervant dans des tonneaux, pour
leurs ufages les plus fomptueux, le rendoient encore
plus cher, & d’un prix au-deffus de la portée du
commun. C’eft ce qui donnoitlieu de fe fervir fouvent
des différentes efpeces de caffe ligneufe, qui étoient
les moindres cannelles, parce qu’elle étoit plus
— dans les lieux des Indes, où elle Cfoiffôitj
& qu’elle étoitmoms recherchée des princes.
Aujourd'huiqueVs circonftances font changées &
devenues plus favorables pour avoir là meilleure
nelle eff vra^ cinamome, ce dont nos bo-
taniftes modernes habiles font convaincus, nous pouvons
dire le contraire des anciens, que nous la con-
noiffons beaucoup mieux que la caffe ligneufe qu’on
apportoit fi communément autrefois. Les Hollandois
ont foin de faire toujours trier la caffe, dans leurs
m a l in s de Colombo , à l’île de Ceylan , lorfque
par°accident ou par mégarde , il s’en trouvée de mêlée
avec la bonne cannelle , enfuite de la récolte. Ce
triage fe fait en préfence de plufieurs perfonnes, établies
fous ferment pour èela, lefquelles veillent a ce
que les ouvriers ou autres n’en gliffent à l’écart pour
en faire du profit. Cette cannelle de rebut ou caffe ,
qui eft la plus groffiere, la plus épaiffe&la plus af-
tringente, parce qu’elle vient de quelques branches
de cannellier un peü trop vieilles,que les ecorqeurs ou
fépareurs de cannelle ont,dépouillées mal-à-propos,
eû toujours brûlée avec foin fous les yeux des fur-
veillans, & autres officiers infpeâeurs de la cannelle.
Or celle qu’on brûle n’eft autre chofe qu’une
cfpece de celle que les anciens appelloient caflia ligne
a. D ’où nous devons conclure que nous la voyons
plus rarement, & que nous la connoiffons moins que
le cinamome. Voyei Cannelle , Dicl. raif. des Sciences.
(;+) '' p ,
CINGULUM, ( Géogr. anc.) ancienne ville d’Italie
dans le Picenum, bâtie aux dépens de Labienus ,
un des premiers lieutenans de Cefar , dans les Gaules.
Avant Labienus, c’étoit un petit bourg d’où la famille
de Labienus éfoit originaire ; fa fituation fur une
montagne efcàrpée , près de la riviere de Mu-
fone, lui avoit fait donner le nom de Cingula S axa ;
fuivant Silius Italicus , dans fon Poème de la deuxieme
guerre Punique. Labienus employa une partie de^fes
richeffes acquifes dans les Gaule«, à augmenter l en-
ceinte de Cingulum, à y faire conftruire desmaifons,
& à la dorre de m urs& d’ouvrages capables d’en défendre
l’entréé î ce lieu devint alors une ville eonfi-
dérable, dont Labienus fut le fondateur : Pline en
nomme les habitans Cingulani ; Frontin fait mention
de leur territoire, Cingulanus ager : Paul Merula,
célébré côfmographe, affure avoir , vu une médaillé
d’argent de Labienus, frappée à l’occafion de la fondation
de cette ville, de Cingulum , dans le cabinet
de l’illuftre Horlæus fon ami ; mais les bons connoif-
feurs regardent cette médaille comme fauffe & fup-
pofèe. ' . _ .
Cette ville eft aujourd’hui Cingoli, dans la marche
d’Ancone fur lè Mufone, à neuf milles de Jefi &
de San-Severino, & à' 1 2 d’Ofimo, dans 1 état de
l’Eglife. Voye^ Mém. Acad.inferip. tom. X I X , in - il
pag. ioo. (C.) • -
CINNYRE , ( Muflq. inftr. des Hébr. ) Voyei K in-
NOR , ( Muflq. inflr. des Hébr. ) Suppl. ( F .D C .)
. * § CIRCENSES, jeux circenfe's . . . « L’empereur
Adrien inftitua , l’an 874 de la fondation de
» Rome , de nouveaux jeux du cirque , qui furent
» nommés jeux Plébéiens ; mais les auteurs qui nous
» en apprennent le nom, n’expliquent point s’ils
' w étoient compofés d’exercices différensdes jeux or-
» dinaires ». • . é.
i ° . L’empereur Adrien n’inftitua point de nouveaux
jeux du cirque , mais il ordonna que ces jeux
feroient célébrés à perpétuité, le XI des calendes de
mai. Voy. Hifl. A u g . ex Nummis, par le P. Hardouin ;
inflol.pag.joo., ’
2.0.' On peut voir dans Spartien quels furent les
exercices.des jeux d’Adrien.
3°- il y avoit des jeuxPlébeïens avant l’empire
d’Adrien. Voy. Bulengerus de lndis circenflbus, ôcc.
4°. Dans Ÿart. C irque., on dit que le cirque d’Adrien
fut ainfi appelle de l’empereur Adrien qui le fit
conftruire. Vaillant,dans fes Médailles d!Adrien^affure
qu’il n’y a pas un feul hiftorien qui ait fait mention d’un
cirque conftruit par cet empereur. Lett. fur /’Encycl.
CIRGOLOMEZZO, ( Muflq. ) On appelloit dans
la mufique des fiecles précédens circolomezzo, un
agrément du chant ou diminution de quatre notes de
même valeur, qui alloient par dégrés conjoints, en
formant à-peu-près la figure d’un demi-cercle, d’oit
cet agrément a tiré fon nom : il y avoit deux fortes
de circolomeyyo, l’un en montant, &C l’autre en defeen-
dant. Voy. jig. y & 8 , pi. VIII de Muflq. Suppl. Aujourd’hui
le compofiteur note lui-même cette figure;
s’il la veut. (i^1. D. C . )
CIRCONLOCUTION, f. f. {Be lles- Lettres.)
C’eft une courte définition qui s’emploie à défigner
la chofe qu’on ne peut ou qu’on ne veut pas nommer.
Ce monflre d voix humaine, aigle, femme & lion.
(V o l.) -
. . . . ; : . 7. Cet art ingénieux,
De peindre la parole &, de parler aux yeux.
( Brebeùf. )
. . . . . . Rudis indigeflaque moles ,
E t malï junclarum difeordia l'emina rerum.
(O v id .)
La circonlocution annonce la pauvreté d’ une lan-
g le, mais elle y fupplée avec avantage, & fait elle-
même la richeffe du ftyle, parles idées qu’elle raf-
femble ou qu’elle réveille en paffant ; elle contribue
aufli quelquefois à l’élégance & à la nobleffe, en évitant
le voifinage des idées baffes ou rebutantes que
le terme propre rappelleroit. Voye^ dans S émir amis y
comme l’idée des médicamens eft ennoblie :
Ces végétaux puiffans quen Perfe on voit eclore ,
Bienfaits nés dans fon fein de l ’aflre quelle adore.
On emploie fouvent la circonlocution s la place des
termes que l’habitude & le préjugé ont avilis : qu’CE^
noné eût dit à Phedre : I l y a trois jours que vous n ave^
bu ni mangé ; cela feroit ignoble.
E t le jour a trois fois chaflè la nuit obfcure
Depuis que votre corps languit fans nourriture.
Voilà comment la même idée eft ennoblie par un
détour : c’eft le befoin qui a inventé la circonlocution.
Indiclifque in rébus egeflas.
Et il en eft des ornemens du ftyle comme de ceux
de l’archite&ure.
Qjiodque olim ufus înops reperit, hune ipfz' voluptaS
Poflulat.
Ainfi là circonlocution, qui fut d’abord un ligne de
pauvreté dans une langué, ëft devenue dans la fuite
un ornement de liixe dont on a fouvent abufé.
Le grand ufage de la circonlocution eft dans les cho-
fes de déliçateffe, de fineffe ou de décence ; car ces
trois caraûeres de la penfée tiennent aux foïns qu’on
a de la voiler à demi par une expreflionmyftérieufe ,
& d’éviter par un détour la trop grande clarté du mot
jufte & précis. ^foye^FiNESSE, Délicatesse, D e-
C E N C E , E S P R IT , &c. Dicl. raif. des Sciences, &c. &
Suppl. ( M. Ma rm o n t e l .)
, CIRCONVOLUTION, f. f. terme de Plain-chant'.
C ’eft une forte de périéléfè qui fe fait en inférant entre
là pénultième & la derniere note de 1 intonation
d’une piecè de chant, trois autres hôtes ; favoir;
une au-deffus.& deux au-deffous de la derniere note ;
lefquellés fe lient avec elle & forment un contour dé
tierce avant que d’y arriver ; comme fi vous avez
tes trois notes ihi fa un pour terminer l’intonation^