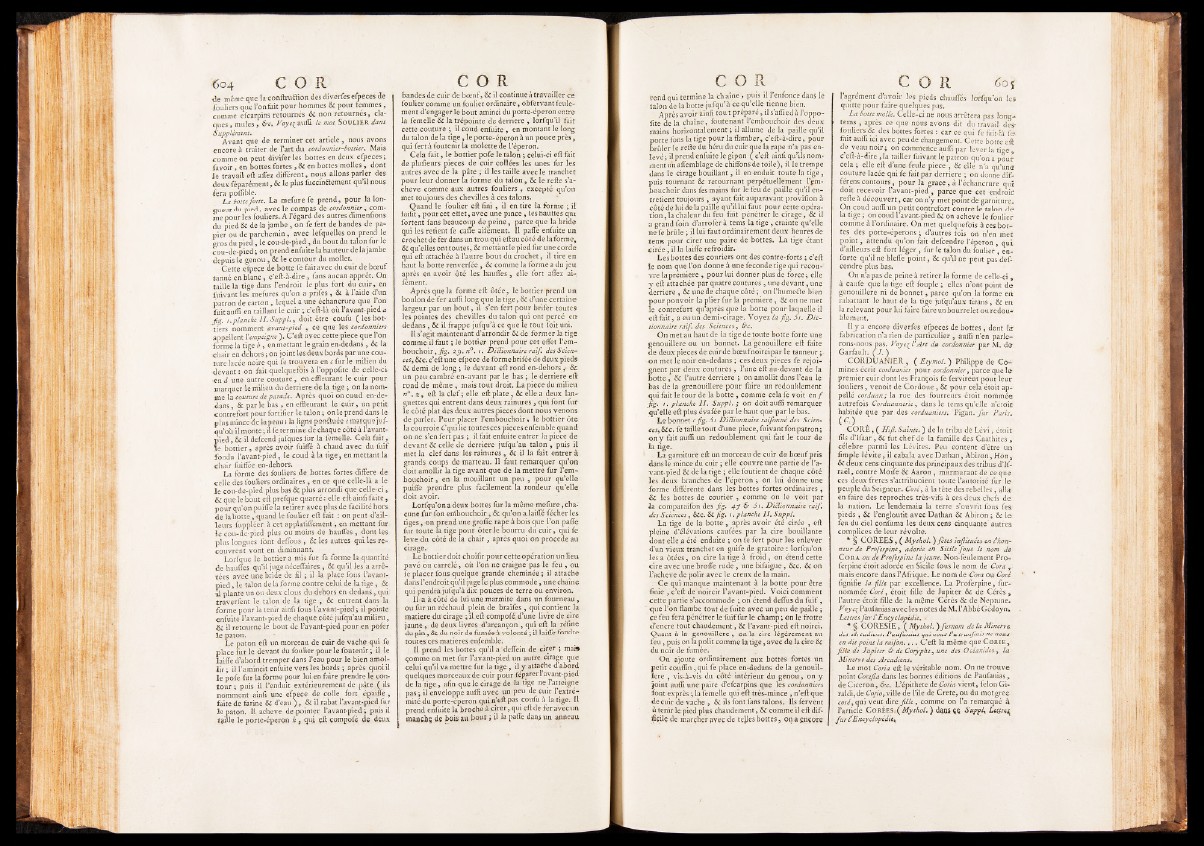
d e m êm e q u e l a c o n f t r u ô i o n d e s d i v e r f e s e f p e c e s d e
i o u l i e r s q u e l ’ o n f a i t p o u r h o m m e s & p o u r f e m m e s ,
c o m m e e f c a r p in s r e t o u r n é s & n o n r e t o u r n é s , c l a q
u e s , m u l e s , &c. Voye[ a u f f i le mot. S o u l i e r dans
Supplément.
Avant que de terminer cet article, nous avons
encore à traiter de l’art du cordonnier-bottier. Mais
comme on peut divifer les bottes en deux efpeces ;
lavoir, en bottes fortes , & en bottes molles , dont
le travail eft affez différent, nous allons parler des
deux féparément, & le plus fuccmûement qu’il nous
fera pofïible. ,
La botte forte. La mefure fe prend, pour la longueur
du pied, avec le compas de cordonnier, comme
pour les fouliers. A l’égard des autres dimenfions
du pied & de la jambe, on fe fert de bandes de papier
ou de parchemin, avec lefquelles on prend le
gros du p ied, le cou-de-pied, du bout du talon fur le
cou-de-pied; on prend enfuite la hauteur de la jambe
depuis le genou, & le contour du mollet.
Cette efpece de botte fè fait avec du cuir de boeuf
tonné en blanc, c’eft-à-dire, fans aucun apprêt. On
taille la tige dans l’endroit le plus fort du cuir, en
fuivant les mefures qu’on a prifes , & à l ’aide d’un
patron de carton , lequel a une échancrure que l’on
fuit auffi en taillant le cuir ; c’ eft-là où l’avant-pied a
fig. i.planche II. Suppl., doit être coufu ( le s bottiers
nomment avant-pied , ce que les cordonniers
appellent Xempeigne ). C’eft avec cette piece que Ton
forme la tige b , en mettant le grain en-dedans, & la
xhair en dehors ; on joint les deux bords par une couture
lacée noire qui fe trouvera en c fur le milieu du
devant : on fait quelquefois à l’oppofite de cellerci-
*en d une autre couture, en effleurant le cuir pour
marquer le milieu du derrière de la tige ; on la nom-
tne la couture de parade. Après quoi on coud en-dedans,
& parle bas , en effleurant le. cuir, un petit
contrefort pour fortifier le talon ; on le prend dans le
plus mince de la peau : la ligne pon&uée « marque juf-
qu’où il monte ; il fe termine de chaque côté à l’avant-
)ied, & il defeend jufques fur la femelle. Cela fait,
e bottier , après avoir fuiffé à chaud avec du fuif
fondu l’avant-pied, le coud à la tige, en mettant la
chair fuiffée en-dehors.
La forme des fouliers de bottes fortes différé de
celle des fouliers ordinaires, en ce que celle-là a le
le cou-de-pied .plus bas & plus arrondi que celle-ci,
& que le bout eft prefque quarré: elle eft ainfi faite,
pour qu’on puiffe la retirer avec plus de facilité hors
de la botte , quand le foulier eft fait : on peut d’ailleurs
fuppléer à cet applatiffemeht, en mettant fur
le cou-de-pied plus ou moins de hauffes , dont les
plus longues font deffous , & les autres qui les recouvrent
vont en diminuant.
Lorfque le bottier a mis fur fa forme la quantité
de hauffes qu’ il juge néceffaires , & qu’il les a arrêtées
avec une bride de fil ; il la place fous l’avant-
pied, le talon de la forme contre celui de la tige, <&
41 plante un ou deux clous du dehors en dedans., qui
traverfent le talon de la tige , & entrent dans la
forme pour la tenir ainfi fous l ’avant-pied ; il pointe
enfuite l’avant-pied de chaque côté.jufqu’au milieu,
& il retourne le bout de l’avant-pied pour en pofer
le paton. * - '
Le paton eft un morceau de cuir de vache qui fe
place fur le devant du foulier pour le foutenir ; il le
laiffe d’abord tremper dans l’eau pour le bien amollir
; il l’amincit enfuite vers les bords ; après quoi il
le pofe fur la forme pour lui en faire prendre leçon-
tour ; puis il l’enduit extérieurement de .pâte ( ils
nomment ainfi une efpece de colle fort épaifle ,
faite de farine & d’eau ) , & il rabat l’avant-pied fur
le paton. Il achevé de pointer l’avant-pied; puis il
taille le porte-éperon h , qui eft çompofé de deux
bandes de cuir de boeuf, & il continue à travailler ce
foulier comme un foulier ordinaire, obfervant feule-*
ment d’engager le bout aminci du porte-éperon entre
la femelle & la trépointe de derrière , lorfqu’il fait
cette couture ; il coud enfuite, en montant le long
du talon de la tige, le porte-éperon à un pouce près,
qui fert à foutenir la molette de l ’éperon.
Cela fait, le bottier pofe le talon ; celui-ci eft fait
de plufieurs pièces de cuir collées les unes fur les
autres avec de la pâte ; il les taille avec le trancher
pour leur donner la forme du talon, & le refte s’achève
comme aux autres fouliers , excepté qu’on
met toujours des chevilles à c'es talons.
Quand le foulier eft fini , il en tire la forme ; il’
faifit, pour cet effet, avec une pince, les hauffes qui
fortent fans beaucoup de peine, parce que la bride
qui les retient fe caffe aifement. Il paffe enfuite un
crochet de fer dans un trou qui eft au côté de la forme,
& qu’elles ont toutes, & mettant le pied fur une corde
qui eft attachée à l’autre bout du crochet, il tire en
haut là botte renverfée, Sc comme la forme a du jeu
après en avoir ôté les hauffes, elle fort affez ai-
fément.
Après que la forme eft ôtée, le bottier prend un
boulon de fer auffi long que la tige, & d’une certaine
largeur par un bout, il s’en fert pour brifer toutes
les pointes des chevilles du talon qui ont percé en-
dedans , & il frappe jufqu’à ce que le tout foit uni.
Il s’agit maintenant d’arrondir & de former la tige
comme il faut ; le bottier prend pour cet effet l’em-
bouchoir, fig. n°. 1. Dictionnaire raif. des Sciences,
&c. c’eft une efpece de forme brifée de deux pieds-
& demi de long ; le devant eft rond en-dehors f &
un peu cambré en-avant par le bas ; le derrière eft
rond de même , mais tout droit. La piece du milieu
n°. 2 , eft la clef ; elle eft plate, & elle a deux languettes
qui entrent dans deux rainures , qui font fut
le côté plat des deux autres pièces dont nous venons
de parler. Peur placer l’embouchoir, le bottier ôte
la courroie C qui lie toutes ces pièces enfemble quand
on ne s’en fert pas ; il fait enfuite entrer la piece de
devant & celle de derrière jufqu’au talon , puis il
met la c lef dans les rainures , & il la fait entrer à
grands coups de marteau. Il faut remarquer qu’on
doit amollir la tige avant que de la mettre fur l’embouchoir
, en la mouillant un peu , pour qu’elle
puiffe prendre plus facilement la rondeur qu’elle
doit avoir.
Lorfqu’on a deux bottes fur la même mefure, chacune
fur fon enibouchoir, & qu’on alaiffé fécher les
tiges, on prend une groffe râpe à bois que l’on paffe
fur toute la tige pour ôter le bourru du cuir, qui fe
leve du côté de la chair , après quoi on procédé au
cirage.
Le bottier doit choifir pour cette opération un lieu
pavé ou carrelé, où l’on ne craigne pas le feu , ou
fe placer fous quelque grande cheminée ; il attache
dans l’endroit qu’il juge le plus commode, une chaîne
qui pendra j.ufqu’à dix pouces de terre ou environ.
Il-aà côté de lui une marmite dans un fourneau,
ou fur un réchaud plein de braifes , qui contient la
matière du: cirage ;il eft compofé. d’une livre de cire
jaune * de deux livres d’arcançon , qui eft la réfine
du pin, & du noir de fumée à volonté ; il laiffe fondre
toutes ces matières enfemble. .
Il prend les bottes qu’il a 'deffein de cirer ; mai»
çomme on met fur l’avant-pied un autre cirage que
celui qu’il va mettre fur la tig e, il y attache d abord
quelques mprceaux de cuir pour féparerl’avant-pied
de la tige, afin que le cirage de la tige ne l’atteigne
, pas; il enveloppe auffi avec un peu de cuir l’extre-
mité du porte-éperon qui n’eft pas coufu à la tige. Il
prend enfuite la broche à cirer, qui eft de fer avec un
majiçb^ dç bois au bout > jfl p^fté dans un anneau
rond qui termine la chaîne, puis il l’enfonce dans le
talon de la botte jufqu’à ce cju’elle tienne bien.
Après avoir ainfi tout préparé, il s’affiedà l’oppo-
lite delà chaîne, foutenant l’embouchoir des deux
mains horizontalement; il allume de la paille qu’il
porte fons la tige pour la flamber, c’eft-à*-dire, pour
brider le refte du héru du cuir que la râpe n’a pas enlevé;
il prend enfuite le gipon ( G’eft ainfi qu’ils nomment
un affemblage de chiffons de toile), il le trempe
dans le cirage bouillant, il en enduit toute la tige,
puis tournant ôc retournant perpétuellement l’gm-
bouchoir dans fes mains fur le feu de paille qu’il entretient
toujours , ayant fait auparavant provifion à
côté de lui de la paille qu’il lpi faut pour cette opération,
la chaleur du feu fait pénétrer le cirage , & il
a grand foin d’arrofer à tems la tige , crainte qu’elle
ne fe brûle ; il lui faut ordinairement deux heures de
tems pour cirer une paire de bottes. La tige étant
c irée, il la laiffe refroidir.
Les bottes des couriers ont des contre-forts ; c’eft
le nom que l’on donne à une fécondé tige qui recouvre
la première , pour lui donner plus de force ; elle
y eft attachée par quatre coutures , une devant, une
derrière , & une de chaque côté ; on l’hume&e bien
pour pouvoir la plier fur la première, & on ne met
le contrefort qu’après que la botte pour laquelle il
eft fait, a eu un demi-cirage. Voyez la fig. 5 t. Dictionnaire
raif. des Sciences, &c.
On met.au haut de la tige de toute botte forte une
genouillère ou un bonnet. La genouillère eft faite
de deux pièces de cuir de boeuf noirci par le tanneur ;-
\on met le noir en-dedans ; ces deux pièces fe rejoignent
par deux coutures , l’une eft au-devant de la
b o tte , & l’autre derrière ; on amollit dans l’eau le
bas de la grenouillère pour faire un redoublement
qui fait le tour de la botte , comme cela fe voit en ƒ
fig. 1. planche II. Suppl.; on doit auffi remarquer
qu’elle eft plus évafée par le haut que par le bas.
Le bonnet cfig.5 t Dictionnaire raifonné des Sciences,
& c . fe taille tout d’une piece, fuivant fon patron ;
qn y fait auffi un redoublement qui fait le tour de
la tige.
. La garniture eft un morceau de cuir de boeuf pris
dans le mince du cuir ; elle couvre une partie de l’a-
vant-pied & de la tige ; elle foutient de chaque côté
les deux branches de l’éperôn ; on lui donne une
forme différente dans les bottes fortes ordinaires ,
& les bottes de courier , comme on le voit par
la comparaifon dès fig. 4 J & 5 i. Dictionnaire raif.
des Sciences, &c. & fig. 1. planche II. Suppl.
La tige de la botte , après avoir été cirée , eft
pleine d’élévations caufées par la cire bouillante
dont elle .a été enduite ; on fe fert pour les enlever
d’un vieux trarichet en guife de gratoire : lorfqu’on
les a ôtées, on cire la tige à froid, on étend cette
cire avec une broffe rude, une bifaigue, &c. & on
l’acheve de polir avec le creux de la main.
; Ce qui manque maintenant à la botte pour être
finie , c’eft de’noircir l’avant-pied. Voici comment
cette partie s’accommode ; on étend deffus du fu if ,
' que l’on flambe tout de fuite avec un peu de paille ;
ce feu fera pénétrer le fuif fur le champ ; on le frotte
d’encre tout chaudement, & l’avant-pied eft noirci.
Quant à la genouillère , .on la cire légèrement au
feu , puis on la polit comme la tige, avec de la cire &
du noir de fumée*
On ajoute ordinairement aux bottes fortes un
petit couffin ,qui fe place en-dedans de la genouil-,v
lere , vis-à-vis du côté intérieur du genou, on y
joint auffi une paire d’efearpins que les cordonniers
font exprès ; la femelle qui eft très-mince , n’eft que
.de cuir de vache , & ils font fans talons. Ils fervent
à tenir le pied plus chaudement, & comme il eft dif-.
ficilç de marcher £Yec de telles bottes, on a encore
l'agrément devoir les pieds chauffés lorfqu’ on les
quitte pour faire quelques pas-.
La botte molle. Celle-ci ne nous arrêtera pas long-
tems , après ce que nôus avons dit du travail des-
fouliers &c des bottes fortes : car ce qui fe fait-là fc*
fait auffi ici avec peu de changement. Cette botte eft:
de veau noir; on cdmmeftce auffi par lever la tige
c’eft-à-dire ,1a tailler fuivant le patron qu’on à pôut
cela ; elle eft d’une feule piece , & elle n’a cju’uné
couture lacée qui fe fait par derrière ; on donne différons.
contours, pour la grâce, à l’échancrure qut
doit recevoir l’avant-pied , parce que cet endroit
refte à découvert., car on n’y met point de garniture.
On coud auffi un petit contrefort contre le talon de
la tige ; on coud l’avant-pied & on achevé le foulier
comme à l’ordinaire. On met quelquefois à ces bottes
des porte-éperons ; d’autres fois on n’en met
point, attendu qu’on fait defeendre i’éperon , qui
d’ailleurs eft fort léger , fur le talon du foulier , en-
forte qu’il ne bleffe point, & qu’il ne peut pas descendre
plus basi
On n’a pas de peine à retirer la forme dè celle-ci,
à caufe que la tige eft fouple ; elles n’ont point de
genouillère ni de bonnet $ parce qu’on la forme eri
rabattant le haut de la tige jufqu’aux tirans , & en
la relevant pour lui faire faire un bourrelet ouredou*
blement.
Il y a encore divetfés efpeces de bottes, dont là
fabrication n’a rien de particulier , auffi n’en parlerons
nous pas. Voyez l'Art du cordonnier par M. dô
Garfau.lt* ( J . )
CORDUANIER, ( Etymol. ) Philippe de Co -
mmes écrit corduanier pour cordonnier, parce que le
premier cuir dont les François fe fervirént pour leur
fouliers, venoit de Cordoue, & pour cela étôit ap-
pellé corduan; la rue des fourreurs étoit nommée
autrefois Corduannerie, dans le tems qu’elle n’étôit
habitée que par des corduaniers. Pigan. fur Paris,
( t - ) , . 1 . m I
CO R É , ( Hiß. Sdiniei ) de la tribu de Lévi t, étoit
fils d’Ifaar, & fut chef de la famille des Câàthites ,
célébré parmi les Lévites; Peu content d’être un
fimple lévite, il cabala avec Dathan, Àbiron, Hon,
& deux cens cinquante des principaux des tribus d’If-
raël, contre Moïfe & Aaron , murmurant de ce que
ces deux freres s’attribuoient toute l’autorité fur le
peuple du Seigneur. CW , à la tête des rebelles ; alla
en faire des reproches très-vifs à ces deux chefs de*
la nation. Le lendemain la terre s’ouvrit fous fea
pieds , & l’engloutit avec Dathan & Abiron ; & le
feu du ciel confuma les deux cens cinquante' autres
complices de leur révolte*
* § CORÉES, ( Mythol. f fêtes infiituées en f honneur
de Prof erp ine, adorée en Sicile fous le nom de
C o r a ou de Proferpine la jeune. Non-feulement Pro-
ferpine étoit adorée en Sicile fous le nom de Cora •
mais encore dans l’Afrique. Le nom de Cora ou Coré
lignifie la fille par excellence. La Proferpine, fur-
nommée Coré, étoit fille de Jupiter & de Gérés ,
l’autre étoit fille de la même Cérès & de Neptune.
Voye^ Paulànias avec les notes de M. l’Abbé Gédoyn*
Lettres fur V Encyclopédie. >•
* § CORESIE, ( Mythol. ) furnom de la Minerve,
des Àrcadiens. Paufanias qui nous C a tranfmis ne nous
en dit point la raifon. 4.. C ’ e f t l a m ê m e q u e C o r i e ,
filée de Jupiter Cr .de Coryphe, une des Océanides , la
Minerve des Arcadiens,.
Le mot Coria eft le véritable nom. On ne trouve
point Confia dans les bonnes éditions de Paufanias ,
de Cicéron, &c. L’épithete de Çoria vient, félon Gi-
raldi,de Corio, ville de l’île de Crete, ou du mot grec
coré, qui veut dire fille , comme on l’a remarqué à
l’article _Co r é e s * ( Mythol. ) dgos ÇÇ Suppl, Lettre^
fur f Encyclopédiey