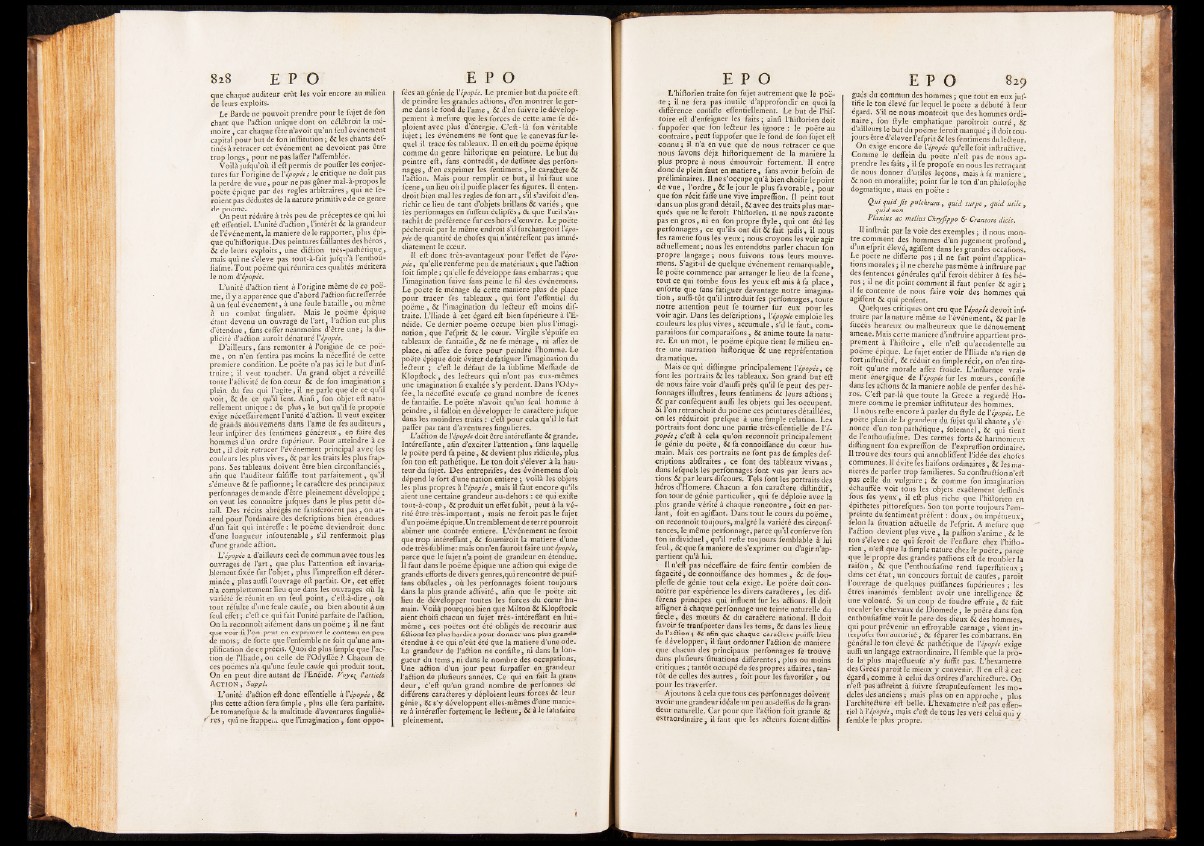
que chaque auditeur crût les voir encore au milieu
de leurs exploits.
Le Barde ne pouvoit prendre pour le fujet de fon
chant que l’aâion unique dont on célébroit la mémoire
, car chaque fête n’avoit qu’un feul événement
capital pour but de fon inftitution ; & les chants def-
tinés à retracer cet événement ne dévoient pas être
trop longs, pour ne pas laffer l’affemblée.
Voilà jufqu’où il eft permis de pouffer les conjectures
fur l’origine de l’épopée; le critique ne doit pas
la perdre de vu e, pour ne pas gêner mal-à-propos le
poète épique par des réglés arbitraires, qui ne fe-
roientpas déduites de la nature primitive de ce genre
de poème.
On peut réduire à très peu de préceptes ce qui lui
eft effentiel. L’unité d’aftion, l’intérêt & la grandeur
de l’événement, la maniéré de le rapporter, plus épique
qu’hiftorique.Des peintures Taillantes des héros,
& de leurs exploits, une diâion très-pathétique,
mais qui ne s’élève pas tout-à-fait jufqu’à l’enthou-
fiafme.Tout poème qui réunira ces qualités méritera
le nom d'épopée.
L ’unité d’attion tient à l’origine même de ce poème,
il y a apparence que d’abord l’aâionfutrefferree
à un feul événement, à une feule bataille, ou même
à un combat fingulier. Mais le poème épique
étant devenu un ouvrage de l’art, l ’a&ion eut plus
d’étendue, fans ceffer néanmoins d’être une ; la duplicité
d’aftion auroit dénaturé Vépopée.
D ’ailleurs, fans remonter à l’origine de ce poème
, on n’en fentira pas moins la néceffité de cette
première condition. Le poète n’a pas ici le but d’inf-
truire ; il veut tçucher. Un grand objet a réveillé
toute l’aâivité de fon coeur & de fon imagination ;
plein du feu qui l’agite, il ne parle que de ce qu’il
v o it, & de ce qu’il fent. Ainfi, fon objet eft naturellement
unique : de plus, le but qu’il fe propofe
exige néceffairement l’unité d’a&ion. Il veut exciter
de grands mouvemens dans l’ame de fes auditeurs,
leur infpirer des fentimens généreux, en faire des
hommes d’un ordre fupérieur. Pour atteindre à ce
b u t , il doit retracer l’événement principal avec les
couleurs les plus vives, & par les traits les plus frap-
pans. Ses tableaux doivent être bien circonftanciés,
afin que l’auditeur faififfe tout parfaitement, qu’il
s’émeuve & fe paffionne; le caraûere des principaux
perfonnages demande d’être pleinement développé ;
on veut les connoître jufques dans le plus petit détail.
Des récits abrégés ne fatisferoient pas , on attend
pour l’ordinaire des defcriptions bien étendues
d’un fait qui intéreffe : le poème deviendroit donc
d’une longueur infoutenable, s’il renfermoit plus
d’une grande aélion.
L 'épopée a d’ailleurs ceci de commun avec tous les
ouvrages de l’a r t , que plus l’attention eft invariablement
fixée fur l’objet, plus l’impreffion eft déterminée
, plus aufli l’ouvrage eft parfait. O r , cet effet
n’a complettement lieu que dans les ouvrages où la
variété fe:réunit en un feul point, c’eft-à-dire , où
tout refaite d’une feule caufe, ou bien aboutit à .un
feul effet; c’eft ce qui fait l’unité parfaite de l’a&ion.
On la reconnoît aifément dans un poème ; il ne faut
que voir fi l’on peut en exprimer le contenu en peu
de mots; de forte que l’enfemble ne foit qu’une amplification
de ce précis. Quoi de plus fimple que l’ac-;
tion de l’Iliade, ou celle de l’Odyffée ? Chacun de
ces poèmes n’a-qu’une feule caufe qui produit tout.
On en peut dire autant de l’Enéide. Voyeç Carticle
A ct ion , Suppl.
L’unité d’adion eft donc effentielle à Xépopée, &
plus cette adion fera fimple, plus elle fera parfaite.
Le romanefque &: la multitude d’aventures fingulié-
res, qui ne frappent que l’imagination, font oppofées
aü génie de Xépopée. Le premier but du poète e ft.
de peindre les grandes adions, d’en montrer le germe
dans le fond de l’ame, & d’en fuivrele développement
à mefure que les forces de cette ame fe déploient
avec plus d’énergie. C ’eft-là fon véritable
lujet; les événemens ne font que le canevas fur lequel
il trace fes tableaux. Il en eft du poème épique
comme du genre hiftorique en peinture. Le but du
peintre eft, fans contredit, de deffiner des perfonnages
, d’en exprimer les fentimens , le caradere &
l’adion. Mais pour remplir ce but, il lui faut une
fcene, un lieu où il puiffe placer fes figures. Il enten-
droit bien mal les réglés de fon a rt, s’il s’avifoit d’enrichir
ce lieu de tant d’objets brillans & variés, que
fes perfonnages en fuffent éclipfés, & que l’oeil s’attachât
de préférence fur ces hors-d’oeuvre. Le poète
pécheroit par le même endroit s’il furchargeoit Xèpor
pée de quantité de chofes qui n’intéreffent pas immér
diatement le coeur.
Il eft donc très-avantageux pour l’effet de Xépopée
, qu’elle renferme peu de matériaux ; que l’adion
foit fimple ; qu’elle fe développe fans embarras ; que
l’imagination fuive fans peine le fil des événemens.
Le poète fe ménage de cette maniéré plus de place
pour tracer fes tableaux, qui font l’effentiel du
poème, & l’imagination du ledeur eft moins distraite.
L’Iliade à cet égard eft bien fupérieure à l’E-
néïde. Ce dernier poème occupe bien plus l ’imagination,
que l’efprit & le coeur. Virgile s’épuife en
tableaux de fantaifie, & ne fe ménage, ni affez de
place, ni affez de force pour peindre l’homme. Le
poète épique doit éviter de fatiguer l’imagination du
ledeur ; c’eft le défaut de la fublime Mefliade de
Klopftock, des ledeurs qui n’ont pas eux-mêmes
une imagination fi exaltée s ’y perdent. Dans l’Ody-
fée, la néceffité excufe ce grand nombre de fcenes
de fantaifie. Le poète n’avoit qu’un feul homme à
peindre, il falloit en développer le caradere jufque
dans les moindres traits : c’eft pour cela qu’il le fait
paffer par tant d’aventures fingulieres.
L’adion de Xépopée doit être intéreffante & grande.
Intéreffante, afin d’exciter l ’attention, fans laquelle
le poète perd fa peine, & devient plus ridicule, plus
fon ton eft pathétique. Le ton doit s’élever à la hauteur
du fujet. Des entreprifes, des événemens d’où
dépend le fort d’une nation entière ; voilà les objets
les plus propres à Xépopée, mais il faut encore qu’ils
aient une certaine grandeur au-dehors : ce qui exifte
tout-à-coup, & produit un effet fubit, peut à la v érité
être très-important, mais ne feroit pas le fujet
d’un poème épique.Un tremblement de terre pourroit
abîmer une contrée entière. L’événement ne feroit
que trop intéreffant, & fourniroit la matière d’une
ode très-fublime: mais on n’en fauroit faire une épopéey
parce que le fujet n’a point de grandeur en étendue.
H faut dans le poème épique une adion qui exige de
grands efforts de divers genres,qui rencontre de puif-
fans obftacles , où les perfonnages foient toujours
dans la plus grande adivité-, afin que le poète ait
lieu de développer toutes les forces du coeur humain.
Voilà pourquoi bien que Milton & Klopftock
aient choifi chacun un fujet très - intéreffant en lui-
même , ces poètes ont été obligés de recourir aux
fidions les plus hardies pour donner une plus grande
étendue à ce qui n’eût été que la matière d ’une ode.
La grandeur de l’adion ne confifte, ni dans la Ion-
gueur du tems, ni dans le nombre des occupations;
Une adion d’un jour peut furpaffer en grandeur
l’adion de plufieurs années. Ce qui en fait la grann
deur, c’eft qu’un grand nombre de perfonnes de
différens caraderes y déploient leurs forces & leur
génie, & s’y développent elles-mêmes d’une manie-:
re à intéreffer fortement le ledeur, & à le fatisfaire
pleinement.
L ’hiftorien traite fon fujet autrement que le poète
; il ne fera pas inutilç d’approfondir en quoi la
différence confifte effentiellement. Le but de l’hif-
toire eft d’enfeigner les faits ; ainfi l’hiftorien doit
fuppofer que fon ledeur les ignore : le poète au
contraire, peut fuppofer que le fond de fon fujet eft
connu ; il n’a en vue que de nous retracer ce que
nous favons déjà hiftoriquement de la maniéré la
plus propre à nous émouvoir fortement. Il entre
donc de plein faut en matière, fans avoir befoin de
préliminaires. Il ne s’occupe qu’à bien choifir le point
de v u e , l’ordre, & le jour le plus favorable, pour
que fon récit faffe une vive impreffion. Il peint tout
dans un plus grand détail, & avec des traits plus marqués
que ne le feroit l’hiftorien. Il ne nous raconte
pas en g ros, ni en fon propre f ty le , qui ont été les
perfonnages, ce qu’ils ont dit & fait jadis, il nous
les ramene fous les yeux ; nous croyons les voir agir
aduellement ; nous les entendons parler chacun fon
propre langage ; nous fuivons tous leurs mouvemens.
S’agit-il de quelque événement remarquable,
le poète commence par arranger le lieu de la fcene,
tout ce qui tombe fous les yeux eft mis à fa place,
enforte que fans fatiguer davantage notre imagination
, auffi-tôt qu’il introduit fes perfonnages, toute
notre attention peut fe tourner fur eux pour les
voir agir. Dans les defcriptions, Xépopée emploie les
couleurs les plus v ives, accumule, s’il le faut, com-
paraifons fur comparaifons, & anime toute la nature.
En un mot, le poème épiqüe tient le milieu entre
une narration hiftorique & une repréfentation
dramatique.
Mais ce qui diftingue principalement Xépopée, ce
font les portraits & les tableaux. Son grand but eft
de nous faire voir d’auffi près qu’il fe peut des perfonnages
illuftres, leurs fentimens & leurs aélions ;
& par conféquent auffi les objets qui les occupent.
Si l’on retranchoit du poème ces peintures détaillées,
on les réduiroit prefque à une fimple relation. Les
portraits font donc une partie très-effentielle de 17-
popée; c’eft à cela qu’on reconnoît principalement
le génie du poète, & faconnoiffance du coeur humain.
Mais ces portraits ne font pas de fimples defcriptions
.abftraites , ce font des tableaux vivans,
dans lefquels les perfonnages font vus par leurs actions
& par leurs difcours. Tels font les portraits des
héros d’Homere. Chacun a fon caraftere diftinôif,
fon tour de génie particulier, qui fe déploie avec la
.plus grande vérité à chaque rencontre , foit en parlant,
foit en agiffant. Dans tout le cours du poème,
on reconnoît toujours, malgré la variété des circonf-
tances, le même perfonnage, parce qu’il conferve fon
ton individuel, qu’il refte toujours femblable à lui
feu l, & que fa maniéré de s’exprimer ou d’agir n’appartient
qu’à lui.
Il n’eft pas néceffaire de faire fentir combien de
fagacité, de connoiffance des hommes , & de fou-
pleffe de génie tout cela exige. Le poète doit connoître
par expérience les divers caraéfceres, les différens
principes qui influent fur les a fiions. Il doit
èffigner à chaque perfonnage une teinte naturelle du
fiecle, des moeurs & du caraftére national. Il doit
favoir le tfanfporter dans lès tems, & dans les lieux
de l’affion ; & afin que chaque caradere puiffe bien
fe développer, il faut ordonner l’adion de maniéré
que chacun des principaux perfonnages fe trouvé
dans plufieurs fituations différentes, plus ou moins
critiques ; tantôt Occupé de fes propres affairés; tantôt
de celles des autres, foit pour les favorifer , otf
pour les traverfer.
' Ajoutons à cela que tous ces perfonnages doivent
avoir une grandeur idéale un peu au-deffus de la gram
deur naturelle. Car pour que l’a&iOn foit grande &
extraordinaire, il faut que les adeiirs foient diftiré
gués du commun des hommes ; que tout ert eux justifie
le ton eleve fur lequel le poète a débuté à leur
égard. S’il ne nous montroit que des hommes Ordinaire,
fon ftyle emphatique paroîtroit outré , &£
d’ailleurs le but du poème feroit manqué ; il doit toujours
être d’élever l’efprit & les fentimens du lefteur*
On exige encore de Xépopée qu’elle foit inftruftive.
Comme le deffein du poète n’eft pas de nous apprendre
les faits, il fe propofe en nous les retraçant
de nous donner d’utiles leçons, mais à fa maniéré',
& non en moralifte; point fur le ton d’un philofophe
dogmatique, mais en poète *
Qui quid Jit pulchrum , quid turpe , quid Utile ,
quid non
Planius ac melius Chryjîppo 6* Crantore dicit.
Il inftruit par la voie des exemples ; il nous montre
comment des hommes d’ün jugement profond,
d un efprit elevé, agiffent dans les grandes occafions*
-Le poète ne differte pas ; il ne fait point d’applications
morales ; il ne cherche pas même à inftruire par
des fentences générales qu’il feroit débiter à fes héros
; il ne dit point comment il faut penfer & agir ;
il fe contente de nous faire voir des hommes qui
agiffent & qui penfent.
Quelques critiques ont cru que Xépopée devoit inf«
truire par la nature même de l’événement, & par le
fuccès heureux ou malheureux que le dénouement
amené. Mais cette manière d’inftruire appartient pro-,
prement à l’hiftoire , elle n’eft qu’accidentelle au
poème épique. Le fujet entier de l’Iliade n’a rien de
fortinftruélif, & réduit en fimple récit, on n’en tire*
roit qu’une morale affez froide. L’influence vraiment
énergique de Xépopée far les moeurs, confifte
dans les actions & la maniéré noble de penfer des héros.
C’eft par-là que toute la Grece a regardé Homère
comme le premier inftituteur des hommes.
Il nous refte encore à parler du ftyle de Xépopée. Lé
poète plein de là grandeur du fujet qu’il chante, s’énonce
d’un ton pathétique, folemnel, & qui tient
de l’enthoufiafme. Des termes forts & harmonieux
diftinguent fon expreffion de l’expreffion ordinaire’.
Il trouve des tours qui annobiiffent l’idée des chofes
communes. Il évite les liaifons ordinaires, & les maniérés
de parler trop familierès. Sa conftruélion n’eft
pas celle du vulgaire ; & comme fon imagination
échauffée voit tous les objets exaûement deffinés
fous fes yeux", il eft plus riche que i’hiftorien en
épithetes pittorefques. Son ton porte toujours l’em-
preinte du fentiment préfent : doux, ou impétueux,
félon la fituation aftuelle de l’efprit. A mefure que
l’aâion devient plus v iv e , la paffion s’anime, & le
ton s’élève : Ce qui feroit de l’enflure chez l’hiftorien,
n’eft que la fimple nature chez le poète , parce
que le propre des grandes paffions eft de troubler la
raifon , & que l’enthoufiafme rend fuperftitieux ;
dans cet état, umconcours fortuit de caufes, paroît
l’oUvrage de quelques puiffances fupérieures ; les
êtres inanimés fèmblent avoir une intelligence ÔC
une vôlonté. Si un coup de foudre effraie, & fait
reculer les chevaux de Diomede, le poète dans fon
enthoufiafme voit le pere des dieux & dès hommes;
qui pour prévenir un effroyable carnage, vient in-
terpofer fon autorité, &c féparer les combattans. En
général le ton élevé & pathétique de Xépopée exige
auffi un langage extraordinaire. Il femble que la pro-
fe lavplus majeftueufe n’y fuffit pas. L’hexametre
des Grecs paroît le mieux y convenir. Il en eft à cet
égard, comme à celui des ordres d’architeâure. On
n’eft pas aftreint à fuivre fcrupuleufement les modelés
des anciens ; mais plus on en approche , plus
l’architedure eft belle. L’hexametre n’eft pas effentiel
à Xépopée., mais c’eft de tous les vers celui qui y
femble le plus - propre. '