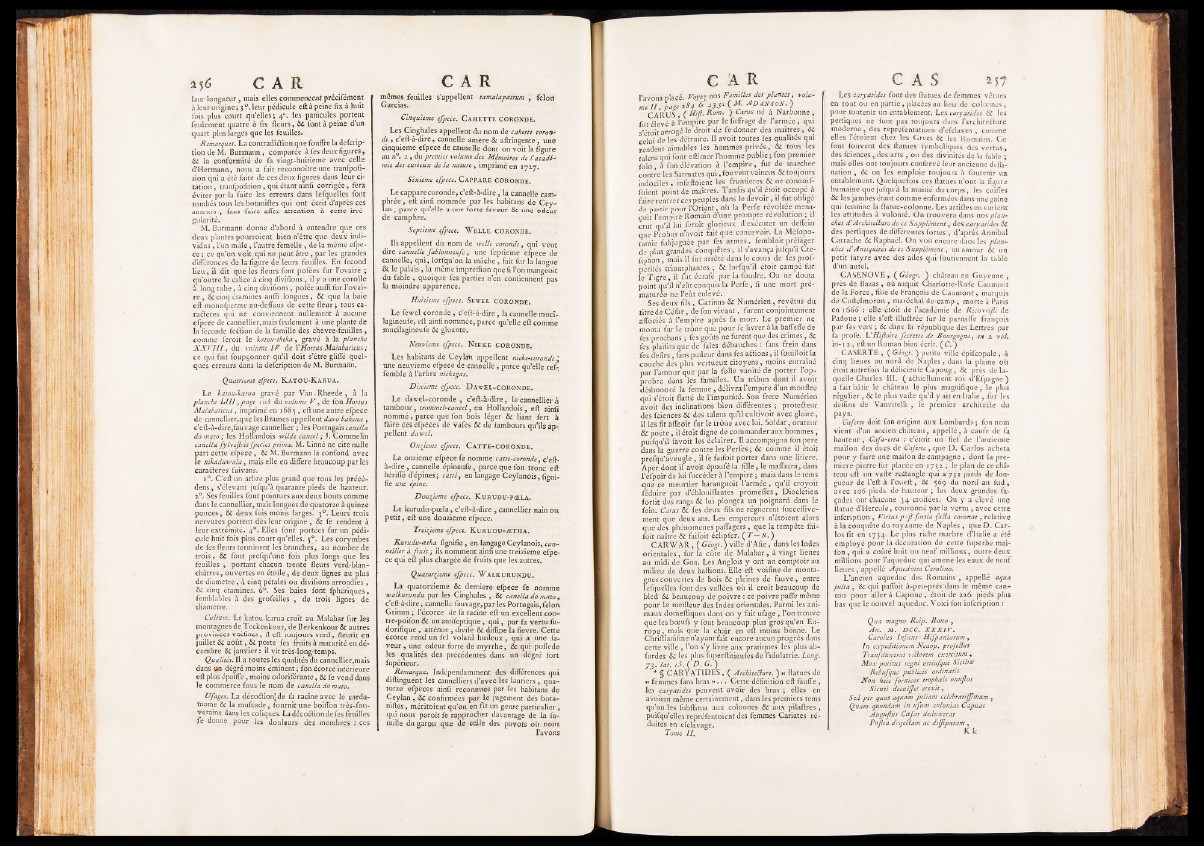
leur longueur, mais elles commencent précifément
à leur origine ; 3?. leur pédicule eft à peine fix à huit
fois plus court qu’elles; 40. les panicules portent
feulement quatre à fix fleurs, & font à peine d’un
quart plus larges que les feuilles.
Remarques. La contradiftion que fouffre la defcrip-
tion de M. Burmann, comparée à fes deux figures,
& la conformité de fa vingt-huitieme avec celle
d’Hermann, nous a fait reconnoître une tranfpofi-
îion qui a été faite de ces. deux figures dans leur citation
, tranfpofition , qui étant ainfi corrigée, fera
éviter par la fuite les erreurs dans lefquelles font
tombés tous les botaniftes qui ont écrit d’après ces
auteurs , fans faire affez attention à cette irrégularité.
M. Burmann donne d’abord à entendre que ces
deux plantes pôurroient bien n’être que deux individus
, l’un mâle, l’autre femelle, de la même efpe-
ce ; ce qu’on voit qui ne peut ê tre, par les grandes
différences de la figure de leurs feuilles. En fécond
lieu , il dit que les fleurs font pofées fur l’ovaire ;
qu’outre le calice à cinq divifions, il y a-une corolle
à long tube, à cinq divifions, pofée auffi fur l’ovaire
, & cinq étamines aufli longues, & que la baie
eft monofperme au-deflous de cette fleur; tous ca-
raûeres qui ne conviennent nullement à aucune
efpeee de cannellier,mais feulement à une plante de
la fécondé feftion de la famille des chevre-feuilles,
comme feroit le katou-theka, gravé à la planche
X X V I I I , du volume IP de YHortus Malabaricus ;
ce qui fait foupçonner qu’il doit s’être gliffé quelques
erreurs dans la defcription de M. Burmann.
Quatrième efpeee. KATOU-KARUA.
Le katou-karua gravé par Van-Rheede, à la
planche L U I , page ro5 du volume V 9 de fon Hortus
Malabaricus, imprimé en 168 ç , eft une autre efpeee
de cannellier,que les Brames appellent davo bahena ,
c’eft-à-dire,fauvage cannellier ; les Portugais canella
do mato ; les Hollandois wilde caneel ; J. Commelin
canella fylvejlris fpecies prima. M. Linné ne cite nulle
part cette efpeee, & M. Burmann la confond avec
le nikaduwala, mais elle en différé beaucoup par les
caraéleres fuivans.
i° . C ’eft un arbre plus grand que tous les précé-
dens, s’élevant jufqu’à quarante pieds de hauteur.
2.0. Ses feuilles font pointues aux deux bouts comme
dans le cannellier, mais longues de quatorze à quinze
pouces, 8c deux fois moins larges. 30. Leurs trois
nervures portent dès leur origine , & fe rendent à
leur extrémité. 40. Elles font portées fur un pédicule
huit fois plus court qu’elles. 50. Les corymbes
de fes fleurs terminent les branches, au nombre de
tro is, & font prefqu’une fois plus longs que les
feuilles , portant chacun trente fleurs vera-blan-
châtres, ouvertes en étoile, de deux lignes au plus
de diamètre, à cinq pétales ou divifions arrondies ,
& cinq étamines. 6°. Ses baies font fphériques,
femblables à des grofeilles , de trois lignes .de
diamètre.
Culture. Le katou-karua croît au Malabar fur les
montagnes de Teckenkour, de Berkenlcour & autres
provinces voifines ; il eft toujours verd, fleurit en
juillet & août, 8c porte fes fruits à maturité en décembre
& janvier : il vit très-long-temps.
Qualités. Il a toutes lès qualités du cannellier,mais
dans un dégré moins éminent ; fon écorce intérieure
eft plus épaiffe, moins odoriférante, 8c fe vend dans
le commerce fous le nom d e canella do mato.
Ufages. La déeo&ion} de fa racine avec' le cardamome
8c la mufeade, fournit une boiffon très-fou-
veraine dans les coliques. La déco&ion de fes feuilles
fe donne pour les douleurs des membres : ces
mêmes feuilles s’appellent tamalapatruth j felori
Garcias.
Cinquième efpeee. C A H E T T E CORONDE.
Les Cinghales appellent du nom de cahette coron*
de, c’ eft-à-dire, cannelle amere & aftringente, une
cinquième efpeee de cannelle dont on voit la figure
au n°. x , du premier volume des Mémoires de üaeadéI
mie des curieux de la nature, imprimé en 172.7*
Sixième efpeee. CAPPARE ÇOROnde.
Le cappare coronde, c’eft-à-dire, la cannelle camphrée
, eft ainfi nommée par les habitans de Cey-
lan, parce qu’elle a une forte faveur 8c une odeur
de camphre.
Septième efpeee. W e l l e CORONDE.
Ils appellent du nom de welle coronde, qui veut
dire cannelle fablonneufe, une feptieme efpeee de
cannelle, qui, lorfqu’on la mâche , fait fur la langue
8c le palais , la même impreffion que fi l’on mangeoit
du fable , quoique fes parties n’en contiennent pas
la moindre apparence.
Huitième efpeee. S e v e l CORONDE.
Le fe v e l coronde, c’eft-à-dire, la cannelle muci-
lagineule, eft ainfi nommée, parce qu’elle eft comme
mucilagineufe 8c gluante.
Neuvième efpeee. N i e k e CORONDE.
Les habitans de Ceylan appellent nieke-coronde 9
une neuvième efpeee de cannelle, parce qu’elle ref-
femble à l’arbre niekegas.
Dixième efpeee. D a w e l - ç o r o n d e .
Le dawel-coronde , c’eft-à-dire, le cannellier à
tambour, trommel-caneel, en Hollandois, eft ainfi
nommé, parce que fon bois léger & liant fert à
faire ces efpeces de vafes 8c de tambours qu’ils appellent
dawel.
Onzième efpeee. C A T T E -C O R O N D E .
La onzième efpeee fe nomme catte-corohde, c’eft-
à-dire , cannelle épineufe, parce que fon tronc eft
hériffé d’épines; cattét en langage Ceylanois, figni-
fie une épine.
Douzième efpeee, KURUDU-POELA.
Le kurudu-poela, c’eft-à-dire , cannellier nain ou,
petit, eft une douzième efpeee.
Treizième efpeee. K urudu-ÆTHA.
Rurudu-atha lignifie, en langage Ceylanois, can-
nellier a fruit ; ils nomment ainfi une treizième efpe»
ce qui eft plus chargée de fruits que les autres.
Quatorzième efpeee. "Wa lk üRUNDU.
La quatorzième 8c derniere efpeee fe nomme
walkurundu par les Cinghales , 8c canella do mato „
c’eft-à-dire, cannelle fauvage,parles Portugais, félon
Grimm ; l’écorce de fa racine eft un excellent con-
tre-poifon & un antifeptique, q ui, par fa vertu fu-
dorifique, atténue, divife 8c diflîpe la fievre. Cette
écorce rend un fel volatil huileux, qui a fune fav
eu r, une odeur forte de myrrhe, 8c quipoffede
les qualités des précédentes dans un dégré fort
fupérieur.
Remarque. Indépendamment des différences qui
diftinguent les cannelliers d’avec les lauriers , qua-
! torzé efpeces ainfi reconnues par les habitans de
Ce ylan, 8c confirmées par le jugement dés botaniftes
, méritoîent qu’on en fît un genre particulier ,
qui nous paroît fe rapprocher davantage de la famille
du garou que de celle des pavots où nous
l’avons
ravons placé r<s fi D
« g II, WÊKË & 433I C »■ Adavso». •>
C ARU S , ( Hïfl. Rom. )■ Car us ne a Narbonne,
fut élevé à i’émpïre par le fuffrage de l’armééi qui
s’étoit arrogé le droit- de fe donner des maîtres’, 8c
celui' de lès détruire. Il avoit toutes les qualités qui
rendent aimables les hommes privés, & tous les
talens qui font eftimer l’homme public; fon premier
fo in , à fon élévation à l’empire, fut de marcher
contre les Sarmates q ui, fouvént vaincus & toujours
indociles, infeftoient les frontières 8c ne eonnoif-
foient point de maîtres. Tandis qu’il étoit occupé à
faire rentrer ces peuples dans le devoir , il fut obligé
de partir pour l’Orient, où la Perfe révoltée mena-
çoit l’empire Romain d’une prompte révolution ; il
crut qu’il lui feroit glorieux d’exécuter un deffein
que Probus n’avoit mit que concevoir. La Mésopotamie
fubjuguée par fes armes, fembloit prefager
de plus grandes conquêtes ; il s’avança jufqu’à Cte-
fiphon, mais il fut arrêté dans le cours de fes prof-
pérités triomphantes ; ôc lorfqu’il étoit campé fur.
le T ig re , il fut écrafé par la foudre. On ne douta
point qu’il n’eût conquis la Perfe, fi une mort prématurée
ne l’eût enlevé.
Ses deux fils , Carinus 8c Numérien, revêtus du
titre de Cé far, de fon vivant, furent conjointement
affociés à l’empire après fa morr. Le premier ne
monta fur le trône que pour fe livrer à la baffeffe de
fès penchans ; fes goûts ne furent que des crimes, 8c
fes plaifirs que de fales débauches : fans frein dans
fes defirs, fans pudeur dans fes aftions, il fouilloit la
couche des plus vertueux c itoyens, moins entraîné
par l’amour que par la folle vanité de porter l’opprobre
dans les familles. Un tribun dont il avoit
déshonoré la femme , délivra l’empire d’un monftre
qui s’étoit flatté de l’impunité. Son frere Numérien
avoit des inclinations bien différentes ; protetteur
des fciences 8c des talens qu’il cultivoit avec gloire,
il les fit affeoir fur le trône avec lui. Soldat, orateur
& poète, il étoit digne de commander aux hommes,
puifqu’il favoit leseclairer. Il accompagna fon pere
dans la guerre contre les Perfes ; 8c comme il étoit
prefqu’aveugle, il fe faifoit porter dans une litiere.
Aper dont il avoit époufé la fille, le maffacra, dans
l’efpoir de lui fuccéder à l’empire ; mais dans le tems
que ce meurtier haranguoit l ’armée, qu’il croyoit
féduire par d’éblouiffantes promeffes, Dioclétien
fortit des rangs & lui plongea un poignard dans le
fein. Carus & fes deux fils ne régnèrent fiicceflive-
ment que deux ans. Les empereurs n’étoient alors
que des phénomènes paffagers , que la tempête faifoit
naître & faifoit éclipfer. ( T —N.)
C A R V A R , ( Gèogr. ) ville d’A fie , dans les Indes
orientales, fur la côte de Malabar, à vingt lieues
au midi de Goal Les Anglois y ont un comptoir au
milieu de deux baftions. Elle eft voifine de montagnes
couvertes de bois & pleines de fauve, entre
lefquelles font des vallées où il croît beaucoup de
bled & beaucoup de poivre : ce poivre paffe même
pour le meilleur des Indes orientales. Parmi les animaux
domeftiques dont on y fait ufage , l’on trouve
que les boeufs y font beaucoup plus gros qu’en Europe
, mais que la chair en eft moins bonne. Le
Chriftianifme n’ayant fait encore aucun progrès dans
cette ville , l’on s’y livre aux pratiques les plus -ab-
furdes &: les plus fuperftitieufes de l’idolâtrie. Long,
y g . lat. iS. ( D . G.')
* § CARYATIDES, ( Architecture. ) « ftatues de
» femmes fans bras » . . . Cette définition eft fàuffe ,
les caryatides peuvent avoir des bras ; elles en
avoient même certainement, dans les premiers tems
qu’on les fubftitua aux colonnes & aux pilaftres ,
puifqu’elles repréfentoient des femmes Cariâtes réduites
en èfclavage.
Tome II,
Les Caryatides font des ftatues de femmes vêtues
en tout ou en partie, placées au lieu de colonnes ,
pour foutenir un entablement. Les caryatides & les
perfiques ne font pas toujours dans l’archite&ure
moderne, des repréfentations d’efclaves , comme
elles l’étoient chez les Grecs 8c les Romains. Ce
font fouvent des ftatues fymbôliques des vertus,
des fciences, des arts , ou des divinités de la fable ;
mais ©lies ont toujours confervé leur ancienne defti-
naticm , & on les emploie toujours à foutenir un
entablement. Quelquefois ces ftatues n’ont la figure
humaine que jufqu’à la moitié du corps, les cuiffes
& les jambes étant comme enfermées dans une gaîne
qui termine la ftatue-eolonne. Les artiflre$en varient
les attitudes à Volonté. On trouvera dans nos planches
d’Architecture de ce Supplément, des caryatides &
des-perfiques de différentes fortes , d’après Annibal
Carrache & Raphaël. On voit encore dans les planches
d.'Antiquités de ce Supplément, un amour & un
petit fatyre avec des ailes qui foutiennent la table
d’un autel.
CASENOVE, ( Géogr. ) château en Guyenne ,
près de Bazas , où naquit Charlotte-Rofe Caumont
de la Force, fille de François de Caumont, marquis
de Caftelmoron , maréchal-de-çamp , morte à Paris
en 1666 : elle étoit de l’académie de Ricovrifli de
Padoue ; elle s’eft illuftrée fur le parnaffe françois
par fes vers ; & dans la république des Lettres par
fa pr-ofe. L’Hijloire fecrette de Bourgogne, en. x vol.
in-1 1 , eft un Roman bien écrit. ( C. )
■ CASERTE , ( Géogr. ) petite ville épifcopale, à
cinq lieues au nord de Naples, dans la plaine où
étoit autrefois la délicieufe Capoue, 8c près de laquelle
Charles III. ( aftuellement roi d’Efpagne )
a fait bâtir le château le plus magnifique, le plus
régulier, & le plus vafte qu’il y ait en Italie , fur les
deflins de Vanvitelli , le premier architecte du
pays.
Caferte doit fon origine aux Lombards ; fon nom
vient d’un ancien château, appellé, à caufe de fa
hauteur , Cafa-erta : c’étoit un fief de l’ancienne
maifon des ducs de Caferte , que D. Carlos acheta
pour y faire une maifon de campagne , dont la première
pierre fut placée en 17^2 ; le plan de ce château
eft un vafte reCtangle qui a 731 pieds de longueur
de l’eft à l’oueft, 8c 569 du nord au fud ,
avec 106 pieds de hauteur ; les deux grandes façades
ont chacune 34 croifées. On y a élevé une
ftatue d’Hercule, couronné par la vertu , avec cette
infeription , Virtus pojt fortia factà coronat, relative
à la conquête du royaume de Naples , que D. Carlos
fit en 1734. Le plus riche marbre dUtalie a été
employé pour la décoration de cette fuperbe maifon
, qui a coûté huit ou neuf millions, outre deux
millions pour l’aqueduc qui amene les eaux de neuf
lieues, appellé Aquedotto Carolino.
L’ancien aqueduc des Romains , appellé aqua
julia , 8c qui pafioit à-peu-près'dans le même canton
pour aller à Capoue , étoit de zz6 pieds plus
l bas que le nouvel aqueduc. Voici fon infeription ;
Qua magno Reip. Bono ,
A n . M. DCC. X X X IV .
Carolus Infans * Hifpaniarum,
In expéditionem Neaop. profeclus
Tranfduxerat viciorem exercitum,
Mox potitus regni utriufque Sicilia
Rebufque publiçis ordinatis
Non heic fornices trophais onujlos
Sicuti decuijfet erexit,
Sed per quos aquam juliam celebratijfimam,
Quant quondam in ufum colonias Capuas
Augujlüs Ccefar deduxerat
Pojlea disjeÛam ac diffipatam,