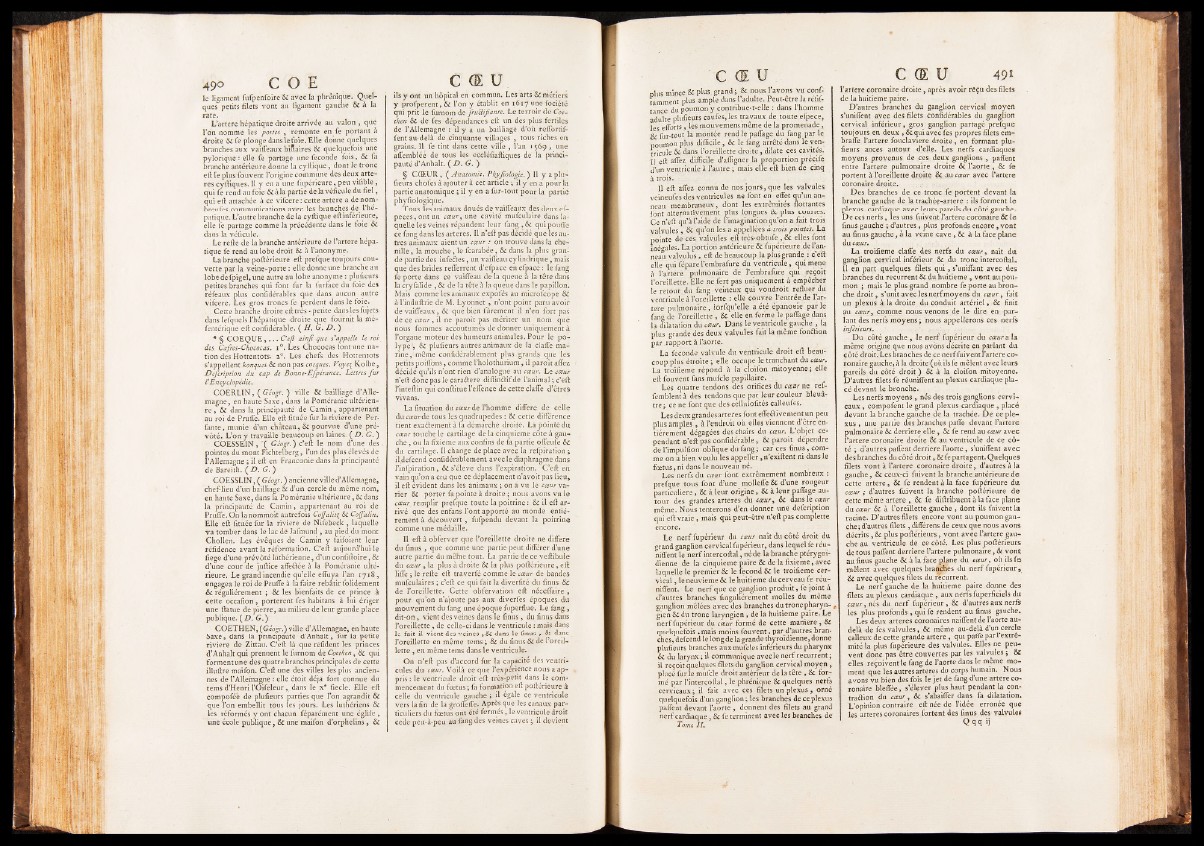
le ligament fufpenfoire 8c avec la phrénique. Quelques
petits filets vont au ligament gauche 8c à la
rate.
L’artere hépatique droite arrivée au valon , que
l’on nomme les portes , remonte en fe portant a
droite 8c fe plonge dans le foie. Elle donne quelques
branches aux vaiffeaux binaires 8c quelquefois une
pylorique : elle fe partage une fécondé fois, 8c fa
branche antérieure donne la cyftique, dont le tronc
eft Te plus fouvent l’origine commune des deux artères
cyftiques. II y en a une fupérieure, peu v ifible,
qui fe rend au foie & à la partie delà véficule du fiel,
qui eft attachée à ce vifcere : cette artere a de nom-
breufes^communications avec les branches de l’he-
patique. L’autre branche de la cyftique eft inférieure,
elle fe partage comme la précédente dans le foie 8c
dans la véficule.
Le refte de la branche antérieure de l’artere hépatique
fe rend au lobe droit 8c à l’anonyme.
La branche poftérieure eft prefque toujours couverte
par la veine-porte : elle donne une branche au
lobe de fpigel, une autre au lobe anonyme : plufieurs
petites branches qui font fur la furface du foie deît
réfeaux plus confidérables que dans aucun autre
vifcere. Les gros troncs fe perdent dans le foie.
. Cette branche droite eft très-petite danslesfujets
dans lefquels l’hépatique droite que fournit la mé-
fentérique eft confidérable. ( H. G. D . }
* § COEQUE , . . . C'ejl ainfi que s'appelle le rov
des Cafres-Chococas. i° . Les Chococas font une nation
des Hottentots. 20. Les chefs des Hottentots
s’appellent konques 8c non pas coeques. Voye[ Kolbe,
Defcnption du cap de Bonne-Efpérance. Lettres fur
V Encyclopédie.
COERLIN, ( Géogr. } ville 8c bailliage d’Allemagne,
en haute Saxe, dans la Poméranie ultérieur
e , & dans la principauté de Camin , appartenant
au roi de Pruffe. Elle eft fituée fur la riviere de Per-
fante, munie d’un château, 8c pourvue d’une prévôté.
L’on y travaille beaucoup en laines. ( D .G .}
COESSE1N , r( Géogr. ) c’eft le nom d’une des
pointes du mont Fichtelberg, l’un des plus élevés de
l ’Allemagne ; il eft en Franconie dans la principauté
de Bareith. ( D . G .)
COESSLIN, ( Géogr.} ancienne ville d’Allemagne,
chef-lieu d’un bailliage & d’un cercle du même nom,
en haute Saxe,dans la Poméranie ultérieure, dedans
la principauté de Camin, appartenant au roi de
Pruffe. On lanommoit autrefois Co(Jalit{ 8c Coffalin.
Elle eft fituée fur la riviere de Nifebeck , laquelle
v a tomber dans le lac dé Jafmund , au pied du mont
Chollen. Les évêques de Camin y faifoient leur
réfidence avant la réformation. C’eft aujourd’hui le
fiege d’une prévôté luthérienne, d’un confiftoire, &
d’une cour de juftice afferiée à la Poméranie ultérieure.
Le grand incendie qu’elle effuya l’an 17 18 ,
engagea le roi de Pruffe à la faire rebâtir folidement
& régulièrement ; 8c les bienfaits de ce prince à
cette occafion, portèrent fes habitans à lui ériger
une ftatue de pierre, au milieu de leur grande place
publique. {D . G.)
COETHEN, {Géogr.} ville d’Allemagne, en haute
Saxe, dans la principauté d’Anhalt, fur la petite
riviere de Zittau. C’eft là que réfident les princes
d’Anhalt qui prennent le furnom de Coethen, & qui
formentune des quatre branches principales de cette
illuftre maifon. C’eft une des villes les plus anciennes
de l’Allemagne : elle étoit déjà fort connue du
tems d’Henri l’Oifeleur, . dans le Xe fiecle. Elle eft
compoféè de plufieurs parties que l’on agrandit &
que l’on embellit tous les jours. Les luthériens &
les réformés y ont chacun féparément une églif e ,
une école publique, 8c une maifon d’orphelins, 8c
ils y ont un hôpital en commun. Les arts & métiers
y profperent, 8c l’on y établit en 1617 une fociété
qui prit le furnom d g fructifiante. Le terroir de Coethen
8c de fes dépendances eft un des plus fertiles
de l’Allemagne : il y a un bailliage d’oü reflbrtif-
fent au-delà de cinquante villages , tous riches en
grains. Il fe tint dans cette ville , l’an 1569 , une
affembléé de tous les eccléfiaftiques de la principauté
d’Anhalt. ( D . G. }
§ COE U R , ( Anatomie. Phyjiologie. ) Il y a plufieurs
chofes à ajouter à cet article ; il y en a pour la
partie anatomique ; il y en a fur-tout pour la partie
phyfiologique.
Tous les animaux doués de vaiffeaux des deux ef-
peces, ont un coeur, une cavité mufculaire dans laquelle
les veines répandent leur fang , 8c qui poufle
ce fang dans les arteres. Il n’eft pas décidé que les autres
animaux aient un coeur : on trouve dans la chenille
, la mouche, le fearabée, 8c dans la plus grande
partie des infeûes, un vaiffieau cylindrique, mais
que des brides refferrent d’efpace en efpace : le fang
fe porte dans ce vaiffeau de la queue à la tête dans
la cryfalide , & de la tête à la queue dans le papillon.
Mais comme les animaux expofés au microfcope St
à l’induftrie de M. Lyonnet , n’ont point paru avoir
de vaiffeaux, 8c que bien fùrement il n’en fort pas
de ce coeur, il ne paroît pas mériter un nom que
nous fommes accoutumés de donner uniquement à
l’organe moteur des humeurs animales. Pour le polype*,
8c plufieurs autres animaux de la claffe marine,
même confidérablement plus,grands que les
petits poiffons, comme l’holothurium, il paroît allez
décidé qu’ils n’ont rien d’analogue au coeur. Le coeur
n’eft donc pas le çarariere diftin&ifde l’animal ; c’eft
l’inteftin qui conftitue l’effence de cette claffe d’êtres
vivans.
La fituation du coeur de l’homme différé de celle
du coeur de tous les quadrupèdes : 8c cette différence
tient exactement à fa démarche droite. La pointe du
coeur touche le cartilage de la cinquième côte à gauche
, ou la fixieme aux confins de fa partie offeufe 8c
du cartilage. Il change de place avec la refpiration ;
ifdefcend confidérablement avec le diaphragme dans
l’infpiration, & s’élève dans l’expiration. C’eft en
vain qu’on a cru que ce déplacement n’avoit pas lieu,
il eft évident dans les animaux ; on a vu le coeur varier
8c porter fa pointe à droite ; nous avons vu le
coeur remplir prefque toute la poitrine : & il eft arrivé
que des enfans l’ont apporté au monde entièrement
à découvert, fufpendu devant la poitrine
comme une médaille.
Il eft à obferver que l’oreillette droite ne différé
du finus , que comme une partie peut différer d’une
autre partie du même tout. La partie de ce veftibule
du coeur, la plus à droite & la plus poftérieure, eft
liffe ; le refte eft traverfé comme le coeur de bandes
mufculaires ; c’eft ce qui fait la diverfité du finus 8c
de l’oreillette. Cette obfervation eft néceffaire ,
pour qu’on n’ajoute pas aux diverfes époques du
mouvement du fang une époque fuperflue. Le fang ,
dit-on, vient des veines dans le finus , du finus dans
l’oreillette , de celle-ci dans le ventricule : mais dans
le fait il vient des veines , 8c dans le finus , & dans
l’oreillette en même tems ; & du finus 8c de l’oreillette
, en même tems dans le ventricule.
On n’eft pas d’accord fur la capacité des ventricules
du coeur. Voilà ce que l’expérience nous a appris
: le ventricule droit eft très-petit dans le commencement
du foetus ; fa formation eft poftérieure à
celle du ventricule gauche ; il égale ce ventricule
vers la fin de la groffeffe. Après que les canaux particuliers
du foetus ont été fermés, le ventricule droit
cecte peu-à-peu au fang des veines caves ; il devient
plus mince & plus, grand; 8c nous l’avons vu conf-
tamment plus ample dans l’adulte. Peut-être la réfif-
tance du poumon y contribue-t-elle : dans l’homme
adulte plufieurs caufes,les travaux de toute efpece,
les efforts, lés mquvemens'même de la promenade,
& fur-tout la montée rend le paffage du fang par le
poumon plus difficile, 8c le fang arrêté dans le ventricule
& dans l’oreillette droite, dilate ces cavités.'
Il eft affez difficile d’afligner la proportion précife
d’un ventricule à l’autre ; mais elle eft bien de cinq
à trois.
Il éft affez connu de no$: jours, que les Valvules
veineufes des ventricules ne font en effet qu’un anneau
membraneux, dont les extrémités flottantes
font alternativement plus longues 8c plus courtes.
Ce n’eft qu’à l’aide de l’imagination qu’on a fait trois
valvules , 8ç qu’on les a àppélléës à trois pointes. La
pointe de ces valvules eft très-qbtufe , & elles, font
inégales. La portion antérieure & fupérie.ure de l’anneau
val v;u lu s , eft de beaucoup, la plus grande : c’éït
elle qui fépare i’embrafure du ventricule, qui mene
à l’artere pulmonaire dé l’embrafure qui .reçoit
l’oreillette. Elle ne fert pas uniquement à empêcher
le retour du fang veineux qui voudroit refluer du
ventricule à l’oreillette : elle couvre l’entrée de l’ar-:
tere pulmonaire, lorfqu’elle a été épanouie par lé
fang de l’oreillette , 8c elle en ferme, le paffage dans
la dilatation du coeur. Dans le ventricule gauche , la
plus grande des deux valvules fait la même fonction
par rapport, à l’aorte.
La fécondé valvule du ventricule droit eft beaucoup
plus étroite ; elle occupe le tranchant du coeur.
La troifieme répond à la cloifon mitoyenne; elle
eft fouvent fans mufcle papillaire.
Les quatre tendons des orifices du coeur ne. ref-
femblent à des tendons que par leur couleur bleuâtre
; ce ne font que des cellulofités calleufes.
Les deux grandes arteres font effectivement un peu
plus amples , à l’endroit oit elles viennent d’être entièrement
dégagées des chairs du coeur. L’objet cependant
n’eft pas confidérable, & paroît dépendre
de l’impulfion oblique du fang ; car ces finus, comme
on a bien voulu les appeller, n’exiftent ni dans le
foetus , ni dans le nouveau ne.
Les nerfs du coeur font extrêmement nombreux :
prefque tous font d’une molleffe 8c d’une rougeur
particulière, 8c à leur origine, 8c à leur paffage autour
des grandes arteres du coeur, & dans le coeur
même. Nous tenterons d’en donner une defeription
qui eft vraie, mais qui peut-être n’eft pas complette
encore.
Le nerf fupérieur du coeur naît du côté droit du
grand ganglion cervical fupérieur, dans lequel fe réunifient
le nerf intercoftal, né de la branche ptérygoï-
dienne de la cinquième paire & de la fixieme, avec
laquelle le premier & le fécond 8c le troifieme cervical
, le neuvième & le huitième du cerveau fe réunifient.
Le nerf que ce ganglion produit, fe joint à
d’autres branches finguliérement molles du même
ganglion mêlées avec des branches du tronc pharyn-,
gien 8c du tronc laryngien , de la huitième paire. Le
nerf fupérieur du coeur formé de cette maniéré, &
quelquefois , mais moins fouvent, par d’autres branches,
defeend le long de la grande thyroïdienne, donne
plufieurs branches aux mufcles inférieurs du pharynx
8c du larynx ; il communique avec le nerf récurrent ;
il reçoit quelques filets du ganglion cervical m oyen,
placé fur le mufcle droit antérieur de la tête , 8c formé
par l’intercoftal, le phrénique 8c quelques nerfs
cervicaux; il fait avec ces filets un plexus, orné
quelquefois d’un ganglion; les branches de ce plexus
paffent devant l’aorte , donnent des filets au grand
nerf cardiaque, 8c fe terminent avec les branches de
Tome II.
l’artere coronaire droite, après avoir reçu des filets
de la huitième paire.
D ’autres branches du ganglion cervical moyen
s’unifient avec des filets confidérables du ganglion
cervical inférieur, gros ganglion partagé prefque
toujours en deux ,8c qui avec fes propres filets em-
braffe l’artere fouclaviere droite, en formant plufieurs
ances autour d’elle. Les nerfs cardiaques
moyens provenus de ces deux ganglions , paffent
entre l’artere pulmonaire droite 8c l’aorte, & fe
portent à l’oreillette droite 8c âu coeur avec l’artere
coronaire droite.
Des branches de ce tronc fe portent devant la
branche gauche de la traçhée-artere : ils forment le
.plexus cardiaque avec leurs.pareils du côté gauche*
De ces nerfs, les uns fuivent l’artere coronaire & le
finus gauche' ; d’autres, plus profonds encore, vont
au finus gauche, à la veine cave , 8c à la face plane
du coeur.
La troifieme claffe des nerfs du coeur, naît dut
ganglion .cervical inférieur 8c du tronc intercoftal.
11 en part quelques filets q u i, s’unifiant avec des
branches du récurrent & du huitième , vont au poumon
; mais le plus grand nombre fe porté au bronche
droit, s’unit avec les ne.rfmoyens du coeur, fait
un plexus à ,1a droite du conduit artériel, & finit
au coeur, comme nous venons de le dire en parlant
des nerfs moyens; nous appellerons ces nerfs
inférieurs.
Du côté gauche, le nerf fupérieur du coeur a là
même origine que nous avons décrite en parlant du
côté droit. Les branches de ce nerf fuivent l’artere coronaire
gauche, à la droite (où ils fe mêlent avec leurs
pareils du côté droit) & à la cloifon mitoyenne.
D ’autres filets fe réunifient au plexus cardiaque pla-,
cé devant le bronche. .
Les nerfs moyens , nés des trois ganglions cervicaux
, çompofent le grand plexus cardiaque , placé
devant la branche gauche de la trachée. De ce plexus
, une partie des branches paffe devant l’artere
pulmonaire 8c derrière e lle , & fe rend au coeur avec
l’artere coronaire droite & au ventricule de ce côté
; d’autres paffent derrière l’aorte, s’unifient avec
des branches du côté d roit, 8c fe partagent. Quelques
filets vont à l’artere coronaire droite, d’autres à la
gauche, & ceux-ci fuivent la branche-antérieure de
cette artere, 8c fe rendent à la face fupérieure du
coeur ; d’autres fuivent la branche poftérieure de
cette même artere , 8c fe diftribuent à la face plane
, du coeur 8ç à l’oreillette gauche, dont ils fuivent la
racine. D’autres filets encore vont au poumon gauche;
d’autres filets ,différens de ceux que nous avons
décrits ,& plus poftérieurs, vont avec l’artere gauche
au ventricule de ce côté. Les plus poftérieurs
de tous paffent derrière l’artere pulmonaire, & vont
au finus gauche & à la face glane du coeur, où ils fes
mêlent avec quelques branches du nerf fupérieur,
8c avec quelques filets du récurrent.
Le nerf gauche de la huitième paire donne des
filets au plexus cardiaque , aux nerfs fuperficiels du
coeur, nés du nerf fupérieur, & d’autres aux nerfs
les plus profonds , qui fe rendent au finus gauche.
Les deux arteres coronaires naiffent de l’aorte au-
delà de fes valvules, & même au-delà d’un^cercle
calleux de cette grande artere , qui paffe par l’extrémité
la plus fuperieure des valvules» Elles ne peuvent
donc pas être couvertes par les valvules ; 8c
elles reçoiventle fang de l’aorte dans le meme moment
que les autres arteres du Corps humain» Nous
avons vu bien des fois le jet de fang d’une artere coronaire
bleffée , s’élever plus haut pendant la con-
' traftion dü coeur, 8c s’abaiffer dans fa dilatation.
L’opinion contraire eft née de l’idée erronée que
les arteres coronaires fortent des finus des valvules
Q q q U