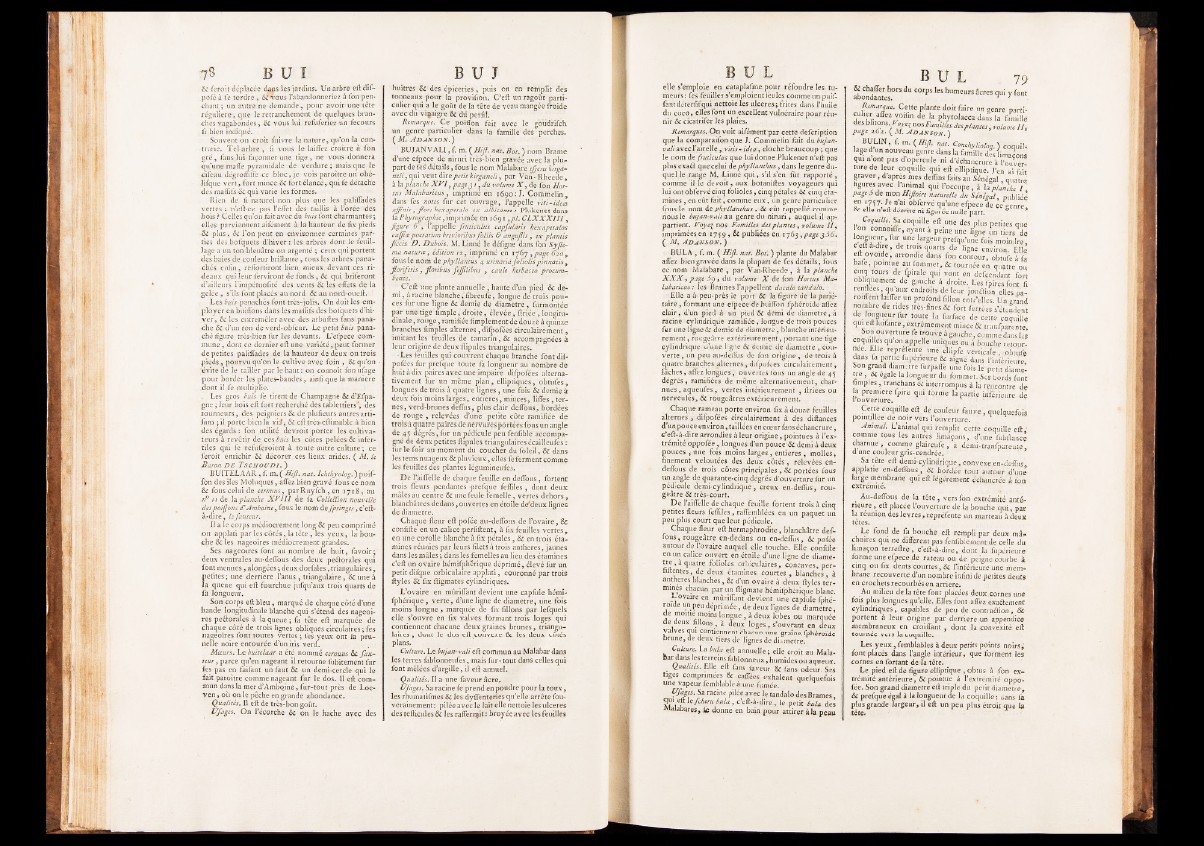
& feroit déplacée dans les jardins. Un arbre eft dif-
,pofé à fe tordre , Sc^vous l’abandonneriez à fon penchant;
un autre ne demande, pour avoir une tête
régulière, que le retranchement de quelques branches
vagabondes, & vous lui réfuteriez un fecours
fi bien -indiqué.
Souvent on croit fuivre la nature, qu’on la contrarie.
Tel arbre , fi vous le laiffez croître à fbn
g r é , fansJui façonner une tige, ne vous donnera
qu’une ma fie pyramidale de verdure ; mais que le
cifeau dégroflïffe ce bloc,.je vois paroître.un obé-
Jifque vert, fort mince .& fort élancé, qui le détache
des maflifs & q u i varie les formes.
Rien de fi naturel non plus que les -paliffades
vertes ; n’eft-ce pas l’effet des taillis à l’orée des
bois ? Celles qu’on fait avec du buis font charmantes ;
elles parviennentaifément à la hauteur de fix pieds
&c plus , Sc l’on peut en environner certaines parties
des bofquets d’hiver: les arbres dont le feuillage
a un ton bleuâtre ou argenté ; ceux qui portent
des baiesde couleur brillante , tous les arbres pana-
chés enfin, reflbrtiront bien mieux devant ces rideaux
qui leur ferviront de fonds, & qui briferorrt
d’ailleurs l’impétuofité des v.ents & les effets de la
gelée, s’ils font placés au nord &c au nord-oueft.
Les buis panachés font très-jolis. On doit les employer
en buiflbns dans les maflifs des bofquets d’hiv
e r , & les entremêler avec des arbuffes fans panache
& d’un ton de verd-obfcur. Le petit buis panaché
figure très-bien fur. les .devants. L’efpeee commune,
dont ce dernier eft une variété, peut former
de petites paliffades de la hauteur de deux ou trois
pieds, pourvu qu’on le cultive avec foin , & qu’on
'évite de le tailler par le haut: on connoît fon ufage
pour border les plates-bandes, ainfi que la maniéré
xlont il fe multiplie.
Les gros buis fe tirent de Champagne & d’Efpa-
gne ; leur bois eft fort recherché des tablettiers*, des
tourneurs, des peigniers & de plufieurs autres arti-
fans ; il porte bien la vi£, & eft très-eftimable à bien
des égards : fon utilité devroit porter les cultivateurs
à revêtir de ces buis les côtes pelées &c infertiles
qui fe refuferoient à toute autre culture ; ce
feroit enrichir & décorer, ces lieux arides. ( M. le
B a r o n D E Ts c h o u d i . )
BUITELAAR, f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog. ) poif-
fon des îles Moluques, affez bien gravé fous.ce nom
& fous celui de cernuus, parRuyfch , en 17 18 , au
ji° 11 de la planche X V I I I de fa Collection nouvelle
despoiflons eCAmboine, fous le nom de fpringer, c’eft-
à-dire, le fauteur.
Il a le corps médiocrement long & peu comprimé
ou applati par les côtés, la tête , les yeux, la bouche
& les nageoires médiocrement grandes.
Ses nageoires font au nombre de huit, favoir;’
deux ventrales au-deffous des deux peftorales qui
font menues, alongées ; deux dorfales »triangulaires,
petites; une derrière,l’anus , triangulaire , &c une à
la queue qui eft fourchue jufqu’aux trois quarts de
la longueur.
Son corps eft bleu, marqué de chaque côté d’une
bande longitudinale blanche qui s’étend des nageoires
pe&orales à la queue ; fa tête eft marquée de
chaque côté de trois lignes obliques circulaires ; fes
nageoires font toutes Certes ; fes yeux ont la prunelle
noire entourée d’un iris verd.
Moeurs. Le buitelaar a été nommé cernuus & fauteur
, parce qu’en nageant il retourne fubitement fur
fes pas en faifant un faut & un demi-cercle qui le
fait paroître comme nageant fur le dos. Il eft commun
dans la mer d’Ambqine, fur-tout près de Loe-
v en , oii on le pêche en grande abondance.
Qualités. Il eft de très-bon goût.
Ufages. On l’écorche &c on le hache avec des
huîtres & des épiceries, puis on e'n remplit des
tonneaux pour la provifion. Ç’eft lin ragoût particulier
qui a le goût de la tête de veau mangée froide
avec du vinaigre & dû perfil.
Remarque. Ce poiffon fait avec le goudrifch
un genre particulier dans la famille des perches.
(M. A DAN S ON.}
BUJANVALI, f. m. ( Hiß. nat. Bót. } nom Brame
d’une efpece de nirüri très-bien gravée avec la plupart
de fe£ détails, fous le nom Malabare tfjeru kirga-
ntli, qui veut dire petit kirgàneli, par Van-Rheede,
à la planche X V I , page,3 / , du volume X , de fon Hortus
Malabaricus, imprimé en 1690: J. Çommelin ,
dans fes notes fur cet ouvrage, rappelle viti-idées
affinis, flore hexapetalo ex albicànte : Plukenet dans
fa Phyto graphie, imprimée en 1691 ,pl. C L X X X I I I ,
figure (T, l’appelle ftuticulus capfulàris hexqpetalos
cafjice poet arum brevioribus foliis & angùflis , ex plantis
ficcïs D . Dubois. M. Linné le défigne dans fon Syfle-
ma natures, édition 12, imprimé en 1/67 > page 620,
fous le nom de phyllàntus4 urinarià foliolis pinnatis ,
fioriferis , fioribus fejfilibtls , caule Herbaceo procum-
bente.
C ’eft une plante annuelle, haute d’un pied & demi,
à racine blanche, fibreufe, longue de trois pouces
fur une ligne & demie de diamètre , furmontée
par une tige fimple, droite, élevée, ftriée § longitudinale
, rouge, ramifiée Amplement de douzè à quinze
branches fimples alternes, difpofées .circulairement,
imitant les feuilles tle tamarin, & accompagnées à
leur origine de deuxftipules triangulaires.
- Les feuilles qui couvrent chaque branche font dif-
pofées fur prefque toute fa longueur au nômbre de
huit à dix paires avec une impaire difpofées alternativement
fur un même plan, elliptiques, obtufes,
longues de trois à quatre lignes , une fois & demie à
deux fois moins larges, entières, minces, liftes »ternes,
verd-brunes deflus,' plus clair deflous, bordées
de rouge , relevées d’une petite côte ramifiée de
trois à quatre paires de nervures portées fous un angle
de 45 dégrés, fur un pédicule peu fenfible accompagné
de deux petites ftipules triangulaires écailleufes :
fur le foir au moment du coucher du foleil, & dans
les tems nuageux & pluvieux, elles fe ferment comme
les feuilles des plantes légumineufes.
DeTàiffelle de chaque feuille en deflous, fortent
trois fleurs pendantes prefque fefliles, dont deux
mâles au centre & une feule femelle, vertes dehors ,
blanchâtres dedans, ouvertes en étoile d^deux lignes
de diamètre.
Chaque fleur eft pofée ati-deflous de l’ovaire, &
confifte en un calice perfiftent, à fix feuilles vertes,
en une corolle blanche à fix pétales, & en trois étamines
réunies par leurs filets à trois anthères, jaunes
dans les mâles ; dansles femelles au lieu des étamines
c’eft un ovaire hémifphêrique déprimé, élevé fur un
petit difque orbiculaire applati, couronné par trois
ftyles 8c fix ftigmates cylindriques.
L’ovaire en mûriflant devient une capfule hémi-
fphérique, verte, d’une ligne de diamètre, line fois
moins longue, marquée de fix filions par lefquels
elle s’ouvre en fix valves formant trois loges qui
contiennent chacune deux graines brunes, triangulaires
, dont le dos eft convexe & les deux côtés
plans.
Culture. Le bujan-vali eft commun au Malabar dans
les terres fablonneufes, mais fur-tout dans celles qui
font mêlées d’argille, il eft annuel.
Qualités. Il a une faveur âcre.
Ufages. Sa racine fe prend en poudre pour la toux,
les rhumatifmes & les dyffenteries qu’elle arrête fou-
verainement : pilée avec le lait elle nettoie les ulcérés
des tefticules 8c les raffermit : broyée ayec les feuilles
elle s’emploie en cataplafme pour réfoudre les tumeurs:
fes feuilles s’emploient feules comme un puif-
fantdéterfifq.ui nettoie les ulcérés; frites dans l’huile
du coco, ejfesfont un excellent vulnéraire pour réunir
& cicatrifêr les plaies.
Remarques. On voit aifément'par cette defeription
que la comparaifon que J. Çommelin fait du bujan-
vali avecl’airelle 9vitis- idea, cloche beaucoup ; que
le nom de fruticulus que lui donne Plukenet n’eft pas
plus exaét .que celui de phyllanthus, dans le genre duquel.
le range M. Linné qui, s’il s’en fut rapporté,
comme il le de voit, aux bo.tàniftes voyageurs qui
lui ont obfervé cinq folioles, cinq pétales, 6c cinq étamines
, en eût fait, comme éux, un genre particulier
fous le nom de phyllanthus ,' & eût rappellé comme
nous le bujan-vali au genre du niruri, auquel il appartient.
Voyeç nos Familles des plantes, volume //,
imprimées en 17 59, & publiées en 1763, page 3
( A/, A d an son . )
BULA , f. m. ( Hifl. nat. Bot'.} plante du Malabar
affez bien gravée dans la plupart de fes détails, fous
ce nom Malabare , par Van-Rheede, à la planche
X X X , page 5 C} 9 du volume -5T.de fon H or tus Malabaricus:
les Brames l’appellent dacalo tandalo. •
Elle a à peu-près le port & la figure-de' la parie*
taire, formant une efpece de buiftbn fphéfoïdè affez
clair, d’un pied à un pied & demi de diamètre, à .
racine cylindrique ramifiée,-longue de trois pouces
fur une ligne & demie de diàmetrè , blanche intérieurement
, rougeâtre extérieurement, portant une tige
cylindrique dTune I-gne & demie de diamètre ».couverte
, un peu au-deflus de fon origine , de trois à
quatre branches alternes , difpofées circulairement,
lâches, affez longues, ouvertes lbus un angle de 45
dégrés, ramifiées de même alternativement, charnues
» aqueufes, vertes intérieurement , ftriées ou
nerveufés, & rougeâtres extérieurement.
Chaque rameau porte environ fix à douze feuilles
alternes y difpofées circulairement à des diftances
d’un, pouce environ, taillées en coeur fans échancrure,
c’eft^-a-dire arrondies à leur origine, pointues à l’extrémité
oppofée, longues d’un pouce & demi à deux
pouces , une fois moins larges , entières , molles,
finement veloutées des deux côtés, relevées en- .
deflous de trois côtes principales , $c portées fous
un angle de quarante-cinq dégrés d’ouverture fur un
pédicule demi-cylindrique, creux en-deffus, rougeâtre
& très-court.
De l’aiflèlle de chaque feuille fortent trois à cinq
petites fleurs fefliles, raffemblées en un paquet un
peu plus court que leur pédicule.
• Chaque fleur eft hermaphrodite, blanchâtre def-
fous, rougeâtre en-dedans ou en-deffus, & pofée 1
autour de l’ovaire auquel elle touche. Elle confifte
en un calicé ouvert en étoile d’une ligne de diame- :
tre , à quatre folioles orbiculaires, concaves, per-
fiftentes, de deux étamines courtes , blanches, à
anthères blanches, & d’un ovaire à deux ftyles termines
chacun par un ftigmate hémifphérique blanc.
L ovaire en mûriflant devient une capfule fphé-
roide un peu déprimée, de deux lignes de diamètre,
de moitié moins longue, à deux lobes ou marquée
de deux filions , à deux loges, s’ouvrant en deux
valves qui contiennent chacun une graine, fphéroïde
brune, de deux tiers de lignes de diamètre.
Culture. La bula eft annuelle ; elle croît au Mala-
Bar dans les terreinsfablonneux, humides ou aqueux.
. (W u « ..E lIe eft fans faveur & fans odeur. Ses
tiges ço,mpnmees & caffées exhalent quelquefois
une vapeur femblable à une fumée.
Vfaga. Sa racine piloeavec le tandalo des Brames
qm eft U fthtru b/tU , c'eft-à.direi, le petit bula des
Malabares, te donne en bain pour attirer à la peau
& chafler hors du corps les humeurs âcres qui y font
abondantes» J
Remarqua. Cette plante doit faire un genre particulier
affea votlin de la phytolatca dans la Famillé
d e sM ito n s .iW o o sFamUlls.rUsplanus, volume //,
page zÇ z. ( M. A d an son. ) . ,
BULIN, f. m. (H M Cohehyiiohg. ) WÊÊL
läge d un nouveau genre dhns la famille df'sïimacons
qui nont pas d’opercule ni d’échancrure à I w V r
turede leur coquille qui eft elliptiquè. J’en ai fait
graver, d apres mes deflins faits au Sénégal quàtré
hguresavec l’anmal qui l’occupe, à 1 uplanche l .
pages de mon Hijloire naturelle du Senegal, publiée
Je n’a. Obfervé qu’une efpqçe de ce genre,
OC elle n efl décrite ni figurée nulle part» '
Coquille. Su coquille eft uhe des plus petites que
on, connotffei âyaut à peine ufle ligne Un tiers dé
WMÊËÈÈBÈÈ lme: B B a n fois moindre,
c cftà-dtre, de trots quarts de ligne environ. Ella
elt ovoïde, arrondie dans fon contour, obtufe à fa
baf? vP om' lie au fommet, Sc tournée en quatre ou
cinq-fours-de fpirale qui vont en dénudant fort
obliquement de gauche à droite. Les fpires font. f.
re"S“ S.î :x «droits de lSt,r jönffifln ailes,parodient
biffer un profondftllqn entr’elles.'Ümérand
nombre de ridéft%'ftnes Sç fort ferrées s’étendent
de longneur fur toute la forface de cette çoquiïle
qui eft hufante . .extrêmement qtince & tranfparente,
Son ouverture fe trouve à gauçhe. Mulme dans les
coqtMIes qu on appelle uniques ou k bouche retournée.
Elle repréfent’e' une :éllipfe verticale , -ohtufa
dans fa partie fupefiéùre fc aiguë dans l’inférieur^
Son gratid diamètre forpéfle tihè fois le-petit diamer
tre , tk egale la longueur du.fommet.-Sts bords font
fimples, trançhans St interrompus à la rencontre de
la première fptre qui forme la partie inférieure de
1 ouverture.
H «quille eft de'Âirdûr fairste, quelquefois
pointillée de noir vers l’ouyerture.
Animal..L’ahimalquj, reftiplit cette’;coquille eft ;
comme fous lés autres ' limaçons, d’uiie fubftancçi
charnue , comme glsireufe , à demi-tranfparenîe,
dune couleurgris-rcendrée.
Sa tête eft demi-cyJindrjqitei convexe en?defliis.'
applatie en-îlelîbiis , & bordée tout autour d’une
large membrane qui eft légèrement éc/iancrée à fon
extrémité.
Au-deffous de la t ê te , vers fon extrémité antérieure
, eft placée l’ouverture de la bouche qui, par
la reunion des le vres, repréfente un marteau à deux
têtes.
Le fond de fa bouche eft rempli par deux ma*
choires qui ne different pas fenfibiement .de celle du
limaçon terreftre, c’eft-à-dire, doiit la fupérieure
formeuneefpece.de rateau ou de peigne .courbe à
.cinq ,ou fix dents courtes, & l’inférieure une membrane
recouverte d’un nombre infini de petites dents
.en crochets recourbés en arriéré.
Au milieu delà tête font placées deux.cornes une
fois plus longues qu’elle. Elles font aflèz exaélement
cylindriques, capables de peu de contra&ion, &
portent à leur origine par derrière un appendice
membraneux en croiffant , dont .la convexité eft
tournée vers la coquille.
Les y e u x , femblables à deux petits points noirs,’
font placés dans l’angle intérieur, que forment les
cornes en fortant de la tête»
Le pied eft.de figure elliptique , obtus à fon extrémité
antérieure, & pointue à f extrémité oppofée.
Son grand diamètre eft triple du petit diamètre,
ôc prefque égal à la longueur de la coquille : dans la
plus grande largeur, il eft un peu plus étroit que la
tête.