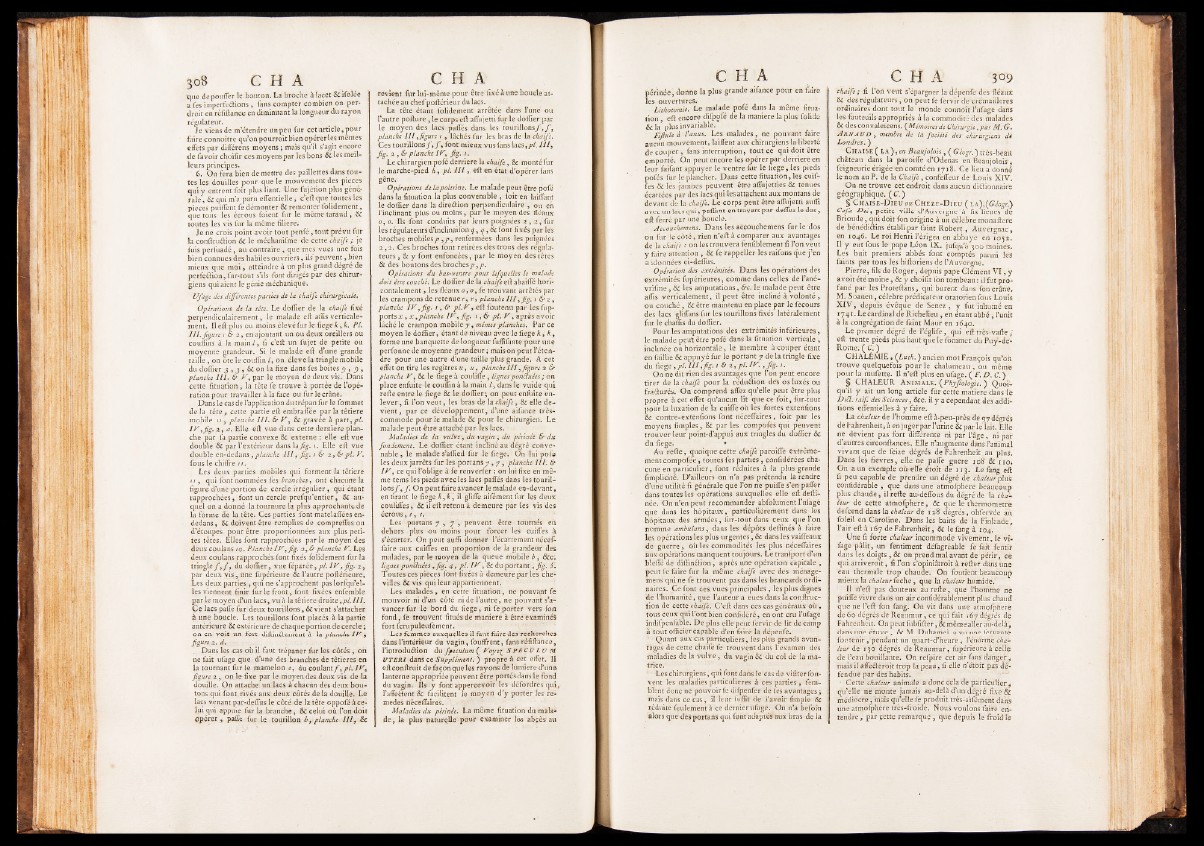
oue de pouffer le bouton. La broche à lacet &ifolée
a (es imperfe&ions , fans compter combien on per-
droit en réfiftance en diminuant la longueur du rayon
régulateur.
Je viens de m’étendre un peu fur cet article, pour
Faire connoître qu’on pourroit bien opérer les mêmes
effets par différéns moyens ; mais qu’il s’agit encore
de favoir choifir ces moyens par les bons 6c les meilleurs
principes.
6. On fera bien de mettre des paillettes dans toutes
les douilles pour que le mouvement des pièces j qui y entrent foit plus liant. Une fujétion plus générale
, 6c qui m’a paru effentielle, c’eft que toutes les
pièces puiffent fe démonter & remonter folidement,
que tous les écrous foient fur le même taraud, 6c
toutes les vis fur la même filière.
Je ne crois point avoir tout penfé, tout prévu fur
la conftruftion & le méehanifme de cette chaife ; je
fuis perfuadé, au contraire , que mes vues une fois
bien connues des habiles ouvriers, ils peuvent, bien
mieux que moi, atteindre à un plus grand degre de
perfe&ion, fur-tout s’ils font dirigés par des Chirurgiens
qui aient le génie méchânique.
Ufage des différentes parties de La chaife chirurgicale.
Opérations de la tête. Le doflier de la chaife fixé
perpendiculairement, le malade eft afiîs verticalement.
Il eft plus ou moins élevé fur le fiege k -, k. PI.
I II. figure i & 2 , en ajoutant un ou deux oreillers ou
couffins à la main/, fi c’eft un fujet de petite ou
moyenne grandeur. Si le malade eft d’une grande
taille, on ôte le couffin /, on éleve la tringle mobile
du doflier 3 , j , & on la fixe dans fes boîtes 9 , 9 ,
planche 111. & V , par le moyen de deux vis. Dans
cette fituation , la tête fe trouve à portée de l’opération
pour travailler à la face ou fur le crâne.
Dans le cas de l’application du trépan fur le fommet
de la tête , cette partie eft embraffée par la têtiere
mobile 11, planche III. & V , & gravée à part ,/»/.
IP^fig. 2, a. Elle eft vue dans cette derniere planche
par fa partie convexe 6c externe : elle eft vue
double 6c par l’extérieur dans la fig. /. Elle eft vue
double en-dedans, planche 1 1 1 , fig. 1 & 2, & pL V.
fous le chiffre 11.
Les deux parties mobiles qui forment la têtiere
11 , qui font nommées fes Branches, ont chacune la
figure d’une portion de cercle irrégulier, qui étant
rapprochées, font un cercle prefqu’entier, & auquel
on a donné la tournure la plus approchante de
la forme de la tête. Ces parties font matelaffées en-
dedans , 6c doivent être remplies de compreffes ou
d’étoupes pour être proportionnées aux plus petites
têtes. Elles font rapprochées parle moyendes
deux coulans 10. Planche I V , fig. 2, & planche V. Les
deux coulans rapprochés font fixés folidement fur la
tringle f , f , du doflier, vue féparée, pl. I V , fig. 2 ,
par deux v is , une fupérieure 6c l’autre poftérieure.
Les deux parties., qui ne s’approchent paslorfqu’el-
les viennent finir fur le front, font fixées enfemble
par le moyen d’un lacs, vu à la têtiere droite ,p l. l ll .
C e lacs paffe fur deux tourillons, 6c vient s’attacher
à une boucle. Les tourillons font placés à la partie
antérieure 6c extérieure de chaque portion de cercle ;
on en voit un fort diftinttement à la planche I V ,
figure 2. d.
Dans les cas oïi il faut trépaner fur les côtés , on
ne fait ufage que d’une dés branches de têtieres en
la tournant fur le mamelon e, du coulant f , pl. IV,
figure 2 , on le fixe par le moyen des deux vis de la
douille. On attache, un lacs à chacun des deux boutons
qui font rivés aux deux côtés de la douille. Le
lacs venant par-deflus le côté de la tête oppofé à celui
qui appuie fur la branche, & celui où l’on doit
Çpérer , paffe fur le. tourillon b,\planche I I I , &
tevieht fur lui-même pour être fixé à une boucle attachée
au chef poftérieur du lacs. • -
La tête étant folidement arrêtée dans l’une ou
l’autre pofture, le corps eft affujetti fur le doflier par
le moyen des lacs, pafles dans les tourillons/, f ,
planche I I I ,figure 1 , lâchés fur les bras de la chaife.
Ces tourillons f , f , font mieux vus fans lacs ,/»/. I I I ,
fig. 2 , & planche IV, fig. 1.
Le chirurgien pofé derrière la chaife, 6c monté fur
le marche-pied h , pl. I I I , eft en état d’opérer fans
gêne.
Opérations de-la poitrine. Le malade peut être pofé
dans la fituation la plus convenable , foit en laiflant
le doflier dans la dire&ion perpendiculaire , ou eh
l’inclinant plus ou moins, par le moyen des fléaux
o, 0. Ils font conduits par leurs poignées 2 , 2 , fur
les régulateurs d’inclinaifon q, q ,6c font fixés par lés
broches mobiles/»,/», renfermées dans les poignées
2 ,2 . Ces broches font retirées des trous des régulateurs
, & y font enfoncées, par le moyen des têtes
& des boutons des broches/»,/».
Opérations du bas-ventre pour lefquelles le malade
doit être couché. Le doflier de la chaife eft abaiffé horizontalement
, les fléaux o, o, fe trouvant arrêtés par
les crampons de retenue/-, r, planche I I I , fig. 1 & 2 ,
planche IV , fig. 1 , & p l.V , eft foutenu par lesfup-
portsx , x,planche IV , fig. 1 , & pl. V , après avoir
lâché le crampon mobile y , mêmes planches. Par ce
moyen le doflier, étant-de niveau avec le fiege k k ,
forme une banquette de longueur fuffifante pour une
perfonnede moyenne grandeur; maison peut l’étendre
pour une autre d’une taille plus grande. A cet
effet on tire les regîtres u , u , planche I I I , figure 2 &
planche V , 6c le 'fiege à cüuliffe, lignes ponctuées ; on
place enfuite le couflin à la main L, dans le vuide qui
refte entré le- fiege 6c le doflier; on peut enfuite enle
v e r , fi l’on v eu t, les bras de la chaife,-6c elle devient,
par ce développement, dtyné aifance très-
commode pour le malade & pour le chirurgien. Le
malade peut être attaché par les lacs. -
Maladies de la vulve , du vagin , du périnée & du
fondement. Lé doflier étant incliné au degré convenable
, le malade s’aflied fur le fieg-e. On lui pofa
les deux jarrets fur les porrans 7 , 7 , planche I I l. &
IV , ce qui l’oblige à fe renverfer : on lui fixe en même
tems les pieds avec les lacs paffés dans les tourillons
ƒ , ƒ. On peut faire avancer le malade en-devant,
en tirant le fiege k , k , il gliffe aifémènt fur les deux
couliffes, 6c il eft retenu à demeuré par les vis des
écrous, / , t.
Les portans 7 » 7 -, peuvent être tournés en
dehors-plus ou moins pour forcer les cuiffes à
s’écarter. On peut aufli donner l’écàttement néceff
faire aux cuiffes en proportion de la grandeur des
malades, par le moyen de la queue mobile b , &c:
lignes ponctuées, fig. 4 , pl. I V , 6c du portant, fig. 5'.
Toutes ces pièces font fixées à demeure par les chevilles
6c vis qui leur appartiennent.
Les malades, en cetté fituation, ne pouvant fe
mouvoir ni d’un côté ni de l’autre, ne pouvant s’a*
vancerfur le bord du fiege, ni fe porter vers fon
fond, fe trouvent fitués de maniéré à être examinés
fort fcrupuleufement.
Les femmes auxquelles il faut faire dés recherches
dans l’intérieur du vagin , fouffrent, fans réfiftance,
i l’iotroduélion du fpeculum ( Voyc^ S p é c u l u m
uteri dans ce Supplément. ) propre à cet effet. Il
eft conftrtiit de façon queles rayons de lütriiere d’un&
lanterne appropriée peuvent être portés dans le fond
du vagin. Ils y font appercevoir les défordres qui,
l’affe&ent 6c facilitent le moyen d’y porter les re*
medes néceffaires.
Maladies du périnée. La même fituation du mala*
de , la plus naturelle pour examiner les abcès au
périnée, donne la plus grande aifance pour en faire
les ouvertures. n
Lithotomie. Le malade pofe dans la meme fituation
eft encore difpofé de la maniéré la plus folide
& la’ plus invariable.
Fifiule à l'anus. Les malades, ne pouvant faire
aucun mouvement, laiffent aux chirurgiens la liberté
de couper, fans interruption, tout ce qui doit être
emporté. On peut encore les opérer par derrière en
leur faifant appuyer le ventre fur le fiege, les pieds
pofés fur le plancher. Dans cette fituation, les cuiffes
6c les -jambes peuvent être affujetties 6c tenues
écartées par des lacs qui les attachent aux montâns de
devant de la chaife. Le corps peut être affujetti aufli
avec un lacs qui, paffant en travers par-deffus le dos,
eft ferré.par une boucle. <■
Accoitckemehs. Dans les accouchemens fur le dos
ou fur le cô té, rien n’eft à comparer aux avantages
de la chaife ■: on les trouvera fenfiblement fi l’on.veut
y faire attention, 6c fe rappeller les raifons q'ue j’-en
a idonnées ci-deffus.
Opération des extrémités. Dans les opérations des
extrémités fupérieures, comme dans celles de l’ané-
vrifme, 6c les amputations ,&c. le malade peut être
aflxs verticalement, il peut être incliné à volonté ,
ou couché, 6c être maintenu en place par le fecours
des lacs gliffans fur les tourillons fixés latéralement
fur le chauis du doflier.
Pour les amputations des extrémités inférieures,
le malade peut être pofé dans la fituation verticale ‘,
inclinée ou horizontale, le membre à couper étant
en faillie 6c appuyé fur le portant 7 de la tringle fixe
du fiege , pl. III,fig. 1 & 2 ,pl. I V , , fig. 1.
On ne dit rien des avantages qüe l’on peut encore
tirer de la chaife pour la réduction des os luxés ou
fra&urés. Ôn comprend affez qu’elle peut être plus
propre à cet effet qu’aucun lit que ce foit, fur-tout
pour la luxation de la cuiffe ôù les fortes extenfions
6c contre-exfenfions font néceffaires, foit par les
moyens fimples, 6c par les compofés qui peuvent
trouver leur point-d’appui aux tringles du doflier 6c
du fiege. •
Au refte, quoique cette chaife paroiffe extrêmement
compôfée j toutes fes parties , confédérées chacune
en particulier, font réduites à la plus grande
fimplicité. D ’ailleurs on n’a pas prétendu la rendre
d’une utilité fi générale que l’on ne puiffe s’en paffer
dans toutes les opérations auxquelles elle eft defti-
née. On n’en peut recommander abfolument l’ufagè
que dans les hôpitaux, particuliérement dans les
hôpitaux des armées, fur-tout dans ceux que l’on
nomme ambulans, dans les dépôts deftinés à faire
les opérations les plus urgentes, 6c dans les vaiffeaux
de guerre , où les commodités les plus néceffaires
aux opérations manquent toujours. Le tranfport d’un
bleffé de diftinâion, après une opération capitale ,
peut fe faire fur la même chaife avec des ménagement
qui ne fe trouvent pas dans les brancards ordinaires.
Ce font ces vues principales , les plus dignes
de l’humanité, que l’auteur a eues dans la conftruc-
tion de cette chaife. C’eft dans ces cas généraux o ù ,
tous Ceux qui l’ont bien confidéré, en ont cru l’ufagé
indifpenfable. De plus elle peut fêrvir de lit de camp
à tout officier capable d’en faire la dépenfe.
' Quant aux cas particuliers, les plus grands avantages
de cette chàifè fe trouvent dans l’examen des
maladies de la vu lve , du vagin 6c du col de la matrice.
; Les chirurgiens, qui font dans le cas de vifiter fou-
vent les maladies particulières à ces parties , fem-
blent donc ne pouvoir fe difpenfer de lés avantages j
mais dans ce cas, il leur fuffit de l’avoir ftmple 6c
réduite feulement à ce dernier ufage. On n’a bèfoin
alors que dès portans qui font adaptés1 aux bras de la
chaife; fi l’ori veut s’épargner la dépenfe des fléaux:
6c des régulateurs, on peut fe fervir de crémaillères
ordinaires dont tout le monde connoît Pufage dans
les fauteuils appropriés à la commodité des malades
6c des convalefcens. (Mémoiresde Chirurgie, par M. G.
A r n a u d , membre de la fociété des chirurgiens dé
Londres. )
C haise l l a ) , en Beaujolois, ( Géogr. ^ très-beait
château dans la paroiffe d’Odenas en Beaujolois ,
feigneurie érigée *çn comté en 1718. Ce lieu a donné
le nom au P. de la Chaife, confeffeur de Louis XIV.
On ne trouve cet endroit dans aucun diûionnaire
géographique. ( C. )
§ C haise-D ieu ou C heze-D ieü ( l a ) ,(Géogr.)
Cafa De i, petite ville d’Auvergne à fix lieues do
Brioude, qui doit fon origine à un célébré monaftere
de bénédi&ins établi par fàint Robert , Auvergnac ,
en 1046. Le roi Henri l’érigea en abbaye en 1052.
Il y eut fous le pape Léon IX. jufqii’à '300 moines.
Les huit premiers abbés font comptés parmi lés
faints par tous les hiftoriens de l’Auvergne.
Pierre, fils de Roger, depuis pape Clément V I , y
àvoit été moine, & y choifit ton tombeau : il fut profané
par les Proteftans, qui burent dans fon crâné.
M. Soanen, célébré prédicateur Oratorien fous Louis
X IV , depuis évêque de Senez, y fut inhumé en
174 t. Le cardinal de Richelieu, en étant abbé, l’unit
à la congrégation de faint Maur en 1640.
Le premier dégré de l’églife, qui eft très-vafte ;
eft trente pieds plus haut que le fommet du Puv-dé-
Rome; ( C. )
GHALÉMIE, (Luth. ) ancien mot François qu’on
trouve quelquefois pour le chalumeau, ou même
pçur la mufette. Il n’e f f plus en ufage. ( F. D . C. )
§ CHALEUR A nimale. ( Phyfiologie. ) Quoiqu’il
y ait un long article fur cette matière dans Iè
Dicl. raif. des Sciences, 6cc. il y a cependant déS'addi-
tions effentielîes à y faire.
La chaleur de l’homme eft à-peu-près de 97 degrés
de Fahrenheit, à en juger par l’urine & parle lait. Elle
ne devient pas fort différente ni par l’â g e , ni pair
d’autres cireonftances. Elle n’augmente dans l’animal
vivant que de feize dégrés de Fahrenheit au plus.
Dans les fievres, elle m paffe guère 108 & ncn
On a un exemple oiVeffe étoit de 113. Le fang eft
fi peu capable de prendre un dégré de chaleur plus
conlidcrable * que dans une atmofphere beaucoup
plus chaude j il refte au-déffous du dégré de là cka^
leur de cette atmofphere, & que le thermOmetrè
defcend dans la chaleur de 128 dégrés, obferVéè ait
foleil en Caroline. Dans les bains de la Finlande,
l’air eft à 167 de Fahrenheit, & le fang à 104.
Une fi forte chaleur incommode vivement, le vi-
fage pâlit, un fentiment défagréable fe fait fentit*
dans les doigts, 6c on prend mal avant de périr, ce
qui arriveroit, fi l’on s’ôpiniâtroit à- rèfter dans une
eau thermale trop chaude. On foutiènt beaucoup
mieux la chaleur feche, que la chaleur humide.'
Il n’eft pas douteux au refte, que l’hominé né
puiffe vivre dans un air confidéràblement plus chaud
que ne l’eft fon fang. On vit dans une atmofphere
de 60 dégrés de Rçaumur, ce qui fait iC j dégrés de
Fahrenheit. On peut fubfifter, &mêmealler au-delà,
dans une étuve , & M. Duhamel à vu une fërvàntè
foutenir, pendant un quart-d’heure , Pého'rnie chaleur
de 130 dégrés deReàumur, fupérieUrê à trèllé
de l’eau bouillante. On refpire, cet air fans diriger,
mais il affefteroit trop la peau, fi elle n’ét'oit pas défendue
par1 dés habits..
1 Cetté chaleur animale a donc cela de particulier ,
■ qu’elle’ rie monte jamais au-delà d’un dé'gré fixe &
médiocre, niais qu’elle fe produit très-aifétrient dâris
une atmofphere très-froidé. Nous voulons faire entendre
, par çette remarque , que depuis le froid le