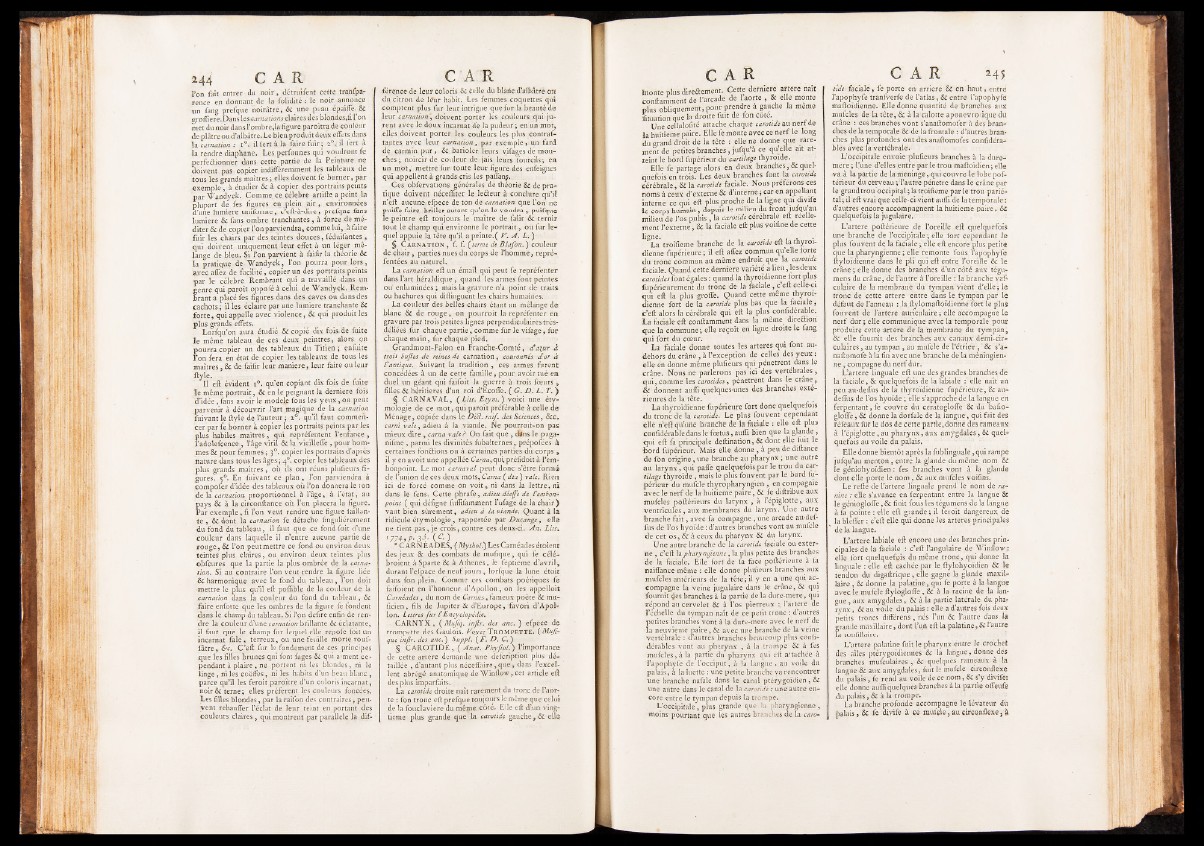
Ton fait entrer du n oir, détruifent cette trahfpa-
rence en donnant de la folidité le noir, annonce
lin fang prefque noirâtre, & une peau épaifle. &
grofliere.Dans les carnaiionschues des blondes,fi l’on ;
met du noir dans l’ombre,la figure paroîtrade couleur
de plâtre ou d’albâtre. Le bleu produit deux effets dans
la carnation : i° . il fert à la faire fuir ; 2°.]il fert à
la rendre diaphane. Les perfoones qui voudront fe
perfectionner dans cette ^partie de la Peinture ne
doivent pas copier indifféremment les tableaux de
tous les grands maîtres ; elles doivent fe borner ., par
exemple, à étudier & à copier des portraits peints
par "Wandyck. Comme, ce célébré artifte a peint^ la
plupart de fes figures en plein a i r , environnées
d’une lumière uniforme , c’eft-à-dire, prefque fans
lumière & fans ombre tranchantes , à force de méditer
& de copier l’on parviendra, comme lui, à'faire
fuir les chairs par dçs teintes douces, féduifantes ,
qui doivent uniquement leur effet à un léger • mêlante
de bleu. Si l’on parvient à faifir la théorie &
la pratique de "Wandyck, l’on pourra pour lors ,
avec affez de facilité, copier un des portraits peints
par le célébré Rembrant qui a travaillé dans un
genre qui paroît oppofé à celui de Wandyck. Rem-
brant a placé fes figures dans des caves ou dans des
cachots ; il les éclaire par une lumière tranchante &
forte, qui appelle avec violence, & qui produit les
plus.grands effets. : - .■ . 'q -
Lorfqu’on aura étudié & copié dix fois, de fuite
le même tableau de ces deux peintres, alors on
pourra copier un des tableaux du Titien ; enfuite
l ’on fera en état de copier les tableaux de tous les
maîtres, & de faifir leur maniéré, leur faire ou leur
ftyle. ■ .
Il eft évident i° . qu’en copiant dix fois de fuite
le même portrait, & en le peignant la derniere fois
d’idée, fans avoir le modelée fous les y eux , on peut
parvenir à découvrir l’art magique de la carnation
fuivant le ftyle de l’auteur ; i ° . qu’il faut commencer
par fe borner à copier les portraits peints par les
plus habiles maîtres, qui repréfentent l’enfançe ,
l’adolefcence , l’âge viril &c la vieilleffe , pour hommes
& pour femmes ; 30. copier les portraits d’après
nature dans tous les âges ; 40. copier les tableaux des
plus grands maîtres, où ils ont réuni plufieurs figures.
50. En fuivant ce plan, l’on parviendra à
composer d’idée des tableaux où l’on donnera le ton
de la carnation proportionnel à l’âge, à l’état, au
pays & à la circonftançe où l’on placera la figure.
Par exemple,fi l’on veut rendre une figure taillante
, & dont la carnation fe détache finguliérement
du fond du tableau, il faut que ce fond foit, d’une
couleur dans laquelle il n’entre aucune partie de
rouge, & l’on peut mettre ce fond ou environ deux
teintes plus claires, ou environ deux teintes plus
obfcures que la partie la plus ombrée de la carnation.
Si au contraire l’on veut rendre la figure liée
& harmonique avec le fond du tableau, l’on doit
mettre le plus qu’il eft poflible de la couleur de la
carnation dans la couleur du fond du tableau, &
faire enforte que les ombres de la figure fe fondent
dans, le champ du tableau. Si l’on defire enfin de rendre
la couleur d’une carnation brillante & éclatante,
il faut que le champ fur lequel elle repofe. foit un
incarnat fale, terreux, ou une feuille morte rouf-
fâtre, &c. C ’eft fur le fondement de ces principes
que les filles brunes qui font fages & qui aiment cependant
à plaire, ne portent ni les blondes, ni le
linge, ni les coëffes, ni les habits d’un beau blanc ,
parce qu’il les feroit paroître d’un coloris incarnat,
noir & terne; elles préfèrent les couleurs foncées.
Les filles blondes , par la raifon des contraires , peuvent
rehauffer l’éclat de leur teint-emportant des
couleurs claires, qui montrent par parallèle la différçiîce
de leur coloris & telle du blàric d’albâtrë otï
du citron de lé’ur habit. Les femmes.coquettes qui
comptent plus fur leur intrigue que fu r la beauté de
.leur carnation, doivent porter les couleurs qui jurent
avec le doux incarnat de la pudeur ; en un mot,
.elles doivent porter les. couleurs les plus contractantes
avec leur carnation exemple,: unTard
de carmin pur, barioler leurs v,ifages de mouches
; noircir de couleur de jais leurs .foufcils; en
un mot,’ mettre fur-toute leur figure des enseignes
qui appellent, à grands cris les paflanj..
Ces obfervations générales de théorie & de pratique
doivent nécefliter le.leéteur à conclure qu’il
n’eft aucune;.efpece de ton de carjiation que l’on ne
puiffe faire briller autant qu’on le voudra , puifque
le peintre’ eft toujours le maître de falir & ternir
tout le champ qui environne le portrait;, où fur lequel
appuie la tête qu’il a peinte.( V. A . L. )
§ C a r n a t io n , f. f. (terme de Blafon.') couleur
de chair, parties nues du corps de l’homme, repré-
fentées au naturel.
La carnation eft un émail qui peut fe repréfenter
dans l’art héraldique , quand les armes font peintes
où enluminées ; mais la.gravure n’a point de traits
ou hachures qui diftinguent les chairs humaines.
La couleur des belles chairs étant un mélange de
blanc & de rouge, on pourroit la repréfenter en
gravure par trois petites lignes perpendiculaires très-
déliées fur chaque partie, comme fur le vifage, fur
chaque main, fur chaque pied.
Grandmont-Falon. en Franche-Comté * t£a{ur i
trois bufies de reines de carnation, couronnés d’or à
l'antique... Suivant la tradition , ces armes’ furent
concédées à un de cette famille, pour avoir tué en
duel un géant qui faifoit la guerre à trois foeurs ,
filles & héritières d’un roi d’Ecoffe. ( G. D. L. T. )
§ CARNAVAL, .( Litt. Etym. ) voici une étymologie
de ce mot, qui paroît préférable à~.celle de
Ménage, copiée dans le Dïct. raif. des Sciences, & c .
carni vale, adieu à la viande. Ne pourroit-on pas
mieux dire , carna vale? On fait que , dâns le paga-
nifme , parmi les divinités fubalternes, prépofées à
certaines fondions ou à certaines parties du corps ,
il y en avoit une appellée Garna, qui préfidoit à l’embonpoint.
Le mot carnaval peut donc s’être form®
de l’union de ces deux mots, Carna ( dea ) vale. Rien
ici de forcé comme on voit , ni dans la lettre, ni
dans le fens. Cette phrafe, adieu dèeffe de £embon*
point ( qui défigne fuftifamment i’ufage de la chair)
vaut bien sûrement, adieu à la viande. Quant à la
ridicule étymologie, rapportée par Ducange, ellé
ne tient pas, je crois, contre ces deux-ci. An. Litt,
' 774. P- 3& (.c - ) , " ' , ■ , . ■
* C A R NÈ A DES, ( Mythol.) Les Carneades et oient
des jeux & des combats de mufique, qui fe céléi-
broient à Sparte & à Athènes, le feptieme d’avril,
durant l’efpace de neuf jours, lorfque la lune étoit
dans fon plein. Comme ces combats poétiques fe
faifoient en l’honneur d’Apollon, on les appelloit
Carneades, du nom de Camus, fameux poète & mu-
ficien, fils de Jupiter & d’Europe, favori d’Apollon.
Lettres fur £ Encyclopédie.
C A R N Y X , (Mujiq. injlr. des anc. ) efpece de
trompette des Gaulois. Voye{T rompette. (Mufi»
que injlr.Aes anc.) SuppL (F . D. C.)
§ CAROTIDE, (Anat. Phyfiol.) l’importance
de cette artere demande une defeription plus détaillée
, d’autant plus néceffaire, que , dans l’excellent
abrégé anatomique de Winftow, cet article eft
des plus imparfaits.
La carotide droite naît rarement du tronc de l’aorte
: fon tronc eft prefque toujours le même que celui
de la fouclaviere du même, côte. Elle eft d’un vingtième
plus grande que la carotide gauche elfe
hionte plus direôement. Cette defmerê R H naît
conftamment de l'arcade de laorte , & elle monte
plus obliquement, pour prendre à gauche la meme
ïituaâon que la- droite fuit de fon cote. ■
Une cellplofité attache chaque carotide au nert de
la huitième paire. Elle fe monte avec ce nerf le long
du grand droit de la tête : elle ne donne que rarement
de petites branches, jufqu’à ce qu’elle ait atteint
le bord fupérieur du cartilage thyroïde.
Elle fe partage alors en deux branches, & quelquefois
en trois. Les deux branches font-la carotide
cérébrale, & la carotide faciale. Nous préférons ces
noms à ceux d’externe & d’interne ; car en appellant
interne ce qui eft plus proche de la ligne qui divife
le corps humain, depuis le milieu du front jufqu’au
milieu de l’os pubis , la carotide cerebrale eft réellement
l’externe, & la faciale eft plus voifine de cette
°La troifieme branche de la carotide eft la thyroïdienne
fupérieure ; il eft affez commun qu’elle forte
du tronc commun au même endroit que la carotide
faciale. Quand cette derniere variété a lieu, les deux
carotides font égales : quand la thyroïdienne fort plus
fupérieurement du tronc de la faciale, c eft Celle-ci
qui eft la plus groffe. Quand cette même thyroïdienne
fort de la carotide plus bas que la faciale,
c’eft alors la cérébrale qui eft la plus^confiderable.
La faciale eft conftamment dans la meme^ direction
que la commune; elle reçoit en ligne droite le fang
qui fort du coeur.
La faciale donne toutes les arteres qui font au-
dehors du crâne, à l’exception de celles des yeux :
elle en donne même plufieurs qui pénètrent dans le
crâne. Nous ne parlerons pas ici des vertébrales,
qui, comme les carotides, pénètrent dans le crâne ,
& donnent aufli quelques-unes des „branches extérieures
de la-'tête.
La thyroïdienne fupérieure fort donc quelquefois
du tronc de la carotide. Le plus fou vent cependant
elle n’eft qu’une branche de la faciale : elle eft plus
confidérable dans le foetus, aufli bien que la glande,
qui eft fa principale deftination, & dont elle fuit le
bord fupérieur. Mais elle donne , à peu de diftance
de fon origine, une branche au pharynx ; une autre
au larynx, qui paffe quelquefois par le trou du car-
tilage thyroïde , mais le plus fouvent par le bord fupérieur
du mufcle thyropharyngien , en compagnie
avec le nerf dè la huitième paire, & le diftribue aux
mufcles poftérieurs du larynx , à l’épiglotte, aux
ventricules, aux membranes du larynx. Une autre
branche fa it, avec fa compagne , une arcade au-def-
fus de l’os hyoïde : d’autres branches vont au mufcle
de cet os, & à ceux du pharynx & du larynx.
Une. autre branche de la carotide faciale ou externe
, c’eft la pharyngienne, la plus petite des branches
de la faciale. Elle fort de fa face poftérieure à la
naiffance même : elle donne plufieurs branches aux
mufcles antérieurs de la tête; il y en a une qui accompagne
la veine jugulaire dans le crâne, & qui
fournit des branches à la partie de la dure-mere, qui
répond au cervelet & à l’os pierreux l’artere de
l’echelle du tympan naît de ce petit tronc : d’autres
petites branches vont à la dure-mere avec le nerf de
la neuvième paire, & avec une branche de la veine
vertébrale : d’autres branches beaucoup plus confi-
dérâbles vont au pharynx , à.la trompe & à fes
mufcles, à la partie du pharynx qui eft attachée -à
l’apophyfe de l’occiput,;.à la langue, au voile du
palais, à la luette : une petite branche va rencontrer
une branche nafale dans le canal ptérygoïdien, &
une autre dans le canal de la carotide : une autre encore
entre le tympan depuis la trompe.
L’occipitale, plus, grande que la pharyngienne ,
moins-pourtant que les autres branches de là carotide
faciale, fe porte en arriéré & eh haut, entre
l’apophyfe tranfverfe de l’atlas, & entre ràpophyfe
maftoïdienne. Elle donne quantité de branches aux
mufcles de la tête, & à la calotte aponevrorique du
crâne : ces branches vont s’anaftomofer à des branches
de la temporale & de la frontale : d’autres branches
plus profondes ont des anaftomofes confidéfa-
blés avec la vertébrale;
L’occipitale envoie plufieurs branches à la dure-
mere ; l’une d’elles entre parle trou maftoïdien ; elle
•va à la partie de la méningé,qui couvre le'lobe pof-
térieur du cerveau'Vl’autre pénétré dans le crâne par
le grand trou occipital ; la troifieme par le trou pariétal;
il eft vrai que celle-ci vient aufli de la temporale:
d’autres encore accompagnent la huitième paire, Ô5
quelquefois la jugulaire. î
L’artere poftérieure .de l’.oreille.eft quelquefois
une branche de l’occipitale ; elle fort cependant le
plus fouvent de la fadiale ;' elle eft encore plus petite
que la pharyngienne ; elle remonte fous l’apophyfe
ftyloïdienne dans le pli qui eft entre l’oreille & le
crâne ; elle donne des branches d’un côté aux tégu-
mens du crâne, de l’autre àToreille : la branche v asculaire
de la membrane du tympan vient d’elle ; le
tronc de cette artere entre dans le tympan par le
défaut de l’anneau : la ftylomaftoïdienne fort le plus
fouvent de lartere auriculaire ; elle à'ccompagne le
nerf dur ; elle communique avec la temporale. pour
produire cette artere de la membrarie du tympant
& elle fournit des branches aux canaux demi-circulaires,
au tympan , au mufcle deTétrier , ' & s’a-
naftomofè à la fin avec une branche de la méningien-
ne ; compagne du nerf dur.
L’artere linguale eft une des grandes branches de
la faciale, & quelquefois de la labiale : elle naît un
peu au-deffus de la thyroïdienne fupérieùre, & au-
deflits de l’os hyoïde ; elle s’approche de la langue en
ferpentant, fe couvre du ceratogloffe & du bafio-
gloffe, & donne la dorfale de la langue’-, qui fait des
réfeaux fur le dos de cette partie, donne des rameaux
à l’épiglotte, au pharynx, aux amygdales, & quelquefois
au voile du palais.
Elle donne bientôt après la fublinguale, qui rampe
jufqu’au menton, entre la glande du même nom St
le géniohyoïdien : fes branches vont à la glande
dont elle porte le nom , & aux mufcl.es voifins.
Le refte de l’artere linguale prend le nom de ra*
rime: elle s’avance en ferpentant entre la langue &
le géniogloffe, & finit fous les tégumens de la langue
à fa pointe : elle eft grande; il leroit dangereux; de
lableffer : c’eft elle qui donne les arteres principales
de la langue.
L’artere labiale eft encore une des branches principales
de la faciale : c’eft l’angulaire de ‘Winflow:
elle fort quelqueffiis du même tronc , qui donne la
linguale : elle eft cachée par le ftylohyoïdien & le
tendon du digaftrique, elle gagne la glande maxillaire
, & donne la palatine , qui fe porte à la langue
avec le mufcle ftylogloffe , & à la- racine de la langue
, aux amygdales, & à la partie, latérale du pharynx
, & au voile du palais : elle- a d’autres fois deux
petits troncs différens, nés l’un & l’autre dans la
grande maxillaire, dont l’un eft la palatine, & l’autre
la tonfillaire.
L’artere palatine fuit le pharynx entre le crochet
des aîles ptérygoïdiennes Sc la langue, donne dés
branches mufculaires , & quelques rameaux à la
langue & aux amygdales, fuit le mufcle circonflexe
du palais, fe rend au voile de ce nom, & s’y divifêt
elle donne aufli quelques branches à la partie offeufe
du palais, & à la trompe.
La branche profonde accompagne le lévateur dû
palais, & fe divife à ce mufcle, au circonflexe, à