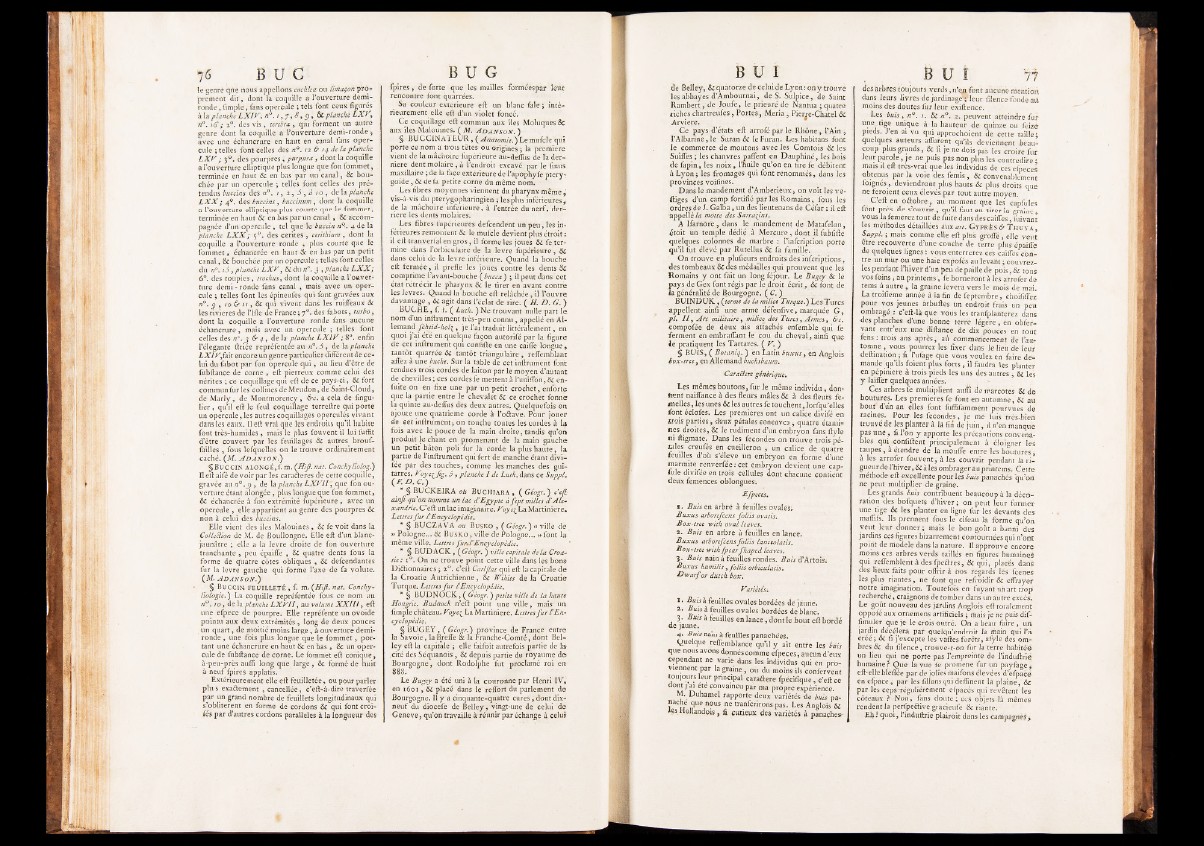
le genre que nous appelions cochlea àu limaçon proprement
dit, dont la coquille a l’ouverture demi-
ronde , limple, fans opercule ; tels font ceux figurés
à la plancha LXIV\ U°. 1 , 7 , 8 , 3 , 8c planche L X f ,
n°. !<y ; i° . des v is , tertbta , qüi forment un autre
genre dont la coquille a l’ouverture demi-ronde -,
avec une échancrure en haut en canal fans opercule
; telles font celles des n°. 12 & 14 de la planche
L X y ; 30. des pourpres, purpura , dont la coquille
a l’ouverture elliptique plus longue que fon fommet,
terminée en haut 8c en bas par un canal, & bouchée
par un opercule ; telles font celles des prétendus
buccins des n°. 1 , 2 , S , à 10 , de la planche
L X X ; 40. des buccins, buccinum, dont la coquille
a l’ouverture elliptique plus courte que le fommet,
terminée en haut 8c en bas par un canal, 8c accompagnée
d’un opercule , tel que le buccin n%. 4 de la
planche L X X ; 50. des cerites , cttithium , dont la
coquille a l’ouverture ronde , plus courte que le
fommet, éohanerée en haut & en bas par un petit
canal, 8c bouchée par un opercule ; telles font celles
du 72°. 1.5 , planche L X l ' , 8c du n°. J , planche L X X i
6°. des toupies, trochus, dont là coquille a l'ouverture
demi - ronde fans canal , mais avec un opercule
; telles font les épineufes qui font gravées aux
72°. , 10 6* 1 1 , 8c qui vivent dans les ruiffeaux &
les rivières de l’Ifle de France *7°. des fabots, turbo,
dont la coquille a l’ouverture ronde fans aucune
échancrure, mais avec un opercule ; telles font
celles des n°. j & 4 , de la planche LX 1V ; 8°. enfin
l’élegante (triée repréfentée au n°. S , de la planché
L X l A',fait encore un genre particulier différent de celui
du fabot par fon opercule q u i, au lieu d’être de
fubftance de corne , eft pierreux comme celui des
nérites ; ce coquillage qui eft de ce pays-ci, 8c fort
commun fur les collines de Meudon, de Saint-Cloud,
de Marly, de Montmorency, &c. a cela de fingu-
lie r , qu’il eft le feul coquillage terreftre qui porte
un opercule, les autres coquillages operculés vivant
dans les eaux. Il eft vrai que les endroits qu’il habite
font très-humides, mais le plus fouvent il lui fuffit
d’être couvert par les feuillages 8c autres brouf-
failles , fous lefquelles on le trouve ordinairement
caché. (Af. A d a n s o n .)
§ BUCCIN ALONGÉ,f.m. (Hiß.nat. Conchyliolog.)
II eft aifé de voir par les caraéteres de cette coquille,
gravée au n°.<), de la planche LXVII'i, que fon ouverture
étant alongée, plus longue que fon fommet,
8c échancrée à fon extrémité fupérieure, avec un
opercule , elle appartient au genre des pourpres &
non à celui des buccins.
Elle vient des îles Malouines, & fe voit dans la
Collection de M. de Boullongne. Elle eft d’un blanc-
jaunâtre ; elle a la levre droite de fon ouverture
tranchante , peu épaiffe , 8c quatre dents fous la
forme de quatre côtes obliques , 8c defcendantes
fur la levre gauche qui forme l’axe de fa volute.
(M. Ad an s on.y
§ Buccin FEUILLETÉ, f. m. (Hiß. nat. Conchyliologie.
) La coquille repréfentée fous ce nom au
72?. 10, de la planche L X V I I , au volume X X I I l , eft
une efpece de pourpre. Elle repréfente un ovoïde
pointu aux deux extrémités, long de deux pouces
un quart, de moitié moins large, à ouverture demi-
ronde , une fois plus longue que le fommet, portant
une échancrure en haut 8c en bas , & un opercule
de fubftance de corne. Le fommet eft conique,
à-peu-près aufli long que large, 8c formé de huit
à neuf fpires applatis.
Extérieurement elle eft feuilletée, ou pour parler
plus exa&ement , cancellée, c’eft-à-dire traverfée
par un grand nombre de feuillets longitudinaux qui
s’oblitèrent en forme de cordons & qui font croi-
fés par d’autres cordons paralleles à la longueur des
ïpires, de forte que les mailles forniéespar leur
rencontre font quarrées.
Sa couleur extérieure eft un blanc fale ; intérieurement
elle eft d’un violet foncé.
Ce coquillage eft commun aux îles Moluques 8c
aux îles Malouines. ( M. Ad a n so n . )
§ BU C C iN A l EUR, ( Anatomie.') Lemufclequi
porte ce nom a trois têtes ou origines ; la première
vient de la mâchoire fupérieure au-defliis de la dernière
dent molaire, à l’endroit excavé par le fînus
maxillaire ; de la face extérieure de l’apophyfe ptery-
goïde, & d e fa petite corne du même nom.
Les fibres moyennes viennent du pharynx même
vis-à-vis du pterygopharingien ; les plus inférieures ,
de la mâchoire inférieure, à l’entrée du nerf, derrière
les dents molaires. '
Les fibres fupérieures defcendent un peu, les inferieures
remontent & le mufcle devient plus étroit:
il eft tranverfal en g ros, il forme les joues 8c fe termine
dans l’orbiculaire de la levre fupérieure, 8c
dans celui de la levre inférieure. Quand la bouche
eft fermée, il prefle les joues contre les dents 8c
comprime l’avant-bôuche (bucca) ; il peut dans cet
état rétrécir le pharynx & le tirer en avant contre
les levres. Quand la bouche eft relâchée, il l’ouvré
davantage , 8c agit dans l’éclat de rire. ( H. D . G. )
BUCHE, f. t. ( Luth. ) Ne trouvant nulle part le
nom d’un inftrument très-peu connu, appellé en Allemand
fcheid-hol£, je l’ai traduit littéralement, en
quoi j’ai été en quelque façon autorifé par la figure
de cet inftrument qui confifte en une caiffe longue ,
tantôt quarrée 8c tantôt triangulaire, reffemblant
allez à une bûche. Sur la table de cet inftrument font
tendues trois cordes de laiton par le moyen d’autant
de chevilles ; ces cordes fe mettent à l’uniffon, 8c en-
fuite on en fixe une par un petit crochet, enforte
que la partie entre le chevalet 8c ce crochet fonne
la quinte au-delfus des deux autres. Quelquefois on
ajoute une quatrième corde à l’o&ave. Pour jouef
de cet inftrument, on touche toutes les cordes à la
fois avec le pouce de la main droite, tandis qu’on
produit le chant en promenant de la main gauche
un petit bâton poli fur la corde la plus haute, la
partie de l’inftrument qui fert de manche étant divin
e par des touches, comme les manches des gui--
tarres. Voyerfig. S , planche I de Luth, dans ce Suppl.
( F D . C.)
* § BUCKEIRA oie Buchiara , ( Gèogr. ) c'eJL
ainfi qu'on nomme un lac d'Egypte à fept milles £ Alexandrie.
C’eft un lac imaginaire. Voye£ La Martiniere.
Lettres fur C Encyclopédie.
* § BUCZAVA ou Busko , (Gèogr. ) « ville d e v
» Pologne... 8c Busko, ville de Pologne... »font la
même ville. Lettres fur»!Encyclopédie.
* § BUDACK., (Gèogr. ) ville capitale delà Croatie:
i° . On ne trouve point cette v ille dans les bons
Dictionnaires ; z°. c’eft Carlflat qui eft la capitale de
la Croatie Autrichienne, & Wihits de la Croatie
Turque. Lettres fur C Encyclopédie.
* § BUDN OCK , ( Gèogr. ) petite ville de la haute
Hongrie. Budnock n’eft point une ville , mais un
limple château. Voye^ La Martiniere. Lettres fur C Encyclopédie.
§ BU G EY, (Gèogr.) province de France entre
la Savoie, la B^refle & la Franche-Comté, dont Bel-
ley eft la capitale ; elle faifoit autrefois partie de la>
.cité des Séquanois, & depuis partie du royaume de
Bourgogne, dont Rodolphe fut proclamé roi en
$8.8.
Le Bugey a été uni à la couronne par Henri IV,
en 1601 , & placé dans le reffort du parlement de
Bourgogne. 11 y a cinquante-quatre cures, dont dix-
neuf du diocefe de Belley, vingt-une de celui de
Geneve, qu’on travaille à réunir par échange à celui
WSmSmm
de Belley, 8c quatorze de celui de Lyon: on y trouve
les abbayes d’Ambournai, de S. Sulpice, de Saint
Rambert, de Joufe, le prieuré de Nantua ; quatre
riches chartreufes, Portes, Meria, Pierrè-Chatel 8c
Arviere.
Ce pays d’états eft arrofé par le Rhône , l’Ain j
l’Albarine, le Suran & le Furan. Les habitans font
le commerce de moutons avec les Comtois 8c les
S u ifle s le s chanvres paffent en Dauphiné, les bois
de fapin, les noix, l’nuile qu’on en tire fe débitent
à Lyon; les fromages qui font renommés, dans les
provinces voifines.
Dans le mandement d’Amberièux, on voit les ve-
ftiges d’un camp fortifié par les Romains * fous les
ordres de S. Galba, un des lieutenans de Céfar ; il eft
"appellé la mótte des Sarrasins.
A Ifarnôre, dans le mandement de Matafelon,
étôit un temple dédié à Mercure, dont il fubfiftë
quelques colonnes de marbre l’infcription porte
qu’il fut élevé par Rutellus 8c fa famille., .
On trouve en plufieurs endroits desinfcriptions,
des tombeaux 8c des médailles qui prouvent que les
Romains y ont fait un longféjour. Le Bugey & le
pays de Gex font régis par le droit écrit, 8c font de
la généralité de Bourgogne. ( C. )
BU IN DUK, (terme de la milice Turque.) Les Turcs
appellent'àinli une arme défenfive, marquée G ,
pl. I I y A tt militaire y milice des Turcs, Armes, &c.
compofée de deux ais attachés enfemble qui fe
ferment eh embraflant le cou du cheval, ainfi que
le pratiquent lés Tartares. ( V. )
§ BUIS, ( Botaniq. ) en Latin buxus, en Anglois
box-tree y en Allemand buchsbaum-
Caractère générique.
Les mèmès boutons, fur le même individu, doi>
fient naiflance à des fleurs mâles 8c k des fleurs femelles
, les unes 8c les autres fe touchent, lorfqu’elles
font éclofes. Les premières ont un calice divifé en
trois parties, deux pétales concaves, quatre étamines
droites, 8c le rudiment d’un embryon fans ftyle
ni ftigmate. Dans les fécondés on trouve trois pétales
creufés en cueilleron ; un calice de quatre
feuilles d’oii s’élève un embryon en forme d’une j
marmite renvèrfée : cet embryon devient une cap-
fule divifée en trois cellules dont chacune contient
deux femënces oblongues;
Êfpeces.
m . Buis en ârbré à feuilles b valés;
Buxus arborefcens foliis ovatis.
B o x -tree with ôVal leaves.
a. Buis en arbre à feuilles en lance;
Buxus arborefcens foliis lanceolatis.
Box-tree with fpear fhaped leaves.
3. Buis nain à feuilles rondes. Buis d’Artôià;
Buxus humilis y foliis Otbiculatis.
Ewarf or dutch box.
Variétés. s
** feuilles ovales bordées dé jâurie.
a. Buis à feuilles ovales bordées de blanc.
3 . Buis à feuilles en lance, dont le bout eft bordé
de jaune.
4. B;2«nain à feuilles panachées.
Quelque reflemblance qu’il y ait entre les buis
que npus avons donnés comme efpeces, aucun d’eux
cependant ne varie dans les individus qui en proviennent
par la graine, ou du moins ils confervent
toujours leur principal caraftere fpéeifique, c’eft ce
dont j ai été convaincu par ma propre expérience.
M. Duhamel rapporte deux variétés -de büis panache
que nous ne tranfcrirons pas. Les Anglois &
ies Hollandais, fi curieux des variétés à panachesdes
hrbres toujours verds, n’q» font a'üctme mention
dans leurs livres de jardinageVleur filence fondé ait
moins des doutes fur leur exiftence.
Les buis y n°. 1. 8cn°. 2. peuvent atteindre fuir
une, tige unique à la hauteur de quinze ou feizè
pieds. J en ai vu qui approchoient de cette taille £
quelques auteurs affurent qu’ils deviennent beaucoup
plus grands, & Üi je ne dois pas les croire fur
leur parole, je ne puis pas non plus les contredire ;
mais il eft très-vrai que les individus de ces efpeceè
obtenus pâr la voie des femis , 8c convenablement
foignés,, deviendront plus hauts 8c plus droits que
ne feroient ceux élevés par tout autre moyen.
C’eft en oétobre , au moment que les capfuleS
font près dé s’ouvrir, qu’il faut en tirer la graine ;
vous la femerez tout de luitè dans des caifles, fuivant
des méthodes détaillées àüx art. Gyprês & T h u y a ,
Suppl. ; mais comme elle eft plus grofle, elle veut
être recouverte d’une couche de terre plus épaifle
de quelques lignes : vous enterrerez CeS caifles contre
un mur ou une haie expofés au levàrit ; couvrez-
les pendant l’hiver d’un peu de paille de pois , 8c tous
vos foins, àü printems, fe borneront à les atrofer de
tems à autre , là graine lèvera vers le mois de mai.
La troifieme année à la fin de feptembre, choififlez
pour vos jeunes ârbuftes im endroit frais un peu
ombragé : c’eft-là que vous les tranfplanterez dans
des planches d’une Bonne terré légère, en obfer-
vant entr’eux une diftance de dix pouces en fout
fehs : trois ans après, ait commencement de l’au^
tomne , vous pourrez les fixer dans, le lieu de leur
deftination ; fi l’ufage qiie vous voulez en faire demande
qu’ils foient plus forts , il faudra les planter
en pépinière à trois pieds les uns des autres , 8c les
y laifler quelques années.
Ces arbres île multiplient aufli de marcotes & de
boutures. Les premières fe font en automne, 8c au
bout d’un an elles font fuflifamment pourvues dé
racines. Pour les fecond.es, je mé fuis très-bien
trouve de les planter à la fin de juin, il n’en manque
pas unê , fi l’On y apporte les précautions convenables
qui ^confident principalement à éloigner les
taupes, à étendre de la moufle entre les boutures i
à les arrofer fouvent^à les couvrir pendant la rigueur
de l’hiver, & à les ombrager au printems. Cette
méthode eft excellente pour les buis panachés qu’on
ne peut multiplier de graihe.
Les grands buis contribuent beaucoup à la décoration
des bofquets d’hiver ; on peut leur former
une tige 8c les planter en ligne fur les devants des
maflifs. Ils prennent fous le cifeaù là forme qu’bh
veut leuf donner ; mais le bon goût a banni des
jardins ces figures bizarrement contournées qui n’ont
point de niodele dans la nature. Il approuve encore
moins ces arbres verds taillés en figures humaines
qui reflemblent à des fpeftfes, 8c qui, placés dans
des lieux faits pour offrir à nos regards les feenes
les plus riantes , ne font que refroidir 8c effrayer
notre imagination. Toutefois en fuyant un art trop
recherché, craignons de tomber dans un àutre excès.
Le goût nouveau des jàrdins Anglois eft totalemenj:
oppofé aux ornemens artificiels ; biais je ne puis dif-
fimuler que je le crois outré. On a beau faire , un
jardin décéléra par quelqu’endroit la rhain qui l’â
créé ; & fi j’excepte les vâftes forêts, afyle des ombres
8c du filence, troüve-t-on fur la terre habité©
un heu qui ne porte pas l’empreinte de l’induftrië
humaine? Que la vUe fe promené fur un payfage^
eft-elle bleflëe par de jolies maifons élevées d’ëfpacd
en efpace,' par les filions qui deflinent la plaine, 8c
par les ceps -régulièrement efpacés qui revêtent les
coteaux ? Non, fans doute; ces objets-là mêmes
fendent la perfpeâive gràcieufe 8c riante.
Efi • quoi, l’induftrie plàirôit dans les campagnes,
ml