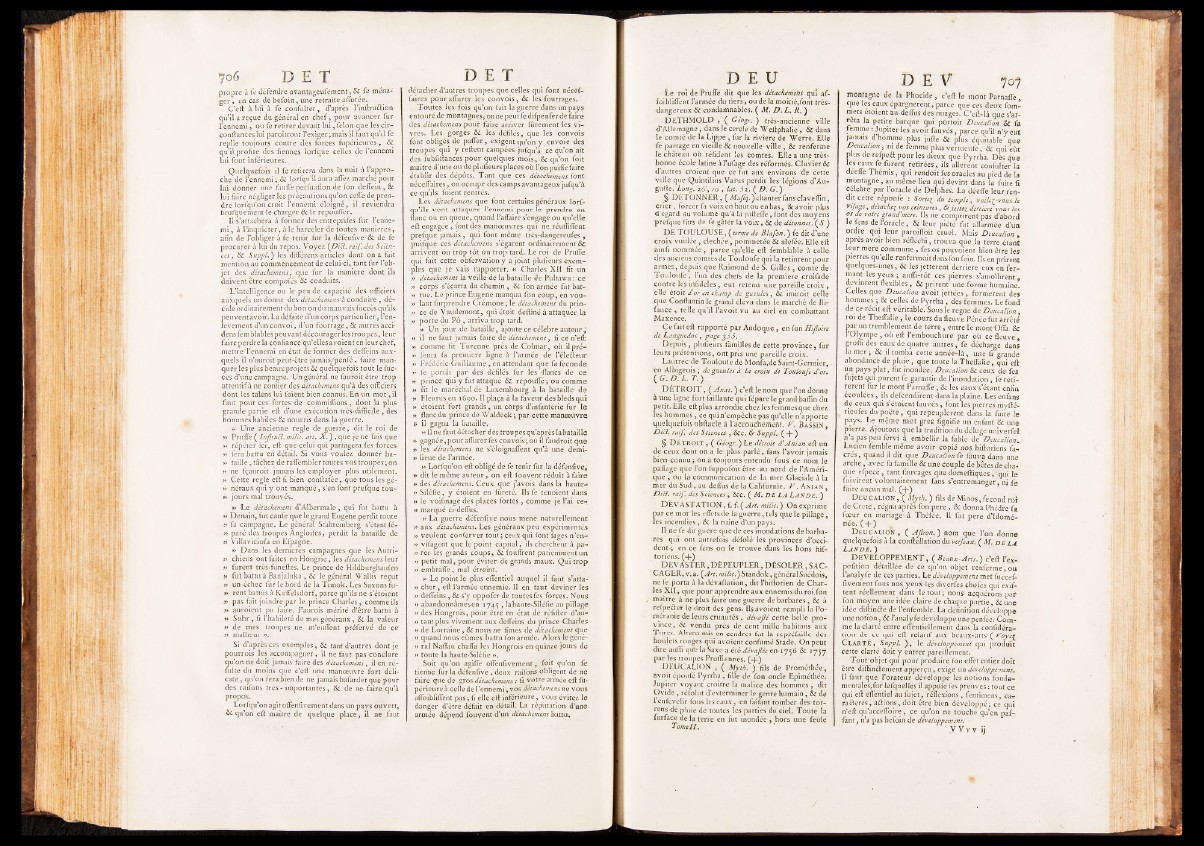
propre à fe défendre avantageufement, & fê mena'1
g e r , en cas de befoin, une retraite afluree.
C ’eft à lui à fe confulter, d’après l ’inftruCtion
qu’il a reçue du général en ch ef, pour avancer fur
l’ennemi, ou fe retirer devant lu i, félon que les cir-
Conftances lui paraîtront l’exiger ; mais il faut qu’il fe
replie toujours contre des forces fupérieures, &
qu’il profite des fiènnes lorfque celles de l’ennemi
lui font inférieures.
Quelquefois il fe retirera dans la nuit à l’approche
de l’ennemi ; & lorfqu’il aura affez marché pour
lui donner une fauffe perfuafion de fon deffein, &
lui faire négliger les précautions qu’on ceffe de prendre
lorfqu’on croit l’ennemi éloigné, il reviendra
brufquement le charger & le repouffer.
Ii s’attachera à former des entreprifes fur l’ennemi
, à l’inquiéter, à le harceler de toutes maniérés,
afin de l’obliger à fe tenir fur la défenfive 8c de fe
procurer à lui du repos. Voyez (Dicl. raif. des Sciences
, 8c Suppl. ) les différens articles dont on a fait
mention au commencement de celui-ci, tant fur l’objet
des dètachemens, que fur la maniéré dont ils
doivent être compofés & conduits.
L’intelligence ou le peu de capacité des officiers
auxquels on donne des dètachemens à conduire , dé- ;
eide ordinairement du bon ou du mauvais fuccès qu’ils
peuventavoir. La défaite d’un corps particulier, l’en-
levement d’un convoi, d’un fourrage, & autres acci-
densfemblables pouvant décourager les troupes , leur
faire perdre la confiance qu’elles avoient en leur chef,
mettre l’ennemi en état de former dès delfeins, auxquels
il n’auroit peut-être-jamais/penfé, faire manquer
les plus beaux projets & quelquefois tout le fuc-
Ces d’une campagne. Un général ne fauroit être trop
attentif à ne confier des dètachemens qu’à des officiers
dont les talens lui foient bien connus. En un mot, il
faut pour ces fortes de commiffions, dont la plus
grande partie eft d’une exécution très-difficile , des
hommes habiles 8c nourris dans la guerre.
« Une ancienne réglé de guerre, dit le roi de
» Prufle ( Injlrucl. milit. art. X . ) , que je ne fais que
» répéter ici, eft que celui qui partagera fes forces
» fera battu eh détail. Si vous voulez donner ba-
>> taille, tâchez de raffembler toutes vos troupes ; on
» ne fçauroit jamais les employer plus utilement.
» Cette réglé eft fi bien conftatée, que tous les gé-
» néraux qui y ont manqué, s’en font prefque tou-
» jours mal trouvés.
» Le détachement d’Albermale, qui fut battu à
» Denain, fut caufe que le grand Eugene perdit toute
» fa campagne. Le général Stahremberg s’étant fé-
» paré des troupes Angloifes, perdit la bataille de
» Villaviciofa en Efpagne.
. » Dans les dernieres campagnes que les Autri-
» chiens ont faites en Hongrie, les détachement leur
» furent très-funeftes. Le prince de Hildburghaufen
» fut battu à Banjaluka , & le général Wallis reçut
» un échec fur le bord de la Timok. Les Saxons fu-
» rent battus à Keffelsdorf, parce qu’ils ne s’étoient
» pas fait joindre par le prince Charles, comme ils
» auroient pu faire. J’aurois mérité d’être battu à
» Sohr, fi l’habileté de mes généraux, & la valeur
» de mes troupes ne m’euffent préfervé de ce
» malheur».
Si d'après ces exemples, 8c tant d’autres dont je
pourrois les accompagner, il ne faut pas -conclure
qu’on ne doit jamais faire des dètachemens, il en ré-
fuite du moins que c’eft une manoeuvre fort délicate
, qu’on fera bien de ne jamais hafarder que pour
des raifons très - importantes, & de ne faire qu’à
propos. ■
Lorfqu’on agit offenfivement dans un pays ouvert,
& qu’on eft maître de quelque place, il ne faut
détacher d’autres troupes que celles qui font nécèf-
faires pour affurer les convois, 8c les fourrages.
Toutes les fois qu’on fait la guerre dans un pays
entouré de montagnes, on ne peut fe difpenfer de faire
des dètachemens pour faire arriver fûrement les vivres.
Les gorges 8c les défilés, que les convois
font obligés de paffèr, exigent qu’on y envoie des
troupes qui y relient campées jufqu’à ce qu’on ait
des lubfiftançes pour quelques mois, 8c qu’on foit
maître d’ une ou de plufieurs places où l’on puiffe faire
établir des dépôts. Tant que ces dètachemens font
néceffaires, on occupe des camps avantageux jufqu’à
ce qu’ils foient rentrési
Les dètachemens que font certains généraux lorf-
qu’ils vont attaquer l’ennemi pour le prendre en
flanc ou en queue, quand l’affaire s’engage ou qu’elle
eft engagée, font des manoeuvres qui ne réuffiffent
prefque jamais, qui font même très-dangereufes *
puifque ces dètachemens s’égarent ordinairement &
arrivent ou trop tôt ou trop tard. Le roi de Prufle
qui fait cette obfervation y a joint plufieurs exemples
que je vais rapporter. « Charles XII fit un
» détachement la veille de la bataille de Pultawa : ce
» corps s’écarta du chemin , 8c fon armée fut bat-
» tue. Le prince Eugene manqua fon coup, en vou-
» lant furprendre Crémone; le détachement du prin-
» ce de Vaudemont, qui étoit deftinéà attaquer la
» porte du Pô , arriva trop tard.
» Un jour de bataille, ajoute ce célébré auteur^
» il ne faut jamais faire de détachement, fi ce n’eft:
» comme fit Turenne près de Colmar, où il pré—
» fenta fa première ligne à l’armée de l’éle&eur
» Frédéric-Guillaume, en attendant que fa fécondé
» fe portât par des défilés fur les -flancs de ce
» prince qui y fut attaqué 8c repouffé ; ou comme
» fit le maréchal de Luxembourg à la bataille de
» Fleurus en 1690. Il plaça à la faveur des bleds qui
» étoient *fort grands, un corps d’infanterie fur le
>» flanc du prince de W aldeck; par cette manoeuvre
» il gagna la bataille.
» 11 ne faut détacher des troupes qu’après labataille
» gagnée, pour affurer fes convois ; où il faudroit que
» les dètachemens ne s’éloignaffent qu’à une demi-,
» lieue de l’armée.
» Lorfqu’on eft obligé de fe tenir fur la défenfive,'
» dit le même auteur, on eft fouvent réduit à faire
» des dètachemens. Ceux que j’avois dans la hautes
» Siléfie, y étoient en fureté. Ils fe tenoient dans
» le voifinage des places fortes, comme je l’ai re-
» marqué ci-deffus.
» La guerre défenfive nous mene naturellement
» aux dètachemens. Les généraux peu expérimentés
» veulent conferver tout; ceux qui font fages n’en-
» vifagent que le point capital, ils cherchent à pa-
» rer les grands coups, 8c fouffrent patiemment un
» petit mal, pour éviter de grands maux. Qui trop
» embraffe, mal étreint.
» Le point le plus effentiel auquel il faut srafta-
» cher , eft l’armée ennemie. Il en faut deviner les
» deffeins, & s’y oppofer de toutes fes forces. Nous
» abandonnâmesen 1745 , lahaute-Siléfie au pillage
» des Hongrois, pour être en état de réfifter d’au-
» tant plus vivement aux deffeins du prince Charles
» de Lorraine, 8c nous ne fîmes de détachement que '
» quand nous eûmes battu fon armée. Alors legéné-
» ral Naffau chaffa les Hongrois en-quinze jours de
» toute la haute-Siléfie ».
Soit qu’on agiffe offenfivement, foit qu’on fe
tienne fur la défenfive , deux raifons obligent de ne
faire que de gros dètachemens : fi votre armée eft fu->
périeure à celle de l ’ennemi, vos dètachemens ne vous
affoibliffent pas ; fi elle eft inférieure, vous évitez le
danger d’être défait en détail. La réputation d’une
armée dépend fouvent d’un détachement battu.
Le roi de Prufle dit que les détachemètïs qui affoibliffent
l’armée du tiers, ou de la moitié,font très-
dangereux 8c condamnables. ( M. D . L . R . à
DETHMOLD * ( Géogr. ) très-ancienne' ville
d’Allemagne, dans le cercle de Weftphalie , & dans
le comté de la Lippe, fur la riviere de Werre. Elle
fe partage en vieille 8c nouvelle ville , 8c renfermé
le château où réfident les comtes. Elle a une très-
bonne école latine à l’ufage des réformés. Cluvier 8c
d’autres croient que ce rut aux environs de cette
ville que Quintilius Varus perdit les légions d’Au-
gufte. Long. ■ *<$', 10 , lat. 62. ( D . G . )
§ DÉTONNER, ( Mujîq. ) chanter fans claveffin,
crier > forcer fa voix en haut ou en bas, & avoir pl^is
d’égard au volume qu’à la jufteffe, font dès moyens
prefque fûrs de fe gâter la voix, 8c de détonner. ( S )
DE TOULOUSE, (terme de Blafon. ) fe dit d’une
croix vuidée, clechée, pommetée & alefée. Elle eft
àinfi nommée, parce qu’elle eft femblable à celle
des anciens comtes de Touloufe qui la retinrent pour
armes, depuis que Raimqnd de S. Gilles , comte de
Touloufe, l’un des chefs de la première croifade
contre les infidèles, eut retenu une pareille croix ,
elle étoit d'or en champ de gueules, 8c imitoit celle
que Conftantin le grand éleva dans le marché de Bi-
ïance j telle qu’il l’avoit vu au ciel en combattant
Maxence.
Ce fait eft rapporté par Andoque , en fon Hijloire
de Languedoc , page \S5 .
Depuis, plufieurs familles de cette province ^ fur
leurs prétentions, ont pris une pareille croix.
Lautrec de Touloufe de Monfa,deSaint»-Germier, •
en Albigeois ; de gueules à la croix de Touloufe (for.
( G . D . L . T . )
DÉTROIT, ( Anat. ) c’eft le nom que l’on donrte
à une ligne fort Caillante qui fépare le grand baffin du
petit. Elle eft plus arrondie chez les femmes que chez
les hommes, ce quin’empêchepasqu’elle n’apporte
quelquefois obftacle à l’accouchement. V . Bassin ,
Dic l. raif. des Silences , &c. & Suppl. ( + )
§ D é tro it , (' Géogr. ) Le détroit d'Anian eft un
de ceux dont on a le plus parlé, fans l’avoir jamais
biep connu ; on a toujours entendu fous ce nom le
paflàge que l’on fuppofoit être au nord de l’Amérique
, ou la communication deTa mer Glaciale à la
mer du Sud, au-deffus de la Californie. V . Anian ,
D ic l. raif. des Sciences, &c. ( M. DE LA L a n d e . )
DÉ VA ST ATION, f. f. ( Ar t. milit. ) On exprime
par ce mot les effets de la guerre, tels que le pillage,
les incendies , &: la ruine d’un pays.
Il ne fe dit guere que de ces inondations de barbares
qui ont autrefois défolé les provinces d’occident;
en ce fens on le trouve dans les bons historiens.
(+)
DÉVASTER, DÉPEUPLER, DÉSOLER, SAC-,
C AG ER, v. a. ( A rt. m ilit. ) Standok, général Suédois,
ne fe porta à la dévaftation, dit l’hiftorien de Charles
Xn, que pour apprendre aux ennemis duroi.fon
maître à ne plus faire une guerre de barbares, & à
refpefier le droit des gens. Ils avoient rempli la Poméranie
de leurs cruautés , dévajlè cette belle province,
& vendu près de cent mille habitans aux
Turcs. Altena mis en cendres fut la repréfaille des
boulets rouges qui avoient confumé Stade. On peut
dire auffi qife la Saxe a été dèvajlèe en 1756 & J757
par les troupes Pruffiennes. (-f)
DEUCALION , ( Myth, ) fils de Prométhée,
avoit époufé Pyrrha , fille de fon oncle Epiméthée.
Jupiter voyant croître la malice des hommes , dit
Ovide, rélolut d’exterminer le genre humain, & de
l’enfévelir fous les eaux, en faiiant tomber des tor-
rens de pluie de toutes les parties du ciel. Toute la
furface de la terre en fut inondée , hors une feule
T omet!.
moiîtàgne de la Phocide, c’eft le mdnt Parnaffe ,
que les eaux épargnèrent, parce que ces deux fom-
mets étoient au-deffus des nuages. C ’eft-là que s'arrêta
la petite barque qui portoit DeucaUort & fa
femme : Jupiter les avoit fauvés, parce qu’il n’y eut
jamais d’homme plus jufte & plus équitable que
Deucahon, m de femme plus vertueufe, & qui eût
plus de refpeél pour les dieux que Pyrrha. Dès que
les eaux fe furent retirées, ils allèrent confulter la
deeffe Thémis, qui rendoit fes oracles au pied de la
montagne, au même lieu qui devint dans la fuite fi
célébré par l’oracle de Delphes. La déeffe leur rendit
cette, reponfe : Sorte^ du temple, voilez-vous le
vifage, détaché^ vos teintures, & jette^ derrière vous les
os de votre grand'mere. Ils ne comprirent pas d’abord
le féns de l’oracle, & leur piété fut allarmée d’un
ordre qui leur paroiffoit cruel. Mais Deucalion ,
après avoir bien réfléchi, trouva que la terre étant
leur mere commune , fes os pouvoient bien être les
pierres qu’elle renfermoit dans fon fein. Ils en prirent
quelques-unes, & les jetterent derrière eux en fermant
les yeux ; aufli-tôt ces pierres s’amollirent ,
devinrent flexibles, & prirent une forme humaine.
Celles que Deucalion avoit jettées , formèrent des
hommes ; & celles de Pyrrha , des femmes. Le fond
de ce récit eft véritable. Sous le régné de Deucalion,
roi de Theffalje, le cours du fleuve Pénée fut arrêté
par un tremblement de terre , entre le mont Offa 8c
l’Olympe , où eft l’embouchure par où ce fleuve
groflï des eaux de quatre autres, fe décharge dans
la mer ; & il tomba cette année^là, une fi grande
abondance de p luie, que toute la Theffalie, qui eft
un pays plat, fut inondée. Deucalion 8c ceux de fes
fujets qui purent fe garantir de l’inondation, fe retirèrent
fur le mont Parnaffe ; & les eaux s’étant enfin
écoulées, ils defeendirentdans la plaine. Les enfans
de ceux qui s’étoient fauvés , font les pierres myfté-
a rieufes du poète, qui repeuplèrent dans la fuite le
pays. Le même mot grec figçifie un enfant & une
pierre. Ajoutons que la tradition du déluge univçrfel
n’a pas peu fervi à embellir la fable de Deucalion, '
Lucien femble même avoir copié nos hiftoriens fa-
cres, quand il dit que Deucalion fe fauva dans une
arche, avec fa famille & une Couple de bêtes de chaque
efpece , tant fauvages que domeftiques ,'qu i le
luivirent volontairement fans s’entremanger, ni fe
faire aucun mal. (-p)
DeU galion , ( Myth. ) fils dê Minos, fécond roi
de Crete, régna après fon pere, & donna Phèdre fa
foeur en mariage-à Théfée. Il fut pere d’Idomé-
née. ( + )
D eucalion , ( AJlron. ) nom que l’on donne
quelquefois à la confteliation du verfeau. (M . d e l a
L a n d e . )
DÉVELOPPEMENT, (Beaux-Arts.) c’eft l’ex^.
pofitiôn détaillée de ce qu’tin objet renferme, ou
l’analyfe de ces parties. Le développement met fuccefi
fivement fous nos yeux les diverfes chofes qui exif-
tent réellement dans le tout ; nôiis acquérons paf
fon moyen une idée claire de chaque partie, 8c une
idée diftinélede l’enfemble. La définition développe
une notion, & l’analyfe développe une penfée. Comme
la clarté entre effentiellement dans la confidéra*
tion de ce qui eft relatif aux beaux-arts ( f^oyet
C l a r t é , Suppl. ) , le développement qui produit
cette clarté doit y entrer pareillement.
Tout objet qui pour produire fon effet entier doit
être diftinélement apperçu, exigé un développement»
Il faut que l’orateur développe les notions fondamentales,
fur lefquelles il appuie fes preuves : tout ce
qui eft eflèntiel au fujet, réflexions , fentimens, caractères,
aCtions, doit être bien développé; ce qui
n’eft qu’acceffoire, ce qu’on ne touche qu’en paf-
fànt, n’a pas befoin de développement.
y Vvv ij