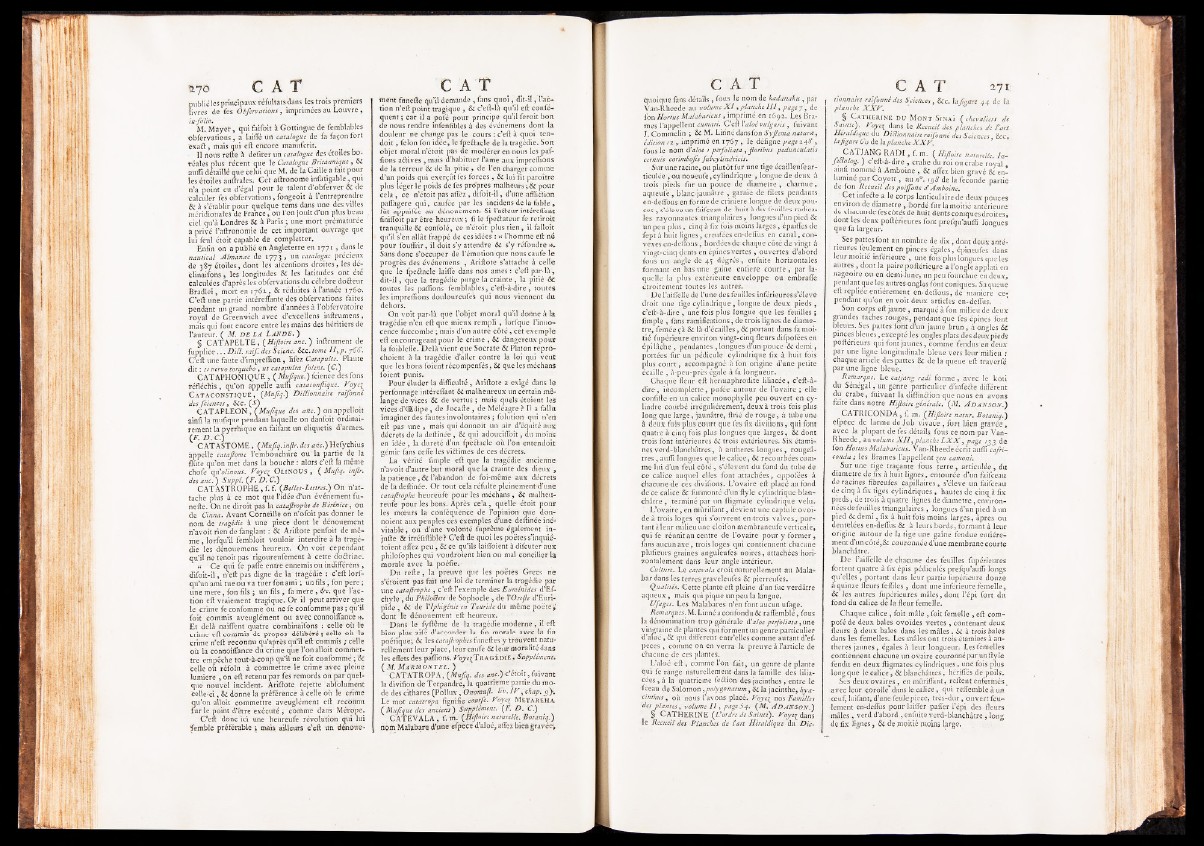
C A T
publié les principaux réfultats dans les trois premiers
livres de fes Obfervatiàns, imprimées au Louvre,
isfolro.
M. Mayer, qui faifoit à Gottingue de femblables
obfervations, a laiffé un catalogue de fa façon fort
ë x a ft, mais qui eft encore manuferit.
Il rtoùS refte à defirèr un catalogue des étoilés boréales
plus fécent que le Catalogue Britdnniqtie , &
suffi détaillé que celui que M. de la Caille a fait pour
les étoiles auftrales. Cèt aftronome infatigable, qui
n’a point eu d’égal pour le talent d’obferver & de
•calculer fes obfervations, fongeoit à l’entreprendre
& à s’établir pour quelque tems dans une des villes
méridionales de France, où l’on jouit d’un plus beau
ciel qu’à Londres & à Paris ; une mort prématurée
à privé l’aftronomie de cet important Ouvrage qué
lui feul étoît capable de completter.
Enfin on a publié en Angleterre en 1 7 7 1 , dans le
nautical Almaiïac de 1773 , un catalogue précieux
de 387 étoiles, dont les afeenfions droites, les dé-
clinaifotts, les longitudes & les latitudes ont ete
calculées d’après les obfervations du célébré doâeur
Bradlei * mort en 1 7 6 1 , & réduites à l’année 1760,
C ’eft une partie intéreffante des obfervations faites
pendant un grand nombre d’années à l’ôbfervâtoire
royal de Greenwich avec d’excellens inft rumens,
mais qui font encore entre les mains des héritiers de
l’auteur. ( M. d e l a L aNd e . )
§ CA TA PE LTE, (Hijloire anc. ) inftrument de
fupplice ».. Dicl. raif. des Scicnc. & c . tome I I , p. 766.
C ’eft une faute d’impreflion, lifez Catapulte. Plaute
dit : ttntrvo torquebo , ut catapulta Joient. (C.)
CATAPHONIQUE, ( Mufique.) fcience des fons
réfléchis, qu’on appelle auffi cütaconfiique. Voye{
C a t ACONSTIQUE, (Mujîq î) Dictionnaire raifonné
des fciences, & c * WtÊÊtÊ
CATAPLEON, {Mufique des atic.) on appelloit
àinli la mufique pendant laquelle on danfoit ordinairement
la pyrrhique en faifant un cliquetis d’armes.
(F. D . C.)
C AT ASTOME, (Mujîq. injlr. des anc.) Hefychius
appelle catafiqme l’embouchure ou la partie de la
flûte qu’on met dans la bouche : alors c’ eft la même
chofe qu'olinous. Voye^ O lin oü S , ( Mujîq. injlr.
des anc. ) Suppl. (F. D .C .)
CATASTROPHE, f. f. (Belles-Lettres.) Oh n’attache
plus à ce mot què l’idée d’un événement fu-
nefte. On ne diroit pas la catafirophe de Bérénice, ou
de Cinna. Avant Corneille on n’ofoit pas donner le
nom de tragédie à une piece dont le dénouement
ii’avoit rien de fanglant : & Ariftote penfoit de même
, lorfqu’il fembloit vouloir interdire à la tragédie
les dénouemens heureux. On voit cependant
qu’il ne tenoit pas rigoüreufement à cette doûrine.
« Ce qui fe paffe entre ennemis ou indifférèns,
difoit-il, n’eft pas digne de la tragédie : c’èft lorf-
qu’un ami tue ou va tuer fon ami ; un fils, fon pere ;
une m ere, fon fils ; un fils , fa mere , &c. que Faction
eft vraiement tragique. Or il peut arriver que
le crime fe confomme: ou ne fe confomme pas ; qu’il
foit commis aveuglément ou avec connoiffancè >>.
Et delà naiffent quatre combinaifons : celle Où le
crime eft commis de propos délibéré ; celle où le
crime n’eft reconnu qu’après qu’il eft commis ; celle
où là connoiffancè du crime q\ie l’onalloit commettre
empêche tout-à-coup qu’il ne foit confommé ; &
celle où réfolu à commettre lè crime avec pleine
lumière , on eft retenu par fes remords Ou par quelque
nouvel incident. Ariftote rejette abfolument
celle-ci, & donne la préférence à celle où le crime
qu’on alloit commettre aveuglément eft reconnu
fur le point d’être exécuté .comme dans Mér'ope.
C’eft donc ici une heureufe révolution qui lui
femble préférable \ mais ailleurs c’eft un dénoue-
C A T
ment funefte qu’il demande , fans qu o i, dit-il ,Tac-
tion n’eft point tragique , & c’eft-là qu’il eft confisquent
; car il a pôle pour principe qu’il feroit bon
de nous rendre infenfibles à des événemens dont la
douleur ne change pas le cours : c’eft à quoi ten-
d o it , félon fon idée, le fpe&acle de la tragédie. Son
objet moral n’étoit pas de modérer en nous les paf-
fions actives , mais d’habituer l’ame aux impreffions
de la terreur &c de la pitié, de l’en charger comme
d’un poids qui exerçât fes forces , & lui Fît paroître
plus léger le poids de fes propres malheurs ;& pour
cela , ce n’étoit pas affez , difoit-il, d’une affliûion
paffâgere qui, caufée par les incidens de la fable ,
fut appaifée au dénouement. Si l’atteur intéreffant
finiffoit par être heureux ; fi le fpeûateur fe retiroit
tranquille & confolé, ce n’étoit plus rien, il falloit
qu’il s’en allât frappé de ces idées : « l’homme éft né
pour fouffrir, il doit s’y attendre & s’y réfoudre >>.
Sans donc s’occuper de l’émotion que nous caufe le
progrès des événemens , Ariftote s’attache à celle
que le fpe&acle laiffe dans nos âmes : c’eft par-là ,
dit-il * que la tragédie purge la crainte, la pitié &
toutes les paffions femblables, c’eft-à-dire, toutes
les impreffions douloureufeS qui nous viennent du
dehors.
On voit par-là que l’objet moral qu’il dorine à la
tragédie n’en eft que mieux rempli , lorfquè l’innocence
fuccombe ; mais d’un autre cô té, cet exemple
eft encourageant pour le crime , & dangereux pour
la foibleflë. Delà vient que Socrate & Platon reprô-
choient à la tragédie d’aller contre la loi qui veut
que les bons foient réeompenfés, & que les médians
ioient punis.
Pouf éluder la difficulté , Ariftote a exigé dans le
perfonnage intéreffant & malheureux un certain mélange
de vices & de Vertus ; mais auels étoient les
vices d’OEdipe, de Jocafte, de Méleagre ? Il a fallu
imaginer des fautes involontaires ; folution qui n’ed
eft pas une, mais qui donnoit Un air d’équité aux
décrets de la deftiriée , & qui adouciffoit, du moinis
en idée , la dureté d’un fpéftacle où l’on entendoit
gémir fans ceffe les vi&imes de ces décrets.
La vérité fimple eft que la tragédie ancienne
n’avôit d’autre but moral que la crainte des dieux ,
la patience, & l’abandon de foi-même aux décrets
de la deftinée. Or tout cela réfulte pleinementd’une
catafirophe heureufe pour les méchanS, & malheu-
reufe pour les bons. Après cela, quelle étoit pouf
les moeurs la eônféquênee de l’opinion que don-
noient aux peuples ces exemples d’une deftinée iné^
vitablé, ou d’uhé volonté fuprême également in-
jufte & irréfiftîblê? C’eft de quoi les poètes s’inquié-
toient affez peu , & ce qu’ils laiffoient à difeuter aux
philofophes qui voudroient bien ou mal concilier la
morale avec la poéfie.
Du refte, la preuve que les pdëtes Grecs né
s’étoient pas fait une loi de terminer la tragédie par
une catafirophe , c ’eft l’exemple des Euménides d’Ef-
chyle , du Philoctete de Sophocle -, de YOrefte d’Euripide
, & de Y Iphigénie en Tauride du même poëte^’
dont le dénouement eft heureux.
Dans le fyftême de la tragédie moderne , il eft
bien plus aifé d’accorder la fin morale avec la fin
poétique; & les catajlropkes funeftes y 'trouvent natu1*
Tellement leur placé, leur caufe & leur moralité dans
le's effets des paffions. e{TRAGÉDlE, Supplément.
(M . Ma rm o n t e l . )
CATATRO PA, (Mujîq. des anc.) -c’étoit, fuivant
la divifion de Terpandre, la quatrième partie du mode
des cithares (Pollux , Onomafl. lïv .IV ,tha,p. cjj.
Le mot catatrôpa fignifie couffe. Voyt{ Me'TarehA
( Mujiaue des anciens) Supplément. (F. D. V.)
CATEVALA , f. m. (Hijloire naturelle,. Botaniq.)
noùvMalabarè d’une efpece d’aloé, affez bien gravée1,
C A T
quoique fans détails , fous le nom de kadanaku , par
Van-Rheede au volume X I y planche I I I , page 7 , de
fon Horïus Malabaricus , imprime en 16^2. Les Brames
l’appellent cumari. C’eft Yaloé vulgaris, fuivant
J. Commelin ; & M. Linné dans fon Syjlema natura,
édition 12 ,. imprimé en 1767 , le défigne page 248 ,
fous le nom d’aloe 1 perfoliata , Jloribus pedunculatis
cernuis coùmbojis fubcylindricis.
Sur une racine, ou plutôt fur une tige écailleufe articulée
, ou noueufe,cylindrique , longue de deux à
trois pieds fur un pouce de diamètre, charnue,
aqueufé, blanc-jaunâtre , garnie de filets pendants
en-deffous en forme de crinière longue de deux pouces
, s’élève un faifeeau de huit à dix feuilles radicales
rayonnantes triangulaires, longues d’un pied &
un peu plus, cinq à fix fois moins larges, épaiffes de
fept à huit lignes, creuféès en-deffus en canal, convexes
en-deffous, bordées de chaque côté de vingt à
vingt-cinq dents en épines vertes , ouvertes d’abord
fous un angle dê 45 dégrés, enfuite horizontales
formant en bas une gaine entière courte, par laquelle
la plus extérieure enveloppe ou embraffe
étroitement toutes les autres.
De l’aifièlle de l’une des feuilles inférieures s^éleve
droit une tige cylindrique , longue de deux pieds ,
c’eft-à-dire , une fois plus longue que les feuilles ;
fimple , fans ramifications, de trois lignes de diamètre,
femée çà & là d’écailles, & portant dans fa moitié
fupérieure environ vingt-cinq fleurs difpofées en
épi lâche , pendantes , longues d’un pouce & demi,
portées fur un pédicule cylindrique fix à huit fois
plus court, accompagné à fon origine d’une petite
écaille , à-peu-près égale à fa longueur.
Chaque fleur eft hermaphrodite liliacée, c’eft-à-
dire , incomplette, pofée autour de l’ovaire ; elle
confifte en un calice monophylle peu ouvert en cylindre
courbé irrégulièrement, deux à trois fois plus
long que large, jaunâtre, ftrié de rouge, à tube une
à deux fois plus court que fes fix divilions, qui font
quatre à cinq fois plus longues que larges, & dont
frois font intérieures & trois extérieures. Six étamines
verd-blanchâtres, à anthères longues, rougeâtres
, auffi longues que le calice, & recourbées comme
lui d’un feul cô té , s’élèvent du fond du tube de
ce calice auquel elles font attachées, oppofées à
chacune de ces divifions. L’ovaire eft placé au fond
de ce calice & furmonté d’un ftyle cylindrique blanchâtre
, terminé par un ftigmate cylindrique velu.
L’ovaire, en mûriffant, devient une eapfule ovoïde
à trois loges qui s’ouvrent entrois valves,.portant
à leur milieu une cloifon membraneufe verticale,
qui fe réunit au centre de l’ovaire pour y former ,
fans aucun ax e, trois loges qui contiennent chacune
plufieurs graines anguleufes noires, attachées horizontalement
dans leur angle intérieur.
Culture^Le caievala croît naturellement au Malabar
dans les terres graveleufes & pierreufes.
Qualités. Cette plante eft pleine d’un fuc verdâtre
aqueux, mais qui pique un peu la langue.
Ufages. Les Malabares n’en font aucun ufage.
Remarques. M. Linné a confondu & raffemblé, fous
la dénomination trop générale d'aloe perfoliata ,une
vingtaine de plantes qui forment un genre particulier
d’aloé, & qui different entr’elles comme autant d’ef-
peces , comme ou en verra la preuve à l’article de
chacune de ces plantes, ■
L’aloé eft , comme l’on fait, un genre de plante
qui fe range naturellement dans la famille des lilia-
cées, à la quatrième fiettion des jacinthes , entre le
fceau de Salomon ,polygonatum, & la jacinthe, hya-
cinthus, où nous l’avons placé. Voye^ nos Familles
des plantes, volume I I , page S 4. (M . A d AN SON.)
§ CATHERINE (Vordre de Sainte). Voye^ dans
le Recueil des Planches de l'art Héraldique du Die-
C A T 2 7 1 ;
iionnaire raifonné des Scierices, &c. hfîeilre 44 de la
planche X X K * 6
§ C atherine du Mo nt Sin aï ( chevaliers de
r °yel dans le Recueil des planches de l'arc
Héraldique du Dictionnaire raifonné des Sciences &C.
la figure Go de la planche X X K
CATJANG R A D I , f. m. ( Hijloire naturelle. In-
feclolog. ) c eft-à-dire , crabe du roi ou crabe royal
ainfi nommé à Amboine , & affez bien gravé & en-
luminé par C o y e tt , au n°. 1^8 de la fécondé partie
de fon Recueil des poijfons d'Amboine.
Cet infette a le corps lenticulaire de deux pouces
environ de diamètre , .bordé fur la moitié antérieure
de chacun de fes côtés de huit dents coniques droites9
dont les deux poftérieures font prefqu’aufïï longues
que fa largeur.
^ Ses pattes font au nombre de dix , dônt deux antérieures
feulement en pinces égales, épineufes dans
leur moitié inférieure , une fois plus longues que les
autres , dont la paire poftérieyire a l’ongle applati en
nageoire ou en demi-lune* un peu fourchue en deux,
pendant cjue les autres ongles font coniques. Sa queue
eft repliée entièrement en-deffous, de maniéré cependant
qu’on en voit deux articles en-deffus; .
Son corps eft jaune, marqué à fon milieu de deux
grandes taches rongés, pendant que fes épines font
bleues'. Ses pattes fotit d’un jaune brun, à ongles &
pinces bleues ,exceptéles onglesplats des deux pieds
poftérieurs qui font jaunes, comme fendus'en deux
par une ligne longitudinale bleue vers leur milieu r
chaque article des pattes & de la queue eft traverfé
par une ligne bleue.
Remarque. Le catjdng radi forme, avec le koti
du Sénégal, un genre particulier d’infe&e différent
du crabe, fuivant la diftinûion que nous en avons
faite dans notre Hijloire générale. (M. A d a n so n .)
CATRICONDA, f. m. (Hijloire natur. Botaniq.)
efpece de larme de Job vivace , fort bien gravée ,
avec la plupart de fes détails fous ce nom par Van-
Rheede, au volume X H , planche L X X , page 173 de
fon Hortus Malabaricus. Van-Rheede écrit auffi cafri-
conda ; les Brames l’appellent {«/z camoni.
Sur une tige rraçante fous terre , articulée , du
diamètre de fix à huit lignes, entourée d’un faifeeau
de racines fibreufes capillaires , s’élève un faifeeau
de cinq à fix tigës cylindriques , hautes de cinq à fix
pieds, de trois à quatre lignes de diamètre, environnées
deVeuilles triangulaires , longues d’un pied à un
pied & demi, fix à huit fois moins larges, âpres ou
dentelées en-deffus & à leurs bords, formant à leur
origine autour de la tige une gaîne fendue entièrement
d’un côte,& couronnée d’une membrane courte
blanchâtre.
De l’aiffelle de chacune des feuilles fupérieures
fortent quatre à fix épis pédiculés prefqu’auflî longs
qu’elles , portant dans leur partie fupérieure douze
à quinze fleurs fefliles,, dont une inférieure femelle,
& les autres fupérieures mâles, dont l’épi fort du
fond du calice de la fleur femelle.
Chaque calice, foit mâle , foit femelle , eft com-
pofé de deux baies ovoïdes vertes , contenant deux
fleurs à deux baies dans les mâles , & à trois baies
dans les femelles. Les mâles ont trois étamines à anthères
jaunes, égales à leur longueur. Les femelles
contiennent chacune un ovaire couronné par un ftyle
fendu en deux ftigmates cylindriques, une fois plus
long que le calice , & blanchâtres, hériffés,de poils.
Ses deux ovaires , en mûriffant, reftent enfermés
avec leur corolle* dans le calice, qui réffembleàun
oeuf, luifant, d’une feule piece, très-dur, ouvert feulement
en-deffus pour laiffer paffer l’épi des fleurs
•mâles, ver.d d’abord , enfuite verd-blanchâtre , long
de fix lignes, ôc de moitié moins large.