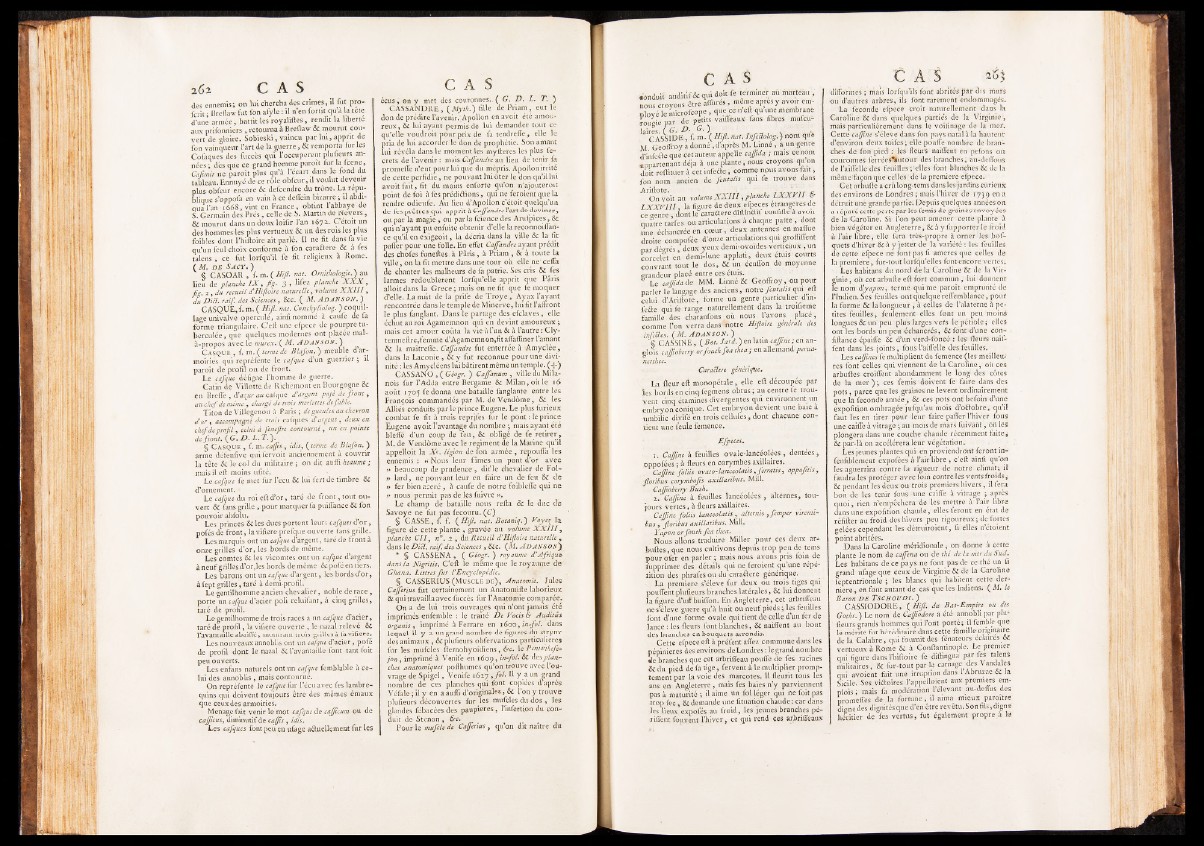
des ennemis ; on lui chercha des crimes, il fut pro-
fcric ; Breflaw fat fon afyle : il n’en fortit qu’à la tete
d’une armée, battit les royaliftes, rendit la liberté
aux prifonniers , retourna à Breflaw 6c mourut couvert
de gloire. Sobieski, vaincu par lui, apprit de
fon vainqueur l’art de la guerre, & remporta fur les
Cofaques des fuccès qui l’occuperent plufieurs années
; dès que ce grand homme paroît fur la fcene,
Cafimir ne paroît plus qu’à l’écart dans le fond du
tableau. Ennuyé de ce rôle obfcur, il voulut devenir
plus obfcur encore 6c defcendre du trône. La république
s’oppofa en vain à ce deffein bizarre ; il abdiqua
l’an 1668, vint en France, obtint l’abbaye de
S. Germain des Prés, celle de S. Martin de Nevers,
& mourut dans un doux loifir l’an 1672- C étoit un
des hommes les plus vertueux 6c un des rois les plus
foibles dont l’hiftoire ait parlé. Il ne fit dans fa vie
qu’un feul choix conforme à fon caraûere 6c à fes
talens , ce fut lorfqu’il fe fit religieux à Rome.
CM. DE S a c y «) .
§ CASOAR , f. m. ( Hijl. nat. Ornithologie. ) au
lieu de planche I X , fig. 3 , üfez planche X X X ,
fig. 2 , du recueil d'Hiflaire naturelle, volume X X I I I ,
du Dict. raif. des Sciences, &c. ( M. ADANSON. )
CASQUE, f. m. ( Hijl. nat. Conchyliolog. ) coquillage
univalve opercule, ainfi nomme • à caufe de fa
forme triangulaire. C’eft une efpece de pourpre tu-
berculée, que quelques modernes ont placée malà
propos avec le murex. ( M. A d a n so n . )
C asque , f. m. ( terme de Blafon. ) meuble d armoiries
qui repréfente le caj'que d’un guerrier ; il
paroît de profil ou de front.
Le cafque défigne l’homme de guerre.
Catin de Villotte de Richemont en Bourgogne 6c
en Breffe , d'açur au calque d’argent poje de front,
au chef de meme , chargé de trois merlettes de fable.
Titon de Villegenou à Paris ; de gueules au chevron
d'or , accompagné de trois cafques d'argent, deux en
chef de profil , celui à fenejlre contourné , un en pointe
de front. {G . D . L .T .} .
§ CASQUE , f. m. ca(Jis , idis, ( terme de Blafon. )
arme défenfive qui fervoit anciennement à couvrir
la tête & le col du militaire ; on dit a'ufli heaume ;
mais il eft moins ufité.
Le cafque fe met fur l’ecu 6c lui fert de timbre 6c
d’ornement. •
Le cafque du roi eft d’o r , taré de front, tout ouvert
6c fans grille , pour marquer fa puiflance 6c fon
pouvoir abfolu.
Les princes 6c les ducs portent leurs cafques d’o r ,
pofés de front, la vifiere prefque ouverte fans grille.
Les marquis ont un cafque d’argent, taré de front à
onze grilles d’or, les bords de même.
Les comtes 6c les vicomtes ont un cafque d’argent
à neuf grilles d’or,les bords de même & pofé en tiers.
Les barons ont un cafque d’argent, les bords d’o r,
à fept grilles, taré à demi-profil.
Le gentilhomme ancien chevalier, noble de race,
porte un cafque d’acier poli reluifant, à cinq grilles,
taré de profil.
Le gentilhomme de trois races a un cafque d’acier,
taré de profil, la vifiere ouverte , le nazal relevé 6c
l’àvantaille abaiffé,, montrant trois grilles à fa vifiere.
Les nouveaux annoblis ont un cafque d’acier, pôle
de profil dont le nazal 6c l’avantaille font tant foit
peu ouverts.
Les enfans naturels ont un cafque femblable à celui
des annoblis , mais contourné.
On repréfente le cafque fur l’écu avec fes lambrequins
qui doivent toujours être des mêmes émaux
que ceux des armoiries.
Ménagé fait venir le mot cafque de cdjjicum ou de
cafficus, diminutif de cafjis, idis.
Les cafques font peu en ufage actuellement fur les
écus, on y met des couronnes.. ( G. D . L. T. )
CASSANDRE, (My/A.) fille de Priam, eut le
don de prédire l’avenir.'Apollon en avoit été amoureux,
ôc lui ayant permis de lui demander tout ce
qu’elle voudroit pour prix de fa tendreffe , elle le
pria de lui accorder'le don de prophétie. Son amant
lui révéla dans le moment les mylteres les plus fe-
crets de l’avenir : mais Cajfandre au lieu de tenir fa
promeffe n’eut pour lui que du mépris. Apollon irrité
de cette perfidie, ne pouvant lui ôter le don qu’il lui
avoit fait, fit du moins enforte qu’on n’ajouterait
point de foi à fes prédirions, qui ne feroientque la
rendre odieufe. Au lieu d’Apollon c’étoit quelqu’un
de fes.prêtres qui apprit à Cafjundre l’art de deviner,
ou par la magie, ou par la fcience des Arufpices, 6c
qui n’ayant pu enfuite obtenir d’elle la reconnoiffan- .
ce qu’il en exigeoit, la décria dans la ville 6c la fit
paffer pour une folle. En effet Cajfandre ayant prédit
des chofes funeftes.à Pâris, à Priam , & à toute la
v ille , on la fit mettre dans une tour oit elle ne1 ceffa
de chanter les malheurs de fa patrie. Ses cris 6c fes
larmes redoublèrent lorfqu’elle apprit que Pâris
alloit dans la Grece ; mais on ne fit que fe moquer
d’elle. La nuit de la prife de T r o y e , Ayax l’ayant
rencontrée dans le temple de M inerve, lui fit l’affront
le plus fanglant. Dans le partage des efclaves, elle
échut au roi Agamemnon qui en devint amoureux ;
mais cet amour coûta la vie à l’un & à l’aut're : C ly-
temneftre,femme d’Agamemnon,fit affaffiner l’amant
& la maîtreffe. Cajfandre fut enterrée à Amyclée ,
dans la Laconie, 6c y fut reconnue pour une divinité
: les Amycléens lui bâtirent même un temple, ( - f )
CASSANO, ( Géogr. ) Cajfanum , ville du Mila-
nois fur l’Adda entre Bergame & Milan, 011 le 16
août 1705 fe donna une bataille fanglante entre les
François commandés par M. de V endôme, 6c les
Alliés conduits par le prince Eugene. Le plus furieux
combat fe fit à trois reprjfes fur le pont : le prince
Eugene avoit l ’avantage du nombre ; mais ayant été
bleffé d’un coup de feu, 6c obligé de fe retirer ,
M. de Vendôme avec le régiment de la Marine qu’il
appelloit la X*. légion de Ion armée , rèpoufîa les
ennemis : « Nous leur fîmes un pont d’of avec
» beaucoup de prudence , dit'le chevalier de Fol-
» lard, ne pouvant leur en faire un de feu & de
» fer bien acéré , à caufe de notre foibleffe qui ne
» nous permit pas de les fuivre ».
Le champ de bataille nous refta ôc le duc de
Savoye ne fut pas fecouru. (C)
§ CASSE, 1. f. ( Hiß. nat. Botaniq. ) Voye^ la
figure de cette plante , gravée au volume X X I I I ,
planche C i l , n°. 2. , .du Recueil d'Hlßoire naturelle ,
dans le Dicl. raif. des Sciences, 6cc. (Af. A d a n so n ^
* § CASSENA , ( Géogr. ) royaume d'Afrique
dans la Nigritie. C ’eft le même que le royaume de
Ghana. Lettres fur /’Encyclopédie.
§ CASSERIUS (Muscle de) , Anatomie. Jules
Cajferlus fut certainement un Anatomifte laborieux
& qui travailla avec fuccès fur l’Anatomie comparée.
On a de lui trois ouvrages qui n’ont jamais été
imprimés enfemble : le traité De Vocïs & Auditûs
organis , imprimé à Ferrare en 1600, in-fol. dans
lequel il y a un grand nombre de figures du îarynx
des animaux , & plufieurs obfervations particulières
fur les mufcles fternohyoidiens ,& c . \e Pentoethefe-
jo n , imprimé à Venife en 1609, in-fol. 6c des planches
anatomiques pofthumes qu’on trouve avec l’ouvrage
de Spigel, Venife 1627 ,> / . Il y a un grand
nombre de ces planches qui font copiées d après
Véfale ; il y en a auffi d’originale«, 6c l’on y trouve
plufieurs découvertes fur les mufcles du dos , les
glandes fébacées des paupières, l’infertion du conduit
de Stenon, &c.
Pour le mufcle de Cajferius, qu’on dit naître du
Conduit auditif & qui doit-fe terminer aü marteau I
nous croyons, être affuré., même après y avoir employé
le microfcope „que**«e.ft qu tmemembrane
iougie par de petits vaiffeaux fans fibres mulcu-
:laires. ( G. D . G.') ■ WÊH
; C ASSI D E , f. m. ( Hiß. nat. Infeclolog. ) nom djub
M. Geoffroy adonné, d’après M. Linné, à un genre
d’infe&e que cetauteur appelle cajfida ; mais ce nom
•appartenant déjà à une plante , nous croyons qu on
<loit reftituer à cet infefte, comme nous avonsfait,
fon nom;'.ancien de fcteealis qui fc tWttw dans
— B WKÊÊÊËSÊKÊBÊI
L X X y i l l la figure de deux efpeces étrangères «le
ce genre.1, dont le carartere diftinaif conûfteîà avoir
quatre tar&s. ou articulations ^chaque patte ,* dont
une1 échancrée en . coeur;;' deux antennes en maffuê
droite compofée d'onze articulatiôns'qm groffiffent
par degrés R deux yeux demi-ovoïdes verticaux , un
corcelet en demi-lune applati, deux étuis • courts
couvrant tout le dos,,; Si un écuffon dé nioÿenne
grandeur place entre ces etuis.
' Le caffida de MM. Linnë.& Geoffroy,-ou pouf
parler le langage des anciens, notre fcutalis qui elf
celui. d’Ariftote, forme un .genre particulier d’in-
ferte qui fe range : naturellement dans lai troifieme
famille des charanfons où nous, l’avons, placé,
comme,l’on verra.dails^otre Hiftoirc générale des
.infectes. ( M■ ADANSON. )
S CASSINE, (Bel,Jard.yenht\ncaffinc;enm-
glois caffiokerry orfouchfeathea; en allemand pema-
nerthee.
Caractère générique.
La fleur eâ monopétale, elle eft découpée par
les bords en cinq fegmens obtus ", au centre fe trouvent
cinq étamines divergentes qui environnent un
embryon conique. Cet embryon devient une baie à
umbilic divifé en trois cellules, dont chacune confient
une feule femenee.
Efpeces.
3. C a fjin e à feuilles ovale-lancéolées, dentées *
oppofées'; à fleurs en corymbes axillaires.
Cafjine foliis ovato-lanceolatis , ferratis, oppojins,
Jloribus corymbojis axillaribus. Mill.
CaJJioberry Bush.
2. Cajfine à feuilles lancéolées , altérnes, toujours
vertes, à fleurs axillaires.
C affine foliis lanceolads , alternis ,femper virenti-
bus , fioribus axillaribus. Mill.
Yapon or fouth fea thea.
Nous allons traduire Miller pour ces deux ar-
buftes, que nous cultivons depuis trop peu de tems
pour ofer en parler ; mais nous avons pris foin de
ïupprimer des détails qui ne feroient qu’une répétition
des phrafes ou du caraôere générique.
La première s’élève fur deux ou trois tiges qui
pouffent plufieurs branches latérales, 6c lui donnent
la figure d’uifbuiffom En Angleterre, cet arbrifl'eau
ne s’élève guere qu’à huit ou neuf pieds 5 les feuilles
font d’une forme ovale qui tient de celle d’un fer de
lance : les fleurs font blanches, & naiffent au bout
des branches en bouquets arrondis.
Cette efpece eft à préfent affez commuiae dans les
pépinières des environs de Londres [ le grand nombre
de branches que cet arbrifl'eau pouffe de fes racines
& du pied de fa tige, fervent à le multiplier promptement
par la voie des marcotes. Il fleurit tous les
•ans en Angleterre , mais fes baies n’y parviennent
pas à maturité ; il aime un fol léger qui ne foit pas
trop fee, -, 6c demande une fituatiôn chaude : car dans
les lieux expofés au froid, les jeunes branches pé-
riffent fouyent l’h iver, ce qui rend ces arbriffeaux
difformes ; mais lorfqu’ils font abrités par des murs
ou d’autres arbres, ils font rarement endommagés.
La fécondé efpece 'croît naturellement dans la
Caroline & dans quelques partie’s de la Virginie
mais particuliérement dans le voifinage de la mei*.
Cette cafjine s’élève dans fon pays natal à la hauteur
d’environ deux toifes; elle pouffe nombre dé branchés
dé fon pied les fleurs naiffent en pefons ou
couronnes ferrées^hutour des branches, au-deffous
de Faiflelle des feuilles j elles font blanches 6c de la
mêmeffaçon que celles de la première efpece.
Cet afbufte a crûlong-tems dans les jardins curieux:
des environs de Londres ; mais l’hiver de 1739 en à
détruit une grande partie: Depuis quelques années on
a réparécette perte par les femis de graines-envoyées
de la Caroline. Si l’on peut amener cette plante à
bien végéter en Angleterre, 6ch y fupporter-le froid
à l’air libre, elle fera très-propre à orner les bof-
quets d’hiver & à y jetter de la variété : les feuilles
de cette efpece ne font pas fi ameres que celles dé
la première, fur-tout lorfqû’elles fonterteore vertes;
Les habitans du nord de là Caroline & de la Virginie,
oü cet arbufte eft fort commun , lui donnent
le nom; à’yapdn, termë qui me paroît emprunté dé
, l’Indien. Ses feuilles ont quelque reflemblance, pour
la formé & la longueur ■, à celles de l’alaterne à petites
feuilles, feulement elles font un peu moin^
longues & un peu plus larges vers le pétiole ; elles
ont les bords un peu échancrés, & font d’une côn-
fiftance épaiffe 6c d’un verd-foncé : leS' fleurs naif-i
fent dans les joints, fous l’aiffelle des feuilles.
Les cajfines k multiplient de femence (les meilleures
font celles qui viennent de la Caroline, oü ces
arbuftes croiflent abondamment le long des côtes
de la m e r ) ; ces femis doivent fe faire dans des
pots, parce que les graines ne lèvent ordinairement
que la fécondé année * 6c ces pots ont befoin d’une
expofition ombragée jufqu’au mois d’oftobre, qu’il
faut les en tirer pour leur faire pafl'er l’hiver fous
une caifle à vitrage ; au mois de mars fuivant, on les
plongera dans une couche chaude récemment faites
6c par-là on accélérera leur végétation.
Les jeunes plantes qui en proviendront feront in-
fenfiblement expofées à l’àir libre , c’eft ainfi qu’on
les aguerrira contre la rigueur de notre climat; il
faudra les protéger avec foin contre lés vents froids;
6c pendant les deux ou trois premiers hivers ,-il fera
bon de les tenir fous-lme caifle à vitrage ; après
quoi, rien n’empêchera de les mettre à l’air libre
dans une expofition chaude, elles feront en état de
réfifter au froid des hivers peu rigoureux; de fortes
gelées cependant les détruiroient, fi elles n’étoient
point abritées.
Dans la Caroline méridionale ; on donne à cette
plante le nom de caffena ou de thé de la mer du Sud.
Les habitans de ce pays ne font pas de ce thé un fi
grand ufage que ceux de Virginie ÔC de la Caroline
feptentrionale ; les blancs qui habitent cette der-4
niere, en font autant de cas que les Indiens; ( M. le
Baron DE Ts ch o u d i . )
CASSIODORE, ( Hijl. du Bas-Empire ou des
Goths. ) Le nom de Caffiodore a été annobli par plusieurs
grands hoinmes qui l’ont porté; il femble que
le mérite fut héréditaire dans cette famille originaire
delà Calabre; qui fournit des fénateurs éclaires &
vertueux à Rome & à Conftantinople. Le premier
qui figure dans l’hiftoire fe diftingua' par fes talens
militaires, 6c fur-tout par le carnaëe,^ ls Vandales
qui avoient fait une irruption dans 1 Abruzze 6c la
Sicile. Ses viftoires l’appelloient aux premiers emplois
; mais fa modération l’élevant au-deffus des
promeffes de la fortune, il aima^ mieux paroîtré
digne des dignités que d’en être revêtu. Son fils; digne
héritier de fes vertus, fut également propre à \à